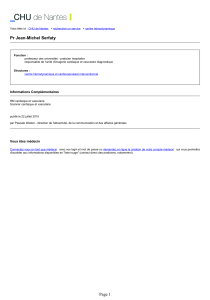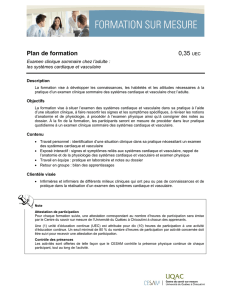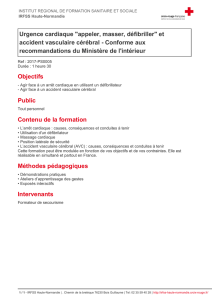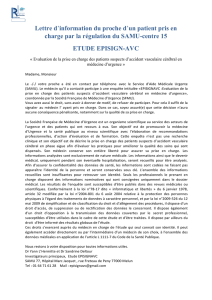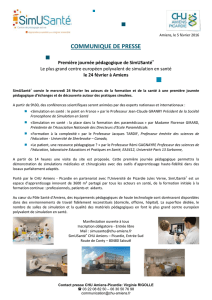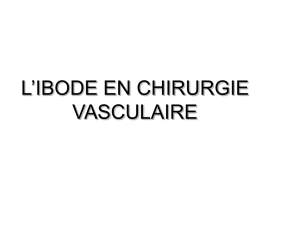Mardi 28 septembre 2004 - Portail Information Santé Picardie

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS
HOPITAL SUD - Avenue René Laënnec - SALOUEL - 80054 AMIENS CEDEX 1
RESEAU THROMBOSE PICARDIE
COTE D’OPALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Procès-verbal de séance
Mardi 28 septembre 2004
L’Assemblée Générale Constituante du Réseau Thrombose Picardie – Côte d’Opale s’est réunie le Mardi 28 septembre
2004 à 17 heures.
Étaient présents:
Raphaël ADDA – Biologiste – CH Boulogne/Mer puis CH Compiègne
Bassam ALBOUKAI - Cardiologue – CH Laon
Christian BALARD - Directeur Adjoint – CHU Amiens
Evelyne CARON – IDE Cardiologie (éducation thérapeutique) – CH Arras
Michèle CARPENTIER – Cadre de santé (pathologie vasculaire) – CHU Amiens
Elisabeth CHEVRIER – Médecin Vasculaire – CH Boulogne
Anne COTREL – Médecin rééducateur – Institut Calvé – Présidente de CME du Groupe HOPALE - Berck/Mer
Alain DENEAUX – Usager - Trésorier du Lion’s Club - ATP
Christiane DENEAUX – Usager - Membre du Lion’s Club - ATP
Régine ECLANCHER – Médecin Vasculaire – CHAM Rang du Fliers
Didier HURPE – Sanofi-Aventis
Laurence KHARBOUTLI - Médecin Vasculaire – Polyclinique de Picardie
Séverine LEGRAND – IDE Cardiologie (éducation thérapeutique) – CH Arras
Stéphane LIEVIN – Kinésithérapeute - ATP
Marie MALPAUX - Médecin Vasculaire – CH Abbeville
Elen MASION – Usager -Trésorière Adjointe - ATP
Pascale MOUGEOT – Médecin Vasculaire – CH Soissons
Jean-Luc PASOTTI – Usager - Président de zone du Lion’s Club– Secrétaire Adjoint ATP
Alain PIERONNE - Chirurgien Vasculaire – Policlinique St Claude - Saint Quentin
Yarek POKORNY – Biologiste -
Abed RIFAI – Médecin Vasculaire – CH Arras
Bertrand ROUSSEL – Biologiste – Hématologie - CHU Amiens
Bruno TRIBOUT – Médecin Vasculaire – CHU Amiens
Florence VERNON-LENOIR – Médecin Vasculaire – CH Saint Quentin
Secrétariat :
Karine RENOU
Absents et excusés :
Jean-Maurice ALLART – Médecin Vasculaire – Clinique Pauchet Amiens
Pierre BATAILLE – Néphrologie Médecine Interne – CH Boulogne sur Mer
Jean-Jacques BAUDOUX – Médecin Vasculaire – Clinique Pauchet Amiens
Fabienne BLERIOT – Médecin Vasculaire – St Quentin
Philippe BOISSELIER – Clinique Victor Pauchet Amiens
Rosaria CAMPANIELLO – Médecin Vasculaire – CH Senlis
Mathias CANAPLE – Médecin Vasculaire – CH Abbeville
Yves CARLIER – Chirurgien orthopédiste - Président Directeur Général – Polyclinique de Picardie Amiens
Philippe COSTES – Gynécologue-Obstétricien – CH Senlis

Nicole DUBOIS-PACQUE – Médecin Vasculaire – Polyclinique de Picardie Amiens
Stéphane DUPAS – Médecin Vasculaire – CHU Amiens
Christian ESCOFFIER – Médecin Vasculaire – Abbeville
Marie-Pierre EVRARD – Cadre supérieur de santé pôle coeur – CHU Amiens
Nathalie GORRIEZ – Médecin Vasculaire – CHU Amiens
Jean-Michel GROSSE – Médecin Vasculaire – Polyclinique de Picardie Amiens
Karim HABI – Chirurgie Vasculaire – CHAM Rang du Fliers
G. KARIMET – Centre Hospitalier de Laon
Frédéric HERMANT – Médecin Vasculaire – Clinique Pauchet Amiens
Christine MORIN – Biologiste – CH Calais
Gilles MOUGEOT – Cardiologue – CH Senlis
Daniel PAITEL – Médecin Vasculaire – Creil
Michèle ROBIN – Médecine Interne – CH Laon
Francis ROUSSELLE – Usager - Trésorier - ATP
Manuella SANTACREU – Médecin Vasculaire – Polyclinique de Picardie Amiens
François SELLIER – Médecin Vasculaire – groupe HOPALE Berck/mer et CHAM Rang du Fliers
Marie-Antoinette SEVESTRE – Médecin Vasculaire – CHU Amiens
François THIEULEUX – Cardiologue – CH Calais
Natacha TOUATI – Médecin Vasculaire – CH Amiens
Stéphanie TRAN VAN – Médecin Vasculaire – Polyclinique de Picardie Amiens
Pascal VERNON – Chirurgie Vasculaire – CH St Quentin
Claire VASSEUR – Médecin Vasculaire – Amiens
Pr DESTREE – Président de CME – CHU Lille
Olivier INK – Président de CME – CH Soissons
Alexandre REMOND – Président de CME – CHU Amiens
Gil PETITNICOLAS – Neurologue - CH Soissons

Bruno TRIBOUT, en qualité de coordonnateur provisoire, ouvre la séance, vérifie les pouvoirs donnés aux membres.
Il est ensuite passé à l’ORDRE DU JOUR.
1- Présentation du réseau, bilan et enseignement 2003-2004
2- Rapport d’activité 09/2003 – 09/2004
A- Formalisation du réseau
B- Formations nationales ou régionales
C- Formations du coordonnateur : éducation thérapeutique
D- Groupe de travail, rédaction de protocoles
E- Projet de formation paramédicale continue
F- Partenariats avec l’industrie pharmaceutique
G- Activités par secteurs sanitaires
3- Présentation des participants à l’Assemblée Générale
4- Programme d’action 2005 : analyse sectorielle
5- ATP : Projet de film de prévention
6- Validation de la convention du réseau
7- Élection du Coordonnateur Provisoire
8- Composition d’un bureau
9- Site Web
Extrait de la charte convention constitutive détaillée
A - Les besoins de la population
Les besoins de la population peuvent être analysés sur une pathologie : la maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) et
sur une thérapeutique : le traitement anticoagulant oral par anti-vitamine K.
Maladie thromboembolique veineuse
La MTEV représente la 3
ème
cause de mortalité dans les pays développés, après les maladies cérébro-cardio-vasculaires et
les cancers, survenant sous forme de mort subite par embolie pulmonaire. La MTEV constitue la 3
ème
cause de maladies
cardio-vasculaires après la maladie coronaire et les accidents vasculaires cérébraux.
Par conséquent la MTEV s'inscrit dans le Programme Régional de Santé "maladies cardio-vasculaires".
L'incidence annuelle dans la population générale est de 1 pour 1000 dans les pays développés. L'incidence augmente de
façon exponentielle avec l'âge pour atteindre 1 %/an chez le sujet âgé. La MTEV est une maladie récidivante avec un risque
de récidive de 17% à 2 ans, 25% à 5 ans et 30% à 8 ans. Outre le risque d'embolie pulmonaire mortelle chez 1 à 2% des
patients, les complications de la MTEV (récidive, syndrome post-thrombotique, insuffisance veineuse sévère) représentent
un poids médico-économique considérable et génèrent un handicap chronique chez 20% des patients.
Traitement anticoagulant oral par anti-vitamine K
La population sous AVK en France correspond à 1% de la population générale. Cette population est exposée à une
incidence d'hémorragies graves de 3 à 5 %/an et de décès de 0,6 %/an. Les hospitalisations liées à une hémorragie grave
sous AVK sont estimées à 17300/an en France. Face à ce péril furent créées les cliniques d'anticoagulation dont l'efficacité
est démontrée, y compris en terme médico-économique, avec une réduction des hémorragies graves de 60 % et une
réduction des récidives thrombo-emboliques de 70% par rapport à un suivi conventionnel.
B - Les attentes des professionnels
MTEV et médecins vasculaires
Le fonctionnement en réseau de santé suppose les conditions suivantes :
- une adhésion individuelle de chaque médecin vasculaire,
- l'engagement d'adresser les patients à l'établissement de santé le plus adapté, d'appliquer les protocoles définis en
commun, d'accepter les enquêtes de pratique et l'évaluation du réseau assurée par l'ANAES
- la participation active aux activités de recherche et d'épidémiologie développées au sein du réseau,
- la mise en place d'une formation de qualité au sein du réseau pour les médecins vasculaires qu'ils pourront répercuter
auprès des autres professionnels de santé collaborant avec eux et situé au plus près du patient.
- une éducation thérapeutique des patients assurée par le réseau.
- l'engagement du réseau et de chaque professionnel adhérent de faire bénéficier aux patients des meilleures informations et
des meilleurs soins actualisés.
MTEV et établissements de santé
La MTEV constitue la 1
ère
cause de réhospitalisation après chirurgie lourde au même titre que les infections nosocomiales.
La MTEV réalise la 2
ème
cause de décès maternel après les hémorragies de la délivrance. Les hôpitaux commencent à

considérer la MTEV comme un fléau au même titre que les infections nosocomiales avec la nécessité de mettre en place
des Comités de LUtte contre les Thromboses (CLUT) avec des fonctions similaires aux CLIN dans un but d'éradication.
C - Les remarques sur le système existant
Le système actuel ne répond pas aux attentes de la population de la Picardie et de la Côte d'Opale :
1) Il n'existe que 2 centres de diagnostic des thromboses, fonctionnant en consultation externe, sans hôpital de jour
structuré, implantés à Amiens et à Compiègne.
2) La saturation des 2 centres aboutit à la réalisation de bilans de thrombose incomplets, parasités par l'épisode aigu
thrombotique, sans dépistage familial d'où une répétition inutile des explorations.
3) La plupart des patients n'ont pas matériellement accès à ce dépistage alors qu'il suffirait de faire voyager les
prélèvements au lieu des patients.
4) L'hôpital public ne pouvant pas facturer les actes non inscrits dans la nomenclature des actes biologiques, l'activité
en consultation externe aboutit à une perte sèche en actes de biologie non facturables.
5) Par conséquent l'existant est inadapté aux besoins actuels.
D - L'Historique
Des conférences régionales de consensus concernant la MTEV ont été organisées en 1992, 1993 et 1995 en présence des
représentants de 15 hôpitaux de Picardie et du Pas-de-Calais avec pour thèmes : la stratégie diagnostique, la stratégie
thérapeutique et la stratégie étiologique. Au décours, deux centres de diagnostic de thromboses ont été mis officiellement en
place, respectivement à Amiens et Compiègne, par un vote de consensus régional en 1995.
E - Présentation d'un projet médical et sa traduction en termes d'organisation de la prise en charge
Le projet médical vise, dans la population de référence, des objectifs médicaux et médico-économiques, en structurant l'offre
de soins, que sont :
1) l'amélioration des pratiques médicales visant la prise en charge décentralisée et ambulatoire de l'accident thrombo-
embolique veineux,
2) l'évaluation des facteurs de risque de thrombose,
3) l'éducation thérapeutique et l'information des patients.
Il se traduit par la mise en place d'un dispositif structuré et décentralisé permettant un accès rapide de la population à la
prise en charge et une amélioration des pratiques par la formation et l'éducation.
F - Descriptif de la coordination à mettre en place, et de son positionnement dans l'environnement professionnel
1) Un médecin vasculaire référent est intégré dans la communauté médicale de son établissement de santé. Ce
médecin réunit un groupe de travail transversal au sein de son établissement et au sein du bassin de vie associé.
Ce groupe modélise les prises en charge par une harmonisation des pratiques vis à vis des consensus. Ce groupe
est à l'origine du Comité de LUtte contre les Thromboses ou CLUT propre à chaque bassin de vie. Le médecin
vasculaire référent travaille en collaboration avec les médecins vasculaires libéraux qui ont choisi de lui adresser
leurs patients.
2) Chaque médecin vasculaire libéral adhérent s'engage individuellement à participer activement au réseau
thrombose Picardie Côte d'Opale et à adresser ses patients à l'établissement de santé le plus adapté.
3) Chaque patient adhère individuellement au réseau, auprès de son médecin vasculaire, afin de bénéficier de la
prise en charge la plus adaptée, d'une information et d'une éducation thérapeutique. Un dossier médical
commun partagé permet de gérer les informations nécessaires à une prise en charge globale du patient.
4) Le dossier médical commun partagé est hébergé et sécurisé par le site du réseau thrombose, élément du GIP-
Télémédecine de Picardie.
G - Conclusions sur la plus value du réseau
Les critères de valeur ajoutée du réseau sont :
1) la prise en compte de l'existant et l'adaptation aux réalités locales de chaque bassin de vie. Deux centres
existent en Picardie, Amiens et Compiègne. Grâce aux structures déjà en place, fortes de leur expérience et de
leur activité en pleine croissance, ce réseau vise à développer et à transposer leur activité sur l'ensemble de la
région, en facilitant l'accès aux soins des patients.
2) la pertinence aux regards des besoins et des attentes : Le réseau répond à un problème prioritaire d'accès aux
soins des patients, non résolu jusqu'à présent, ainsi qu'aux besoins de la population. Les structures actuelles sont
proches de la saturation.
5) le caractère global et la vision globale des réalités : Ce projet ne recherche pas l'exclusivité de la prise en
charge des patients. L'interaction avec les autres réseaux Neurologie Vasculaire-AVC, HTA-Vasculaire, Pôles de
Prévention et d'Education est purement complémentaire et non concurrentielle
3) la dimension multipartenariale - un projet partagé par plusieurs promoteurs fondateurs – l'association des
personnes concernées. Ce réseau est le regroupement de différents partenaires fondateurs institutionnels ou
associatifs que sont les centres de diagnostic des thromboses, des hôpitaux pivots, des établissements privés de
santé, des établissements participant au service public hospitalier, l'association des patients ATP avec des

collaborations multiples entre hôpital-université, centre de référence régional-hôpitaux pivots, ville-hôpital, médecin
vasculaire libéral-médecin généraliste.
4) le caractère novateur avec l'absence de rôle dominant du CHU dans les choix du réseau.
5) le caractère transversal. Le réseau s'inscrit dans un axe transversal à plusieurs programmes et à partenaires
multiples : formation des professionnels, éducation des patients, recherche, épidémiologie.
6) la capacité d'autofinancement : La création d'hôpitaux de jour dans chaque établissement de santé permet de
garantir un retour en terme d'activité (sous la forme de points ISA) eu égard aux explorations biologiques hors
routine. Ce réseau prône la prise en charge décentralisée et ambulatoire de la MTEV, vise à limiter le risque
d'accidents hémorragiques sous anticoagulants d'où une économie substantielle en journées d'hospitalisation.
7) la faisabilité de l'évaluation : L'évaluation du réseau s'appuie sur la base de données constituée par les dossiers
des patients et des familles suivis prospectivement, sur le taux d'accidents hémorragiques ou de récidives
thrombotiques des patients suivis par rapport à un suivi conventionnel analysé en pharmacovigilance, sur un audit
des dossiers d'enquête génétique pour bilan de thrombose, et sur la réalisation systématique d'enquêtes de
pratique.
A- FORMALISATION DU RESEAU
De septembre à novembre 2003, 5 réunions du comité de pilotage associant hospitaliers, libéraux et représentants de
l’ARMV, se sont tenues afin de :
- rédiger la charte-convention constitutive du Réseau
- proposer le dossier de dotation régionale des réseaux
- établir les objectifs opérationnels
- définir le contrat patient-soignant
- préciser le cahier des charges d’informatisation
Un audit parallèle à ces réunions a été effectué par l'ARH et l'URCAM.
Le 22 novembre 2003, le résumé du projet déposé au comité des réseaux, fut présenté à l'Assemblée Générale de
l'ARMV (Association Régionale de Médecine Vasculaire).
Le 03 décembre 2003, le comité des réseaux ARH - URCAM s'est réuni.
L'avis du rapporteur était favorable avec un accompagnement pour le financement et l'organisation du réseau.
L'avis de la commission a été défavorable pour les causes suivantes :
- adhésion insuffisante des professionnels de santé de proximité : généralistes, infirmier(e)s, pharmaciens,
biologistes....
- complémentarité insuffisante avec les pôles sectoriels de prévention et d'éducation du patient.
Le 13 janvier 2004, fut connue la dotation de l'ARH pour 2003-2004 avec deux volets :
- 1 poste de secrétaire pérenne occupé par Karine RENOU
- 116 000 € non reconductibles dont 50 000 € destinés au GIP Télémédecine et visant l’informatisation du réseau.
Le reste concerne du matériel informatique et audiovisuel, la création de supports pédagogiques tels qu'un film sur
l'éducation thérapeutique AVK, le carnet de traitement anticoagulant du réseau basé sur la maquette mise au point au
CH de Senlis, la création de logos.
Le 13 mai 2004, la notification officielle de l’absence de financement par la Dotation Régionale de Développement des
Réseaux est rendue pour les motifs suivants :
- Le dossier ne correspond pas à la définition d’un réseau de santé : il n'est pas assez formalisé, pas assez structuré.
- Le projet manque de lien avec les pôles de prévention.
- Il n’y a pas assez d'éducation du patient.
- L'impact financier n'a pas été abordé.
- Le dossier est axé sur la recherche et orienté vers l'hospitalier.
Le 22 mai 2004, l'Association de patients ATP (Association des Thromboses en Picardie) s'est réunie en assemblée
générale et a adopté à l’unanimité la charte-convention constitutive du réseau ainsi que le contrat patient-soignant.
Le 01 juillet 2004, le Comité de pilotage (hospitaliers – libéraux – ATP) s’est réuni afin d’étudier les points suivants :
- Le budget du réseau.
- L’éducation thérapeutique : film sur le traitement AVK, logos.
- Il fut donné un mandat à l’unanimité au coordonnateur provisoire afin de convoquer l’Assemblée Générale
Constituante du réseau.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%