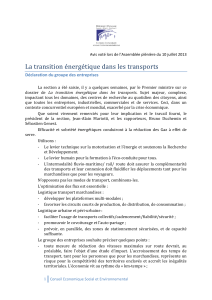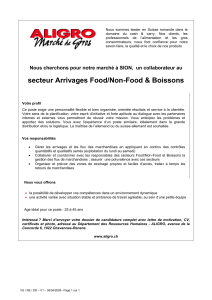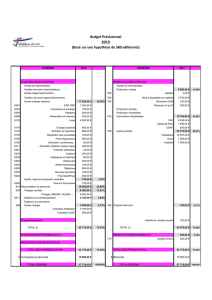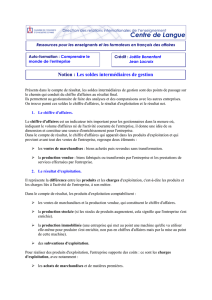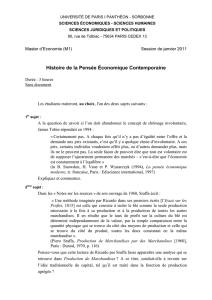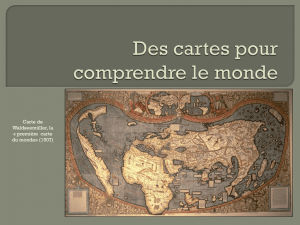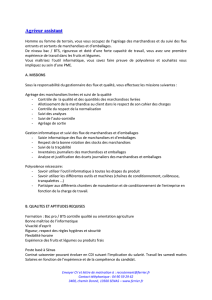partie 3 - retouralaccueil Érudit - Promouvoir et diffuser la recherche

181
Troisième partie : la politique publique en
matière de logistique en Europe
3.1 Introduction
Ce troisième volet de la thèse a pour objectif de participer à la réponse à la seconde question
de notre problématique, relative aux impacts territoriaux de la logistique. Nous défendons le
fait que ces derniers sont le fruit d’une combinaison des attentes des industriels du secteur et
de la politique menée par les pouvoirs publics, à différents niveaux de décision.
Pour rappel, notre hypothèse de départ relative à la politique publique en Europe suggère que
la gouvernance actuelle est orientée vers une approche entrepreneuriale et guidée par le souci
d'attirer des investisseurs privés pour créer de l’activité et des emplois. Dès lors, notre
approche s'organise par le biais d'une étude des interactions et rapports de force des
différentes parties prenantes intervenant dans la problématique.
Dans ce cadre, ce volet est consacré à l’identification des politiques publiques menées en
Europe à tous les niveaux hiérarchiques. L’étude de la question est organisée en deux parties
principales. Il s’agit d’abord de décrypter le rôle des différents échelons de pouvoir en Europe
et les modalités guidant leur action actuelle en matière de développement territorial et de
logistique, par le biais d’une étude des textes politiques et des mesures prises ou envisagées
par l’Union européenne et les États membres. Ceci constitue le cadre théorique de l’étude des
politiques menées en matière de développement territorial et de logistique dans les régions
d’ancienne industrie et en Wallonie en particulier, et dans les villes européennes, avec une
analyse fine du cas bruxellois.
La combinaison de ces résultats avec ceux relatifs à la géographie de la logistique constitue la
base de notre analyse des impacts territoriaux, qui est l’objet de la partie suivante.
3.2 Logistique et politique publique, un état des lieux
Nous défendons l’hypothèse selon laquelle la politique publique influe et régule selon
différentes modalités la façon dont l’activité logistique et de transport de marchandises
interagit avec le territoire. En effet, les autorités déterminent l’affectation du sol, la régulation
du marché du transport ou des échanges internationaux. En cela, elles orientent et s’inscrivent
dans les rapports de force de la société, participant à la médiation entre les attentes des
différents acteurs socio-économiques et notamment du secteur logistique (Jessob, 1997 ;
Gunder, 2010).

182
Pour défendre et étayer notre hypothèse, il est nécessaire de déterminer le rôle des niveaux de
pouvoirs et les options politiques suivies par ces derniers. Après avoir identifié les enjeux
posés par la logistique aux autorités publiques et les différentes façons dont ces dernières
peuvent agir, nous nous interrogeons sur la répartition des compétences en Europe en matière
de développement territorial, en partant de l’échelon européen et en descendant dans la
hiérarchie décisionnelle.
3.2.1 Les enjeux de la logistique pour les décideurs et la répartition des
compétences
La logistique suscite différents enjeux pour les autorités publiques en matière de
développement territorial. Leurs politiques s’organisent à plusieurs échelles et se déclinent en
une série de domaines d’actions, relatifs à l’économie, au transport, à l’aménagement du
territoire et au social.
Pour les autorités, les problématiques relatives à la logistique sont d’abord économiques, il
s’agit de déterminer la façon dont cette activité participe au fonctionnement de l’économie, en
créant des emplois ou en permettant un meilleur fonctionnement du reste des acteurs. Dans ce
contexte se posent des questions sociales et sociétales, à propos du type d’emplois que
proposent les logisticiens et de la manière dont cette activité est perçue par les populations.
Dès lors se posent des enjeux relatifs au transport de marchandises, qui concernent l’évolution
des flux et leur répartition modale. De même, l’usage du sol par l’activité logistique et ses
lieux d’implantations ainsi que leur régulation doivent être pris en charge par les autorités.
Enfin, de ces éléments découlent des problématiques relatives à l’environnement, émissions
polluantes, consommation d’espaces et autres nuisances.
L’intégration économique et politique européenne s’est traduite par une redéfinition de la
répartition de ces compétences. L’Union européenne a progressivement intégré des politiques
relatives aux infrastructures et équipements, aux services (anciennement) publics, au transport
et télécommunications et à l’environnement. Cette européanisation, allant de pair avec
l’extension géographique de l’Union, vise à unifier les États membres derrière un projet
politique et économique commun. Cependant, cette évolution progresse de façon différenciée
selon les domaines. Ainsi, l’Union européenne, telle qu'elle est structurée après le traité de
Lisbonne de 2007, dispose d’un pouvoir exclusif sur les problématiques relatives à
l’établissement des règles de concurrence et le fonctionnement du marché intérieur ainsi
qu’au niveau de l’union douanière (UE, 2012a). Certaines compétences sont dites partagées,
c’est-à-dire qu’elles sont exercées tant par l’Union européenne que par les États membres.
Dans notre cas, il s’agit du transport et des réseaux transeuropéens, de l’environnement, de la
cohésion économique, sociale et territoriale et de la politique sociale. Enfin, pour certains
domaines, qualifiés de compétences de coordination, l’Union européenne dispose uniquement
de la possibilité de mener des politiques d’appui et de coordination de l’action des États
membres ; ceci concerne notamment la politique industrielle. La répartition fine des
compétences partagées entre l’Union et les États membres est régie par les principes de

183
subsidiarité et de proportionnalité. En vertu de ceux-ci, les décisions politiques prises doivent
s'appliquer autant que possible sur les niveaux inférieurs, donc sur les organes de décision
nationaux, régionaux ou locaux des États membres. L'Union européenne doit devenir active
seulement si les niveaux de décision inférieurs ne sont pas en mesure de résoudre des
problèmes indépendamment et raisonnablement (UE 2012b). Dans ce cadre, au niveau de la
politique sociale, de l’aménagement du territoire ou du développement économique, les
compétences restent presque exclusivement aux mains des États membres. De plus, les
décisions opérationnelles relatives au territoire, qu’il s’agisse d’aménagement ou de choix
économiques opérationnels, sont de plus en plus intégrées aux compétences des autorités
régionales (Baudelle et coll., 2011 ; Getimis, 2012).
Les modalités de cette évolution semblent symptomatiques de l’idéologie guidant la
construction européenne et ont des impacts en matière des choix politiques et de leurs
conséquences (Vanolo, 2010). Nous traitons la question en deux étapes, d’une part la
politique de l’Union européenne et ensuite les politiques des États membres du Nord-Ouest de
l’Europe.
3.2.2 Le rôle de l’Union européenne pour la politique publique en matière
de transport de marchandises et de logistique
Plusieurs politiques sectorielles de l’Union européenne, relatives au transport, à la régulation
du marché unique, à la concurrence ou à l’orientation économique sont susceptibles
d’influencer le secteur de la logistique et du transport de marchandises (Karamistos, 2005).
Bien que ces politiques n’aient pas nécessairement un caractère spatial, elles influent
indirectement fortement sur le territoire de l’Union et son économie (UE, 1999). De plus, la
politique régionale européenne, qui est territorialisée et mobilise d’importants budgets, peut
impacter l’organisation de l’activité logistique.
Nous passons en revue ces différents domaines et déterminons leurs impacts sur l’évolution
sur le secteur du transport de marchandises et de la logistique et sa géographie.
3.2.2.1 La formation du marché unique européen
En premier lieu, l’une des réalisations majeures de la Communauté puis de l’Union
européenne a été la création d’un marché unique européen, qui était déjà inscrit dans le traité
de Rome de 1958 (Baudelle et coll., 2011). Il se traduit par la suppression des droits de
douane sur tout le territoire et des contrôles aux frontières dans le périmètre Schengen et par
l’instauration de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, dans le cadre
d’un marché concurrentiel. Cette mesure a servi de cadre à de nombreuses autres politiques.
Elle s’accompagne d’une libéralisation de certains services publics et d’un encadrement strict
et une réduction des aides d’État, compensés par la mise en place d’une politique régionale
européenne (Buunk et coll., 1999 ; Baudelle et coll., 2011). Par ailleurs, en plus de la
poursuite de mesures juridiques et macro-économiques visant à uniformiser progressivement

184
le marché, des politiques d’infrastructures transnationales sont menées. Nous évoquons la
portée de ces différents éléments dans la suite du propos.
3.2.2.2 La politique des transports
Les autorités européennes ont mis tardivement en place une politique des transports puisque
ce n’est qu’en 1992 qu’est sorti le premier livre blanc traitant de la question (CE, 2001). Ce
retard est lié à l’importance stratégique du transport, qui a poussé les États membres à
conserver leur prérogative nationale. Cette compétence reste d’ailleurs partagée entre les deux
niveaux de pouvoir.
En constatant l'inefficacité du marché, se traduisant par des coûts externes élevés, la
congestion et un déséquilibre modal favorable au transport routier, la politique de l’Union en
matière de transport de marchandises s’organise autour de plusieurs objectifs : le
désengorgement, le désenclavement et la libéralisation du marché et, plus récemment, le
développement du transport intermodal et le découplage de la croissance économique et de
celle du transport (Tight et coll., 2004 ; EC, 2007).
La principale réalisation de l’Union a été de libéraliser le marché du transport de
marchandises, tous modes confondus. Le transport routier a été réformé en plusieurs étapes,
entre 1990 et 1998, pour aboutir à une libéralisation totale, que ce soit au niveau du prix, du
transport international, de l’accès à la profession ou pour le cabotage, c’est-à-dire le transport
effectué à l’intérieur d’un État membre par une compagnie étrangère à ce pays (CEMT,
2001). Au niveau aérien, la libéralisation a été mise en œuvre par paquets entre 1987 et 1997.
Ainsi, en 1992, les tarifs aériens ont été libéralisés, et le cabotage a été ouvert en 1993 et
généralisé le 1
er
avril 1997 (Dobruszkes, 2009). Au niveau fluvial, cette évolution est
intervenue entre 1996 et 2000, avec la suppression du tour de rôle, qui régissait la répartition
du trafic entre les opérateurs. Ceci s’inscrivait dans la continuité d’une politique plus ancienne
de limitation volontaire du nombre de bateaux pour réduire la surcapacité de la flotte
intérieure européenne et d’encouragement à la restructuration du secteur privilégiant de plus
grands opérateurs (CEMT, 2006). Enfin, le transport ferroviaire de marchandises a également
été complètement libéralisé, en plusieurs étapes. Il s’est agi d’une œuvre de plus grande
envergure dans la mesure où elle supposait de réformer un marché quasi entièrement public et
essentiellement basé sur des acteurs étatiques (CE, 2007). Dès 1991, a été rédigée une
directive visant à séparer du point de vue de la comptabilité le transport et la gestion des
infrastructures, d’orienter les opérateurs ferroviaires vers un objectif de rentabilité financière
et de réduction de l’endettement et de permettre l’accès au marché à de nouveaux opérateurs
(CEMT, 2001). C’est à partir de 1997 que des réalisations concrètes ont été engrangées, avec
la libéralisation de corridors de fret européens. En 1998 a été adopté le premier paquet
ferroviaire qui prévoit la définition d’un réseau transeuropéen, le libre accès au réseau, la
séparation des organismes de transport de ceux assurant la gestion des infrastructures et un
système indépendant de tarification de l’utilisation des infrastructures. Ces mesures se sont
traduites par une libéralisation totale du transport ferroviaire de fret en 2007 (CE, 2006). En

185
parallèle, les services aéroportuaires au sol ont également été libéralisés complètement en
2003.
Du point de vue des infrastructures, plusieurs mesures ont été prises. L’objectif de l’Union
européenne en la matière est de promouvoir et développer le report modal, 80 % des fonds
dédiés au transport devraient y être consacrés, tout en reconnaissant que la route restera la
colonne vertébrale des échanges (EC, 2009). Plusieurs projets sont menés en parallèle. Un
réseau transeuropéen de transport (RTE-T) a été dessiné pour guider les futurs
investissements en infrastructures de transport (CE, 2005). Il s’accompagne d’une
identification des goulets d’étranglement à supprimer et des axes à réaliser en priorité. Sur ces
axes, l’Union peut participer partiellement au financement de nouvelles infrastructures et
entend privilégier des montages en partenariat public-privé pour les réaliser. D’autre part,
l’Union souhaite revitaliser le rail, en développant un réseau réservé au fret et en uniformisant
les pratiques et les infrastructures. Cette politique doit se baser sur l’amélioration de la
compétitivité du secteur, par le biais de la libéralisation, en tirant exemple des situations nord-
américaines et britanniques (CEMT, 2001). L’Union entend profiter de cette libéralisation des
opérateurs ferroviaires pour favoriser l’émergence d’entreprises européennes en créant un
marché unique harmonisé censé leur être favorable (EC, 2007). L’action se focalise dès lors
sur la mise en place de corridors européens, correspondant aux RTE-T, sur lesquels la
signalisation est progressivement uniformisée et le matériel est interopérable, permettant la
circulation de convois sans interruption. L’objectif de 2001 était d’arriver à une part de
marché de 15 % du rail en 2020 pour les échanges intérieurs, c’est-à-dire de doubler sa part de
l’époque et de tripler la productivité du personnel ferroviaire (CE, 2007). De plus, l’Union
entend favoriser le transport maritime et fluvial, notamment en créant des autoroutes de la
mer, c’est-à-dire des liaisons maritimes à courte distance entre ports européens pour le
transport de poids lourds, dans le cadre du programme Marco Polo (EC, 2007). Enfin, la
régulation de la construction et du développement des infrastructures portuaires et
aéroportuaires au niveau européen est organisée par le biais de la mise en concurrence des
terminaux et des services associés, qui doit favoriser leur compétitivité économique.
Par ailleurs, pour favoriser le report modal et réduire les impacts environnementaux du
transport, l’Union européenne a mis en place une stratégie dont l’objectif est d’intégrer les
coûts externes des différents modes, c’est-à-dire de monétariser leurs impacts négatifs et de
les faire payer par les usagers ou les transporteurs (EC, 2007). Ceci réduirait la compétitivité
de la route et de l’avion, qui sont les moyens de transport les plus polluants, tout en ne
remettant pas en cause la régulation par le marché libre. La seule mesure concrète relative à
cette internalisation des coûts est l’intégration progressive du transport aérien européen dans
le marché européen des droits d’émissions de gaz carbonique. Dans le cadre de celui-ci, les
compagnies aériennes devraient acheter leurs droits d’émettre de tels gaz, qui correspondent à
une partie de leurs impacts environnementaux, à partir de 2012.
L’Union mène également plusieurs actions relatives à la promotion et la diffusion des bonnes
pratiques, européennes et étrangères, en matière de transport de marchandises, en privilégiant
les démarches de benchmarking (EC, 2007). L’objectif est d’identifier et de promouvoir des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
1
/
47
100%