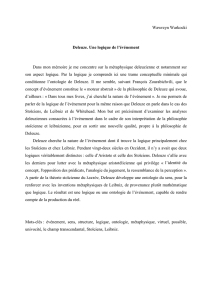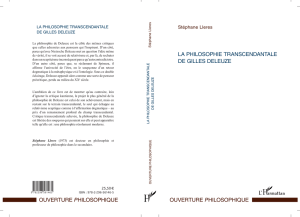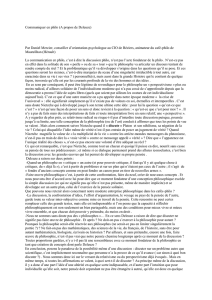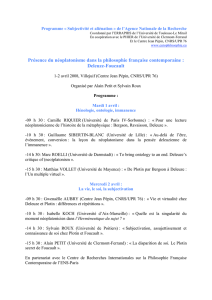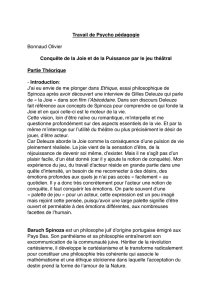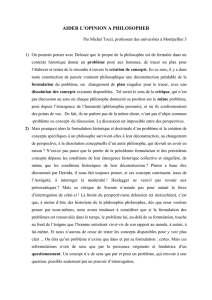fabio_treppiedi_entre pouvoir et puissance

1
Fabio Treppiedi (PhD Université de Palerme)
Entre pouvoir et puissance
Deleuze et l’image de la pensée
διὸ οὐδέποτε νοει᷆ ἄνευ ϕαντάσµατος ἢ ψυκή
Aristote, De anima, 431a 17-18
Pour amorcer la compréhension du sens dans lequel, par exemple, un problème à spectre large et
très actuelle comme celui du pouvoir des images se pose dans la philosophie de Deleuze, on peut
prendre comme point de départ la dernière fois que Deleuze parle explicitement de «l’image de la
pensée». Il s’agit de la préface à l’édition américaine de Différence et répétition, qui cependant ne
paraît aux États Unis qu’en 1994 (Deleuze va mourir d’ici un an). Dans cette très brève préface,
Deleuze résume les cinq problèmes principales abordés dans Différence et répétition et il affirme ce
qui suit à propos du chapitre III, ayant justement pour titre «l’image de la pensée»:
Finalement dans ce livre, il me semblait qu’on ne pouvait atteindre aux puissance de la différence et de
la Répétition qu’en mettant en question l’image qu’on se faisait de la pensée. Je veux dire que nous ne
pensons pas seulement d’après une méthode, tandis qu’il y a une image de la pensée, plus ou moins
implicite, tacite et présupposée, qui détermine nos buts et nos moyens quand nous nous efforçons de
penser. Par exemple, on suppose que la pensée possède une bonne nature, et le penseur, une bonne
volonté ; on se donne comme modèle la récognition […] et l’on suppose que le vrai concerne les
solutions, c’est-à-dire des propositions capable de servir de réponses. Telle est l’image classique de la
pensée, et tant qu’on n’a pas porté la critique au cœur de cette image, il est difficile de mener la pensée
jusqu’à des problèmes qui débordent le mode propositionnel, de lui faire opérer des rencontres qui se
dérobent à toute récognition, de lui faire affronter vrais ennemies […] dans Différence et répétition,
cette recherche devient autonome, et devient la condition pour la découverte des deux concepts. Aussi
est-ce le chapitre III qui me paraît maintenant le plus nécessaire et le plus concret
1
.
A partir d’une problématisation de la structure théorétique de la philosophie de Deleuze, il y a la
possibilité de montrer le rôle centrale qu’y joue l’image de la pensée. Ensuite, à la lumière de
quelques références kantiennes, il faudra voir que le discours deleuzien sur l’image de la pensée, en
réagissant au pouvoir de cette image, en montre un certain puissance inépuisable.
Structure et probléme
On n’a pas l’habitude d’associer le concept d’«image de la pensée» à la philosophie de Gilles
Deleuze avec la même instantanéité avec laquelle, plus souvent, d’autres concept plus célèbres y
sont associé, comme ceux de «différence», «corps sans organes», «machine désirante», «schizo-
analyse» etc. Mais on peut affirmer, comme l’ont déjà fait certains lecteurs, la primauté du
problème de l’image de la pensée dans la philosophie de Deleuze
2
. Par primauté, dans ce cas, on
entend le rôle propulseur que le problème de l’image de la pensée assume dans la philosophie de
Deleuze. L’image de la pensée est, en effet, non pas un problème entre autres, pour Deleuze, mais
1
G. DELEUZE, Deux régimes de fous, Minuit, Paris 2003, p. 282.
2
Cf. J. C. MARTIN, Variations. La philosophie de Gilles Deleuze, Payot, Paris 2005, pp. 193-229 et P.
VERSTAETEN, De l’image de la pensée à la pensée sans image, in T. Lenain (ed.), L’image. Deleuze, Foucault,
Lyotard, Vrin, Paris 2003, pp. 65-94.

le problème par excellence de la philosophie. Si bien que ce problème va engager la partie la plus
intime de sa pensée et il va en constituer le milieu: une sorte de noyau toujours décentrée duquel,
tour à tour, les problèmes affrontés et le concepts créés par Deleuze jaillissent de manière
concentrique ou stratigraphique, au cours d’une expérience très variée comme la sienne, qui, on le
sait, s’étend de l’histoire de la philosophie à la politique, de la critique littéraire à la psychiatrie, de
la peinture au cinéma.
À la différence de ce qu’on dit habituellement au sujet de sa pensée (et de ce qu’il peut peut-être
paraître en lisant ses textes) Deleuze affirme que la philosophie est essentiellement système
3
. Si on
devait se demander ce que Deleuze entend pour «système» on pourrait dire, de manière générale,
qu’il s’agit d’une conception de la pensée philosophique comme quelque chose qui, loin de
s’enfermer ou de se compléter dans un système donné, ne cesse de se structurer de manière
systématique: c’est le devenir du système plutôt que le système lui même. On dirait alors que
Deleuze se réfère essentiellement à la systématicité de la pensée philosophique. Sous ce jour, le
système n’est rien que la structure théorique qui anime la pensée d’un philosophe
4
.
Il faut penser notamment à ce que Deleuze a appelé structure. Qu’est-ce que la structure? Ou bien
ne vaudrait-il mieux de se demander, comme le fait Deleuze, «à quoi reconnaît-on» une structure?
5
Une structure est fondée sur trois règles essentielles:
- La structure est composée de deux séries d’éléments hétérogènes.
- Chaque élément d’une série peut se reconduire à un élément correspondant de l’autre série.
- Un élément de la deuxième série doit toujours pouvoir être distingué d’un élément de l’autre série.
Or, le principe fondamental de la structure est qu’il ne peut y avoir qu’un seul élément qui soit en
même temps hétérogène par rapport à la première série ainsi qu’à la seconde. Faute de cet élément
très particulier - qui est pensable à l’instar d’un sorte de chromosome anomale et que Deleuze lui
même définit comme «instance paradoxale» - il n’y a pas de système du tout, pas de structure du
tout. Faute de cet élément, en effet, il ne pourrait y avoir ni correspondance ni discernibilité entre
les éléments des deux séries, ni même la possibilité de rapporter un élément d’une série à un
élément de l’autre
6
.
Le caractère centrale de l’image de la pensée dans la philosophie de Deleuze doit être démontré, et
ce serait ma thèse, en établissant un rapport avec l’idée fondamentale pour laquelle un concept
n’existe pas indépendamment du problème auquel il répond. C’est cette idée qui permet d’envisager
la philosophie de Deleuze en tant que système et - plus précisément - en tant que pensée, qui a une
structure théorétique justement en ce qu’il a en soi l’élément qui fonctionne en tant que «instance
paradoxale», comme un principe premier de la structure. Dans la philosophie de Deleuze, l’image
de la pensée joue donc ce rôle décisif.
3
“Je crois à la philosophie comme système. C’est la notion de système qui me déplâit quand on la rapporte aux
coordonnées de l’Identique, du Semblable et de l’Analogue. C’est Leibniz, je crois, qui le premier idéntifie système et
philosophie. Au sens où il le fait, j’y adhère. Aussi les questions «dépasser la philosophie», «mort de la philosophie» ne
m’ont jamais touché. Je me sens un philosophe trés classique. Pour moi le système ne doit pas seulement être en
perpétuelle hétérogénéité, il doit être une hétérogenèse, ce qui, il me semble, n’a jamais été tenté” G. DELEUZE, Deux
régimes de fous, cit., p. 338.
4
À propos de Kant, par exemple, Deleuze parle d’un certain «fonctionnement» de son système, comme de ses
engrenages ou «rouages», cf. G. DELEUZE, Pourparlers, Minuit, Paris 1990, pp.14-15.
5
cf. G. DELEUZE, L’île déserte, Minuit, Paris 2002, p. 238 et sq.
6
Si on définit cette instance «paradoxale», comme on peut le comprendre, c’est avant tout parce qu’elle ne semble pas
recouper ce qu’est, d’après Aristote, le «principe le plus sûr» (Metaph. IV, 1005b 19-20), c’est-à-dire le principe de non
contradiction, en vertu duquel un même élément ne pourrait pas, «en même temps et sous le même respect», appartenir
et ne pas appartenir à une série ou à l’autre. En réalité, le rapport entre la dite «instance paradoxale» et le principe de
non contradiction est beaucoup plus complexe de ce qu’il peut paraître aux premiers abords. C’est pourquoi il mériterait
d’être approfondi de manière plus détaillée. Ici, il faut uniquement mettre en clair que Deleuze ne veut pas nier la
validité du principe aristotélicienne, mais qu’il tente plutôt de s’installer sur un plan de discours dans lequel les effets
nécessaires du principe sont, pour ainsi dire, «temporairement» suspendus. Cf. le texte deleuzienne complémentaire, sur
ces thèmes, à Différence et répétition, a savoir Logique du sens, Minuit, Paris 1969, p. 46 et sq.

3
Il faut commencer, dans ce sens, par l’hypothèse d’après laquelle la philosophie de Deleuze est une
structure avec deux séries hétérogènes (les problèmes et les concepts) et une instance paradoxale,
qui ne se réduit, justement, ni au concept, ni au problème. C’est uniquement en vertu cette instance,
donc, qui nous pouvons reconduire tout concept deleuzien à un problème déterminé, en évitant ainsi
de prendre un de ses concepts pour un de ses problèmes. C’est dans cette valeur paradoxale que,
dans cette article, il sera possible parler de l’image de la pensée comme le problème de la
philosophie de Deleuze.
Concepts et problèmes
Dans Qu’est-ce que la philosophie? (dernier livre écrit avec Guattari) Deleuze clarifie la distinction
entre un concept et un problème en explicitant le rapport nécessaire qui les relie:
Tout concept renvoie à un problème, à des problèmes sans lesquels il n’aurait pas de sens, et qui
ne peuvent eux-mêmes être dégagés ou compris qu’a fur et à mesure de leur solution […] Il est
vain de se demander si Descartes a tort ou raison. Les concepts cartésiens ne peuvent être
évalués qu’en fonction des problèmes auxquels ils répondent […] Et si des concepts peuvent être
remplacés par d’autres, c’est sous la condition de nouveaux problèmes […] Un concept a
toujours la vérité qui lui revient en fonction des conditions de sa création […] Et si l’on peut
rester platonicien, cartésien ou kantien aujourd’hui, c’est parce que l’on est en droit de penser
que leurs concept peuvent être réactivés dans nos problèmes et inspirer ces concept qu’il faut
créer. Et quelle est la meilleure manière de suivre les grands philosophes, répéter ce qu’ils ont
dit, ou bien faire ce qu’ils ont fait, c’est-à-dire créer des concepts pour des problèmes qui
changent nécessairement? […] quand un philosophe en critique un autre, c’est à partir de
problèmes et sur un plan qui n’étaient pas ceux de l’autre, et qui font fondre les anciens concepts
comme on peut fondre un canon pour en tirer de nouvelles armes. Critiquer, c’est seulement
constater qu’un concept s’évanouit, per de ses composantes ou en acquiert qui le transforment,
quand il est plongé dans un nouveau mileu
7
.
L’idée deleuzienne de «problème», cependant, trouve sa première configuration déjà dans la dense
réflexion que Deleuze a conduit entre les années ’50 et ’60, notamment dans le cadre de la difficile
gestation de sa thèse, Différence et répétition. On pourrait rappeler, à ce propos, que cette thèse, au
départ, aurait dû porter sur la «notion de problème»: ce ne fut qu’après la rupture inattendue avec
Jean Hyppolite (son première maître ainsi que premier directeur de sa thèse) que Deleuze choisit un
autre directeur, Maurice De Gandillac, et pour un autre sujet, c’est à dire, Différence et répétition
8
.
Dans le troisième chapitre de Différence et répétition, Deleuze affirme que le lien imposé à la
pensée par le pouvoir de l’image dite «dogmatique» ou «classique» de la pensée (ici la notion de
«pouvoir» semblerait avoir une acception encore négative, comme si c’était potestas, ou bien
quelque chose de limitant) aurait, au cours de l’histoire, empêché à la philosophie d’accéder
complètement à ce qu’il définit le «problème en tant que problème» ou bien «l’être en soi du
problématique»
9
. D’après Deleuze affirme que cette pouvoir de l’image postulerait l’impossibilité
de penser authentiquement les problèmes en tant que tels, en limitant ainsi la philosophie à
«décalquer les problèmes et les questions sur les propositions correspondantes qui servent ou
peuvent servir de réponses»
10
. D’où aussi l’habitude de concevoir le problème en tant que quelque
chose qui «disparait», dit Deleuze, dans le moment même où la solution comparaît. Pour Deleuze,
au contraire, les solutions n’ont aucun pouvoir d’épuiser le problème, qui est tel uniquement en
vertu du fait qu’il possède la véritable puissance enracinée de continuer subsister non pas au delà, ni
abstraction faite des solutions, mais dans et à travers toutes les solutions :
7
G. DELEUZE, F. GUATTARI, Qu’est-ce que la philosophie?, Minuit, Paris 1991, p. 22 et sq.
8
Cf. G. BIANCO, Ferdinand Alquié et Jean Hyppolite, in S. Leclerq (ed.), Aux sources de la pensée de
Gilles Deleuze, Vrin-Sils Maria, Paris, 2006.
9
G. DELEUZE, Différence et répétition, Puf, Paris 1968, p. 204 et sq.
10
Ibid.

Un problème n’existe pas hors de ses solutions. Mais loin de disparaître, il insiste et persiste dans
ces solutions qui le recouvrent. Un problème se détermine en même temps qu’il est résolu ; mais sa
détermination ne se confond pas avec la solution, les deux éléments diffèrent en nature, et la
détermination est comme la genèse de la solution concomitante
11
.
Cela entraîne, en dernier ressort, et une différence nette entre problème et solution (comme on l’a
vu) et ce que Deleuze définit un «déplacement des valeurs logiques» (le vrai et le faux) du plan des
solutions à celui des problèmes. C’est en vertu de tel argument que, dès ses écrits sur Bergson qui
datent des années ’50, Deleuze soutient la thèse selon laquelle il n’y a pas des solutions vraies ou
fausses en philosophie, mais uniquement des vrais ou faux problèmes, puisque seul le problème est
capable, ou bien a la puissance (on ne dira plus pouvoir, à cause de l’acception négative de lien, de
borne et d’oppression qu’il a) de déterminer le sens par lequel nous affirmons la vérité ou la
fausseté des solutions
12
. Il faut maintenant se concentrer sur deux éléments décisifs qui ont émergé
jusqu’ici:
I. La logique du rapport entre problème et solution, c’est-à-dire du rapport entre problème
et concept (bien que le lexique et l’horizon du discours, la forme du rapport est pensée
de la même manière)
II. Le «cercle vicieux» qui empêche d’accéder au «problème en tant que tel».
I. Entre problème et solution — ou entre problème et concept, si on choisit se référer à Qu’est-ce
que la philosophie? — il y a un rapport d’ «expression» que Deleuze emprunte, à son tour, aux
philosophies de Leibniz et Spinoza. D’après ce schéma, d’après lequel «l’exprimé n’existe pas
indépendamment de l’expression qui l’exprime»
13
, le problème (en tant qu’il est ce qui est exprimé)
n’existe pas indépendamment de la solution ou du concept qui l’expriment (puisque ceux-ci
constituent justement l’expression du problème). Le schéma est, en résumé, le même que celui par
lequel Spinoza conçoit les rapports entre la substance, les attributs et les modes, c’est-à-dire l’ainsi
dite logique de la «disjonction inclusive», en vertu de laquelle deux termes subsistent tous les deux
en fonction d’une appartenance réciproque(je dirais en synthèse: l’un n’existe pas sans l’autre).
Dans cette logique, ce qui compte, pour Deleuze, est moins le schéma lui-même par lequel elle se
reproduit que son fondement, par lequel elle est littéralement «motivée» où «innervée», c’est-à-dire
l’immanence réciproque des deux termes l’un avec l’autre. C’est cette idée d’immanence qui
représente, on le sait, le Leitmotiv de la pensée deleuzienne
14
.
II. Le point le plus délicat du discours deleuzien autour de la notion de problème est constitué par le
fait qu’il fait venir au jour un «cercle vicieux» dont la compréhension relève de manière décisive de
la notion de problème et, plus indirectement, notre propre thèse sur l’image de la pensée comme le
problème de la philosophie de Deleuze:
Étrange saut sur place et cercle vicieux, par lesquels le philosophe prétend porter la vérité, des
solutions jusqu’aux problèmes, mais, encore prisonnier de l’image dogmatique, renvoie la vérité
des problèmes à la possibilité de leurs solutions. Ce qui est manqué, c’est la caractéristique interne
du problème en tant que tel, l’élément impératif intérieur qui décide d’abord de sa vérité et de sa
fausseté, et qui mesure son pouvoir de genèse intrinsèque : l’objet même de la dialectique
15
.
11
Ibid., p. 212.
12
“Ce n’est pas par hasard que, parlant de l’intuition, Bergson nous montre quelle est l’importance, dans la vie de
l’esprit d’une activité qui pose et constitue les problèmes: il y a des faux problèmes plus encore qu’il n’y a de fausse
solutions, avant qu’il n’y ait de fausses solutions pour les vrais problems. Or, si une certaine intuition est toujours au
cœur de la doctrine d’un philosophe, une des originalities de Bergson est dans sa proper doctrine d’avoir organisé
l’intuition meme comme une véritable méthode, méthode pour eliminer les faux problèmes, pour poser les problèmes
avec vérité”, G. DELEUZE, L’île déserte, cit., pp. 28-29.
13
Cf. G. DELEUZE, Spinoza et le problème de l’expression, Minuit, Paris 1968.
14
Cf. M. DE BEISTEGUI, Immanence. Deleuze and philosophy, Edinburgh University Press, Edinburgh 2010.
15
G. DELEUZE, Différence et répétition, cit., p. 210 (c’est moi qui souligne).

5
La thèse de Deleuze est claire: jusqu’à ce que la pensée philosophique ne pénètre, par la critique, au
cœur de l’image qu’elle s’est construite à elle-même historiquement, aucune opération autre que
celle par laquelle on décalque la vérité du plan des solutions à celui des problèmes ne peut résulter
possible. En nous montrant ce «faux mouvement», c’est-à-dire cette «décalque» par lesquelles le
problème est pensé à partir de la possibilité de le résoudre, Deleuze dévoile un aspect lui aussi
décisif par rapport au problème de l’image: c’est que l’image empêche le véritable mouvement de la
pensée.
Pouvoir et puissance
Deleuze affirme donc explicitement qu’il y a une image «dogmatique» ou «classique» de la pensée
qui empêche de commencer à penser véritablement (de faire, pour ainsi dire, «le premier pas»).
Mais c’est justement sur ce point qu’il y a la possibilité de «rater» la cible, c’est-à-dire de manquer
la nature la plus intime de l’image de la pensée. Cela irait dans le même sens de ce que Deleuze
pointe du doigt, dans le passage qu’on vient de citer, comme la possibilité de rater l’essence
intrinsèque du problème. En effet, si l’on se tromperait en concevant le problème uniquement à
partir des solutions, on se tromperait tout aussi bien si on lisait Deleuze en concevant l’image à
partir de ces effets ou, pour le dire de façon plus concrète, à partir du fait que dans Différence et
répétition Deleuze nous montre les effets historiques de l’image (ce qu’elle aurait entraîné et,
surtout, ce qu’elle continue à empêcher).
L’impossibilité de penser est justement imputable au pouvoir que l’image exerce: on n’arrive pas à
penser autre que ce que elle même permet de penser. Deleuze semble, à ce stade, rendre ses
intentions manifestes, voire dicter un programme. Les premières pages du chap. III de Différence et
répétition s’adonnent, en effet, à une «lutte rigoureuse contre l’image», dans une «critique radicale
des ses présupposés», ayant pour but une sorte de libération de la pensée, qui doit se réaliser par des
«grandes destructions». C’est une instance réactive de la pensée deleuzienne, donc, laquelle
semblerait conduire nécessairement à une conclusion qu’on pourrait bien définir iconoclaste
(destruction tout court de l’image). Conclusion qui n’est pas si évidente, en revanche, surtout si l’on
considère que c’est dans ces pages mêmes que Deleuze entame une exposition du thème connu du
dehors
16
.
Ce que l’image empêche de retenir, en effet c’est ce que Deleuze appelle son Dehors. Mais ce
même Dehors ne doit pas être pris comme quelque chose qui est en dehors de l’image elle-même.
L’aspect le plus radical du problème revient au fait qu’il y a quelque chose qui empêche de le
penser : l’hypothèse centrale c’est qu’il s’agit ici de la même forme disjonctive/inclusive de rapport
qui a émergé à propos du rapport entre problème et concept.
La nature complexe de cette véritable «limite» de la pensée peut être approfondie davantage.
Définissons à nouveau le problème de l’image de la pensée, ou bien, plus précisément revenons à
insister sur le même problème. Demandons-nous si le rôle exercé par cette limite, par l’image de la
pensée donc, soit à son tour limité à empêcher à la pensée de penser autre que ce que la limite lui
permet de penser. Plus précisément, demandons-nous si une limite n’existe qu’en rapport à sa
fonction la plus notoire (celle de «limiter», d’«empêcher», de «borner», d’«interdire») ou bien si
elle ne puisse avoir d’autres fonctions.
Dans les Prolégomènes à toute métaphysique future (datant de 1783), par exemple, Kant propose
une double signification de «limite»
17
. Le dernier chapitre des Prolégomènes, intitulé « De la
16
La «pensée du dehors», ou «philosophie du dehors», qui relie Deleuze à deux autres penseurs français (Blanchot et
Foucault) et dont les origines sont envisageables dans la philosophie de Heidegger, est un thème si complexe qu’elle
mériterait une réflexion autonome. Il faut donc vous renvoyer aux textes intéressants de ces deux auteurs, auxquels
Deleuze se réfère explicitement L’entretien infini (notamment le premier chapitre) de Blanchot et le petit texte –paru
dans Critique- que Foucault dédia à Blanchot en 1966, qui s’intitule justement La pensée du dehors.
17
Cf. I. KANT, Prolégomènes à toute métaphysique future, trad. fr. de L. Guillermit, Vrin, Paris 1986, pp. 130-131.
C’est en ce texte que, entre autres, on peut trouver la célèbre phrase kantienne sur Hume : «celui qui interrompit [...]
mon sommeil dogmatique». Kant, en effet, estime dans ce texte, plus que dans la Critique de la raison pure, de
reconnaître ses mérites à Hume en tant que le premier philosophe qui a introduit la compréhension purement
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%