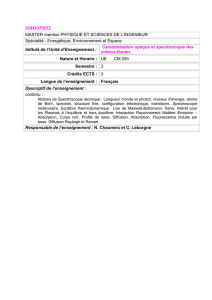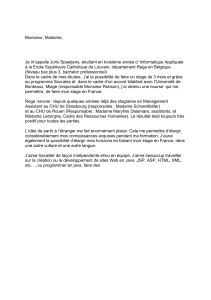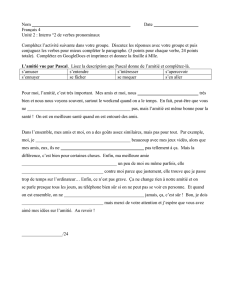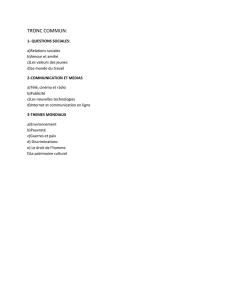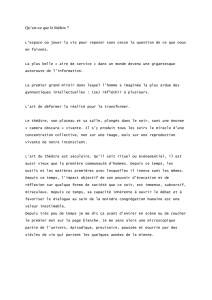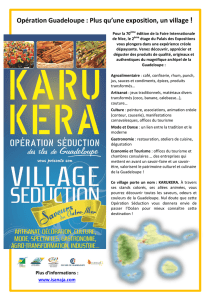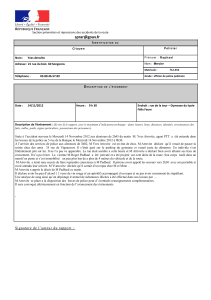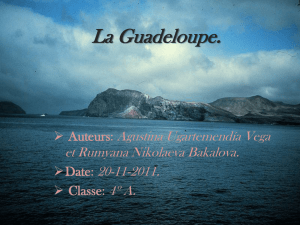Inauguration du Lycée Yves LEBORGNE, 3 mai 2014 Madame la

!
1!
Inauguration du Lycée Yves LEBORGNE, 3 mai 2014
Madame la Préfète de Région,
Monsieur le Président du Conseil Régional,
Monsieur le Recteur d’Académie,
Monsieur le Maire de Sainte-Anne,
Monsieur le Proviseur du Lycée Yves Leborgne, cher Christian Louis,
Mesdames, Messieurs,
Chers lycéennes et lycéens,
Chers Amis,
C’est un honneur et une émotion particulière que de participer à la
dénomination de ce lycée qui est celui de ma commune et qui portera
dorénavant le nom d’Yves Leborgne qui fut, comme certains ici le
savent, mon ami et mon maître.
Je voudrais dire pour commencer aux jeunes qui sont là, lycéennes et
lycéens, qu’ils ont la chance de nommer ainsi leur lycée, et je suis
assuré qu’il sauront le dire avec fierté.
Yves Leborgne est né à quelques pas d’ici, à Bois Jolan, le 17 octobre
1927.
1927, c’est aussi l’année de naissance de Gabriel Garcia Marquez, de
Gunther Grass, c’est l’année où a lieu à New York le quatrième congrès
panafricain. On ne sait pas encore que la guerre et le fascisme
viendront, le pétainisme, Sorin.

!
2!
L’enfance, c’est la pauvreté dignement affrontée dans une famille où le
père est paysan indépendant comme Leborgne le désigne lui-même.
Père dont la mort précoce et tragique l’enleva à son affection. C’est le
lent apprentissage du lien qu’il ne perdra jamais avec la terre et qui
décida de son amour pour les paysans de son pays, les germinations,
les floraisons. Sans cet amour-là, on tourne le dos à l’histoire de ce pays
et à cette tradition avec laquelle rompre serait, selon lui, une trahison.
Quand il parlait de Virgile, et des Géorgiques, c’était pour dire que Virgile
le poète lui avait appris que trahir la terre, que trahir sa terre, c’était trahir
ce pays et sa propre histoire qui depuis le marronage avait conduit
jusqu’au temps où il vivait. Il disait des paysans qu’ils étaient ainsi les
héritiers du courage des marrons.
Rappelons-nous, 1927, c’est l’année de la mort d’Achille René-Boisneuf
qui fut fils d’un esclave affanchi. L’esclavage n’est donc pas très loin
dans les tracées de l’histoire de la Guadeloupe.
Leborgne assumait cette nostalgie pour ce qu’il pensait être les beautés
de la tradition. Il disait, les yeux encore écarquillés par les souvenirs
d’enfance, le plaisir et l’admiration qu’il avait à regarder son grand-père,
dressé sur ses étriers, faisant danser son cheval Pierrot.
Je n’insiste pas ici pour seulement reprendre une part de sa propre
enfance, mais pour marquer ce qui fut probablement une de ses
premières et une de ses plus insistantes fidélités, la fidélité à la
paysannerie et à la terre. Quiconque l’a aperçu loin des salles de cours
et des tréteaux politiques, tenter de tirer quelque sève de la terre de
Petit-Havre ou construire avec une infinie patience des murets de pierres
sèches, l’aura aussitôt appris.
Il faut savoir la rareté de cette époque. La rareté des livres, la difficulté
d’accès à la lecture. La rareté et la joie d’avoir accès à un texte, à

!
3!
quelques lignes volées à une revue, et à cette chance au lycée d’avoir,
enfin, une bibliothèque, un programme. Son père avait appris des pages
entières de Gil Blas de Santillane, et c’est ainsi qu’il rencontra Lesage,
le premier auteur dont il aura lu un roman,—un grand roman picaresque.
On voit comment nait la gourmandise, et sans doute cette promesse
d’élévation et de culture qui décida de ses persévérances et de
l’attention qu’il porta toujours aux humanités.
Il quittera l’île en 1946, ayant obtenu le Brevet de Capacité Coloniale afin
d’entreprendre ses études de Lettres et de Philosophie.
Cet après guerre donna forme à un engagement politique dont on
apercevait les prémices dans les oppositions lycéennes que le pays
vivait tandis que l’idéologie pétainiste tissait ses filets.
Alors que je lui demandais si son entrée en politique pouvait être dite
ainsi d’enfance et de campagne, il me répondit sur un ton à la fois serein
et désabusé : « oui. Je crois que je ne pouvais être d’un autre côté que
celui que j’ai choisi. Il y a une cohérence, une logique, j’allais dire
presqu’une fatalité de mon adhésion à un certain moment au Parti
Communiste. Comme il y a une logique et une nécessité de ma rupture
avec ce Parti. »
Ainsi commença une participation longue et parfois mouvementée à la
vie politique depuis la présidence de l’AGEG, la participation aux
Assemblées mondiales de la jeunesse, le Front Antillo-Guyanais, le
départ du Parti Communiste. Mais une biographie complète devra dire et
expliquer.
Une date pourtant mérite d’être gardée, car elle changea le cours de sa
vie et participa à la construction de son identité.
1961, expulsion de la Guadeloupe de fonctionnaires au motif que leur
présence était susceptible de trouble l’ordre public. Ordonnance née du

!
4!
cerveau de Michel Debré, l’année précedente à propos des affaires
algériennes. Ainsi soudain, en Guadeloupe comme en Martinique, il
fallait partir, au loin, sans délai et sans recours. Ce qui fut un exil n’aura
pas entamé l’homme et aura construit davantage sa fierté et son sens de
l’honneur. Son engagement se renforça par la conscience de l’injustice
et par la certitude que seule l’opposition lui permettrait d’obtenir ce qu’il
souhaitait : le retour au pays natal.
Il écrivait à Max Lancrerot, un de nos condisciples, depuis la Corse où il
avait trouvé pourtant un chaleureux et amical accueil, ceci que je vous
lis : « l’exil m’aura appris ces chemins hautains par où avancent l’orgueil
d’un peuple, sa force, son triomphe ». Sur nos cahiers d’écolier nous
avions inscrit cette phrase.
Après avoir quitté la Corse, en 1967, pour Cannes, il comprit que pour
retrouver les petits matins de son île, il faudrait autre chose qu’une
protestation, que des interventions, que des pétitions. Il faudrait quelque
chose qui dise la gravité de l’acte d’expulsion dont il avait été victime,
quelque chose qui le mettrait, lui, aux limites de ce qui est possible, là où
il est question de la mort et de sa nudité flagrante et décisive. Il n’y avait
rien d’autre à opposer que cela, dans l’extrême gravité de l’acte. Le 22
novembre 1971, à Cannes où il enseignait, il commença dans sa classe
de philosophie une grève de la faim qui dura 11 jours.
Alors et seulement alors, il put revenir ici, à la Guadeloupe, reprendre sa
tâche interrompue.
J’ai devant les yeux son allure et ses mains, sa moustache lissée
lentement du doigt et l’ironie de son sourire. Il parle.
Ce qui a lieu chaque fois c’est cette exigence de présenter une pensée
qui s’élabore et se risque devant ses élèves, à la fois dans la liberté et la
rigueur. On reconnait dans cette façon de tenir le langage, non une

!
5!
habileté mais une conquête chaque fois indispensable. Ainsi Yves
Leborgne, professeur de philosophie, soumettait à sa propre raison et à
celle de ses jeunes élèves l’expérience qu’il faisait devant eux de sa
pensée. Et il transmettait ainsi non simplement des contenus mais ce qui
était plus essentiel et qui décide du reste: il transmettait une attitude.
Celle qui permet d’affronter des problèmes ou des situations qui nous
sont inédites.
Eduquer, c’est donc inscrire l’homme en l’enfant, le citoyen libre dans
l’homme, et ce n’est possible que si l’on accepte de penser que la liberté
implique que nous soumettions le jugement, tous les jugements, y
compris les nôtres, à l’examen et au consentement de la raison. L’enfant,
l’adolescent doit donc apprendre la liberté, et Leborgne pensait qu’il y
avait là une tâche difficile et noble qui tourne le dos à l’obéissance
servile, craintive, automatique, qui applique sans rien examiner.
Le devoir de l’élève est d’apprendre. C’est, pour ainsi dire, son métier. Le
devoir de Leborgne c’était la sévérité et l’attention affectueuse, la
vigilance sourcilleuse et l’ironie qui éveille et retient, l’impossibilité
finalement de s’enfuir devant la sommation d’étudier.
Dans une conférence pour la Mutuelle Générale de l’Education nationale,
Leborgne appelant qu’une vaillance nouvelle porte aux études citait
Césaire et son Roi Christophe : « Plus de travail, plus d’enthousiasme,
écrit Césaire, un pas, un autre pas et tenir gagné chaque pas. C’est
d’une retombée jamais vue que je parle, Messieurs, et malheur à celui
dont le pied flanche. »
C’est cette remontée qui le guida donc ensuite et encore, à l’Ecole
Normale de Cayenne en 1982, et enfin de de 1986 à 1993, à la direction
du CRDP à Fort-de-France.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%