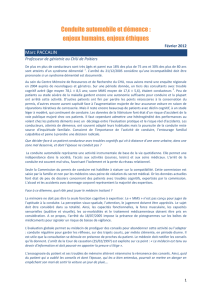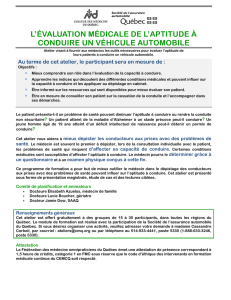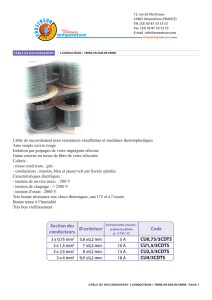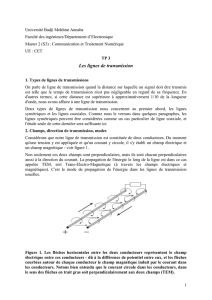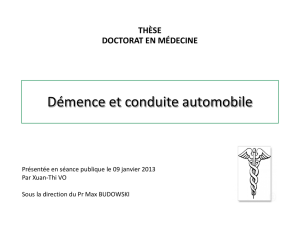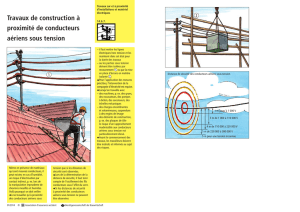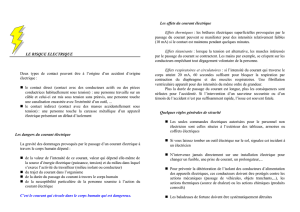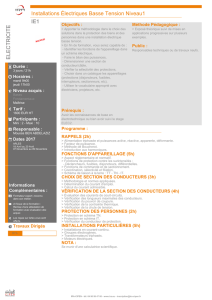La démence et la conduite automobile

Même si ce cas est hypothétique,
il ne peut que donner froid
dans le dos aux médecins qui
autorisent le renouvellement du
permis de conduire d'un patient âgé.
Aujourd'hui, la plupart des médecins
sont un peu plus sensibilisés à la
fréquence accrue des accidents d'au-
tomobile impliquant des conducteurs
âgés. Pourtant, selon les statistiques
individuelles, cette catégorie de con-
ducteurs a relativement peu d'acci-
dents, ce qui peut étonner. Toutefois,
lorsqu'on tient compte du nombre de
kilomètres parcourus, le taux d'acci-
dent des conducteurs de plus de
70 ans est égal ou supérieur à celui
des jeunes conducteurs de 16 à
24 ans – un groupe à risque élevé1,2.
Ces accidents ont des conséquences
graves, et la fréquence des trauma-
tismes est en hausse chez les conduc-
teurs âgés.
Facteur de vieillissement
Le vieillissement entraîne des
changements nombreux et bien défi-
nis des aptitudes physiques et psy-
chiques nécessaires à la conduite d'un
véhicule automobile. Cependant, la
plupart des experts reconnaissent
qu'il est peu probable que les change-
ments liés au vieillissement normal
expliquent les accidents d'automobile
impliquant des conducteurs âgés. Il
est beaucoup plus vraisemblable que
ce soit des conditions médicales liées
au vieillissement ou les traitements
médicaux qui diminuent la compé-
tence d'une personne à conduire.
En 1996, le ministère des
Transports de l'Ontario avait montré
que l'un des deux facteurs de risque
les plus utiles pour prévoir l'implica-
tion d'un conducteur âgé dans un
accident d'automobile au cours des
cinq dernières années était la pré-
sence d'au moins une maladie3. En
général, cependant, le fait d’être
atteint d’une maladie n'empêche pas
une personne âgée d'obtenir un
permis de conduire. Diverses affec-
tions qui augmentent le risque d'un
accident causé par la faute du
14 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001
La démence et la conduite automobile
par Peter N. McCracken, M.D., FRCPC, Jean A. Caprio Triscott, M.D., CCFP, FAAFP
(gériatrie), et Allen R. Dobbs, Ph. D.
Le Dr McCracken est codirecteur
du département de gériatrie et
professeur de médecine à
l'Université de l'Alberta, à
Edmonton en Alberta.
CAS HYPOTHÉTIQUE
Vous êtes le médecin de famille de monsieur J. P. depuis
20 ans. Il a 86 ans et sa santé est plutôt bonne, puisque ses
antécédents médicaux incluent seulement l'hypertension
légère, l'arthrose des genoux et un ulcère gastroduodénal.
Il y a 12 ans, vous l'avez adressé à un chirurgien général
pour une cholécystectomie élective; le patient a très bien
toléré cette intervention chirurgicale. Vous avez toujours
pensé que cet homme était en bonne santé étant donné que
ses visites à votre bureau avaient principalement pour but
d'obtenir l'attestation nécessaire au renouvellement de
son permis de conduire. En général, ses visites étaient
brèves et ne révélaient rien de préoccupant au sujet de son
état de santé.
Le traitement actuel de monsieur J. P. inclut l'hy-
drochlorothiazide (HCTZ), un comprimé tous les
matins, le rofécoxib, 25 mg par jour, pour soulager
l'arthrose, et le lorazépam, 1 mg par jour, au coucher.
Le patient prend ces trois médicaments depuis au moins
sept ans, et vous n'avez jamais hésité à renouveler les
ordonnances.
Un dimanche soir, vous recevez un appel du service d'ur-
gence de votre hôpital vous annonçant que monsieur J. P. a
été impliqué dans un grave accident d'automobile. Il a
survécu, mais il est semi-comateux. Il a heurté une autre
voiture en faisant un virage à gauche. Les deux véhicules
sont gravement endommagés, presque une perte totale, et
l'autre conducteur a subi un traumatisme crânien.
Vous vous rendez rapidement à l'hôpital pour examiner
le patient. À votre arrivée, vous rencontrez le fils de
monsieur J. P. dans le corridor. Dans un excès de colère
qui vous étonne, il affirme qu'il vous a téléphoné il y a
neuf mois parce qu'il craignait que son père ne soit plus
apte à conduire une automobile. Il ajoute que sa sœur a
laissé un message à votre secrétaire il y a six mois pour
signaler la détérioration de la mémoire et du jugement
chez son père ainsi qu'une diminution de son autonomie.
La famille de monsieur J. P. est bouleversée par cet acci-
dent, et son fils vous demande comment vous avez pu
autoriser le renouvellement du permis de conduire de son
père.

conducteur sont énumérées au
Tableau 1. Le risque le plus élevé est
la présence d'un trouble cognitif. Les
omnipraticiens doivent se rappeler
que plusieurs maladies peuvent al-
térer les aptitudes psychiques essen-
tielles à la conduite. Néanmoins,
aucune affection particulière ne s'est
révélée être un bon facteur de prédic-
tion de conduite automobile sécuri-
taire. De fait, Johansson4a comparé
le taux d'accidents chez les conduc-
teurs âgés en Finlande, un pays où la
loi exige un examen médical pour
obtenir le renouvellement du permis,
avec le taux d'accidents chez les con-
ducteurs âgés en Suède, où le renou-
vellement du permis n'est soumis à
aucune restriction. L'étude a révélé
que les taux étaient comparables dans
les deux pays, ce qui laisse supposer
que l'examen médical n'est pas telle-
ment efficace pour diminuer le
nombre d'accidents. En dépit de ces
données, la présence d'une affection
quelconque comme principal critère
pour déterminer l'aptitude d'une per-
sonne âgée à conduire une voiture est
encore utilisée. Il serait plus logique
de considérer ces maladies ainsi que
certains médicaments non pas
comme des critères absolus, mais
plutôt comme des signaux d'alarme
devant retenir l'attention du médecin.
Considérations démographiques
Au Canada, le taux de blessures
graves chez les conducteurs âgés de
65 ans ou plus a augmenté de 21 %
entre 1989 et 19995. Les statistiques
récentes sur les conducteurs âgés sont
encore plus inquiétantes, car les
blessures graves chez les jeunes con-
ducteurs ont diminué pendant cette
même période. En outre, les person-
nes âgées courent un risque plus grave
que les personnes jeunes d'être
blessées ou même tuées lors d'un acci-
dent d'automobile6,8; et lorsqu'elles
sont blessées, elles courent un risque
quatre fois plus grand d'être hospita-
lisées9. De même, leur convalescence
est plus longue, et leur guérison,
moins complète.
Dans quelles mesures les méde-
cins de famille doivent-ils s'inquiéter
du risque lié aux conducteurs âgés?
Quel est le rôle du médecin de famille
pour ce qui touche la protection de
l'autonomie et de l'indépendance du
patient en regard des risques pour la
santé et la sécurité publique? Quels
sont les outils offerts aux médecins
de famille pour évaluer l'aptitude à
conduire? Au Canada, existe-t-il des
lois pour obliger les médecins à si-
gnaler les conducteurs dont la capa-
cité à conduire est diminuée?
Le nombre de conducteurs âgés
devrait plus que doubler d'ici 2020.
On constate en effet que le nombre de
conducteurs âgés de plus de 70 ans
s'accroît plus rapidement par rapport
à tous les autres groupes d'âge. Non
seulement on compte un plus grand
nombre de conducteurs âgés sur les
routes, mais ces personnes con-
duisent plus souvent et jusqu'à un âge
plus avancé, où le risque d'accident
est très élevé10. En supposant que les
taux actuels de mortalité liés aux
accidents demeurent les mêmes, on
peut dire que le nombre de décès chez
les conducteurs âgés en 2030 sera
trois ou quatre fois plus grand qu'en
1995. Ce taux serait plus élevé que
celui des décès causés par des con-
ducteurs dont les facultés étaient
affaiblies par l'alcool en 199511.
Démence et conduite automobile
En 1995, la Société Alzheimer du
Canada a créé un groupe de travail
sur l'éthique pour examiner la déli-
cate question de la démence et de la
conduite automobile. Ce groupe était
composé d'experts des domaines de la
médecine, du droit, de la recherche,
de l'éthique et de la prestation des
soins. Un projet de lignes directrices
sur les questions délicates a été
élaboré et soumis sous forme de
questionnaire à un vaste échantillon-
nage de personnes concernées. Cette
enquête a permis de récolter plus de
500 réponses. La compétence à
conduire une automobile a été la
deuxième question pour laquelle le
groupe d'experts a reçu le plus grand
nombre de réponses, ne cédant le pas
qu'à l'épineux problème de l'annonce
du diagnostic de la maladie d'Alzhei-
mer. Le problème de la conduite
automobile était considéré comme
une question délicate parce qu'il
n'existait aucune méthode efficace
pour évaluer la compétence d'un
patient à conduire.
La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001 • 15
En outre, les personnes âgées courent un risque plus
grave que les personnes jeunes d'être blessées ou
même tuées lors d'un accident d'automobile6,8; et
lorsqu'elles sont blessées, elles courent un risque
quatre fois plus grand d'être hospitalisées9. De même,
leur convalescence est plus longue, et leur guérison,
moins complète.
Tableau 1
Facteurs de risque d'accidents
causés par les conducteurs
âgés
Facteur de risque Risque relatif
Diabète 2,2
Maladie vasculaire 1,8
Maladie pulmonaire 2,1
Maladie psychiatrique 2,5
Maladie neurologique 5,1
Trouble cognitif 7,6
Adaptation de DILLER E. et coll. NHTSA
Technical Report HS 809023, Washington,
199819.

16 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001
Après avoir analysé les réponses,
le groupe a élaboré la version finale
des Lignes directrices sur l'éthique –
Sujets délicats, document publié en
1997 par la Société Alzheimer du
Canada.
Ces lignes directrices soulignent
l'importance de surveiller la compé-
tence d'un patient à conduire et
recommande que « s'il est clair que
conduire est dangereux, il faut retirer
tout accès au véhicule immédiate-
ment. » On peut y lire aussi que le
diagnostic de la maladie d'Alzheimer
(ou de toute autre démence) ne signi-
fie pas automatiquement que la per-
sonne est incapable de conduire.
Même si les lignes directrices
réitèrent l'importance de surveiller et
d'évaluer l'aptitude des patients à
conduire, l'absence d'instruments
appropriés pour le faire est largement
reconnue. Cette lacune place les
médecins et les autres intervenants
dans une position très difficile.
Statu quo
Dans certaines provinces, la loi
oblige le médecin à surveiller et à si-
gnaler l'inaptitude de leurs patients à
conduire une automobile12. Dans
d'autres, les médecins doivent effec-
tuer un examen médical pour vérifier
l'aptitude à conduire en tenant
compte de l'âge du patient ou d'autres
critères. Il n'existe cependant aucun
consensus sur l'instrument à utiliser
avec les personnes atteintes de
démence ou d'autres troubles cogni-
tifs. L'instrument le plus souvent
recommandé est le mini-examen de
l'état mental (MMSE)13. Cette
recommandation est déconcertante,
compte tenu des résultats d'études
rétrospectives ayant montré que le
MMSE est très peu utile pour ce
genre d’évaluation parce qu'il se
révèle un piètre prédicteur du risque
d'accident14-17. En effet, lorsqu'on a
comparé les scores MMSE à la per-
formance à l'examen de conduite, les
corrélations ont la plupart du temps
été dans la plage de 0,5 à 0,6. À ce
degré de corrélation, le MMSE
explique moins de 40 % de la va-
riance, et c'est donc un instrument
inadéquat pour aider à prendre une
décision au sujet d'un patient donné.
Beaucoup de médecins présument
qu'il suffit d'orienter les patients
atteints de troubles cognitifs et de
démence vers les agences gouverne-
mentales chargées de délivrer les
permis de conduire pour savoir si le
patient est apte ou non à conduire un
véhicule automobile. Malheureuse-
ment, ces examens pratiques ne sont
pas efficaces pour mettre en évidence
l'inaptitude à conduire chez ces per-
sonnes. Cette lacune s'explique sans
aucun doute par le fait que les exa-
mens pratiques sont conçus pour
évaluer les aptitudes de base qui, chez
un conducteur expérimenté, sont
presque des réflexes. Ces aptitudes
réflexes sont souvent préservées,
même lorsque les facultés mentales
diminuent. Il faut mentionner que,
dans certains centres urbains, des
méthodes spécialisées d'évaluation de
l'aptitude à conduire ont été éla-
borées, mais il faut déplorer qu’elles
sont surtout axées sur les handicaps
physiques et sur les modifications à
apporter aux véhicules pour faciliter
la conduite, plutôt que sur l'évalua-
tion de la compétence d'une personne
souffrant d'un trouble cognitif.
Méthodes efficaces pour évaluer
l'aptitude à conduire
Il y a plus de 10 ans, le Dr Allen Dobbs
et ses collègues étaient déjà convaincus
de l'importance primordiale d'évaluer
l'aptitude d'un patient à conduire une
automobile. De concert avec des mé-
decins, des neuropsychologues et des
thérapeutes en réadaptation du pro-
gramme Northern Alberta Regional
Geriatric (NARG), le Dr Dobbs a tra-
vaillé à élaborer une méthode d'évalua-
tion efficace. Les étapes de cette
recherche menée sur plusieurs années
et fondée sur les examens pour évaluer
des conducteurs âgés incluent :
1. L'élaboration d'une consultation
clinique pour évaluer l'aptitude
des patients à conduire une auto-
mobile.
2. Le recrutement de partenaires
(NARG, Association canadienne
des automobilistes [CAA-Alberta],
adjoint du ministre de la Justice de
l'Alberta, ministère de la Santé et
du Bien-être social de l’Alberta,
l'Alberta Transportation and Utili-
ties et la Ville d'Edmonton) pour
mettre sur pied un programme de
recherche en collaboration.
3. L'élaboration d'une méthode d'éva-
luation autonome à double volet :
i) test de dépistage de l'aptitude à
conduire; ii) examen pratique pour
rechercher les erreurs de conduite
témoignant de la diminution de
l'aptitude à conduire.
4. La validation du test de dépistage
de l'aptitude à conduire et de l'exa-
Beaucoup de médecins présument qu'il suffit
d'orienter les patients atteints de troubles cognitifs et
de démence vers les agences gouvernementales
chargées de délivrer les permis de conduire pour
savoir si le patient est apte ou non à conduire un
véhicule automobile. Malheureusement, ces examens
pratiques ne sont pas efficaces pour mettre en
évidence l'inaptitude à conduire chez ces personnes.

men pratique auprès d'un nouvel
échantillon de conducteurs âgés.
Peu après le début de cette étude,
le groupe du Dr Dobbs a découvert
que le principal obstacle à l'évalua-
tion d'un conducteur était l'absence
d'information sur les différents types
d'erreurs de conduite. Il a donc mo-
difié l'hypothèse de départ comme
suit : toutes les erreurs de conduite ne
témoignent pas nécessairement d'une
diminution de l'aptitude à conduire.
Toujours selon cette hypothèse, cer-
taines erreurs reflètent parfois sim-
plement de mauvaises habitudes chez
des conducteurs par ailleurs compé-
tents. Par conséquent, avant de passer
à l'examen pratique, il importe de
démontrer de façon empirique les
erreurs qui témoignent d'une diminu-
tion de l'aptitude à conduire et celles
qui témoignent simplement de mau-
vaises habitudes. Ces chercheurs ont
donc élaboré des méthodes de com-
paraison pour étudier l'aptitude à con-
duire de centaines de conducteurs
présentant des troubles de santé (par
rapport à des conducteurs témoins en
bonne santé). Il fallait comparer la
performance de conducteurs poten-
tiellement dangereux avec celle de
conducteurs témoins, puisque les
patients atteints de démence cons-
tituent un groupe de conducteurs dan-
gereux. En effet, la documentation
médicale cite de nombreuses études
démontrant le nombre accru d’acci-
dents d'automobile impliquant des
conducteurs atteints de démence14,18.
Il était donc évident que comparer les
erreurs qui permettraient de dis-
tinguer un groupe de l'autre serait
utile pour élaborer un examen pra-
tique visant à évaluer l'aptitude à con-
duire d'une personne.
Toutefois, les examens pratiques
sont, en plus d'être coûteux, dan-
gereux lorsque le conducteur est
inapte à conduire, et ils sont inutiles
si le conducteur est compétent. Pour
ces raisons, le deuxième objectif de
l'étude était de diminuer le coût et
d'accroître la sécurité des examens de
conduite. Le groupe de recherche a
alors élaboré un test de dépistage des
aptitudes permettant de prévoir avec
exactitude la performance à l'examen
pratique, du moins pour les conduc-
teurs les plus compétents et les con-
ducteurs les plus dangereux. Cette
démarche avait pour but de concevoir
un test de dépistage établissant
deux points limites. Le point limite
supérieur définissait le niveau de per-
formance nécessaire pour prévoir
avec exactitude la réussite de l'exa-
men pratique. Le point limite
inférieur définissait le niveau de per-
formance sous lequel on pouvait
prédire avec exactitude l'échec à
l'examen pratique. Les erreurs de
conduite ont été classées par la suite.
On a ainsi établi 12 catégories
d'erreurs précises (par exemple la
position pour amorcer un virage, la
signalisation, la vitesse) ainsi qu'une
catégorie d'erreurs dangereuses ou
potentiellement désastreuses. Ces
dernières correspondaient à des situa-
tions où les autres conducteurs
devaient s'ajuster à la manœuvre
effectuée ou l'examinateur devait
prendre le contrôle du véhicule pour
éviter une collision ou une situation
dangereuse. On a ensuite déterminé
la fréquence et la gravité des erreurs
dans chaque catégorie et on a analysé
les résultats pour chacun des
trois groupes :
1) Les résultats au-dessus du point
limite supérieur.
2) Les résultats sous le point limite
inférieur.
3) Les résultats intermédiaires.
Ces comparaisons ont permis de
définir trois groupes d'erreurs de
conduite.
Dans le premier, on a classé les
erreurs non discriminantes parce
qu'elles étaient faites à la fois par les
conducteurs compétents et les con-
ducteurs incompétents. Ces erreurs
La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001 • 17
Tableau 2
Évaluation de l'aptitude à conduire :
antécédents médicaux à surveiller
• Prise de médicaments (narcotiques, anticholinergiques, benzodiazépines,
psychotropes, antispasmodiques, antiparkinsoniens)
• Prise de drogues sans prescription (alcool ou substances illicites)
• Troubles de la vue (cataracte, glaucome, dégénérescence maculaire, rétinopathie
diabétique)
• Troubles de l'ouïe
• Troubles cardiovasculaires (anévrisme de l'aorte, arythmies, syndrome de dys-
fonctionnement sinusal, stimulateur cardiaque, changements orthostatiques de la
tension artérielle causant des étourdissements, infarctus du myocarde, angor
instable)
• Maladies vasculaires cérébrales (accident ischémique transitoire, accident vascu-
laire cérébral)
• Maladies du système nerveux (convulsions, apnée centrale du sommeil,
labyrinthite ou maladie de Ménière, maladie de Parkinson, démence, trauma-
tisme crânien ou hémorragie sous-durale, sclérose en plaques)
• Maladies respiratoires (maladie pulmonaire obstructive chronique, apnée
obstructive du sommeil)
• Troubles endocriniens et métaboliques (diabète, hyperparathyroïdie, hypothy-
roïdie, hyperthyroïdie, déséquilibre des électrolytes [p. ex. du sodium])
• Maladies psychiatriques (dépression, schizophrénie, trouble bipolaire, psychose)
• Maladies musculosquelettiques (arthrose, ostéoporose, arthrite rhumatoïde, neu-
ropathie périphérique)
• Maladies infectieuses (des voies respiratoires, des voies urinaires, SIDA)
• Antécédents de conduite (contraventions ou accidents de voiture)

témoignent des mauvaises habitudes
de conducteurs expérimentés, et non
pas d'aptitude moindre à la conduite.
Par conséquent, toute évaluation
fondée sur ce type d'erreurs comme
indicateurs de l'inaptitude à conduire
serait inappropriée.
Dans le second groupe d'erreurs
(position dans les virages, erreurs
d'observation), le score de gravité
permettait de distinguer de façon
fiable les conducteurs âgés souffrant
de troubles cognitifs et les conduc-
teurs témoins en bonne santé en plus
de différencier les conducteurs âgés
en bonne santé des conducteurs
jeunes en bonne santé. Ces erreurs
discriminantes sont définies comme
« potentiellement dangereuses » et
témoignent d'une diminution des
aptitudes à la conduite automobile.
Le troisième groupe d'erreurs (par
exemple s'engager à contre-sens sur
une autoroute, arrêter à un feu vert,
brûler un feu rouge) était composé
d'erreurs de critère. Ces erreurs
étaient observées seulement chez les
conducteurs présentant des troubles
cognitifs.
La définition de ces catégories
d'erreurs et la découverte qu'elles
étaient regroupées ont aidé à mieux
comprendre la signification des dif-
férents types d'erreurs de conduite.
Grâce à ces données, les chercheurs
ont pu élaborer une échelle d'évalua-
tion empirique valide et établir des
critères pour concevoir des parcours
qui mettraient en évidence les erreurs
discriminantes importantes. Ces ré-
sultats de recherche constituaient
également une base pour déterminer
les critères de conduite dangereuse.
Ces travaux ont permis de con-
cevoir une épreuve de dépistage com-
posée de tests à l'ordinateur. Pour
réussir ces tests, il faut de la
mémoire, du jugement, la capacité de
décision, l'attention, des aptitudes
motrices et de la rapidité, et il faut
pouvoir intégrer ces aptitudes ou être
en mesure de passer de l'une à l'autre.
Pour sa part, l'examen pratique se fait
sur un parcours spécial d'une durée
de 40 minutes. On utilise un véhicule
de classe intermédiaire, équipé d'une
boîte de vitesses automatique et d'un
double système de freinage. Les ma-
nœuvres à effectuer ont été conçues
pour mettre en évidence les erreurs de
conduite chez des conducteurs dont
la santé est compromise.
Pour valider l'utilité de ce test de
dépistage, les résultats doivent satis-
faire à deux critères :
1. Les scores au-dessus du point li-
mite supérieur et sous le point li-
mite inférieur doivent permettre de
prévoir avec exactitude le passage
et l'échec de l'examen pratique.
2. Les conducteurs qui obtiennent un
score intermédiaire sont ceux qui
doivent subir un examen pratique.
Ce groupe qui nécessite un tel
examen doit être significativement
réduit par rapport au total de
personnes initial.
Cette démarche en deux étapes est
maintenant appliquée dans quelques
centres au pays, dont quatre sont
situés en Alberta; ce sont les
DriveAble Assessment Centres. L'éva-
luateur n'a pas besoin de recevoir une
formation spéciale. D’autre part, le
test est difficile : de nombreuses per-
sonnes atteintes d'un léger trouble
cognitif présumé échouent l'examen.
Par conséquent, cette évaluation
enlève au médecin de famille le
fardeau d'avoir à prendre seul une
décision au sujet de l'aptitude à con-
duire de ses patients âgés.
Cependant, le coût de cette éva-
luation, payé par le patient ou ses
proches, est un sujet de controverse.
On continue à espérer que le gou-
vernement provincial couvrira un
jour les frais de cet examen.
La plupart des données statis-
tiques du programme de recherche
18 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001
Tableau 3
Examen physique ciblé pour l'évaluation de l'aptitude à conduire
Paramètre Tests
Vue Champ visuel, test de Snellen
Ouïe Test du chuchotement
Appareil cardiovasculaire Examen courant, électrocardiogramme au besoin,
tension artérielle posturale
Appareil respiratoire Examen courant, oxymétrie au besoin (test et exercice)
Appareil digestif Examen courant
Appareil musculosquelettique Amplitude des mouvements de la colonne cervicale,
résistance, tonus, mouvement en extension et en
flexion (épaules, poignets, chevilles, hanches et genoux)
Équilibre et démarche Test Get-up-and-go (le patient se lève de sa chaise,
reste debout, puis marche sur une distance de
trois mètres, revient et s'assoit)
Système nerveux central Examen courant, réflexes cérébelleux (épreuve doigt-
nez, talon-tibia), réflexe moteur des membres
supérieurs et inférieurs, proprioception, réflexe sen-
soriel
Fonction cognitive Mini-examen de l'état mental, en particulier le test des
pentagones et de l’horloge, praxie (capacité d'exécuter
une série de mouvements en réponse à un ordre),
gnosie (capacité d'identifier des objets), fonctions d'exé-
cution (parcours A et B), jugement, compréhension
Troubles psychiatriques Examen courant, échelle d'évaluation de la dépression
chez la personne âgée au besoin
Capacité fonctionnelle Évaluation de la diminution de la capacité à exécuter
les activités de la vie quotidienne et les activités ins-
trumentales (faire les courses, cuisiner, gérer l'argent)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%