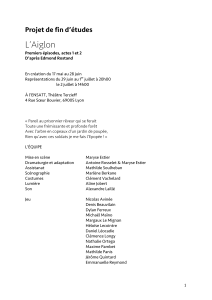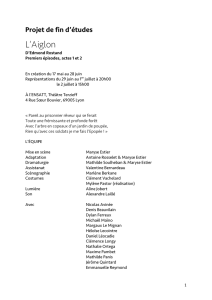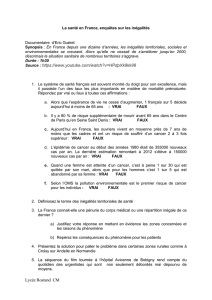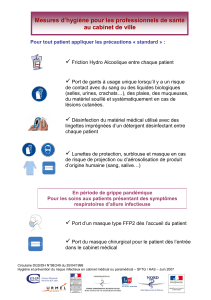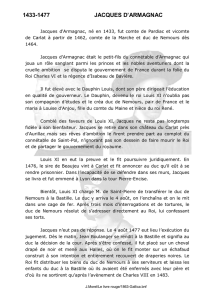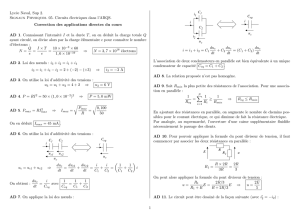LA PLANETE DU PETIT PRINCE

APPENDICE
ARANY János BERNHARDT Sarah
BERTHE de grand pied COUBERTIN de Pierre
DUMAS Alexande
ESZTERHÁZY famille
HAYDN Joseph Histoire de la langues francaise
HOMME AU MASQUE DE FER INNSBRUCK
KODÁLY Zoltán Migration des MAGYARS
Mont Saint Michel Pasteur Louis
Rostand Edmond Sainte Genevieve
Saint Étienne Saint-
ÉXUPERY Antoine
SÁRKÖZY famille SASFIÓK
SYLVESTRE II SZÉCSENYI famille

ARANY JÁNOS (1817-1882)
Figure dominante de la littérature hongroise de la seconde moitié du xixe siècle,
Arany, père du « classicisme national », pratiqua à la fois le genre épique et le genre
lyrique. Fidèle à la tradition politique qui régnait dans les lettres hongroises, il
s'efforça de ne servir que la cause du patriotisme, écartant ses problèmes personnels ;
mais ceux-ci transparaissent malgré tout à travers ses poèmes épiques. Ambiguïté du
genre qui reflète une dualité permanente de l'esprit : un rationalisme impérieux y
contrôle avec vigilance une sensibilité vulnérable, mais l'ironie, dirigée souvent
contre le poète lui-même, équilibre la mélancolie de la désillusion. Arany essaya de
résoudre ses drames intérieurs en les projetant dans des scènes et des personnages
historiques et folkloriques. Son œuvre, d'inspiration populaire, mais d'élévation
classique, contribua à préparer spirituellement la lutte d'indépendance de 1848-1849
et à en garder vivant le souvenir contre toute force, positive ou négative, qui tendait
à l'effacer. Né d'une famille de hobereaux retombée à la condition paysanne,
Arany se considérait comme le « rejeton du peuple qui vit avec sa souche, pour elle,
par elle ». Après avoir longtemps cherché sa voie, il débuta dans la littérature en 1845
par un poème satirique, la Constitution perdue (Elveszett alkotmány).
Mais l'œuvre qui le promut poète national fut TOLDI (1847). Son intention de créer
une littérature « nationale paysanne », base d'un futur classicisme, rejoignait celle de
l'élite intellectuelle et lui valut l'amitié de Petőfi. Toldi, le personnage principal du
poème, est un héros légendaire, dans la lignée de Bertrand du Guesclin ; il met sa
force fabuleuse au service de Louis d'Anjou de Hongrie. Arany emprunta l'intrigue à
la chronique médiévale d'Ilosvai : la fureur du désespoir conduit au meurtre un
jeune noble rejeté dans la condition paysanne par la jalousie de son frère ; après une
longue pérégrination, il sauve l'honneur de la chevalerie hongroise dans un duel
avec un Tchèque jusqu'alors invincible, et obtient ainsi le pardon du roi. Mais Arany
donne une actualité à ce thème en suggérant une symbolique nouvelle : Toldi est le
fils du peuple qui, victime de sa propre naïveté, ne trouve dans le monde la place
qu'il mérite qu'après avoir triomp […]

L'atmosphère de l'époque de la résistance passive s'harmonise avec la nature
mélancolique d'Arany ; sa renommée toujours croissante l'arrache bientôt à la
solitude et le conduit jusqu'au fauteuil de secrétaire général de l'Académie hongroise.
Après l'échec de la révolution de 1848, pour fuir le présent, il se tourne vers le
romantisme du passé, et, sous l'influence de Byron, commence de nombreux poèmes
épiques sur des sujets médiévaux qu'il ne termine pas.
Mais ses chefs-d'œuvre de cette époque sont les ballades (« tragédies en forme de
chant », comme disait un de ses critiques), reposant également sur des thèmes
médiévaux rendus actuels par la protestation patriotique contre l'oppression
étrangère. En 1864, il publie La Mort de Buda (Buda halála
).
Après une dépression qui dura douze ans, il recommence à écrire en 1877 dans le
calme de l'île Marguerite. Il publie L'Amour de Toldi (Toldi szerelme, 1879). La jeune
génération se détourne de sa poésie qu'elle juge démodée, mais son art n'en atteint
pas moins son sommet dans les ballades du recueil Fleurs d'automne (Őszikék) où, de
l'obscurité des croyances populaires, jaillissent des images tourmentées.

Bernhardt Sarah (1844-1923)
Sarah Bernhardt, de son vrai nom Henriette Rosine Bernhard, naît le 22 octobre
1844 à Paris.
Elle entre au Conservatoire en 1860 où elle débuta à la Comédie-Française en 1862
mais elle n'y resta pas longtemps puis joua ailleurs de petits rôles et chanta
l'opérette.
Sa vie personnelle été assez remplie : à 20 ans, elle a une liaison avec un noble
belge du nom de Charles-Joseph-Eugene-Henri, Prince de Ligne avec
qui elle eut son seul enfant. Son fils Maurice Bernhardt deviendra écrivain.
Par la suite, elle connaît plusieurs amants, également artistes comme Gustave Doré
et Georges Clairin ou des acteurs tels que Mounet-Sully et Lou Tellegen.
Elle est engagée à l'Odéon où elle remporte ses premiers succès et retourna à la
Comédie-Française en 1872. Son triomphe dans “Phèdre” la fit nommer sociétaire
en 1875. 8 ans plus tard, elle quitta avec fracas le Théâtre Français et commença sa
vie de tournées et de créations à Paris.
Elle parcourut l'Europe, les 2 Amériques et de 1891 à 1893, les 4 parties du monde.
À Paris, elle joua à l'Ambigu, à la Porte Saint-Martin, à la Renaissance, enfin, en
1899 au Théâtre des Nations dont elle devint directrice et auquel elle donna son
nom.
En 1882, elle se marie à Londres avec un acteur d'origine grecque, Aristides
Damala, mais il est dépendant de la morphine et leur relation ne dure pas. Elle
reste cependant son épouse légitime jusqu'à sa mort en 1889 à l'âge de 34 ans.

En 1900, Edmond Rostand lui apporte “L'Aiglon” et le cinéma fait appel à ses
services. Elle paraît dans une courte scène extraite d' “Hamlet” (1900) qu'elle avait
joué sur scène. Pierre Magnier lui donne la réplique et Clément Maurice les filme.
Mais il faut attendre le brusque essor du film d'Art pour retrouver Sarah incarnant
“La Tosca” (1909) aux côtés de Lucien Guitry.
Le cinéma était muet et l'on n'entendait pas sa voix d'or. Pourtant celle que
Rostand avait célébrée comme “Reine de l'attitude et princesse du geste” aurait pu
faire une carrière à l'écran.
Elle réussit à s'imposer grâce à la publicité colossale qu'elle orchestrait et qui
alerta un producteur américain /origine hongrois/ nommé Zukor.
Adolphe Zukor apprit en 1912 que le réalisateur français Louis Mercanton se
proposait de tourner “Les Amours De La Reine Elisabeth” qu'Emile Moreau venait
de fournir à la tragédienne et qui s'était soldé par un cuisant échec.
Zukor entrevit une combinaison fructueuse : il lancee sur le marché américain un
film de long métrage en misant sur la célébrité mondiale de l'actrice. Il se fit
réserver les droits pour 40 000 dollars et avança une somme qui permit à
Mercanton de reprendre son projet.
La publicité fut massive et le film triompha au Lyceum Theatre de New York.
Zukor avec “Les Amours De La ReinE Elisabeth” qui durait 90 minutes gagna son
pari : l'oeuvre de Mercanton fut le premier film de Famous Lasky qui devait
rapidement se transformer en Paramount. Quant à la vedette, un critique écrivit à
son sujet : “Bien qu'avoir joué devant la caméra ne puisse rien ajouter à la gloire de
Mme Sarah Bernhardt, les générations futures lui en seront reconnaissantes”.
Pendant la Grande Guerre, Sarah devenue âgée est amputée d'une jambe.
Elle entre dans la légende. Signoret lui donnait une réplique muette et la
cathédrale de Reims servait de fond de décor.
À 79 ans, elle commença son dernier film pour éponger des dettes. Mercanton
avait groupé autour d'elle Mary Marquet, Lili Damita, Harry Baur et François
Fratellini. Sarah tournait dans son hôtel du boulevard Péreire mais ne put achever
le film.
Jeanne Brindeau, qui fut un temps l'égérie d'Anatole France raccorda de dos les
scènes qui restaient à terminer et “La Voyante” (1923) marqua la conclusion d'une
carrière magnifiée par le théâtre et s'arrêtant sur le cinéma.
Sarah Bernhardt décède d'un empoisonnement urémique le 26 mars 1923 à Paris.
Le gouvernement voulait lui faire des obsèques nationales, ce fut finalement la
ville de Paris qui assura l'ordonnance de ses funérailles qui eurent lieu en
présence d'une foule immense et bouleversée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
1
/
83
100%