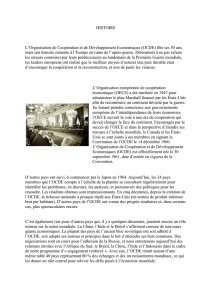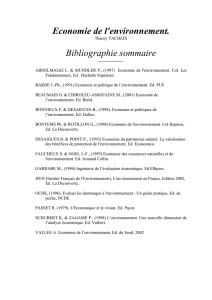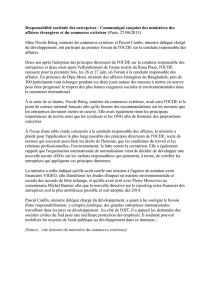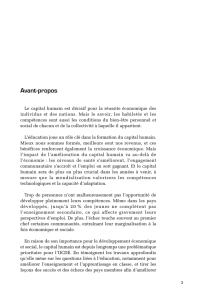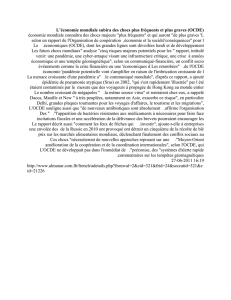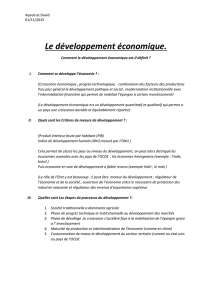Les débuts du Centre : une analyse personnelle

Sous la direction de
Jorge Braga de Macedo,
Colm Foy et Charles P. Oman
«
Retour
sur le développement
Études du Centre
de Développement

259
Chapitre 15.
Les débuts du Centre : une analyse personnelle
Chapitre 15
Les débuts du Centre :
une analyse personnelle
Angus Maddison1
La suggestion de créer le Centre de Développement de l’OCDE revient au
président Kennedy, qui la formule lors d’une allocation au Sénat et à la Chambre
des communes du Canada, en mai 1961. Cette proposition est approuvée par le
conseil de l’OCDE en octobre 1962 et le Centre commence à fonctionner à la
mi–1963. Le Centre de Développement jouera un rôle déterminant dans la
transition de l’OECE à l’OCDE. L’OECE traduisait l’effort de coopération de 16 pays
d’Europe de l’Ouest désireux de promouvoir la reprise et l’expansion de leurs
économies entre 1948 et 1961. L’OCDE vise un objectif supplémentaire :
encourager la croissance des pays « les moins avancés » d’Afrique, d’Amérique
latine et d’Asie en stimulant les entrées de capitaux (responsabilité qui incombe
à la Direction de la Coopération pour le développement de l’OCDE) et en
prodiguant des conseils sur la formulation et la mise en œuvre de politiques
économiques (mission attribuée au Centre). La nouvelle organisation élargit le
cercle de ses membres pour accueillir le Canada, les États–Unis et le Japon (le
Canada et les États–Unis étaient déjà membres associés de l’OECE).
Trois grandes raisons motivent ces changements. Le constat, tout d’abord,
d’une croissance beaucoup plus rapide en Europe que dans le reste du monde
dans les années 50. Les écarts de revenu, déjà importants, entre les pays riches et
les autres ne font que se creuser. Les États–Unis (qui envoient des flux massifs
d’aide à l’Europe en 1948–52) poussent les pays d’Europe de l’Ouest à aider les
pays en développement ou à augmenter leur aide. Tous ont aussi le sentiment que
l’expérience de l’OCDE en matière de libéralisation des échanges, de promotion
de la croissance et de distribution de l’aide au titre du plan Marshall peut être utile
aux pays pauvres. La deuxième raison tient au fait que la décolonisation est en
passe de s’achever en Afrique et en Asie. Ces régions veulent élargir leurs relations
internationales et l’on pense que l’OCDE doit encourager ce processus. Enfin, la
rivalité entre les nations occidentales et le bloc sino–soviétique s’accentue. L’URSS
et la Chine s’efforcent par tous les moyens de se faire des amis et des alliés dans les

260
Retour sur le développement
pays en développement en apportant une assistance technique, financière et
militaire. De nombreux pays nouvellement indépendants rejoignent le groupe des
non–alignés (emmené par l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique et la Yougoslavie),
qui souhaitent conserver leur neutralité vis–à–vis de l’Est et de l’Ouest.
A cette époque, les flux de capitaux privés sont peu abondants et les ONG
marginales. C’est pourquoi le financement public a une telle importance. Sur
l’initiative de l’administration Eisenhower, un Groupe d’aide au développement
est créé afin de préparer le terrain au Comité d’aide au développement (CAD) de
la nouvelle organisation.
Ce Groupe d’aide au développement se compose de douze pays d’Europe,
du Canada, des États–Unis et du Japon. Il se réunira à cinq reprises, à Washington
(mars et octobre 1960), à Bonn (juillet 1960), à Londres (mars 1961) et à Tokyo
(juillet 1961). Je suis alors le secrétaire du groupe, dont la première mission
consiste à mettre en place un système complet de comptes–rendus statistiques
permettant de suivre les divers flux de moyens de financement en direction des
pays en développement (prêts et dons publics, crédits privés, achats obligataires,
investissements direct et en actions, garanties de crédit à l’exportation, etc.), qui
sont appelés à se développer, et en provenance de chaque pays membre. La
plupart des pays n’ont pas de vision globale de ces flux. Une évaluation grossière
est possible à partir des données des balances des paiements, mais il faut solliciter
les banques centrales, les ministères des Finances, les organismes de crédit à
l’exportation, la Banque mondiale et le FMI pour parvenir à décomposer ces flux
en différentes catégories. Les résultats sont souvent surprenants : ainsi, les flux en
provenance de la France sont proportionnellement largement supérieurs à ceux
émanant des États–Unis ; en revanche, et cela ne surprend personne, l’Allemagne,
le Japon et la Scandinavie envoient des sommes relativement faibles. La première
enquête, portant sur Les flux financiers destinés aux pays sur la voie du
développement économique, est réalisée en un temps record et publiée en avril
1961. Elle fixe les grandes lignes directrices qui sont utilisées encore aujourd’hui
par le Comité d’aide au développement pour collecter des données auprès de
ses pays Membres.
Une seconde enquête est présentée lors de la cinquième réunion du Groupe
d’aide au développement à Tokyo, en juillet 1961. Elle met en évidence les
différents types de flux financiers destinés à 60 pays et propose certains
indicateurs : croissance et niveau du PIB, formation intérieure de capital et épargne,
poids de la dette publique, recettes des exportations, taux d’alphabétisation et
démographie. Nous disposons là d’un outil fondamental pour l’analyse du rôle
de l’aide et des flux de capitaux dans le développement économique, même s’il
est évident que cette enquête doit être suivie d’une analyse plus détaillée de
l’efficience de la politique économique dans la répartition des ressources, tâche
que les fondateurs pensent confier au Centre de Développement.

261
Chapitre 15.
Les débuts du Centre : une analyse personnelle
La troisième mission du Groupe d’aide au développement consiste à
concevoir une procédure analytique permettant d’évaluer le bien–fondé et
l’efficacité de l’effort d’aide des pays donateurs.
Le Centre de Développement a été créé afin de mieux comprendre les
politiques des pays en développement et d’agir comme intermédiaire
« conceptuel » entre ces derniers et l’OCDE. Aux termes de son mandat, il doit
« rassembler les connaissances et l’expérience des pays participant tant sur le
plan du développement économique que de la formulation et de l’exécution des
politiques économiques générales, les adapter aux besoins des pays ou des régions
en voie de développement économique et mettre les résultats, par des moyens
appropriés, à disposition des pays concernés ».
C’est Carl Kaysen, de la Maison– Blanche, qui soumet au Groupe d’aide au
développement réuni à Tokyo la proposition de l’administration Kennedy de créer
le Centre. Cette proposition est le fait d’Edward Mason, fondateur du Service de
conseil en développement de l’université d’Harvard, et de David Bell, directeur du
premier groupe de Harvard au Pakistan, avant qu’il ne prenne la direction de l’AID
(USAID) à Washington. Le Secrétaire général de l’OCDE, Thorkil Kristensen (1899–
1989), très enthousiasmé par l’idée, constitue un groupe d’experts (composé de
Roger Grégoire, P.S. Lokanathan, Edward Mason et Jan Tinbergen) censé donner
des conseils sur la structure du personnel et les domaines de recherche.
M. Kristensen souhaite que le président du Centre soit un universitaire de renom.
Robert Buron (1910–72) est le premier président du Centre. Ce député MRP
(démocratie chrétienne) français compte de nombreuses relations dans les pays
en développement. Il avait occupé entre 1950 et 1962, sous les quatrième et
cinquième Républiques, neuf postes ministériels ; il fut notamment ministre de
la France d’Outre–Mer sous Mendès France, en 1954–55, et ministre des Travaux
publics et des transports, de 1958 à 1962. Il avait participé aux négociations sur
le retrait de la France d’Indochine et d’Algérie. Il compte parmi ses amis les
présidents Eduardo Frei (Chili), Félix Houphouët–Boigny (Côte d’Ivoire) et Ahmed
Sékou Touré (Guinée), ainsi que le Premier ministre iranien Amir Abbas Hoveyda.
Il s’intéresse particulièrement aux séminaires « itinérants » à l’intention des
ministres et des hauts fonctionnaires des pays avec lesquels il entretient des
contacts et à l’occasion desquels il est possible de dialoguer sur les problèmes et
les politiques de développement (Cameroun, Chili, Côte d’Ivoire, Équateur,
Guinée, Iran, Pérou et Sri Lanka). C’est également un ardent défenseur des activités
opérationnelles, qu’il connaît bien en raison de sa longue expérience acquise
comme président du Centre français pour la productivité nationale. Parmi ces
grandes activités opérationnelles, trois méritent d’être évoquées : a) la création
d’un service questions–réponses « conçu de telle façon que les autorités de chaque
pays en développement le considèrent comme leur propre bibliothèque, et doté
d’une équipe à même de comprendre leurs besoins et de trouver rapidement la

262
Retour sur le développement
bonne réponse » ; b) les conseils aux petites et moyennes entreprises sur les
méthodes destinées à accroître leur productivité ; c) le transfert de l’expérience
de l’OCDE sur la planification de l’éducation (dans le cadre du projet régional
méditerranéen). Robert Buron demande à Rostislaw Donn de se charger de ces
activités. Ce dernier avait travaillé à l’ambassade de France à Washington (de
1945 à 1956) sur le transfert du savoir–faire américain vers la France et, à compter
de 1957, au sein de l’Agence européenne de productivité. Il s’occupera de ces
activités au Centre jusqu’en 1971.
Raymond Goldsmith (1904–88) assume la fonction de vice–président
pendant les deux premières années. Professeur à l’université de Yale, il a fait
notablement avancer la théorie de l’étude du capital et de la richesse, l’analyse
de l’épargne et des flux financiers, et produit de nombreuses études empiriques
comparatives dans ces domaines. D’un naturel plutôt solitaire, il ne constitue pas
d’équipe de recherche. Menant ses travaux de son côté, il laisse ses collaborateurs
choisir librement leurs sujets d’étude, en insistant seulement pour que ces derniers
soient d’une manière ou d’une autre liés à la question de l’aide extérieure.
Bibliophile convaincu, il œuvre pour que la bibliothèque du Centre joue un rôle
actif au service des responsables et des économistes des pays en développement.
La documentaliste, Billie Salter, contribue grandement aux recherches du Centre,
et à celles de nombreux autres économistes du monde entier. Elle quittera le
Centre de Développement en 1967 pour rejoindre le Yale Growth Centre.
Raymond Goldsmith publiera en 1966 deux études pour le compte du Centre de
Développement : The Determinants of Financial Structure et The Financial
Development of Mexico.
C’est à Raymond Goldsmith que l’on doit la création de la division de la
recherche. Cette division noue des contacts avec les bureaux de statistiques des
pays en développement, afin de standardiser les comptes nationaux, outils de
recherche essentiels sur les performances économiques comparées. Le premier
gros volume, National Accounts of Less Developed Countries, 1950–66, est publié
en 19682 ; il sera suivi par 23 volumes annuels, dont la parution s’est poursuivie
jusqu’en 1991. Dans le cadre de mes déplacements pour le Centre, je prends
ainsi l’habitude de me rendre dans les bureaux de statistiques pour leur expliquer
ce que nous faisons, discuter des ajustements nécessaires pour faciliter les
comparaisons internationales du PIB et du taux d’investissement, et rapporter
autant de documentation que possible. J’ai agi ainsi en Argentine, au Brésil, en
Iran, au Japon, au Mexique, au Pakistan, aux Philippines, en Thaïlande et en
URSS. En avril 1965, j’organise un atelier du Centre de Développement sur la
comparaison internationale du revenu réel et des variations de pouvoir d’achat
des monnaies. C’est un domaine dans lequel l’OECE avait accompli des travaux
novateurs (Gilbert et Kravis, 1954 ; Paige et Bombach, 1959), et Irving Kravis
souhaite étendre cette analyse aux pays à bas revenu. Wilfred Beckerman rédige
une contribution sur les méthodes abrégées à utiliser en attendant les résultats
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%