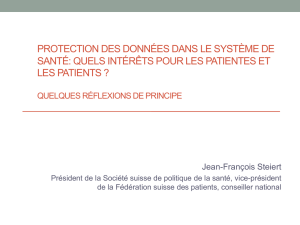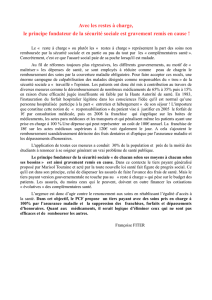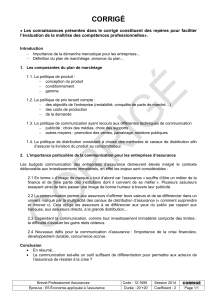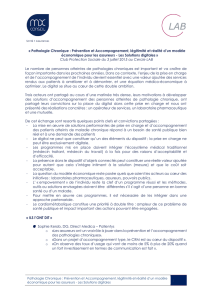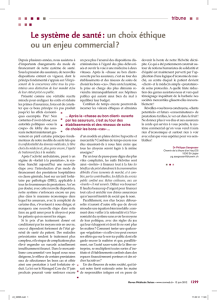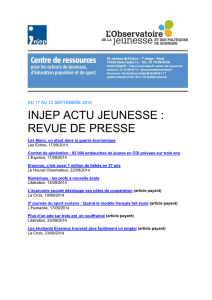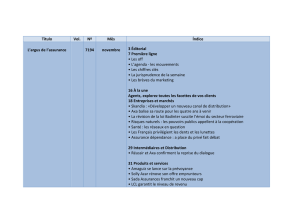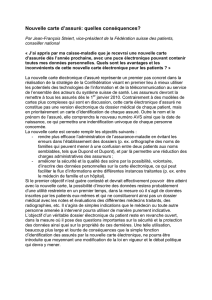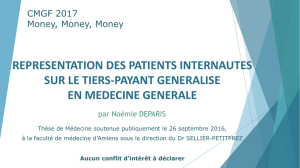Consulter - Exton Consulting

FINANCIAL SERVICES
1er trimestre
33
numéro
2016

SANTÉ:
LE GRAND BOULEVERSEMENT !
EDITO
Le marché de la santé est en pleine transformation.
Après l’entrée en vigueur de l’ANI, la n des clauses de désignation et la réforme des contrats
responsables, c’est la généralisation du tiers payant en 2017, qui va modier tant les règles de
fonctionnement du marché que les règles de fonctionnement internes aux acteurs. Avec pour
eets principaux, la concentration du secteur de l’assurance, mais aussi la transformation de la
relation des banques avec les professionnels de santé.
Par ailleurs, la santé connectée ouvre le champ à de nouvelles opportunités en termes de
marketing, d’ores et de business model : c’est notamment l’occasion de développer des services
d’accompagnement innovants, dans une logique préventive et non plus seulement curative.
Nous avons choisi de consacrer ce numéro de notre lettre
Inside Financial Services
à ce secteur
en pleine mutation, à travers quatre articles, traitant respectivement de la transformation de
l’assurance santé, des impacts du tiers payant généralisé sur le monde bancaire, du développement
des réseaux de professionnels de santé et des perspectives ouvertes par l’expansion de l’e-santé.
Nous remercions très chaleureusement Christian Babusiaux, Président de l’Institut des
Données de Santé, Norbert Bontemps, Directeur Assurances des Particuliers de Groupama et
Guillaume Oreckin, Directeur Général Adjoint de Pacica, pour leurs éclairages sur ces sujets.
Bonne lecture
Les Associés
SOMMAIRE
3 5
LA TRANSFORMATION DU MARCHÉ
DE L’ASSURANCE SANTÉ
6 7
LA GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT :
UNE NOUVELLE DONNE DANS LA
RELATION DES BANQUES AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
10 11
LES RÉSEAUX DE SOINS : DES ACTEURS QUI
S’IMPOSENT FACE AUX PROFESSIONNELS
DE SANTÉ, AU BÉNÉFICE DES ASSUREURS
ET DES ASSURÉS
13 15
LA SANTÉ CONNECTÉE :
UNE TRANSFORMATION EN MARCHE !
Pour plus d’informations
contactinfo@extonconsulting.com
- 2 -

LA TRANSFORMATION
DU MARCHÉ DE
L’ASSURANCE SANTÉ
MANAGER
SENIOR
Florence
DAUBIN
Bertrand
LAUZERAL
ASSOCIÉ 3 5
La complémentaire santé est jugée trop coûteuse par
les consommateurs, par rapport au niveau de prise
en charge oert ; les pouvoirs publics remettent en
cause son fonctionnement, et les coûts qu’il génère.
Ainsi, le principe de l’assurance complémentaire
santé se trouve de plus en plus contesté.
Les quinze dernières années ont vu le coût de
l’assurance santé complémentaire s’envoler de près
de 100 %, pour couvrir les transferts du régime
obligatoire, une hausse de la scalisation, suivre les
progrès de la médecine et les exigences croissantes
des assurés devenus consommateurs pour certains
postes de dépense (ex. : optique).
Ainsi, le prix et le pouvoir d’achat ont constitué un
critère de segmentation fort des ores. Le marché
s’organise d’une part autour d’ores haut de gamme,
incluant de nombreux services et souvent collectives,
et d’autre part autour de couvertures beaucoup plus
restreintes, souvent individuelles.
Dans le même temps, la mise en place successive
de cadres juridiques spéciques à certains types
de bénéciaires ou de garanties a amplié un
mouvement de standardisation des ores, des
services et de leur contenu : loi Evin en 1989 pour
les anciens salariés, contrats Madelin pour les TNS
en 1994, contrats labellisés pour les fonctionnaires
depuis 2012, garanties standard de la CMU-C en 2000
puis appel d’ores ACS en 2015, label contrat solidaire
et responsable en 2004, refondu en 2015, et surtout
l’ANI, conjuguant un socle restrictif et un périmètre
d’application d’ampleur incomparable.
Les services associés aux garanties, autrefois
diérenciants, se sont banalisés, à l’image du tiers-
payant, des plates-formes de devis et des réseaux
de professionnels de santé et ne sont plus perçus
aujourd’hui comme une réelle valeur ajoutée.
- 2 - - 3 -
LES FRANÇAIS TROUVENT LEUR CONTRAT DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ CHER
ET PRÈS D’UN SUR DEUX EN CONNAÎT MAL LE CONTENU
Les Français jugent le prix de leur complémentaire santé… Les Français et le contrat de leur complémentaire santé...
Contrat dicile
à comprendre Contrat
simple à
comprendre
Contenu du contrat
très mal ou pas du tout
connu
33%
15%
52%
Source : Etude Odoxa / Les Furets, octobre 2015.
3%
Raisonnable
Élevé
Excessif
Bon marché
47%
13%
37%
Cher
60%
Prix
correct
40 %

LA CONVERGENCE DES CADRES JURIDIQUES
ACCENTUE L’UNIFORMISATION DES MODÈLES
Le contexte réglementaire du secteur, très actif, connaît également un phénomène
d’uniformisation qui tend à gommer les particularités de certains modèles, notamment
mutualistes ou groupes de protection sociale, sur un marché historiquement marqué par
les identités fortes de ses acteurs.
Ainsi, l’uniformisation touche les instances de régulation (l’ACPR devenue tutelle commune à toutes
les familles d’assureurs) comme les règles prudentielles et les codes (directive Solvabilité II, transposée
dans le seul code des assurances), mais aussi la scalité ou les modes de gouvernance (règle des
« 4 yeux », compétence des administrateurs). Elle découle aussi de l’application du droit européen relatif
aux assurances, à la concurrence et l’intermédiation en assurance (IDD), et de la reconnaissance par le
conseil constitutionnel du caractère contractuel des dispositifs de protection sociale complémentaire.
La dernière réforme en date, la généralisation du tiers payant, engage peut-être la dernière
étape de la transformation du marché. Elle prévoit une application du dispositif de tiers payant
pour l’ensemble des assurés sociaux au 1er janvier 2017, avec une application eective et totale au
plus tard au 30 novembre 2017, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie
obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire.
Cette réforme est vue par certains acteurs de la santé comme l’amorce de la mise en place d’un guichet
payeur unique, étape vers l’unication des outils de gestion de la complémentaire santé qui réduira à
terme les acteurs à des opérateurs anonymes sans particularisme ni lien avec leurs assurés.
La mise en place du Tiers Payant Généralisé reste encore à préciser, mais une évolution de
l’assurance santé analogue à celle de la retraite ne semble alors plus si hypothétique, avec un
régime complémentaire devenant universel, arrimé au régime obligatoire, très normé et géré
industriellement par des acteurs quasi indiérenciés, associé par ailleurs au développement de
sur-complémentaires premium destinées à certaines catégories de consommateurs.
LA STANDARDISATION ET LA NORMALISATION DE
L’ASSURANCE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE IMPACTENT
LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DES OPÉRATEURS
La normalisation des ores et services malmène
in ne
tous les opérateurs du marché.
En eet elle concourt à réduire les marges techniques dans un contexte de concurrence
exacerbée sur des marchés très segmentés et de baisse mécanique des cotisations
collectées (particulièrement dans le cas de la santé collective et des eets socle - ANI, contrat
responsable, ACS).
La partition du marché en segments spéciques accroît les risques de déstabilisation technique liée à
la démutualisation (actifs / inactifs - notamment seniors pour l’ANI). Elle fragilise ainsi particulièrement
les acteurs mono activité, poussés à puiser dans leurs réserves. Le développement des sur-
complémentaires ne semble pas pouvoir compenser à terme ces tendances. Normalement moins
risquées techniquement, ces sur-complémentaires sont susceptibles de générer de l’anti sélection.
La succession d’évolutions réglementaires nécessite des aménagements fréquents
et importants des modèles de distribution et systèmes de gestion, avec un impact
important sur les coûts des acteurs. L’ANI a contraint les acteurs spécialisés en assurance de
personnes à transformer en un temps record leurs modèles de distribution : nécessité pour les
mutuelles d’accéder aux branches, et de disposer d’un réseau commercial capable d’exploiter
les recommandations en démarchant des ux très importants d’entreprises ; pour les acteurs
paritaires, enjeu de mobiliser de véritables réseaux de distribution et d’intégrer les coûts associés,
le modèle historiquement adapté à la négociation de branche devenant insusant face à la
suppression des clauses de désignation. Par ailleurs, assureurs traditionnels et bancassureurs,
dans le cadre de leur stratégie de positionnement sur le marché des Pros et TPE/PME, élargissent
leur ore à l’ensemble de la gamme de produits d’assurance (IARD et assurance de personnes) et
positionnent leurs réseaux commerciaux sur ce marché considéré comme un des rares espaces
de croissance restants.
Pour les seules trois dernières années, les fonctions opérationnelles et techniques ont été
sollicitées en continu pour s’adapter successivement et selon les cas à la gestion du collectif, de
l’ACS et des contrats responsables : projets informatiques importants, recours à des intérimaires,
formations intensives…
Les services « de base », tiers-payant et réseaux de soins, peuvent également représenter un
coût non négligeable, d’autant plus élevé pour les acteurs ne disposant pas d’une surface de
négociation susamment importante vis-à-vis des opérateurs de ces plates-formes… et d’autant
moins valorisable que ces services se sont généralisés.
La maîtrise des frais généraux est de plus en plus cruciale pour les opérateurs, an de nancer
l’eort de développement, supporter les contraintes sur les coûts de gestion (notamment pour
l’ACS) et anticiper l’eort à venir sur le niveau de redistribution vers les adhérents, suite logique à
l’obligation de publication des taux de frais de gestion. Or les acteurs de la santé sont, pour nombre
d’entre eux, contraints par des eectifs souvent importants notamment en gestion, des modèles
sociaux relativement favorables aux salariés et disposent souvent de marges de productivité
conséquentes. Face à eux, des courtiers gestionnaires plus agiles proposent des coûts de gestion
souvent inférieurs et les fragilisent.
- 4 - - 5 -

LA PRESSION ÉCONOMIQUE ET LA DISPARITION DES
SPÉCIFICITÉS POUSSENT AU RAPPROCHEMENT DES ACTEURS
QUELLES SONT ALORS LES OPTIONS
POUR LES ACTEURS DU MARCHÉ ?
Le paysage de l’assurance santé se transforme rapidement et profondément, avec la
réduction drastique du nombre d’acteurs.
Les eets conjugués des exigences prudentielles, du renversement de marché provoqué
par la généralisation de la complémentaire santé et de l’exigence de taille critique
toujours plus importante, requise tant en gestion des moyens qu’en distribution, ont
déjà nourri la spectaculaire accélération des rapprochements. Ce mouvement est soutenu
par le développement d’outils juridiques spéciques (SGAM, SGAPS, UMG…), qui élargissent les
opportunités de collaboration et donnent lieu à des alliances variées.
Les mutuelles du code de la mutualité sont particulièrement concernées : leur nombre a été divisé
par plus de 2 en 8 ans. Elles n’étaient plus que 250 entités actives en 2015, contre 483 en 2010(1).
Au-delà des alliances et fusions « classiques » entre mutuelles ou groupes de protection sociale,
on assiste à des rapprochements inter-familles (mutuelle - IP - assureur) avec les éventuelles
incompréhensions réciproques que cela provoque, notamment du point de vue de la gouvernance.
Deux voies de diérenciation, non exclusives, nous semblent se dessiner.
Le développement d’ores de services à forte valeur ajoutée, dans les domaines du
conseil, de l’accompagnement, de l’accès aux soins et de la prévention, semble la meilleure
alternative face aux modèles économiques contraints de la distribution et gestion d’ores
standardisées et normées. L’essor de la santé connectée constitue à ce titre un parfait tremplin
pour nourrir l’innovation dans le domaine des services : santé mobile,
quantied self…
servent
directement les démarches d’accompagnement et de prévention. Les professionnels des réseaux
de soins peuvent représenter des relais précieux dans la collecte ou l’analyse de ces données. Ces
services peuvent aussi être inscrits dans le cadre plus large d’ores globales, autour de l’habitation,
de la mobilité, des services de bien-être…
L’évolution vers un rôle d’opérateur d’usine de gestion constitue l’autre option. Les acteurs
choisissant cette voie devront s’inscrire dans une véritable logique industrielle, disposer de plates-
formes agiles, économiquement performantes, assurant de bons niveaux de qualité, largement
dématérialisées et connectées à l’ensemble des écosystèmes (assurance maladie obligatoire,
réseaux de soins…) et s’appuyer sur un modèle social adapté. Ils pourront bénécier des ux
d’activité de gestion déléguée par les acteurs désireux de se recentrer sur les métiers de l’ore et
de la distribution ou ne parvenant pas à atteindre les standards économiques exigés.
Si tous les acteurs ne seront pas en capacité de constituer des groupes
importants, innovants en termes d’ores et de distribution, avec un portefeuille
diversié et en maîtrise industrielle, leur capacité à se positionner sur ces métiers
nous semble déterminante, dans une logique de
make or buy
,en fonction de leurs
atouts et marchés.
La conclusion de partenariats
ad hoc
leur fournira l’opportunité de se doter des
solutions les plus performantes dans chacun des domaines.
(1) Source DREES - juin 2015. 453 mutuelles dont 203 totalement substituées au 31/12/2014 et 719 mutuelles dont 236
totalement substituées au 31/12/2010.
LA DIMINUTION DU NOMBRE D’ACTEURS SUR LE MARCHÉ
DE LA SANTÉ SE POURSUIT
Source : DREES – Juin 2015
Assureurs Mutuelles 45 IP/GPS
Évolution du nombre d’acteurs
de l’assurance santé en France
2007
1198
38
1069
91
847
34
2010
719
94
605 28
2013
481
96
573
26
2014
453
94
- 4 - - 5 -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%