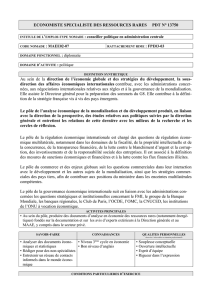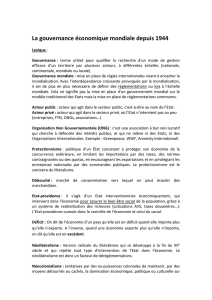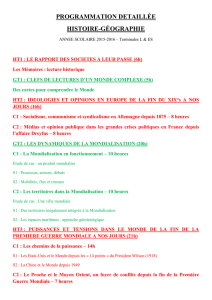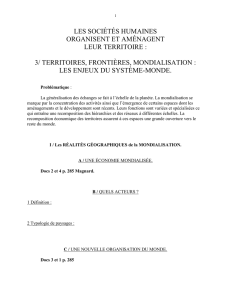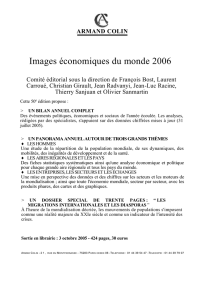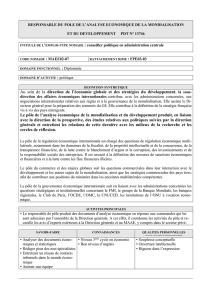La mondialisation dans l`histoire

1
La mondialisation dans l’histoire.
Comment aborder la mondialisation au collège et au lycée ?
Didier Rouaux,
agrégé d’histoire et de géographie, professeur en classes préparatoires
Conférence donnée le 15 novembre 2006 aux journées académiques de formation d’histoire et
de géographie, sous l’égide de Mme l’IPR-IA Régine Deschamps.
Dans le « métier d’historien », ouvrage écrit durant l’occupation peu avant sa mort
sous les balles nazies, Marc Bloch pose la question que se posent sans doute beaucoup de nos
élèves : ce livre, qui se présente comme un dialogue entre lui et son fils, commence en effet
par cette question : « Papa, explique-moi à quoi sert l’histoire ? ». Page 72, à la fin du livre
Marc Bloch conclut : « un mot pour tout dire : comprendre ». Je pense que c’est là que réside
notre raison d’être, la légitimité de notre enseignement et par là-même la justification des
généreux émoluments que nous verse la République. C’est d’ailleurs ce que disent, de
manière plus prosaïque, les programmes officiels qui nous enjoignent de « donner du sens au
monde »
Si, au terme de 7 années de collège et de lycée nos élèves comprennent mieux ce
qu’est cette mondialisation dont les médias parlent sans arrêt, notre enseignement n’aura pas
été inutile. En effet, depuis une dizaine d’année tout le monde parle de la mondialisation, en
France le plus souvent pour la déplorer, mais peu seraient capables d’en donner une définition
claire. Il est vrai que la compréhension de cette expression nécessite un certain nombre de
connaissances en particulier en histoire et en géographie mais aussi en économie.
C’est à cette tâche que nous allons nous atteler aujourd’hui. J’essaierai pour ma part
d’expliquer les origines de ce phénomène, que l’on peut au moins faire remonter aux Grandes
Découvertes.
Pour parler de la mondialisation, la première chose qu’il faut comprendre, c’est que les
mots ont une histoire. Personne ne parlait de mondialisation quand Christophe Colomb a
découvert l’Amérique ou lorsque Bougainville a découvert Tahiti : il s’agissait pourtant déjà
de la mise en contact de deux mondes. De même, lorsque j’étais au collège et que les premiers
hommes, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, débarquaient sur la lune devant des centaines de
millions de téléspectateurs ou que ces mêmes téléspectateurs voyaient tous les jours à la télé
les images de la guerre du Vietnam, nul n’employait encore cette expression : il s’agissait
pourtant déjà de la formation d’une opinion publique mondiale et d’un extraordinaire
rétrécissement du monde. Le mot n’apparaît qu’à la fin des années 1980 et n’est d’usage
courant, en France ou il est la traduction du néologisme anglais « globalization », qu’à partir
de 1995. Pourquoi à ce moment ? Parce qu’à ce moment l’effondrement du monde
communiste en Europe de l’Est ou sa conversion au capitalisme en Chine imposent
l’évidence d’un monde relativement ouvert et fonctionnant selon les règles de l’économie de
marché, de Pékin à New York en passant par Moscou. Parce que les effets de la nouvelle
révolution des transports font sans cesse baisser les prix des produits qui viennent de loin,
accélérant ainsi la croissance du commerce international et les délocalisations d’industries de
main d’œuvre vers l’Asie et notamment la Chine et engendrant, du même coup à la fois la
baisse très rapide de nombreux produits, textile ou électronique notamment, mais aussi des
pertes d’emplois dans des secteurs industriels qui constituaient depuis le début de la
révolution industrielle des spécialités des pays développés : avec le recul de l’emploi
industriel, la fermeture des aciéries, des chantiers navals ou des mines, celle de nombreuses
usines « fordistes » de la métallurgie ou de l’électronique, on touche à une part de l’identité
de la France : celle de la France ouvrière. S’y ajoute également la prise de conscience du

2
changement climatique en cours. Dès lors, cet ensemble de phénomènes nourrit deux idées :
d’abord que le monde est « mondial » c’est à dire unifié pour le meilleur et pour le pire, alors
qu’auparavant et depuis un demi siècle socialisme et capitalisme se partageaient la planète ;
l’autre idée et que la dynamique du monde est celle de la croissance générée par l’économie
de marché. Les termes de « globalization » ou mondialisation désignent cette réalité que l’on
croit nouvelle : celle d’une économie de marché triomphante, génératrice de croissance mais
aussi d’inégalités, voire de menaces pour les générations futures.
Et le débat s’engage sur les bienfaits ou les méfaits supposés de cette situation. En
1996, Viviane Forrester publie L’horreur économique (Fayard) essai dans lequel elle
dénonce un capitalisme étendu à la planète entière qui réduit, selon elle, l’homme à
l’inactivité en Europe et à une nouvelle forme d’esclavage en Asie. L’année suivante Alain
Minc lui répond dans La mondialisation heureuse (Plon). Le succès de « L’horreur
économique », ouvrage pourtant fort peu informé économiquement s’explique par l’angoisse
du chômage de masse en France et la peur d’une accélération des délocalisations d’usines : la
critique antimondialiste a donc révélé la mondialisation. Dans La mondialisation heureuse
Alain Minc soutient au contraire que la mondialisation est synonyme de croissance au Nord
comme au Sud, que ce phénomène est fondamentalement vertueux mais que ses conséquences
positives ou négatives sur les sociétés dépendent largement de la capacité de celles-ci à s’y
adapter, à anticiper les évolutions nécessaires.
Mais le débat sur les vertus ou les méfaits de la mondialisation est mal posé. D’abord
parce que la mondialisation est un fait, qu’elle a commencé voici plusieurs siècles. Ensuite
parce que la mondialisation s’inscrit dans la dynamique historique du progrès technique et de
l’expansion de l’économie de marché.
On peut définir en effet la mondialisation d’abord comme l’accroissement des
échanges, de biens, de services, d’informations, entre les différentes parties du monde.
Ensuite comme la résultante de ce phénomène : un monde interdépendant où tout phénomène
local ou régional est susceptible d’avoir un retentissement planétaire faisant de la terre un
village global comme le dit le sociologue McLuhan. De ce double point de vue, si la
mondialisation est une idée neuve du moins dans le grand public, le phénomène est ancien.
L’histoire des quatre derniers siècles est en grande partie celle de l’accroissement des
échanges et de l’augmentation de leur rapidité, des caravelles de Colomb ou Magellan aux
porte-containers, aux Boeing 747 et à internet. La guerre de sept ans (1756-63) était déjà une
guerre mondiale, opposant la France à l’Angleterre aussi bien en Europe qu’en Amérique ou
en Inde. Fernand Braudel en 1942 percevait bien cette idée d’un monde destiné, au-delà de la
guerre mondiale en cours, à devenir de plus en plus ouvert : dans une conférence donnée
devant ses camarades de captivité dans un stalag allemand il disait, citant l’historien des
sociétés rurales Gaston Roupnel : « le monde est une bourgade » et anticipait sur la victoire de
la dynamique universelle d’ouverture des marchés et d’expansion de la démocratie sur celle
des totalitarismes et du fractionnement du monde.
C’est donc à une approche historique de la mondialisation que je vous invite ce matin
I) Genèse de la mondialisation : des conquistadores à La Pérouse
A) Les économies-mondes avant les grandes découvertes
Dans Civilisation matérielle économie et capitalisme , F. Braudel développe le
concept d’économie-monde, empruntée à l’anthropologue et historien Immanuel Wallerstein
Le monde d’avant les Grandes découvertes maritimes européennes du XVI° siècles est
composé de plusieurs « économies-mondes », des espaces qui n’entretiennent que peu de

3
rapports entre eux, à l’image de l’empire romain, du monde indien et de l’empire chinois, ou
plus tard de la Chrétienté médiévale, de l’Islam et de la Chine. Chacun de ces espaces forme
une « économie-monde » avec ses frontières, plus ou moins fluctuantes, un centre qui est
généralement une ville. Ainsi, au XV° siècle la Chrétienté médiévale forme une économie
monde englobant la Méditerranée orientale et s’étendant jusqu’aux confins de la Moscovie ; le
centre de l’économie-monde européenne est Venise. Au XVI° siècle ce sera Anvers. Certaines
économies mondes sont totalement enclavées, inconnue du reste du monde, à l’image des
empires américains précolombiens. Les économies-mondes d’Eurasie entretiennent déjà des
liens commerciaux, à l’image de la route de la soie, ensemble de pistes caravanières qui relie
la Chine à l’Occident via les déserts d’Asie centrale et les ports de Syrie ou de la Mer Noire :
la peste noire de 1348 qui tue la moitié des Européens est venue d’Asie, puis, par le port de
Caffa en Crimée et celui de Marseille a touché l’Europe. Mais en dehors de ces liens soit
occasionnels, soit très ténus, il n’y a pas d’économie mondiale unifiée : celle ci n’est faite que
de la juxtapositions d’économies-mondes. Mais Braudel observe aussi que « l’économie va
plus vite dans ses agrandissements que la politique ou la culture ». Autrement dit les relations
économiques que ces économies-mondes entretiennent les transforment par le simple jeu des
échanges. C’est ce qui se produit à grande échelle au XVI° quand les Européens se lancent à
la découverte et à la conquête du Nouveau Monde
B) 1492 et le « temps du monde fini » (Paul Valéry) : la mondialisation
ibérique au Siècle d’Or et l’essor du commerce atlantique
Les expéditions européennes du XV0° et du XVI° siècles constituent une première étape
de l’unification du monde. Pour la première fois des hommes, les Occidentaux, font le tour de
la terre (expédition de Magellan, 1519/22) et en proposent une représentation proche de la
réalité (planisphère de Mercator, globe de Martin Behaim). Portugais et Espagnols, puis au
siècle suivant, Hollandais, Français et Anglais qui les supplantent, dilatent l’économie-monde
occidentale aux dimensions du globe terrestre. La première mondialisation est européenne :
hispano-portugaise au Siècle d’Or de Séville et de Lisbonne, puis à partir du milieu du XVII°
siècle, s’effectue surtout au bénéfice des ports de l’Europe du nord Ouest : Amsterdam,
Londres et Liverpool, Nantes ou Bordeaux. Cependant, et jusqu’à la révolution industrielle du
XIX° siècle, les échanges entre l’Europe et sa périphérie coloniale portent sur des métaux
précieux (l’or et l’argent des mines américaines –Potosi) et des produits à haute valeurs
ajoutée consommés essentiellement par les élites (sucre de Saint Domingue, café, cotonnade
ou « chinoiseries ») issus des plantations des îles à sucre ou des comptoirs des Indes
orientales.
Cette première mondialisation que l’on peut qualifier d’atlantique est plutôt une «proto-
mondialisation » : elle n’affecte guère la vie de l’immense majorité des habitants de l’Europe
dont 80% sont encore des paysans vivant dans une quasi autarcie ; seules les marins ou ceux
qui tentent l’aventure du Nouveau Monde (seulement quelques milliers chaque année au
XVII° siècle) sont concernés. L’Asie elle-même est peu affectée par ces premiers contacts. Il
n’en va pas de même de l’Amérique dont la population autochtone est décimée par la variole
introduite par les conquistadores (baisse de 75% de la population) : l’Amérique devient
progressivement un monde métis, produit de la colonisation européenne. De même l’Afrique
qui, du XVII° au début du XIX° siècle constitue un réservoir d’esclaves pour les colonies
européennes d’Amérique ou le monde arabo-musulman : ses structures économiques et
sociales sont profondément transformées par l’impact des deux traites : la traite orientale
depuis le IX° siècle, via le Sahara et l’Océan indien, et la traite atlantique depuis le XVI° :
certains Etats ou peuples africains (Fons du royaume de Dahomey, Ashantis de Ouidah, cités
haoussas telle Sokoto) se spécialisent dans la razzia et la vente d’esclaves aux négriers

4
chrétiens de Nantes ou Liverpool ou aux négriers musulmans de Zanzibar ou Tripoli (Olivier
Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières. Essai d’histoire globale, Gallimard, 2004).
II) La mondialisation libérale du XIX° siècle et de la Belle Epoque : le temps
de Jules Verne et du Titanic
A) Une mondialisation européenne: industrialisation, libre échange et
migrations vers les pays neufs ou l’occidentalisation du monde.
La seconde vague de la mondialisation accompagne l’industrialisation du XIX° siècle
et la libéralisation des échanges du milieu du XIX° siècle. Si la mondialisation des Temps
Modernes n’avait pas affecté en profondeur les sociétés occidentales, encore rurales à 80 ou
90%, celle du XIX° siècle fait déjà entrer l’Europe et l’Amérique du Nord dans l’univers de la
communication instantanée et du transport de masse. Cette seconde mondialisation est due à
deux facteurs : la révolution des transports et le triomphe du libre échange.
La révolution des transports et de la communication du XIX° constitue un premier
facteur d’accélération des échanges avec les navires à vapeur à partir de 1840, le réseau
télégraphique sous-marin mis en place par l’Angleterre à la fin du XIX° siècle ainsi que les
grands liners à coque d’acier de 300m de long, transportant des milliers de passagers à la
Belle Epoque sur les lignes des compagnies Cunard, White Star (Titanic, 1912) , Compagnie
Générale Transatlantique (la Transat) ou Messageries maritimes ; on peut y ajouter
l’ouverture des grands canaux interocéaniques, le canal de Suez (1869) ou celui de Panama en
1914, la sécurisation du trafic maritime grâce aux phares et à la lentille de Fresnel. La
généralisation du libre échange entre les puissances du monde industriel constitue l’autre
facteur : en 1846, à l’initiative du premier ministre Peel, le Royaume-Uni abroge les corn
laws qui avaient institué un tarif protectionniste sur le blé, ouvrant ainsi son marché au blé
américain. En 1860 la France et l’Angleterre signe un traité de libre échange (traité Cobden-
Chevalier). D’autres traités bilatéraux suivront entre tous les pays d’Europe jusqu’en 1870.
L’existence de l’étalon or, c’est à dire d’un système de monnaies convertibles en or s’étendant
à 90% des Etats de la planète facilite également les échanges. Le pays moteur de cette
deuxième mondialisation est le Royaume-Uni, « workshop of the world » et première
puissance maritime. L’impact de cette deuxième mondialisation est beaucoup plus important
que celui de la mondialisation atlantique des XVI°-XVIII° : entre 1840 et 1914 le volume du
commerce mondial est multiplié par 7 ; celui de la France par 6 (de 2,5 à 15 milliards de F.
entre 1847 et 1913), le commerce de la Grande Bretagne est multiplié par 3 entre 1870 et
1914, de 15 à 35 milliards de F., celui de l’Allemagne par 5, de 5 à 25 milliards. La libre
circulation des capitaux permise par l’étalon or favorise l’essor de l’investissement
international : 150 milliards de F. sont placés sur l’ensemble de la planète, principalement aux
Etats-Unis et sur les marchés émergents de Russie, d’Argentine, de l’Empire ottoman, de
Chine et accessoirement dans les colonies européennes : 50% de ces capitaux sont
britanniques et 30% français.
A l’augmentation du commerce s’ajoutent des migrations internationales sans
précédent dans l’histoire : à cette époque c’est l’Europe qui envoie ses pauvres vers le reste du
monde, comme nous le rappellent encore la statue de la Liberté de New York due au sculpteur
Bartholdi et à l’ingénieur Eiffel et le poème de l’américaine Emma Lazarus gravé sur son
socle : Give me you tired, your poor,
Your huddled masses
Yearning to breathe free.

5
L’Europe est encore pauvre et fortement peuplée (25% de la population mondiale en
1900, contre 7% aujourd’hui) : pour des millions d’Européens souvent issus des régions
rurales l’Amérique ou les autres pays neufs représentent des « terres d’espérance », comme
l’Europe d’aujourd’hui pour les populations d’Afrique ou du Moyen Orient. 60 millions
d’Européens s’installent dans les pays neufs, les deux tiers en Amérique du Nord, les autres
en Amérique latine (Argentine, Brésil, Uruguay, Chili), en Australie, Nouvelle Zélande,
Afrique du Sud. Les Etats-Unis à eux seuls ont accueilli 4 millions d’Italiens, 2 millions de
Juifs ashkénazes fuyant les pogroms dans l’empire russe, plus d’un millions d’Irlandais, des
millions de Slaves : l’Amérique d’aujourd’hui est largement un produit de cette seconde
mondialisation, célébrée par l’écrivain Israël Zangwill dans sa pièce The Melting Pot jouée à
Washington en 1907.
Enfin il faut aussi prendre en compte la dimension culturelle de cette seconde
mondialisation : les capitales des pays émergents imitent l’urbanisme haussmannien de Paris :
c’est le cas de Buenos Aires, de Mexico, du Caire. Les missionnaires et les fonctionnaires
coloniaux répandent l’usage de l’anglais et du français dans les colonies, notamment en
Afrique et en Asie du Sud. Les vieux empires asiatiques se modernisent, à l’image de
l’Europe, tel le Japon de l’ère Meiji, la Chine, l’Egypte des khédives, ou l’Empire ottoman :
les élites y adoptent le costume occidental, les normes administratives ou techniques, les
institutions. Cette seconde mondialisation correspond à une période de forte croissance
économique marquée par deux phases A du cycle de Kondratiev, le « boom victorien » de
1850 au début des années 1870 d’une part, la Belle Epoque de 1896 à 1914 en Europe et
l’extraordinaire croissance de l’économie américaine qui dure jusqu’en 1929.
B) Le grand repli de l’entre-deux-guerres : absence de puissance
régulatrice, crises économiques, protectionnisme et totalitarismes.
La Grande guerre ouvre une période de repli de la mondialisation qui dure jusqu’en 1945 :
d’abord parce qu’elle déséquilibre durablement le système monétaire international, en raison
de la mise en place du contrôle des changes durant la guerre, et de ses conséquences
l’inflation et son corollaire, les dévaluations des monnaies (le F de 4 sous en 1926 ) ; ensuite
parce que l’Europe, appauvrie par la guerre, investit moins dans le reste du monde. Le repli
est aussi dû à des causes politiques : la guerre a provoqué l’arrivée au pouvoir de régimes
totalitaires qui adoptent des politiques autarciques : la Russie communiste en 1917 annule sa
dette extérieure, les fameux emprunts russes, l’Italie fasciste se ferme des la fin des années
1920, l’Allemagne nazie adopte une politique autarcique dans le cadre de la préparation d’une
économie de guerre. Enfin la crise des années trente relance la tentation protectionniste y
compris dans les démocraties capitalistes d’Europe de l’ouest : accord d’Ottawa en 1932 sur
la préférence impériale au sein du Commonwealth. Bref, face aux difficultés économiques, la
tentation du chaque pour soi, du repli sur le marché intérieur (Etats-Unis) ou sur les empires
coloniaux (France et Royaume-ni) s’est avérée suicidaire : elle a aggravé la crise de 1929 en
accentuant spectaculairement la contraction du commerce international qui est divisé par trois
en valeur durant les années trente. Par ailleurs, le fractionnement du monde, dans l’entre-
deux-guerres n’est pas seulement économique : les frontières se ferment ; au libéralisme de la
Belle Epoque, du « monde d’hier » pour reprendre le titre de l’autobiographie de Stefan
Zweig (Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, 1942), se substituent dans la majorité des
pays d’Europe des dictatures ou des Etats totalitaires : le libéralisme était sans doute injuste
socialement mais il était politiquement et culturellement permissif et il apportait aussi la
croissance. Lénine, Mussolini, Staline ou Hitler ont apporté crimes de masse, régression
culturelle, stagnation économique et au final une nouvelle guerre mondiale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%