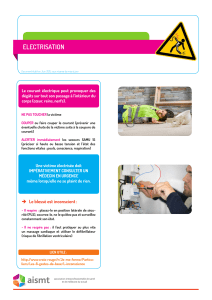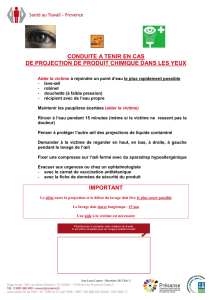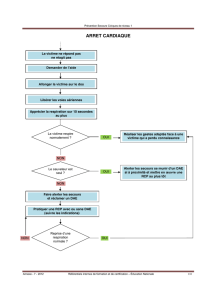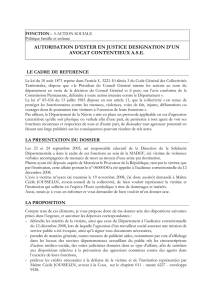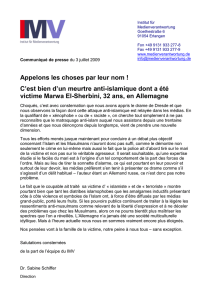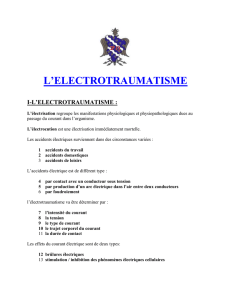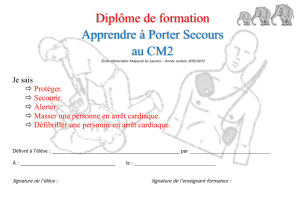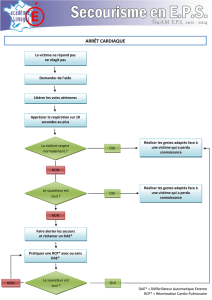responsabilite medico-legale et administrative

SDIS – SSSM 69 -Page 1 sur 22
R
RE
ES
SP
PO
ON
NS
SA
AB
BI
IL
LI
IT
TE
E
M
ME
ED
DI
IC
CO
O-
-L
LE
EG
GA
AL
LE
E
E
ET
T
A
AD
DM
MI
IN
NI
IS
ST
TR
RA
AT
TI
IV
VE
E
I
In
nf
fi
ir
rm
mi
ie
er
r
d
de
e
C
Ch
he
ef
ff
fe
er
ri
ie
e
N
Ni
ic
co
ol
la
as
s
C
Co
ou
uë
ës
ss
su
ur
re
el
l
–
–
J
Ju
ur
ri
is
st
te
e
–
–
S
SS
SS
SM
M
6
69
9
–
–
S
SD
DI
IS
S
d
du
u
R
Rh
hô
ôn
ne
e
Pour une bonne lecture de ce document, la connaissance préalable des notions de responsabilité civile, pénale
voire administrative et disciplinaire est conseillée.
Les sapeurs-pompiers composant le VSAV sont l’instrument d’un service public ayant pour
mission la protection et la sauvegarde des biens et des personnes. La victime est alors
considérée comme le bénéficiaire d’une prestation de service public, dispensée par des agents
publics.
Tous les intervenants du VSAV sont assimilés à des agents publics :
Le SPP : Fonctionnaire territorial
Le SPV : Le Conseil d’Etat, par un avis en date du 3 mars 1993, eut à définir le statut
juridique des sapeurs-pompiers volontaires en ces termes : « les sapeurs pompiers volontaires
sont des agents publics contractuels à temps partiel ». Les SPV s’ils ne sont pas des
fonctionnaires restent soumis aux règles de droit public applicables dans le cadre de l’exercice
des missions de service public. Les droits et obligations opposables aux SPV, s’inspirant du
statut général de la fonction publique, sont explicités notamment dans le cadre du décret 99-
1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires.
C
Ch
he
ef
f
d
d’
’a
ag
gr
rè
ès
s
V
VS
SA
AV
V
1
L
La
a
v
vi
ic
ct
ti
im
me
e
2
L’équipe
VSAV
3
Régulation
médicale
4
SSSM
SAMU
5
Autorité

Janvier 2005-SSSM-SDIS 69 - Page 2 sur 22
Ainsi l’intervenant est soumis au respect de certaines obligations :
L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle
(loi 13/7/83 – art 26)
L’obligation d’information de l’usager
(loi 13/7/83 – art 23)
L’obligation de non-discrimination et de respect de la personne
(Arrêt CE 3/5/50 Dlle Jamet)
Secret et discrétion professionnelle
Discrétion professionnelle
Le sapeur-pompier ne doit pas divulguer toute information dont il aurait eu connaissance dans
le cadre de son exercice (lu, vu, entendu, compris,…) ou permettre à des tiers l’accès à des
pièces ou des documents de service, description de l’activité de service, c’est la discrétion
professionnelle . Cette obligation est liée à l’activité et au fonctionnement du service. La
discrétion professionnelle est confirmée et renforcée pour le sapeur-pompier professionnel
fonctionnaire par le statut général de la fonction publique (art 26- loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ).
La demande d’informations (levée de l’obligation de discrétion professionnelle) ne pourra
trouver réponse que si elle émane de l’autorité SP (ex : rapport circonstancié), des forces de
l’ordre (officier de police judiciaire) ou de la justice.
Si le sapeur-pompier a connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions,
il a obligation d’en informer le procureur de la République
(code procédure pénale art 40)
ou
d’établir à l’attention de son autorité un rapport circonstancié afin de relater les éléments lui
permettant d’évoquer la constatation d’un crime ou délit dans le cadre opérationnel.
La violation de l’obligation de discrétion professionnelle expose le sapeur-pompier à des
sanctions disciplinaires au titre de faute professionnelle.
Secret professionnel
Article 226-13 code pénal: « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Article 226-14 code pénal: « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou
administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze
ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou
psychique. »
Le sapeur-pompier, de part la nature de ses missions, et amené à connaître ou partager avec
des professionnels de santé des informations d’ordre médical concernant la victime telles
que : antécédents médicaux, symptômes, traitements, pathologies, diagnostic. Il est aussi
amené à s’immiscer dans la vie privée des victimes. Les éléments de vie privée connus ou
compris dans le cadre de l’intervention sont soumis au même titre que les informations
d’ordre médical au secret professionnel. Ces éléments peuvent comprendre le mode de vie, la
situation sentimentale, la religion, la famille ou plus généralement toute information d’ordre
privé dont la divulgation porterait préjudice à la victime… Ces informations relèvent du secret
professionnel. Le secret professionnel, et plus particulièrement le secret médical lié aux
informations d’ordre médical, ne peut-être levé exclusivement que par un professionnel
soumis à ce secret, participant à la prise en charge de la victime. Ainsi, dans le cadre
opérationnel, seuls la régulation médicale, les intervenants médicaux participant à

Janvier 2005-SSSM-SDIS 69 - Page 3 sur 22
l’intervention ou les sapeurs pompiers dès lors que cette communication présente un intérêt
dans le cadre de la prise en charge de la victime, sont susceptibles de vous demander ce type
d’informations.
Le législateur est venu renforcer cette notion dans le cadre de la loi 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé en s’inspirant de la
jurisprudence constante en la matière qui prévoit l’opposabilité du secret médical à tous les
intervenants impliqués dans le processus de soins. L’opposabilité du secret médical est
explicitement étendue à tous les acteurs collaborant au système de santé ; « Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé. »
Les forces de l’ordre, élus ou médias n’ont donc pas à être destinataires d’informations
d’ordre médical concernant la victime.
La violation du secret professionnel est sanctionnée par le code pénal.
Cas particuliers susceptibles de lever ces obligations
Dans la mesure où le sapeur-pompier est convoqué au titre de témoin, il n’est pas délié du
secret professionnel. Effectivement le code de procédure pénale dispose que « toute
personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment
et de déposer, sous réserve des dispositions de l’article 226-13 du code pénal ». En l’espèce,
cet article du code pénal prévoit le respect du secret professionnel, médical (diagnostic,
traitement, éléments de confidence sur sa vie privée,….). Dans le cas où vous seriez mis en
examen ou prévenu (en instance de jugement), vous pouvez être délié de cette obligation dans
la mesure où vous le jugez nécessaire à votre défense (
art 11 code de procédure pénale
). Le secret
professionnel n’est pas opposable à l’éventuel médecin expert étant lui même soumis au
secret médical. C’est l’expert qui divulguera les éléments dits « nécessaires à la
manifestation de la vérité ».
-> En cas d’enquête préliminaire effectuée par la police, l’obligation de discrétion
professionnelle est maintenue et ne peut être relevée que par l’autorité hiérarchique SP.
L’obligation de secret professionnel est maintenue.
-> En cas d’instruction ou de jugement (témoignage à faire auprès du juge ou des policiers
ayant reçu du juge une commission rogatoire), l’obligation de discrétion professionnelle est
levée. Cette discrétion consiste en la description de ce que l’on a vu, lu, entendu dans le
cadre de son exercice professionnel et concerne l’organisation du service, la constatation des
agissements des membres de l’équipe, etc… Seuls les juges, officiers de police judiciaire ou
l’autorité hiérarchique SP (notion de rapport circonstancié) peuvent lever l’obligation
de discrétion professionnelle. L’obligation de secret professionnel est maintenue. Le fait
de refuser de déposer sur des faits et informations couverts par le secret professionnel
n'entraîne aucune sanction judiciaire. Seules les dérogations prévues par la loi
permettent de lever ce secret.
Les exceptions susceptibles de lever l’obligation de secret professionnel sont donc
lorsque le sapeur-pompier a connaissance de sévices ou privations infligés à un mineur
de moins de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique (art 222-14 nouveau code pénal),
lorsque la nécessité de porter assistance à une personne en péril l’exige (art 122-7 code pénal)
ou que la levée du secret professionnel par le sapeur-pompier lui semble indispensable dans le
cadre d’un témoignage pour empêcher la condamnation d’un innocent (art 434-11 code
pénal).

Janvier 2005-SSSM-SDIS 69 - Page 4 sur 22
En définitive…
Ces obligations, et plus particulièrement l’obligation de secret professionnel, sont des notions
majeures. Le principe repose sur le respect de la vie privée de la victime qui ne saurait voir sa
situation médicale ou privée exposée au public à l’issue d’une intervention. A noter que la
victime elle-même ne peut vous délier du secret professionnel. Le décès de la victime ne vous
exonère pas de l’obligation de secret professionnel.
Il est opportun de protéger du regard des autres (si le contexte d’intervention le permet) la
victime et de disperser avec diplomatie les « observateurs » ne justifiant pas leur présence sur
les lieux.
Ainsi, soyez extrêmement vigilants en terme d’informations divulguées, particulièrement
lorsqu'elles sont nominatives (ex : les fiches bilans nominatives et descriptives doivent être
placées dans un lieu sécurisé, pas d’information par téléphone, de dossiers qui traînent, de
discussions dans les couloirs, en dehors du lieu d’exercice,…).
Il convient de bien faire le distinguo entre la discrétion professionnelle, le secret professionnel
et l’obligation de réserve ;
- Le secret professionnel protège les intérêts de la victime
- La discrétion professionnelle protège les intérêts de l’administration
- L’obligation de réserve, à contrario des précédentes, n’est pas une obligation de non
divulgation mais, selon l’éminent professeur Chapus « la retenue dans l’extériorisation
des opinions », notamment concernant le service, ses collègues,…
Obligation d’information
L’équipe VSAV doit informer la victime dans les limites imposées par le respect de la
discrétion et du secret professionnel. Il faut bien comprendre que l’objectif de cette obligation
est d’éviter la rétention d’informations préjudiciables à la victime.
Il convient d'apporter une attention particulière à cette notion. En effet, la jurisprudence
médicale se montre extrêmement sévère quant à l'obligation d'information des médecins vis à
vis de leurs patients. On retrouve cette même sévérité quant à l'obligation d'information des
administrés par l'administration. La mise en œuvre de cette obligation par les sapeurs-
pompiers est manifeste par exemple dans le cas du refus d'hospitalisation (cet aspect est traité
dans le chapitre "Refus d'hospitalisation" mais sera abordé ici sous l'angle de l'obligation
d'information).
Effectivement, si une victime décide de ne pas être transportée en milieu hospitalier, elle
s'appuie entre autre sur les informations que vous lui délivrez pour asseoir sa décision. En cas
de contentieux, elle pourrait invoquer que les informations que vous lui avez données ou omis
de lui donner ont vicié sa décision. Vous êtes face au syndrome du "ah si on m'avait
dit…j'aurais accepté…". Il est souvent délicat de démontrer le contraire.
Prenez donc soin d'expliquer, tant que possible, les incidences et/ou risques connus à la
victime. Ex : un saignement apparent de l’oreille interne est un signe de gravité que la victime
n’est pas censé considérer comme tel. Essayez d'apporter ces explications en présence d'une
personne qui pourra, le cas échéant, attester que vous avez fourni les explications idoines. Ne
vous aventurez pas à présupposer d'un diagnostic médical. Alarmer une victime en
présupposant d’une « lésion des cervicales » est médicalement audacieux… et susceptible de
compromettre le libre arbitre de la victime quant à ses choix. Restez simple. Dans le cas

Janvier 2005-SSSM-SDIS 69 - Page 5 sur 22
précédent, annoncer que vu le contexte de l’accident, il y a toujours suspicion d’atteinte à la
colonne permet de justifier et d’expliquer les actes pratiqués (pose d’un collier cervical),
légitime votre suggestion de transport, correspond à une réalité (la suspicion d’atteinte) et
n’alarme pas la victime outre mesure (l’intérêt de ne pas alarmer inutilement une victime qui
vient de subir un sinistre contribue à la qualité de la prise en charge…)
Pour illustrer mon propos, prenons un exemple concret:
- Une VSAV intervient sur un accident sur la voie publique, impliquant un véhicule léger
entré en collision avec un cyclomoteur. Le conducteur du scooter s'oppose à son transport,
considérant qu'il ne constate que quelques dermabrasions aux bras, n'a apparemment pas eu
de perte de conscience initiale, etc…Hormis son droit au refus d'hospitalisation, sa décision
n'apparaît pas manifestement déraisonnable. En effet, le bilan ne met pas en évidence de
problèmes particuliers.
Soucieux de sa responsabilité, le chef d'agrès prend soin de faire signer une "décharge de
responsabilité suite au refus de transport"….
Quelques heures plus tard, la victime est hospitalisée en urgence, dans le coma, suite à un
hématome sous-dural. La famille envisage de porter plainte considérant que la victime aurait
du être transportée par les sapeurs-pompiers. Les chances de réussite d'un recours dans ce cas
d'espèce sont réelles, considérant le non respect de l'obligation d'information (on peut même
supposer dans ce cas d'espèce que la théorie juridique de la perte de chance sera obtenue).
-> Le chef d'agrès aurait du simplement indiquer que, considérant le contexte de l'accident
(choc) et l’avis médical de la régulation médicale le cas échéant, il apparaît préférable
d'envisager un examen de contrôle et d'obtenir un avis médical à l’hôpital. Si suite à cette
délivrance d'informations la victime persiste dans son refus…c'est alors en toute connaissance
de cause, et donc sans possibilité d'invoquer votre responsabilité sur la base d'un manquement
à l'obligation d'information. Il ne vous ait absolument pas demandé de supposer l'existence
d'un hématome sous-dural, nul n'est tenu à l'impossible !. Seules vos connaissances
secouristes sont sollicitées. Toujours dans ce cas, le document signé relatif au refus
d'hospitalisation n'a pour seul objectif que de confirmer que la victime a bien refusé son
transport, mais ne présuppose pas qu'elle ait pris sa décision en disposant des éléments qu'elle
est en droit d'attendre à cette fin. Une victime à qui le chef d'agrès aurait conseillé le transport
(sur demande de la régulation médicale et/ou se basant sur ses propres connaissances), en
présence d'un autre sapeur-pompier au titre de témoin et qui de surcroît aurait signé un
document de refus de transport aurait de grandes difficultés à démontrer que sa décision
n'était pas éclairée…
Il convient de préciser que la loi relative aux droits des malades de mars 2002 (art L1111-2 csp) est explicite et
prévoit, confortant ainsi la jurisprudence, qu’en cas de litige il appartient au professionnel de démontrer par tous
moyens la dispensation d’informations (les témoignages, le bilan radio transmis au SAMU et le document de
refus d’hospitalisation peuvent faire partie de ces moyens) et non à la victime de démontrer l’absence de ces
informations. Ceci est un renversement de la charge de la preuve qu’on ne retrouve qu’en matière d’infections
nosocomiales (infections contractées lors de gestes secouristes ou dans la cellule du VSAV par défaut de respect
des règles d’hygiène).
Si une victime demande des nouvelles d’autres victimes, vous ne devrez pas éconduire sa
question mais l’adapter, en invoquant qu’elle est prise en charge par une autre équipe par
exemple...
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%