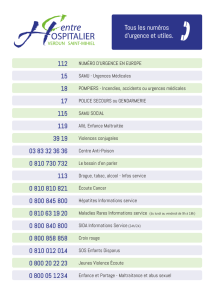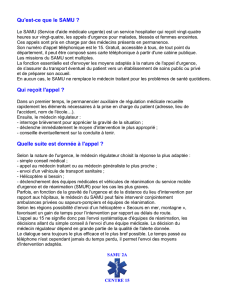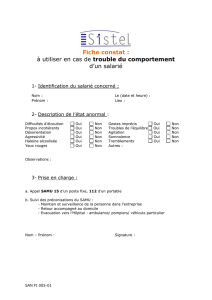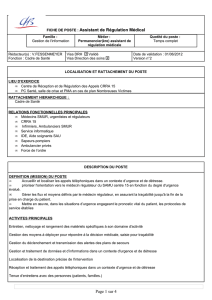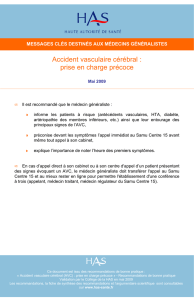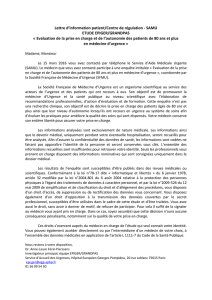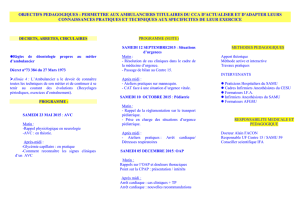lire le cinquieme volet - GCS Sud de l`Yonne et Haut Nivernais

MARDI 11 DECEMBRE 2012 27
MOHAMED DYANI
Médecin régulateur
En quoiconsiste le rôle
du médecin régulateur?
La partie conseil est très
importante dans la régulation.
Celavadusimple avis pour
de la fièvre ou une douleur
jusqu’audéclenchement d’une
équipe médicale héliportée. À
chaque fois, nous devons poser
lesbonnes questions, pour
évaluerledegréd’urgence.
Quelles sont les difficultés
que vousrencontrez ?
La demande de chacunest
qu’on leur envoie une équipe
àdomicile. La difficulté, c’est
d’affiner lesbesoinspour
adapterles moyens. Il ya
beaucoup de pression de la
part des patients. Les gens
sont de plusenplus exigeants.
Comment parvenez-vous
àlameilleure réponse ?
L’interview téléphonique,c’est
comme un entonnoir. On ferme
lesyeux et on s’imaginesur
place. On demanded’abord
aux gensdeseprésenter.
Ensuite,ilfaut employer un
langage simple,pour avoir une
idée claire de la situation.
La première chose,c’est de
rassurer et de détendre le
patient. Parfois, le risque,c’est
de sous-évaluer la situation.
Il faut toujoursavoir un œil
neufsur le patient et faire un
examen pour ne pas passer à
côté de quelque chose. Nos
prises de décisions ne sont pas
innées. C’esttoujours un
raisonnement médical, c’est
comme un algorithme.
èè
3QUESTIONS À
Le Samu toujours sur le fil
REPORTAGES
Volet réalisé par
LaurenneJannot (textes)
et Florian Salesse (photos)
Ilyades moments cal
mes,d’autres moins ;une quin
zaine d’interventions en un
weekend, une pleine journée
sans un seul appel vital. «C’est
aléatoire»;«çadépend des
jours »;«iln’y apas de ten
dance », sont autant de constats
que partagent les membres de
l’équipe de régulation, au pre
mier étage du bâtiment du
Samu. Surplace,outreleméde
cin régulateur,ilyatoujours
deux assistants de régulation
médicale (ARM), parfois trois
selon les besoins,chargés d’éva
luer l’urgence des appels avant
de les transmettreauprofes
sionnel de santé. Tous sont rac
cordés aux autres par le biais
d’un système informatisé qui
enregistreaussi bien les don
nées relatives aux patients,aux
interventions,que les appels,
conservés pour vérification en
casdeplainte auprès de la di
rection. Un cas de plus en plus
fréquent d’après les profession
nels sur place.
Les ARM sont habitués aux ca
nulars,qu’ils ont appris àre
connaître, et aux appels pour
rien, ou pas grandchose :un
mal de ventrepassager,une
égratignure, ou l’avis du docteur
sur la prise d’un cachet pour la
tête.Ladernièremode,cesont
les adultes qui encadrent des
groupes d’enfants et qui doivent
désormais appeler le Samu
avant d’administrer un produit
àunmineur dont ils ont la
charge.
Il yaaussi les appels plus sé
rieux, souvent des accidents sur
la voie publique ou des arrêts
cardiaques,pour lesquels ils
sont habilités àlancer euxmê
mes l’intervention, sans même
attendrelavalidation par le pra
ticien hospitalier.Formés sur le
tas,les ARM sont le premier fil
treavant le médecin régulateur.
Dans la plupartdes cas,après
avoir échangé avec le docteur,
et si besoin est, l’appel revient
sur la ligne des ARM, qui sont
chargés de déclencher les se
cours (ambulance privée,pom
piers,hôpital de Sens où l’une
des antennes du CHA àJoigny,
Tonnerre, Avallon ou Clamecy),
toujours choisis en fonction de
leur proximité avec le lieu d’in
tervention. Le médecin régula
teur reste,lui, informé de la si
tuation tout au long de
l’intervention. ■
èè
L’ARM. Il accueille, écouteetanalyse
chaque appel dansles plus brefs délais,et
localise le plus précisément possible l’adresse
de chaque intervention. Il procèdeàla
hiérarchisation des appels par un
interrogatoirebrefetprécis. Lors d’une
intervention, il s’assuredeladestination et de
la position de chaque intervenant,recueille
les bilans et prévient les structures d’accueil
àlademande du médecin régulateur.
Régulation
Le cinquième voletdenotre série
consacrée àl’hôpital d’Auxerre
s’intéresse au Samu. Centre né-
vralgique,lasalle de régulation
vit au rythme des sonneriesdu
téléphone. Tous les appelspassés
au 15 dans l’Yonne yaboutissent.
SECOURS. Lesagents de régulation envoient les équipes en fonction de leur proximitéavec le lieud’intervention.
Lorsqu’ils ne sont pas sur une in-
tervention, les secours restent
leurprincipal sujetdeconversa-
tion. Le rez-de-chaussée, havre
des ambulanciers, résonne des
nombreuses anecdotesqu’ils ont
àraconter.Toujours sur la brè-
che,ils doivent être prêts àpartir
dès que l’alarme retentit.
L’équipe est constituée de
quatorze ambulanciers,enca
drés par Laurent Privé. Quatre
d’entreeux sont mobilisés par
jour,par équipe de deux, en
deux fois douzeheures.Encas
de troisième départ, c’est le ca
drequi s’ycolle.Une entreprise
privée est chargée d’assurer
tous les transports intrahospi
taliers.
Les ambulanciers ont des obli
gations propres àleur fonction :
connaîtrelacartographie de
leur secteur,êtreaptes àcon
duiredans n’importe quelle
condition. Surneige,sur glace,
ils ont régulièrement des forma
tions spécifiques.Enplus du
permis B, ils doivent avoir obte
nu leur permis poids lourd, être
titulairedudiplôme d’État
d’ambulancier et de la Forma
tion d’adaptation àl’emploi
(FAE) ambulancierSmur.
Mais loin de n’êtretenus qu’au
transport, ils sont aussi la pre
mièremain des secours.Une
heuredevérification des équi
pements àchaque prise de pos
te,matin et soir ;uninventaire
complet une fois par mois,au
cours duquel les VRM sont vi
dés et nettoyés.Chaque mem
bredel’équipe est référent de
quelque chose :pharmacie,hy
giène,véhicules,cartographie,
gestes d’urgences,etc.Cesont
eux, aussi, qui préparent tous
les kits,d’urgences,deprélève
ments,etqui assurent le réas
sort. Ilsconnaissent par cœur
les codes couleurs.Mallette
rouge :circulatoire; mallette
bleue :ambulatoire;mallette
jaune :médicaments.Etencore,
en plus de ces valises,ils s’assu
rent que le double de chaque
produit est présent dans les ti
roirs,àl’arrièredes voitures.
Ilsn’ont pas de formation mé
dicale.Mais,minutie de la pré
paration oblige,cesont eux qui,
lors d’une intervention, passent
les produits.Eux aussi qui, une
fois utilisés,rangent les déchets
en toute sécurité. Ilsn’inter
viennent pas sur les patients,
mais ne ratent pas une miette
de leur prise en charge.Lelivre
d’or des secours,ensomme. ■
■WEB
Retrouvezles témoignages d’ambu-
lanciers du Samu sur
www.lyonne.fr
PRÉPARATION. Hors intervention, les ambulanciers ont diverses obligations.
Ambulanciers
Au rez-de-chaussée,l’équipe entreattente,préparation et célérité
Si le secours intervient sur le lieu de travail ou au domicile d’un
particulier,leSamu fait appel àunambulancier privé, àcondition que
le secours ne relève pas de l’urgencevitale. Dans ce cas,les pompiers
sont envoyés sur place,pour transporter le patient, secouru par une
équipe du Smur.Les pompiers peuvent aussi être envoyés “en carence”,
si aucune ambulance privéen’est disponible.
■Àchaque situation sonmodedetransport
Àcœur ouvert

28 MARDI 11 DECEMBRE 2012 MARDI 11 DECEMBRE 2012 29
À
90 km/h en ville,160 hors agglomé
ration, mieux vaut ne pas avoir l’es
tomac fragile.Une fois l’intervention
lancée,tout est une question de minutes.
Ce jourlà, il n’en faut pas une vingtaine
pour que le véhicule de secours rejoigne
unemaison de retraite chablisienne,de
puis le CHA. Sortie de l’hôpital, l’équipe
médicale n’aplus qu’un objectif :êtrele
plus rapidement possible sur les lieux. Et
peu importe pour l’ambulancier que les
sièges en cuir,àl’arrièreduvéhicule,
soient particulièrement glissants.Aux
passagers la responsabilité d’êtrebien at
tachés.
L’intervention
de secours est lancée
en trois àcinq minutes
Entreledéclenchement d’un secours
par le médecin régulateur et le départ, il
ne doit pas s’écouler plus de trois minu
tes en semaine,cinq le weekend. Un laps
de temps particulièrement réduit pen
dant lequel l’ambulancier doit préparer
l’itinéraire, embarquer àbordduvéhicule
et récupérer le reste de l’équipe,médecin
et infirmier,généralement occupés au
service des urgences.Silelieu où doivent
se rendreles secours est situé àplus de
20 km de l’hôpital, et si les conditions cli
matiques le permettent, le Samu envoie
l’hélicoptère. Avec le Samu de Dijon, celui
de l’Yonne est le seul de la région àdispo
ser d’un service de secours héliporté.
Qu’elles se déplacent par voie terrestre
ou aérienne,les équipes de premiers se
cours adoptent toutes la même philoso
phie,qui pourrait se résumer en une
phrase :prendreletemps de ne pas per
dredetemps.«Ilnefaut pas confondre
vitesse et précipitation », remarque Gla
dys FrançoisHaugrin, cadreduSamu.
Àchacun son rôle
Lorsqu’elle arriveprès du patient, Véro
niqueDrouin, médecin urgentiste,vérifie
tout :constantes,tension, rythme cardia
que,etc.Après les soins d’urgence si né
cessaire. Le reste de l’équipe connaît son
rôle sur le bout des doigts.Del’ambulan
cier qui sait par cœur le contenu de cha
que mallette et est capable de donner les
produits adaptés en fonction des requê
tes,àl’infirmier qui effectue les premiers
relevés et prodigue les premiers soins,
jusqu’à la décision finale du médecin.
«Jem’assureque le patient est stable et
que tout est OK avant de le transporter »,
explique Véronique Drouin. La pression
est donc rare en ambulance ou dans l’hé
lico.«Letransportdoit êtreunmoment
calme parce que tout doit êtregéré avant.
On prépareaumaximum tout ce dont on
peut avoir besoin pendant le trajet », ex
plique Arnaud,infirmier.D’autant que si
un problème survient, l’ambulance est
obligée de s’arrêter et l’hélico,desepo
ser.Mais le plus souvent, le travail de
l’équipe consiste essentiellement, àcet
instant, àmaintenir la stabilité du patient
et, au besoin, àlerassurer.
Au CHA, les services du Samu et des ur
gences sont couplés.Sibien que lors
qu’un médecin prend en charge un pa
tient, il le suit depuis les premiers secours
jusqu’à son admission dans un service,
après passage aux urgences.Excepté s’il
est appelé sur une nouvelle intervention.
C’est alors l’un des praticiens de perma
nence aux urgences qui récupèreledos
sier.Sans que ces transitions ne semblent
inquiéter aucun des membres de l’équi
pe,tous habitués àtravailler pour l’un et
l’autredes services.«Nous ne sommes
pas spécialistes partout, mais nous som
mes capables de stabiliser toutes les pa
thologies aiguës », rappelle le docteur
Ibrahim Taleb,duSamu. ■
Secours
Les équipesdesecourssont rôdées aux
soins d’urgence. Si ellessont bien conscien-
tesque chaque minute compte,elles pren-
nent le temps de faire au mieux.
URGENCE. Lessecours, une fois lancés,arrivent rapidement sur les lieux d’intervention.
Christian Sigonneau aobtenu son diplôme d’infirmier en
1983, et s’est spécialisédans l’urgence, il ya20ans.
■Pourquoi vous êtrespécialisédans la médecine d’urgence ?
Je suis passé par d’autres services,mais je me suis rendu
compte que j’étais plus àl’aise dans les gestes techniques,
alors que certains collègues les fuyaient. Plus tard, j’ai es
sayé de me sauver des urgences,jevoulais m’en aller.Peut
êtreque j’étais fatigué, ou blasé. Peutêtre… Sûrement
d’ailleurs !Mais je ne suis pas allé au bout de la démarche.
■Et le Smur ? C’était l’évolution logique de ma carrière.
C’était la même chose que ce que je faisais àl’hôpital,
mais àl’extérieur.Çamesortait de la routine.Jemesuis
spécialisé dans lessorties hélico.Onvaaudevant de ca
tastrophes.Dans la gravité, c’est l’échelon audessus.
■Comment définiriez-vous votrerôle ? C’estune aide para
médicale au service du médecin et du patient. Je ne me dis
pas que je vais sauver le monde,que je vais fairedubien
ou du mal, que les patients le méritent ou pas.Ils ont un
besoin, j’yréponds avec mon savoir et mes compétences.
“L’inconvénient,quand ça dure
longtemps, c’est qu’on s’attache”
■Qu’est-ce qui rend la tâche difficile ? Ce n’est pas désagréa
blederendreservice.Même si, des fois,onleregrette.Un
jour,onasecouruquelqu’un qui avait pris son véhicule
après avoir bu. Quelques mois plus tard, il atué quelqu’un
sur la route… Je crois qu’il ne faut pas trop avoir de senti
ments,même si notrechef nous dit de fairepreuvede
compassion. Elle araison, mais il ne faut pas aller jusqu’au
bout. La population abesoin d’entendrelavérité.
■Vosmeilleurs souvenirs ? J’aime bien lesnaissances.Onfait
partie de la fête.Etaussi le fait de participer au sauvetage
d’une personne.Onsedit :“J’ai été un maillon de cette
chaîne de survie.”
■Les pires?Il yades choses très très très très difficiles
(qu’il refuse de détailler,NDLR). En raison du contexte,des
faits,delalongueur de l’intervention. L’ inconvénient
quand ça durelongtemps,c’est qu’on s’attache ;par exem
ple quand on tient la main d’une personne qui est sous
une voiturependant cinq ou six heures.Des fois,çasepas
se bien, d’autres non… Desfois,onsait qu’ils vont mourir ;
des fois,ils le savent aussi.
■Il yadelafierté, de la prétention?De la fierté oui. Mais
avec le recul, je me rends compte que je ne suis pas indis
pensable.J’ai peutêtreeucette prétention au début. Mais
on finit par se rendrecompte qu’il yaeudumonde avant,
qu’il yenauraaprès.
■De la culpabilité ? On ne peut pas aller plus loin que nos
compétences.Onn’est pas Dieu, on est là pour réparer.On
ades limites.Jenefais pas de cauchemars.C’est le fardeau
de chaque infirmier qui commence.Cequi est nouveau est
beaucoup plus marquant. Mais je n’en fais plus.
■Au crépuscule de votrecarrière, comment la regardez-vous ?
La retraite,estce que j’en ai vraiment envie… Je ne sais
pas.Jecommence àvivreensociété. C’est un métier qui
prend beaucoup de place,onadumal àêtreaveclafa
mille et àsefairedes amis.Mais je suis content de l’avoir
fait. Je préparemaretraite doucement. J’enseigne les soins
d’urgence et je suis formateur hélico.Cequi compte désor
mais,c’est de transmettremon savoir. ■
CHRISTIAN SIGONNEAU. Infirmierurgentiste.
Témoignage
«Onn’estpas Dieu»
640
C’est, en euros, le prix de
la demi-heure d’intervention
avecunvéhicule de secours
terrestre.
34
En euros, c’est le prix de la
minutedevol en hélicolors
d’une intervention héliportée
du Samu.
■LESCOÛTS ■LES MOTS DE LA MÉDECINE D’URGENCE
Samu
Serviced’aide médicaleurgente,c’est
le service de régulationmédicaledes
urgences d’une régionsanitaire(ici, l’Yonne).
Il apporte l’assistancepré-hospitalière (dans
la rue,àdomicile,sur le lieu de travail, etc.)
aux victimes d’accidents ou d’affections
soudaines en état critique. Le médecin
régulateur gère les moyens et oriente les
patientsvers les services les plus adaptés à
leur cas.
Smur
Servicemobile d’urgence et de réanimation,
il s’agitd’un service hospitalier,qui possède
une ou plusieurs Unitémobile hospitalière
(UMH),destinées àdélivrer des soins intensifs
dans le cadredel’aide médicaleurgente,
hors de l’hôpital.
Il peut aussi effectuer destransports entre
hôpitaux lorsqu’un patient nécessite des
soinsouune surveillance intensive pendant
sontrajet.
VRM
Véhicule radio-médicalisé,c’est un véhicule
léger (voiture) qui transportel’équipe
médicale(médecin, infirmier et ambulancier)
et tout le matériel permettant des
interventions d’urgence. Il est en contact
avec la régulationmédicalepar
radiotéléphonie. L’envoi d’un VRMest
complémentaire àl’envoi d’une ambulance
ou d’un véhiculedesecours et d’assistance
aux victimes (VSAV).
Primaire/secondaire
S’agissant des sorties Smur,untransport
primaire est celuiqui découle d’une
interventiondirecte sur un lieu où un patient
nécessitedes soins d’urgence.
Un transport secondaire,ouinterhospitalier,
est le transport médicalisé d’un patient d’un
hôpital àunautre. Il intervient lorsque le
malade abesoin de soins ou d’explorations
spécialisés que ne peut faire l’hôpital
d’origine.
Àtoute vitesse,maissansprécipitation
Àcœur ouvert
INTERVENTION. Unefois la décision prise par le médecin régulateur d’aller secourir un patient, l’équipe n’aque quelques minutes pour se lancer.Silelieu d’intervention est àplus de 20 km de l’hôpital, le Samu peut opterpour l’hélicoptère.

30 MARDI 11 DECEMBRE 2012
1972
Naissance de Teddy,
le 13 février,àMarseille.
1994
Teddy Alcazarentre dans
l’armée,oùilsuit une
formation pour devenir
piloted’hélicoptère.
2010
Il quittel’armée,le
1
er juillet et devient pilote
chezInaer. Après
Bordeaux et Bayonne, il
partage son temps plein
entre Auxerre et Nice.
■BIO EXPRESS
Teddy voleausecoursdes patients
S
ur le mur de son bu
reau, des cartes :au
10eou au 100e,dudé
partement et du pays,
crayonnées de toutes
parts,delongues lignes
représentants les couloirs
aériens.Des données bien
compliquées pour l’œil
novice en aéronautique.Et
bien éloignées de ce qui
fait traditionnellement le
décor des autres pièces du
Samu, plutôt composé de
directives sanitaires.
Teddy Alcazar,40ans,est
l’un des trois pilotes qui
assurent les transports en
hélicoptèrepour le comp
te du Samu. Il ne travaille
àAuxerrequ’àmitemps,
et effectue un autre50%
au Samu de Nice.AuCHA
par contre, il yatoujours
un pilote de permanence.
Teddy apassé
16 ans dans
l’armée
«Jereste cantonné à
mon rôle », remarquetil,
avant de l’expliquer en
peu de mots :«Mon bou
lot, c’est d’héliporter
l’équipe médicale sur le
lieu d’intervention le plus
rapidement possible et en
toute sécurité, puis de ra
mener le patient. »Rien
de plus,rien de moins.
Même s’il avoue qu’au dé
part, il yavait une certaine
frustration lorsqu’il ne
pouvait pas intervenir,en
général àcause du temps.
«Cesont les conditions de
volqui déterminent. Lors
que ce n’est pas possible,
je me dis qu’il vaut mieux
ça que de risquer la vie de
toute l’équipe.»
Ancien militaire, Teddy a
passé 16 ans dans l’armée,
avant de rejoindreInaer,
société prestatairedeser
vice en contrat avec l’hô
pital. Initialement, il n’a
pas de notion médicale.Il
lui afallu six mois avant
de se sentir pleinement
rodé àl’exercice.Ets’il dit
en plaisantant qu’il a
«troqué une combinaison
vertecontreune blan
che », il tient àconserver
une certaine distance avec
tout ce qui relèvedes pre
miers secours.
«Onrend service quand
il yabesoin de bras,mais
on doit se concentrer sur
la mission aéro. J’évite
d’aller me renseigner,no
tamment quand il s’agit
d’un AVP(accident sur la
voie publique) », explique
le pilote,qui refuse de voir
des horreurs de trop près.
«J’attends qu’on m’amène
le patient àl’hélico.La
plupartdutemps,jele
vois allongé et drapé.
J’évite de m’encombrer
d’images désagréables.
Nous n’avons pas de di
rectives,c’est propreà
chaque pilote.»
Il adéshumanisé la si
tuation ;dit de l’équipe
qu’elle aune «solide ar
mure»etdelamortque
«çaarriveetonlesait »;
lâche,sans médisance,
que les patients sont deve
nus comme des «colis »
pour ne pas devoir affron
ter de trop près l’aspect
souvent tragique de la si
tuation. Dont il est pour
tant bien conscient. «En
16 ans d’armée,laguerre,
je ne l’ai jamais vue.Etlà,
c’est la “guerre” tous les
jours », remarquetil.
«C’estlesymbole
de la médecine »
Sonrôle,toujours pré
sent mais un peu àl’écart,
le placedans une position
qu’iljuge parfois inconfor
table.«Onsait qu’on fait
partie d’un dispositif com
plet. Mais on se sent seul.
Et c’est un peu le cas.»
D’autant que lorsqu’il as
surelapermanence,c’est
pour sept jours complets,
du vendredi au jeudi. Loin
de sa femme et de ses
deux enfants,qui vivent
dans le sud de la France.
D’astreinte de 8à22heu
res, il dortàl’internat, au
milieu de jeunes prati
ciens qui ne parlent que
médecine.«Cen’est pas le
même monde… Ce n’est
pas facile.»
Mais le regarddupilote
s’éclaireànouveau lors
qu’il évoque l’importance
du Samu :«C’est le sym
bole de la médecine.S’ils
n’étaient pas là, une gros
se partie des patients
mourrait. »Etreconnaît :
«Jesuis assezfier de bos
ser dans une boutique
comme cellelà, j’ai l’im
pression d’êtreutile.»■
Pilote
Teddy Alcazar est pilote
d’hélicoptère. Pasformé
aux gestesd’urgence, il
évitedeseconfronterde
tropprès aux horreurs du
métieretseconcentre sur
sa mission :letransport.
TRANSPORT. Teddy Alcazar,ancien militaire, est d’astreinteauSamu d’Auxerreonzesemaines par an, l’équivalent d’un mi-temps.
MARDI 18 DÉCEMBRE
Volet n° 6. C’est aux urgences
quesepoursuivra le périple.
èè
RENDEZ-VOUS
Àcœur ouvert
1
/
3
100%