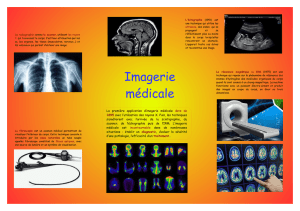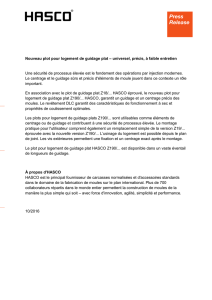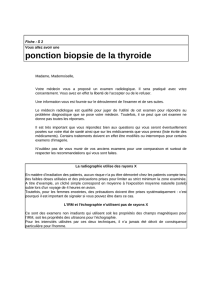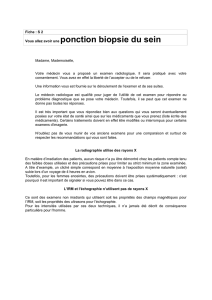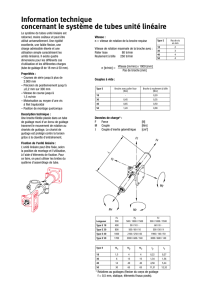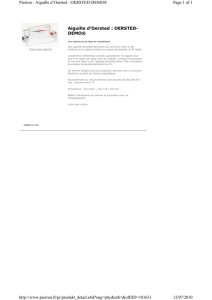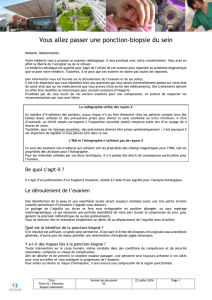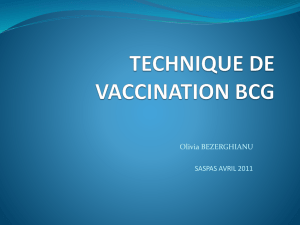échographie et scanner

33-680-A-05
Techniques
de
guidage
et
de
ponctions
en
imagerie
interventionnelle
abdominale
(échographie
et
scanner)
P.
Balageas, T.
Carteret, H.
Caillez, N.
Frulio, C.
Salut, M.
Bouzgarrou, H.
Trillaud
La
radiologie
interventionnelle
occupe
une
place
grandissante
dans
la
médecine
moderne.
La
pathologie
abdominale,
très
variée,
offre
un
champ
d’applications
vaste
au
guidage
radiologique
qui
se
retrouve
tant
dans
le
domaine
diagnostique
avec
les
biopsies,
que
thérapeutique
avec
les
drainages,
infiltrations,
et
thermothérapies.
Les
différentes
modalités
d’imagerie,
avec
en
chef
de
file
l’échographie
et
le
scanner,
guident
le
radiologue
dans
des
gestes
«mini-invasifs
»
avec
une
précision
de
quelques
millimètres.
Le
radiologue
doit
connaître
les
avantages
et
limites
de
chacun
de
ses
moyens
d’imagerie
ainsi
que
des
matériels
de
ponction
à
disposition,
afin
de
choisir
le
plus
adapté
à
chaque
geste.
La
radioprotection
des
patients
et
du
personnel
médical
doit
être
une
considération
constante
dans
la
pratique
quotidienne.
Il
est
indispensable
de
connaître
les
bonnes
indications
et
les
contre-indications
de
chaque
procédure
pour
réaliser
les
actes
dans
de
bonnes
conditions
de
sécurité.
Les
progrès
technologiques
permettent
le
développement
de
nouvelles
stratégies
de
guidage
élargissant
encore
le
champ
des
possibilités.
Les
systèmes
de
navigation
en
temps
réel
sur
table
d’angiographie
à
partir
d’acquisitions
cone-beam
volu-
métriques
combinent
les
avantages
d’une
imagerie
scanner
avec
un
guidage
fluoroscopique
en
temps
réel.
L’imagerie
de
fusion
et
la
navigation
électromagnétique
facilitent
parfois
l’accès
à
des
cibles
invisibles
en
échographie
conventionnelle
ou
sur
un
scanner
sans
injection.
©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
Mots-clés
:
Techniques
de
guidage
;
Guidage
échographique
;
Guidage
tomodensitométrique
;
Fusion
;
Navigation
électromagnétique
;
Biopsie
;
Radiofréquence
Plan
■Introduction
2
■Choix
de
la
modalité
de
guidage,
avantages
et
inconvénients
de
chaque
technique
2
Guidage
échographique
2
Guidage
scanographique
2
Guidage
multimodalité
2
■Préparation
du
geste
2
Information
du
patient
2
Prévention
des
complications
hémorragiques
3
Prévention
des
complications
infectieuses
3
Prévention
des
douleurs
3
■Règles
communes
de
réalisation
pratique
3
Positionnement
du
patient
3
Choix
de
la
voie
d’abord
4
Anesthésie
locale
4
Surveillance
4
■Matériel
de
ponction
4
Aiguilles
de
ponction
4
Système
coaxial
4
■Drainage
de
collection
5
Matériel
de
drainage
5
Techniques
de
drainage
5
■Guidage
échographique
6
Choix
du
matériel
et
de
la
technique
6
Réalisation
pratique
7
■Guidage
scanographique
9
Optimisation
des
réglages
9
Sécurisation
du
geste
par
les
techniques
de
dissection
10
Module
de
guidage
interventionnel
en
scanner
et
sur
capteur
plan
en
salle
d’angiographie
11
Applications
du
guidage
scanographique
au
foie
12
Biopsies
pancréatiques
13
Biopsies
et
drainage
de
masses
et
collections
pelviennes
14
■Imagerie
de
fusion
15
Principe
15
Fusion
d’image
et
navigation
électromagnétique
sous
guidage
échographique
15
Applications
de
la
fusion
d’images
en
guidage
échographique
16
Application
de
la
fusion
d’images
pour
un
guidage
sous
scanner
16
Guidage
électromagnétique
16
■Conclusion
18
EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
abdominale
-
digestive 1
Volume
9
>
n◦2
>
juin
2014
http://dx.doi.org/10.1016/S1879-8527(14)51571-7
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

33-680-A-05 Techniques
de
guidage
et
de
ponctions
en
imagerie
interventionnelle
abdominale
(échographie
et
scanner)
Introduction
Les
techniques
de
guidage
en
radiologie
interventionnelle
ont
permis
l’essor
d’une
activité
florissante
qui
trouve
sa
place
tant
au
niveau
d’une
prise
en
charge
diagnostique
que
thérapeutique.
Les
guidages
échographiques,
tomodensitométriques
(TDM),
fluoroscopiques,
et
en
imagerie
par
résonance
magnétique
(IRM)
ouvrent
la
porte
à
des
procédures
mini-invasives
parfois
com-
plexes
tout
en
conservant
un
maximum
de
sécurité
dans
l’acte
par
une
visualisation
précise
de
la
cible
à
atteindre,
du
chemin
jusqu’à
la
cible,
et
de
la
progression
de
l’aiguille
au
cours
du
geste.
Le
guidage
par
imagerie
voit
ses
indications
continuellement
s’accroître
dans
de
multiples
disciplines
médicochirurgicales.
La
nécessité
d’une
caractérisation
histologique,
de
typages
immuno-
histochimiques,
et
le
recours
de
plus
en
plus
fréquent
à
la
biologie
moléculaire
pour
la
mise
en
place
de
stratégie
thérapeutique
ont
rendu
quasi
systématique
la
pratique
des
ponctions–biopsies
per-
cutanées
en
pathologie
cancéreuse [1,
2].
Le
caractère
mini-invasif
des
procédures
de
drainage
de
collec-
tions
profondes
a
permis,
dans
ces
indications,
de
remplacer
une
part
considérable
des
procédures
chirurgicales.
Le
développement
des
traitements
par
thermothérapie
a
ouvert
une
place
de
choix
pour
les
procédures
de
guidage
percutané
en
oncologie.
Choix
de
la
modalité
de
guidage,
avantages
et
inconvénients
de
chaque
technique
Le
choix
de
la
modalité
de
guidage
est
souvent
multifactoriel,
dépendant
de
la
disponibilité
du
matériel,
de
la
technicité
du
geste,
des
habitudes
de
l’opérateur,
et
des
avantages
et
limites
propres
à
chaque
technique.
Il
est
indispensable
d’avoir
une
bonne
connaissance
des
moyens
aujourd’hui
disponibles
afin
de
choisir
le
plus
adapté
à
chaque
geste.
Le
guidage
par
IRM
n’est
pas
abordé
car
il
ne
trouve
à
l’heure
actuelle
que
peu
d’indications
en
pathologie
abdominale,
est
lar-
gement
limité
par
la
faible
disponibilité
des
machines
et
nécessite
un
matériel
spécifique
compatible
avec
les
champs
magnétiques.
Guidage
échographique
C’est
dans
les
années
1970
qu’ont
été
décrites
les
premières
ponctions
sous
contrôle
échographique.
Les
avantages
de
cette
modalité
expliquent
sa
large
utilisation
:
•
le
guidage
en
temps
réel
permet
une
visualisation
en
continu
du
matériel
pendant
sa
progression
vers
la
cible
;
•
la
possibilité
de
réaliser
des
coupes
dans
tous
les
plans
de
l’espace
notamment
dans
deux
plans
orthogonaux,
et
d’avoir
des
angles
d’approches
variés
est
très
utile
pour
choisir
la
voie
d’abord
la
plus
sûre
et
permettre
un
bon
repérage
dans
l’espace
;
•
c’est
un
examen
non
irradiant
à
utiliser
en
priorité
chez
les
femmes
enceintes
et
les
enfants
;
•l’échographie
offre
une
très
bonne
résolution
spatiale
des
plans
superficiels
;
•
l’utilisation
de
produit
de
contraste
permet
d’améliorer
la
visi-
bilité
des
cibles
;
•
sa
simplicité
d’utilisation
permet
de
raccourcir
les
temps
de
procédures
;
•
son
accessibilité
et
la
possibilité
de
déplacer
la
machine
d’échographie
permettent
de
réaliser
des
gestes
au
lit
du
patient,
au
bloc
opératoire,
en
salle
de
scanner
ou
sur
table
de
radiologie
avec
fluoroscopie
pour
coupler
cette
modalité
de
guidage
aux
rayons
X.
Les
échographes
portatifs
ont
maintenant
une
qualité
d’image
suffisante
pour
des
procédures
de
guidage
simple
;
•
l’absence
d’arceau
permet
une
très
bonne
accessibilité
au
patient
et
permet
également
de
réaliser
des
gestes
en
position
demi-assise
chez
les
patients
dyspnéiques
;
•
son
faible
coût
permet
une
large
utilisation
et
l’achat
de
machines
dédiées
aux
actes
interventionnels.
Ses
inconvénients
sont
les
suivants
:
•
une
accessibilité
limitée
aux
structures
profondes
par
atténua-
tion
du
faisceau
acoustique
;
•
une
détérioration
de
la
fenêtre
échographique
chez
les
patients
obèses,
avec
une
stéatose
hépatique
ou
en
cas
d’interpositions
osseuses,
aériques
digestives
ou
au
sein
d’une
collection
;
•
certaines
lésions
sont
isoéchogènes
au
parenchyme
adjacent
et
donc
mal
identifiables.
Guidage
scanographique
Les
indications
du
guidage
par
TDM
découlent
des
limites
de
l’échographie
:
•
la
TDM
offre
une
plus
grande
sécurité
pour
les
cibles
profondes
ou
en
cas
d’important
pannicule
adipeux
;
•
elle
va
permettre
un
repérage
plus
précis
des
structures
diges-
tives,
vasculaires
qui
ne
doivent
pas
être
lésées
;
•
elle
permet
un
accès
aisé
aux
poumons
et
aux
structures
osseuses.
Mais
le
guidage
scanner
présente
ses
propres
limites
:
•il
ne
permet
pas
de
suivi
en
temps
réel
lorsque
utilisé
en
mode
spiralé
ou
séquentiel.
Le
geste
est
plus
complexe
en
cas
de
cible
mobile
ce
qui
nécessite
une
participation
active
du
patient
notamment
par
la
réalisation
d’apnée
contrôlée
;
•
il
est
tributaire
des
possibilités
de
décubitus
du
patient
;
•
l’accessibilité
au
patient
est
limitée
par
la
taille
du
gantry
;
•
il
ne
peut
être
réalisé
que
dans
une
salle
de
radiologie
équipée
ce
qui
impose
la
mobilisation
de
patients
parfois
fragiles
;
•
le
repérage
des
cibles
qui
ne
sont
visibles
qu’après
injection
de
produit
de
contraste
est
délicat
dans
le
suivi
de
la
progression
de
l’aiguille
car
limité
par
le
nombre
d’injections
;
•
c’est
une
technique
irradiante [3,
4] qui
ne
doit
être
utilisée
qu’en
cas
d’impossibilité
d’un
guidage
par
échographie
pour
les
femmes
enceintes
et
les
enfants.
Guidage
multimodalité
Il
est
parfois
nécessaire
ou
judicieux
de
coupler
les
modalités
de
guidage
échographique,
TDM,
ou
fluoroscopique
afin
d’assurer
une
procédure
la
plus
sûre
possible.
L’association
courante
de
l’échographie
et
de
la
radioscopie
télé-
visée
résulte
de
leur
complémentarité
souvent
nécessaire
dans
les
actes
nécessitant
des
abords
précis,
l’opacification
de
cavités
ou
structures
anatomiques,
ou
la
mise
en
place
de
matériel
radio-
opaque
tel
que
des
endoprothèses
et
autres
drains.
Les
indications
sont
essentiellement
hépatobiliaires
et
urinaires
Les
techniques
de
fusion
multimodalités
et
guidage
électroma-
gnétique,
dernières
avancées
technologiques
dans
le
domaine,
semblent
être
une
très
bonne
solution
aux
limites
de
chaque
tech-
nique.
Les
avantages
du
guidage
en
temps
réel
échographique
peuvent
par
exemple
être
associés
à
la
résolution
en
contraste
d’un
scanner
injecté
ou
d’une
IRM.
Préparation
du
geste
L’optimisation
de
l’efficacité
et
de
la
sécurité
d’un
geste
sous
gui-
dage
radiologique
nécessite
au
préalable
une
bonne
préparation
de
la
procédure.
Information
du
patient
L’information
du
patient
et/ou
du
représentant
légal
est
une
obligation.
Le
recueil
d’un
consentement
écrit
est
fortement
recommandé.
La
consultation
d’information
se
fait
au
mieux
plu-
sieurs
jours
avant
le
geste
afin
de
laisser
au
patient
le
temps
de
réflexion
nécessaire
pour
accepter
ou
refuser
la
procédure.
Le
médecin
opérateur
va
pouvoir
expliquer
dans
un
discours
adapté
les
modalités
du
geste,
ses
objectifs
et
les
complications
poten-
tielles.
Cette
consultation
permet
de
préparer
le
geste
(choix
du
meilleur
mode
de
guidage,
recherche
de
contre-indications,
2EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
abdominale
-
digestive
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

Techniques
de
guidage
et
de
ponctions
en
imagerie
interventionnelle
abdominale
(échographie
et
scanner) 33-680-A-05
prescription
du
bilan
biologique
nécessaire,
et
information
des
précautions
préalables
au
geste).
Ce
qui
est
parfois
le
premier
contact
du
malade
avec
le
radiologue
interventionnel
va
per-
mettre
d’établir
une
relation
de
confiance
indispensable.
Cela
va
également
aider
à
diminuer
l’anxiété
du
patient.
Il
est
souvent
judicieux
de
réexpliquer
la
procédure
juste
avant
l’installation
du
patient
pour
obtenir
une
bonne
coopération
lors
des
procédures
sous
anesthésies
locales.
Prévention
des
complications
hémorragiques
Les
modalités
de
guidage
percutané
par
échographie
et
scan-
ner
donnent
accès
à
des
procédures
mini-invasives.
Cependant
les
risques
hémorragiques
restent
présents
et
doivent
toujours
être
évalués
en
pondérant
l’indication
du
geste
par
le
rapport
bénéfice–risque
hémorragique.
Ce
risque
est
évalué
avant
le
geste
par
l’analyse
de
l’hémostase
primaire,
secondaire,
et
de
la
fibrinolyse
avec
la
réalisation
de
tests
sanguins
comprenant
le
temps
de
Quick
ou
temps
de
thrombine
(TP),
le
temps
de
céphaline
activé
(TCA),
la
numération
plaquet-
taire.
Le
dosage
du
fibrinogène
et
le
calcul
du
temps
de
saignement
ne
sont
pas
systématiques
et
restent
controversés.
Les
contre-indications
classiques
d’une
procédure
de
ponction
percutanée
sont
un
TP
inférieur
à
50
%,
un
TCA
supérieur
à
deux
fois
le
témoin,
un
taux
de
plaquettes
inférieur
à
50
000/ml.
Ces
valeurs
sont
à
moduler
en
fonction
des
comorbidités
pouvant
majorer
le
risque
hémorragique
(cancer,
cirrhose,
insuffisance
rénale,
etc.)
et
du
type
de
geste
réalisé [5].
En
cas
de
traitement
anticoagulant
ou
antiagrégant
plaquet-
taire,
il
est
indispensable
d’évaluer
le
rapport
bénéfice–risque
de
leur
arrêt [6].
En
cas
de
biopsie
profonde,
les
traitements
antivitamines
K
doivent
être
arrêtés
trois
à
cinq
jours
avant,
avec
un
contrôle
de
l’International
Normalized
Ratio
(INR)
avant
le
geste.
Un
traite-
ment
par
héparine
non
fractionnée
par
voie
veineuse
doit
être
arrêté
quatre
à
six
heures
avant
le
geste,
12
heures
en
cas
de
voie
sous-cutanée,
et
24
heures
en
cas
d’héparine
de
bas
poids
molécu-
laire.
Les
antiagrégants
plaquettaires
préviennent
la
thrombose
arté-
rielle
;
10
%
des
plaquettes
se
renouvellent
tous
les
jours,
donc
il
faut
dix
jours
pour
retrouver
une
hémostase
normale.
Si
un
trai-
tement
par
aspirine
peut
être
interrompu,
un
délai
de
trois
à
cinq
jours
avant
le
geste
est
à
respecter.
Pour
certains
auteurs,
un
trai-
tement
par
aspirine
peut
être
maintenu
pour
les
actes
à
risque
hémorragique
faible
ou
modéré [7].
Pour
les
autres
antiagrégants,
notamment
le
clopidogrel,
un
délai
de
cinq
jours
est
recommandé.
Le
traitement
peut
être
repris
à
24
heures
du
geste
en
l’absence
de
complication [6].
La
gestion
du
risque
hémorragique
en
cas
de
stent
actif
est
plus
complexe,
et
doit
être
adaptée
au
geste
prévu,
aux
antécédents
cliniques
et
impose
un
avis
spécialisé
auprès
du
cardiologue
en
charge
du
patient.
Généralement,
en
cas
de
double
antiagrégation
plaquettaire,
un
traitement
sur
les
deux
peut
être
temporairement
interrompu.
Pour
certains
actes
tels
que
les
biopsies
d’organes
pleins,
il
est
judicieux
de
disposer,
en
cas
de
besoin,
de
matériel
d’embolisation
(gélatines
résorbables,
colles
hémostatiques,
etc.)
qui
peuvent
per-
mettre
de
contrôler
facilement
un
saignement
localisé.
Prévention
des
complications
infectieuses [8]
La
maîtrise
du
risque
infectieux
repose
sur
le
respect
des
pré-
cautions
standards
d’hygiène
et
d’entretien
des
appareillages
notamment
ceux
utilisés
pour
le
guidage.
Pour
limiter
les
risques
infectieux,
chaque
geste
invasif
doit
être
réalisé
dans
des
conditions
d’asepsie
chirurgicale.
Pour
un
geste
réalisé
en
salle
de
radiologie
interventionnelle,
le
patient
doit
au
préalable
faire
une
douche
antiseptique.
En
cas
d’hyperpilosité
de
la
zone
d’abord
percutané,
une
dépilation
au
moyen
d’une
tondeuse
avec
tête
à
usage
unique
précède
la
douche.
Sur
table,
les
différents
temps
de
désinfection
doivent
être
respectés
et
être
larges
autour
du
point
de
ponction
qui
est
placé
au
centre
d’un
champ
stérile
troué.
Un
premier
temps
de
détersion
est
réalisé
(Bétadine®Scrub,
Hibiscrub®)
suivi
d’un
rinc¸age,
d’un
séchage
puis
d’une
antisepsie
cutanée
alcoolique.
L’opérateur
fait
le
geste
avec
des
gants
stériles
après
un
lavage
chirurgical
des
mains.
La
sonde
d’échographie
est
habillée
de
fac¸on
stérile.
Le
contact
entre
la
sonde
et
la
protection
peut
être
fait
avec
un
gel
non
stérile.
Le
contact
entre
la
peau
du
patient
et
la
protection
est
fait
avec
un
gel
stérile
en
conditionnement
à
usage
unique
L’utilisation
d’antibiotique
en
prophylaxie
n’est
pas
sys-
tématique [9] et
les
indications
suivent
les
recommandations
de
la
Société
franc¸aise
d’anesthésie-réanimation
(SFAR)
avec
la
révision
en
2010
de
la
Conférence
de
consensus
de
1992
«Antibioprophylaxie
périopératoire
»(www.sfar.org/article/669/
antibioprophylaxie-en-chirurgie-et-medecineinterventionnelle-
patientsadultes-cc-2010).
On
réserve
l’antibioprophylaxie
aux
gestes
comportant
l’effraction
d’une
cavité
ou
d’un
organe
non
stérile,
en
ciblant
les
germes
habituellement
rencontrés
dans
la
cible.
L’antibiotique
est
administré
juste
avant
le
geste
et
pendant
la
durée
la
plus
courte
possible,
souvent
en
prise
unique.
Selon
les
recommandations
de
l’American
Heart
Association
de
2007,
l’administration
d’antibiotique
pour
prévenir
l’endocardite
n’est
pas
recommandée
pour
les
patients
qui
subissent
une
procé-
dure
sur
le
système
génito-urinaire
ou
le
tractus
digestif [10].
Selon
les
recommandations
de
2010,
les
seules
interventions
à
risque
de
bactériémie
pouvant
conduire
à
une
endocardite
sont
celles
de
la
sphère
dentaire.
Seuls
les
patients
avec
une
valve
prothétique,
un
matériel
prothétique
utilisé
pour
une
réparation
valvulaire,
un
antécédent
d’endocardite
infectieuse,
ou
une
car-
diopathie
congénitale
sont
candidats
à
une
antibioprophylaxie
pour
l’endocardite.
Pour
toutes
les
autres
interventions
(trac-
tus
respiratoire,
gastro-intestinal,
génito-urinaire,
dermatologique
ou
musculosquelettique),
l’antibioprophylaxie
n’est
pas
systéma-
tique.
Prévention
des
douleurs
De
nombreuses
procédures
peuvent
être
réalisées
sous
anesthé-
sie
locale
telles
que
les
biopsies
et
la
plupart
des
gestes
de
drainage.
L’anesthésie
générale
ou
la
neurosédation
profonde
sont
réservées
aux
procédures
plus
douloureuses
ou
justifiant
une
immobilité
parfaite
et
prolongée
(thermothérapies,
alcoolisation
hépatique,
drainage
biliaire,
embolisation
portale).
Pour
un
geste
donné,
les
douleurs
induites
pendant
et
au
décours
sont
le
plus
souvent
prévisibles.
Il
est
donc
judicieux
de
les
traiter
par
anticipation.
L’administration,
avant
la
procé-
dure,
d’antalgique
de
palier
I
ou
II
permet
un
contrôle
efficace
des
douleurs
par
une
action
très
précoce.
L’analgésie
multimodale,
en
associant
plusieurs
classes
d’antalgiques
dont
le
mode
d’action
intervient
à
différents
niveaux
des
voies
de
la
douleur,
permet
d’obtenir
une
antalgie
efficace
tout
en
évitant
les
effets
secondaires
et
surdosages.
Chez
les
patients
angoissés,
une
prémédication
par
anxioly-
tique
peut
s’avérer
utile.
Règles
communes
de
réalisation
pratique
Afin
de
réaliser
un
geste
dans
de
bonnes
conditions
de
confort
et
de
sécurité,
plusieurs
étapes
s’imposent
à
l’opérateur
quels
que
soient
la
cible
et
le
mode
de
guidage,
avant
même
la
mise
en
place
du
matériel
de
ponction.
Positionnement
du
patient
Pour
les
procédures
sous
anesthésie
locale,
le
patient
doit
être
placé
suffisamment
confortablement
pour
qu’il
puisse
maintenir
la
position
pendant
toute
la
durée
de
la
procédure.
Ce
position-
nement
doit
également
permettre
de
dégager
la
voie
d’abord
la
plus
sûre,
la
moins
contraignante
pour
le
confort
de
l’opérateur,
et
la
plus
stable
pour
le
matériel
afin
d’éviter
son
déplacement
inopportun
lié
à
son
poids.
En
cas
d’abord
hépatique
ou
rénal
sous
guidage
échogra-
phique,
le
décubitus
latéral,
voire
ventral
peut
fournir
une
EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
abdominale
-
digestive 3
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

33-680-A-05 Techniques
de
guidage
et
de
ponctions
en
imagerie
interventionnelle
abdominale
(échographie
et
scanner)
meilleure
fenêtre
échographique,
permettre
un
abord
plus
pos-
térieur,
ou
permettre
de
déplacer
des
structures
digestives.
Le
décubitus
latéral
modifie
la
profondeur
des
culs-de-sac
pleuraux,
ouvrant
le
cul-de-sac
du
côté
surélevé
et
fermant
le
cul-de-sac
le
plus
bas.
Cette
position
permet
d’accéder
à
des
lésions
sous-
diaphragmatiques
haut
situées
sans
créer
de
pneumothorax
en
passant
par
le
cul-de-sac
fermé [11].
Sous
guidage
scanographique,
le
positionnement
adéquat
du
patient
peut
permettre
au
matériel
de
ne
pas
dépasser
du
diamètre
du
gantry,
ce
qui
empêcherait
les
contrôles
pendant
le
geste.
Choix
de
la
voie
d’abord
Le
trajet
de
ponction
doit
être
le
plus
sûr
possible.
Il
est
intéressant
de
privilégier
la
graisse
et
d’éviter
les
muscles.
Les
connaissances
anatomiques
de
la
région
à
ponctionner
vont
per-
mettre
d’éviter
certaines
structures
nobles
telles
que
les
nerfs
(par
exemple,
le
nerf
sciatique
exposé
lors
du
drainage
d’une
collec-
tion
présacrée
par
voie
postérieure)
et
les
vaisseaux
(par
exemple
les
artères
épigastriques
inférieures
lors
d’un
abord
antérieur).
Les
structures
vasculaires
peuvent
être
repérées
grâce
au
Doppler
cou-
leur,
à
l’injection
de
produit
de
contraste
échographique,
ou
par
la
réalisation
d’un
scanner
avec
injection
de
produit
de
contraste
iodé.
En
cas
d’abord
hépatique,
il
est
indispensable
de
bien
repé-
rer
les
culs-de-sac
pulmonaires
dont
la
ponction
expose
au
risque
de
pneumothorax.
Sous
échographie,
ils
peuvent
être
repérés
au
cours
d’inspirations
profondes.
Il
est
souvent
préférable
d’aborder
une
lésion
par
son
grand
axe
afin
de
diminuer
le
risque
d’atteinte
de
structures
nobles
en
arrière
de
la
cible
et
pour
augmenter
la
quantité
de
tissu
lésionnel
biopsié
en
cas
de
petit
nodule.
Une
fois
le
point
d’entrée
cutané
choisi,
la
distance
entre
la
peau
et
la
limite
profonde
de
la
cible
doit
être
mesurée
pour
détermi-
ner
le
choix
du
matériel
et
connaître
la
distance
maximale
à
ne
pas
dépasser.
La
plupart
des
aiguilles
de
ponction
et
des
systèmes
coaxiaux
disposent
de
mécanismes
de
butée,
sous
forme
de
man-
chon
plastique
ou
métallique
permettant
d’adapter
la
longueur
maximale
qui
peut
être
utilisée.
Anesthésie
locale
Les
biopsies
et
drainages
sont
le
plus
souvent
réalisés
sous
anes-
thésie
locale.
L’injection
de
lidocaïne
à
0,5
ou
1
%
non
adrénalinée
se
fait
du
plan
cutané
au
plan
profond
en
suivant
le
trajet
prévu
de
ponc-
tion.
Ce
sont
essentiellement
les
plans
cutanés,
fascias
(péritoine)
et
capsulaires
qui
sont
les
plus
sensibles.
L’aiguille
d’anesthésie
ne
franchit
pas
la
capsule
hépatique
ou
rénale
;
10
à
20
ml
de
lido-
caïne
sont
le
plus
souvent
suffisants.
Il
peut
être
réalisé
un
mélange
de
l’anesthésique
local
avec
une
solution
de
bicarbonate
ce
qui
neutralise
le
pH
et
réduit
les
sensations
de
brûlure
à
l’injection.
Des
proportions
de
2
ml
de
bicarbonate
à
4,2
%
pour
10
ml
de
lidocaïne
sont
le
plus
souvent
proposées.
Ce
premier
temps
anesthésique
va
pouvoir
également
servir
à
réaliser
une
hydrodissection
des
plans
sur
le
trajet
de
ponction
en
cas
d’interposition
vasculaire
ou
digestive.
L’utilisation
d’un
mélange
équimolaire
de
protoxyde
d’azote
et
d’oxygène
est
largement
pratiquée
en
pédiatrie.
Il
associe
un
effet
antalgique
et
anxiolytique.
Il
est
également
très
utile
pour
des
procédures
courtes
chez
l’adulte,
en
association
avec
une
anes-
thésie
locale.
Son
efficacité
est
rapide
après
trois
à
cinq
minutes
d’inhalation
et
ses
effets
se
dissipent
en
quelques
minutes
au
retrait
du
masque.
Surveillance
Dans
les
suites
immédiates
d’un
geste
de
ponction–biopsie,
le
patient
va
rester
en
position
allongée,
et
l’opérateur
va
exercer
une
compression
douce
du
point
de
ponction
pendant
quelques
minutes
afin
de
diminuer
le
risque
hémorragique,
notamment
d’hématome
des
plans
superficiels.
En
cas
de
biopsie
hépatique,
un
contrôle
échographique
sur
table
dans
les
suites
immédiates
du
geste
est
conseillé
pour
permettre
de
rechercher
la
constitu-
tion
d’un
hématome
sous-capsulaire
ou
périhépatique
précoce.
Le
patient
reste
ensuite
allongé
pendant
un
temps
variable
de
quelques
heures
selon
la
procédure
(6
h
pour
une
biopsie
hépa-
tique).
Matériel
de
ponction
(Fig.
1)
Aiguilles
de
ponction
Les
cytoponctions
ont
été
largement
utilisées
à
visée
diag-
nostique
pour
la
caractérisation
histologique
car
cela
permet
l’utilisation
d’aiguilles
à
aspiration
de
petit
calibre
de
20
à
22
gauges
(G).
Classiquement
l’aiguille
à
aspiration
est
position-
née
vers
le
centre
de
la
lésion,
et
une
aspiration
est
réalisée
manuellement.
Mais
la
quantité
de
matériel,
souvent
insuffisante
avec
cette
méthode,
notamment
pour
la
biologie
moléculaire,
justifie
dans
la
grande
majorité
des
cas
l’utilisation
d’aiguilles
à
guillotine
classiquement
placées
à
l’entrée
de
la
lésion.
Le
positionnement
est
choisi
pour
assurer
un
maximum
de
pré-
lèvement
au
sein
de
la
cible.
Le
positionnement
optimal
peut
être
également
déterminé
par
le
repérage
des
portions
les
plus
nécrotiques
afin
de
centrer
le
ciblage
vers
les
contingents
vivaces.
Ce
repérage
peut
être
réalisé
au
préalable
sur
les
imageries
de
coupes
disponibles
(TDM,
IRM,
tomographie
par
émission
de
posi-
tons
[TEP]-scan),
ou
au
cours
du
geste
avec
une
échographie
de
contraste.
Le
choix
de
l’aiguille
à
biopsie
repose
sur
trois
caractéristiques
:
•
son
diamètre
exprimé
en
gauges
déterminant
le
calibre
des
pré-
lèvements
;
il
est
classiquement
de
14
à
20
G
pour
les
systèmes
semi-automatiques
et
de
12
à
20
G
pour
les
systèmes
automa-
tiques.
Le
choix
du
calibre
est
déterminé
par
la
nature
de
la
cible,
la
nécessité
d’une
quantité
plus
ou
moins
importante
de
matériel,
et
le
risque
hémorragique.
Un
calibre
de
14
G
est
asso-
cié
à
un
risque
de
saignement
significativement
plus
important
qu’avec
une
aiguille
de
calibre
inférieur [12] ;
•
sa
longueur
est
choisie
en
fonction
de
la
profondeur
de
la
cible
;
•
la
longueur
de
son
débattement
allant
de
12
à
32
mm
est
choisie
en
fonction
de
la
taille
de
la
cible.
Il
existe
des
aiguilles
réglables
dans
leur
débattement
ce
qui
a
l’avantage
de
limiter
le
nombre
de
modèles
différents
nécessaire
en
réserve.
Les
aiguilles
automatiques
vont
se
déployer
et
réaliser
le
prélè-
vement
en
un
ou
deux
temps.
Elles
sont
utiles
pour
des
lésions
plus
dures
ou
des
ganglions
en
raison
de
leur
mobilité.
Les
aiguilles
semi-automatiques
vont
permettre
un
déploiement
contrôlé
avec
un
prélèvement
dans
un
second
temps.
Il
existe
un
intérêt
en
cas
de
nécessité
de
positionnement
très
précis
contrôlé
en
temps
réel
par
exemple
en
cas
de
vaisseau
à
proximité
ou
en
cas
de
nécessité
d’un
déploiement
limité.
Système
coaxial
La
grande
majorité
des
biopsies
est
réalisée
avec
un
système
de
coaxial.
Les
avantages
sont
nombreux
:
•
une
possibilité
de
prélèvements
multiples
avec
un
seul
abord
et
donc
une
augmentation
de
la
probabilité
de
prélèvements
contributifs,
un
raccourcissement
de
la
durée
de
la
procédure,
et
une
diminution
du
risque
hémorragique
;
•
une
limitation
du
risque
de
dissémination [13] ;
•
une
manipulation
plus
facile
du
fait
d’un
poids
moindre
que
les
aiguilles
à
biopsie
et
donc
moins
de
risque
de
déplacements
inopportuns
si
l’opérateur
doit
relâcher
son
maintien
du
maté-
riel
;
•
certains
coaxiaux
disposent
d’un
stylet
à
bout
mousse
qui
per-
met
de
se
déplacer
dans
les
tissus
mous
de
manière
moins
traumatique,
de
refouler
sans
léser
des
structures
vasculaires
ou
digestives [14] ;
•
la
possibilité
de
réaliser
une
embolisation
du
trajet
de
biopsie
après
le
retrait
de
l’aiguille
à
biopsie.
Les
inconvénients
sont
une
augmentation
modérée
du
diamètre
du
système
(+1
G)
et
un
surcoût
minime.
Le
choix
du
coaxial
est
déterminé
par
le
calibre
et
la
longueur
de
l’aiguille
à
biopsie
nécessaire.
4EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
abdominale
-
digestive
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

Techniques
de
guidage
et
de
ponctions
en
imagerie
interventionnelle
abdominale
(échographie
et
scanner) 33-680-A-05
ABC
DEF
5 cm
Figure
1.
Matériel
de
ponction.
A.
Aiguille
à
aspiration
comprenant
un
axe
creux
dont
le
calibre
varie
de
20
à
22
G
et
un
stylet
à
bout
pointu.
B.
Différents
modèles
d’aiguilles
à
guillotine.
C,
D.
Biopsie
d’un
ganglion
avec
une
aiguille
à
guillotine
semi-automatique
:
aiguille
fermée
(C)
et
ouverte
(D).
E.
Système
coaxial
comprenant
un
axe
porteur
creux,
un
stylet
à
bout
pointu
et
un
stylet
à
bout
mousse.
F.
Aiguille
à
biopsie
positionnée
dans
le
coaxial
correspondant.
L’aiguille
dépasse
du
coaxial
de
5
mm
avant
même
d’être
déployée.
En
pratique,
le
système
coaxial
est
positionné
de
telle
sorte
que
le
débattement
de
prélèvement
de
l’aiguille
à
biopsie
se
projette
au
niveau
de
la
cible.
En
cas
de
cible
volumineuse,
le
coaxial
peut
être
positionné
en
son
sein.
Si
la
taille
de
la
cible
est
inférieure
au
débattement
de
l’aiguille
à
biopsie,
le
coaxial
peut
être
positionné
en
périphérie
de
la
lésion
en
l’absence
de
structure
à
risque
en
arrière
de
la
cible
par
exemple
pour
une
adénopathie
entourée
de
graisse
sous-cutanée.
Dans
le
cas
contraire,
le
coaxial
est
posi-
tionné
de
telle
sorte
que
le
débattement
calculé
ne
franchisse
pas
la
cible
comme
par
exemple
dans
le
cas
d’un
nodule
rénal
central
situé
à
proximité
des
calices
et
pédicules
vasculaires.
Le
calcul
du
débattement
doit
toujours
intégrer
le
fait
que
l’aiguille
à
biopsie
va
dépasser
de
quelques
millimètres
de
son
coaxial
avant
même
qu’il
ne
soit
déployé.
Drainage
de
collection
Le
drainage
de
collection
est
devenu
pratique
courante
dans
l’activité
du
radiologue.
Il
peut
s’agir
d’un
abcès,
d’un
biliome,
d’un
kyste
compliqué
ou
compressif,
d’un
hématome
ancien
liquéfié.
L’approche
percutanée
permet
le
plus
souvent
d’éviter
ou
de
différer
une
chirurgie
plus
invasive,
permet
d’améliorer
rapide-
ment
les
symptômes
et
si
nécessaire
permet
d’obtenir
une
docu-
mentation
bactériologique
pour
une
antibiothérapie
adaptée.
Matériel
de
drainage
(Fig.
2)
Le
choix
du
drain
est
conditionné
par
le
type
de
la
collection
et
son
siège.
•
La
plupart
des
drains
sont
hydrophiles
ce
qui
permet
leur
pro-
gression
plus
facile
dans
les
tissus.
•
Le
calibre
allant
classiquement
de
6
à
22
F
est
déterminé
par
la
densité
du
liquide
à
drainer.
Des
drains
beaucoup
plus
volu-
mineux
jusqu’à
28
F
peuvent
être
utilisés
pour
les
coulées
de
nécrose
pancréatiques
très
épaisses.
•
Les
trous
à
l’extrémité
du
drain
sont
plus
ou
moins
larges
selon
les
fabricants
pour
des
drains
de
même
calibre
interne.
Plus
les
trous
sont
importants,
meilleure
est
l’efficacité
du
drainage.
•
Leur
extrémité
est
souvent
en
«
queue
de
cochon
»
parfois
asso-
ciée
à
un
système
de
blocage
par
un
fil
à
mettre
sous
tension.
Cela
permet
l’enroulement
du
drain
dans
la
collection
de
fac¸on
non
traumatique.
•
Les
drains
double
voie
permettent
un
lavage
avec
irrigation
en
continu
de
la
collection
mais
diminuent
le
calibre
efficace
de
drainage.
Techniques
de
drainage
Trois
techniques
peuvent
être
utilisées
pour
positionner
un
drain.
•
La
ponction
directe
est
la
plus
simple
et
la
plus
rapide.
Le
drain
est
monté
sur
un
rigidificateur
creux
et
une
aiguille
à
bout
pointu.
La
collection
est
abordée
directement,
l’aiguille
est
alors
retirée,
le
drain
est
avancé
sur
le
mandrin
maintenu
en
point
fixe
puis
entièrement
retiré.
Cette
technique
est
plus
trauma-
tique
en
cas
d’erreur
de
trajectoire
et
ne
permet
pas
de
dilatation
du
trajet
préalable.
•
La
ponction
directe
tutorisée,
moins
précise,
est
précédée
d’un
abord
de
la
collection
par
une
aiguille
fine
de
20
à
22
G
qui
servira
de
support
latéral
au
drain
monté
sur
rigidificateur
et
aiguille.
Cette
méthode
permet
de
corriger
la
trajectoire
avec
un
matériel
moins
traumatisant
avant
d’aborder
la
collection.
•
La
technique
de
Seldinger
(Fig.
3)
est
plus
sûre,
mais
plus
longue.
Elle
offre
la
possibilité
de
réaliser
des
dilatations
pro-
gressives
du
trajet
avant
la
mise
en
place
du
drain.
Elle
consiste
à
aborder
la
collection
avec
une
aiguille
creuse
montée
sur
un
mandrin
à
bout
pointu.
Un
guide
rigide,
avec
une
extrémité
en
J,
est
introduit
dans
l’aiguille
après
retrait
du
stylet
pointu
et
enroulé
largement
dans
la
collection.
L’aiguille
creuse
est
retirée
et
le
drain
est
monté
sur
le
guide
avec
un
rigidificateur
EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
abdominale
-
digestive 5
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%