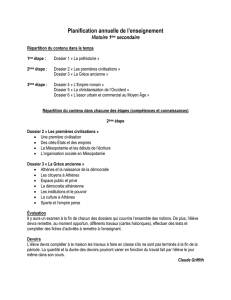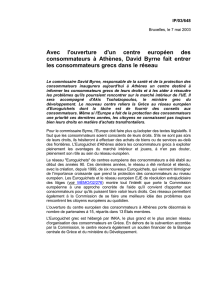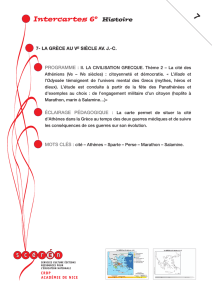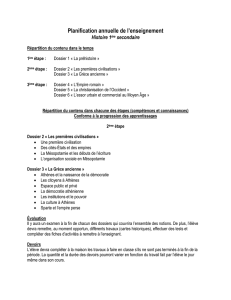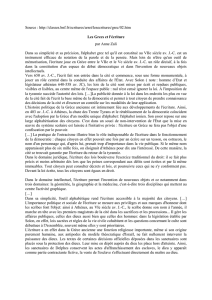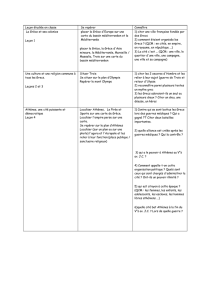histoire de la grèce sous la domination romaine

HISTOIRE DE LA GRÈCE SOUS LA
DOMINATION ROMAINE
PAR LOUIS PETIT DE JULLEVILLE
Professeur à la Faculté des lettres de Dijon, ancien membre de
l'École française d'Athènes
1875

PRÉFACE.
CHAPITRE PREMIER. — Première guerre entre Rome et la Macédoine
CHAPITRE II. — Seconde guerre de Macédoine
CHAPITRE III. — Antiochus en Grèce et Philopœmen
CHAPITRE IV. — Troisième guerre de Macédoine et triomphe du parti
romain en Grèce
CHAPITRE V. — Défaite des Achéens et destruction de Corinthe
CHAPITRE VI. — Polybe et l'organisation de la conquête
CHAPITRE VII. — État de la Grèce après la conquête
CHAPITRE VIII. — Sylla en Grèce et le siège d'Athènes
CHAPITRE IX. — Pompée en Grèce et les Corsaires
CHAPITRE X. — Cicéron en Grèce
CHAPITRE XI. — La Grèce pendant les guerres civiles
CHAPITRE XII. — La Grèce an temps d'Auguste
CHAPITRE XIII. — La Grèce au temps des Césars
CHAPITRE XIV. — Saint Paul en Grèce
CHAPITRE XV. — La Grèce sous les empereurs Flaviens et Antonins
CHAPITRE XVI. — Les Écoles d'Athènes au second siècle après J.-C.
CHAPITRE XVII. — La Grèce au troisième siècle après J.-C.
CHAPITRE XVIII. — Les Ecoles d'Athènes au quatrième siècle après J.-
C.
CHAPITRE XIX. — La Grèce au temps de Constantin et de Julien
CHAPITRE XX. — La Grèce au temps de Théodose, et l'invasion d'Alaric

PRÉFACE.
La plupart des historiens de la Grèce ont limité leur œuvre à l'époque où
l'intervention des Romains dans les affaires de ce pays en confondit en partie
l'histoire avec celle de Rome. Quelques-uns même ont pensé que les dernières
années de la Grèce libre ne méritent pas d'être racontées : le plus considérable
entre ces historiens, Grote, n'a pas prolongé son grand ouvrage au delà du récit
des luttes qui suivirent la mort d'Alexandre.
Ces dédains ne me semblent pas justifiés. Un peuple tel que le peuple grec
mérite d'être étudié même dans sa décadence; sa vie ne fut pas finie du jour où
il perdit sa liberté politique. L'influence très marquée qu'il exerça ensuite sur ses
vainqueurs et la prééminence qui lui demeura dans les lettres, dans l'éducation
des jeunes gens, ne sont-elles pas une preuve suffisante que la Grèce respirait
encore ?
Elle n'était plus qu'une province dans l'immense empire romain. Mais, à ce point
de vue même, quelle lumière ne jetterait pas sur l'histoire de l'Empire une suite
de monographies où serait étudiée, avec un détail suffisant, chacune des
provinces dont il se composait? Un tel travail a été fait déjà pour la Gaule, pour
l'Asie, pour d'autres régions encore. J'essaie ici de raconter brièvement l'histoire
de la Grèce sous la domination des Romains, sans négliger rien d'important
parmi les nombreux matériaux que nous a transmis cette époque.

CHAPITRE PREMIER. — PREMIÈRE GUERRE ENTRE ROME ET LA
MACÉDOINE. - (217-205 av. J.-C.)
La conquête de la Grèce a coûté aux Romains soixante et dix ans d’efforts ; et
n’a pas été aussi aisée qu’on le croit généralement. La Grèce, à la veille de sa
chute, était encore très forte ; elle avait une population compacte de trois à
quatre millions d’habitants ; son sol se prêtait merveilleusement à une guerre
défensive qu’elle eût pu rendre interminable. Impuissante à agir au dehors par
les armes, elle pouvait rester invincible chez elle, au moins dans les limites du
Péloponnèse. Enfin, elle avait partout des alliés ; Rome, des ennemis partout :
en Asie, à Carthage, en Espagne. La cause de la Grèce n’était donc pas
désespérée. Montesquieu ne s’y est pas trompé ; contre la plupart des historiens,
il croit « que la Grèce était redoutable par sa situation, la force, la multitude de
ses villes, le nombre de ses soldats ; sa police, ses mœurs, ses lois ; elle aimait
la guerre ; elle en connaissait l’art, » et il ajoute : « elle aurait été invincible, si
elle avait été unie1. »
Là se trouve, en effet, l’explication de sa défaite ; et tout le monde sait bien que
la Grèce périt par ses funestes divisions. Mais ce fait si connu a lui-même besoin
d’être éclairci. On croirait, à tort, qu’il régnait entre les cités des haines de races
et des rivalités permanentes. Le temps et d’autres passions plus violentes
avaient apaisé ces animosités traditionnelles, qui excitaient, deux siècles
auparavant, la guerre du Péloponnèse.
La période que nous allons étudier offre un spectacle tout différent. Alors, le
caprice des alliances, bouleversées sans cesse, rapproche pour un jour deux
villes, ennemies la veille, sans les lier pour le lendemain ; et jette chaque cité,
tour à tour, dans les partis les plus contraires. C’est qu’il y a désormais non plus
deux races en Grèce, mais deux factions dans chaque ville, qui s’y disputent le
pouvoir. Aussitôt que l’une d’elles devient maîtresse, avec une rigueur
inexorable, et dénuée de tout scrupule patriotique, elle brise les alliances
engagées ; elle va chercher dans les autres cités l’appui de la faction semblable,
et déclare la guerre à la faction rivale. Ainsi la Grèce a péri, comme on le répète
souvent, par la division ; non pas, comme on le croit, par l’hostilité des villes
entre elles ; mais par l’acharnement des factions qui déchiraient chaque ville en
particulier, et mettaient en présence, dans toutes les agoras, deux partis, ou
plutôt deux armées ennemies ; lesquelles s’appelaient encore, par tradition, les
aristocrates et les démocrates ; mais qui n’étaient en réalité que les riches et les
pauvres. La politique n’était plus qu’un prétexte dans cette lutte toute sociale. A
la fin du troisième siècle avant Jésus-Christ, les constitutions aristocratiques ou
oligarchiques étaient depuis longtemps partout tombées en désuétude. Tous les
hommes libres étant égaux, l’esclave ne comptant pas encore, la démocratie
pure régnait de fait dans tous les États. Mais l’égalité politique n’avait pas guéri
l’inégalité sociale ; elle en avait seulement rendu plus sensible l’inévitable
amertume ; et la lutte, assoupie entre la noblesse effacée et le peuple vainqueur,
s’était réveillée entre les riches et les pauvres ; c’est-à-dire entre ceux qui,
possédant quelque chose, voulaient le garder ; et ceux qui ne possédant rien,
voulaient tout prendre.
1 Considérations, etc., chap. V.

Malgré le retour possible de luttes semblables dans le monde moderne, il faut
convenir que notre état social est aujourd’hui mieux armé contre leurs
désastreuses conséquences. Le travail, source première de toute richesse (et ce
n’est pas là une banalité morale, c’est le principe même et le mieux démontré de
la science économique), le travail est au moins libre à tous, par les mœurs,
comme par les lois. Dans l’antiquité, les lois quelquefois, les mœurs presque
toujours l’interdisaient à l’homme libre ; l’esclave seul travaillait ; mais l’esclave
appartenait au riche ; ainsi le riche s’enrichissait sans cesse, et par le travail, et
par le capital ; le pauvre traînait dans une orgueilleuse paresse sa liberté
misérable, et chaque jour la pauvreté l’étreignait plus pressante. Empruntait-il
au riche ? S’acquitter, même des intérêts, lui était impossible, et la dette, tous
les jours grossie, le mettait à la merci du créancier. Cependant, la décadence des
mœurs avait rendu les besoins plus nombreux, et poussé jusqu’à la fureur
l’amour du bien-être et du plaisir. Qu’arriva-t-il au jour où la démocratie
triomphante, ayant partout renversé les constitutions aristocratiques, eut remis
le pouvoir aux mains du plus grand nombre ? C’est que la guerre fut ouverte
entre les deux classes ; elle ne devait se terminer que par la ruine de la Grèce.
Les pauvres, repoussant le travail, moyen trop lent, demandèrent la richesse à la
violence. Dépouiller les riches fut l’unique but de leur politique ; leurs moyens
furent la confiscation, l’emprunt forcé, l’impôt progressif et l’abolition des dettes
ou la suspension indéfinie des paiements. Mais les riches ne se laissèrent pas
dépouiller sans combat ; ils ne se résignèrent pas au rôle de victimes ; ils
usèrent plutôt de moyens qui ne valaient pas mieux que ceux de leurs
adversaires ; et repoussèrent souvent la violence par la violence, et la terreur
par la terreur. Cette lutte sociale allait entrer dans la période de sa plus vive
intensité par l’intervention des Romains dans les affaires de la Grèce.
Par un enchaînement singulier des événements, cette intervention se produisit
pour la première fois au plus fort de la lutte engagée entre Rome et les
Carthaginois. Polybe raconte comment, durant la seconde année de la deuxième
guerre Punique1, tandis qu’Annibal, vainqueur au Tésin, à la Trébie, semblait
déjà menacer Rome, le roi Philippe de Macédoine et les Étoliens consumaient
leurs forces dans une lutte obscure. Profitant d’une courte trêve, le roi assistait
un jour aux jeux Néméens ; un courrier se présenta ; il apportait une nouvelle
dont l’importance fit pâlir en un instant tout l’intérêt que le jeune roi prenait aux
jeux. Les Romains sont vaincus à Trasimène, leur général est tué, l’armée est en
pièces, et Annibal va marcher contre Rome. Philippe avait à ses côtés son
confident le plus cher, Démétrius de Pharos ; il lui montra les lettres qu’il venait
de recevoir, et ne les montra qu’à lui seul. Démétrius les lut ; puis, s’adressant
au roi : « Débarrassez-vous au plus vite, » lui dit-il, « de cette guerre d’Étolie, et
passez en Italie. C’est là que vous jetterez les bases de la monarchie universelle,
dont nul n’est plus digne que vous ; mais c’est maintenant qu’il faut agir, quand
les Romains sont abattus2. »
Philippe avait alors vingt ans. Il avait succédé trois années auparavant à son
oncle, Antigone Doson. Il régnait sur les Macédoniens, nation brave et
disciplinée, de longtemps faite à respecter l’autorité absolue de ses rois, prête à
les suivre dans tous les hasards, et fière de son obéissance autant que d’autres
nations le furent jamais de leur liberté. Je ne sais si l’antiquité offre un autre
exemple de ces monarchies compactes et vigoureuses, comme l’ère chrétienne
1 217 avant J.-C.
2 Polybe, V, 101.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
1
/
169
100%