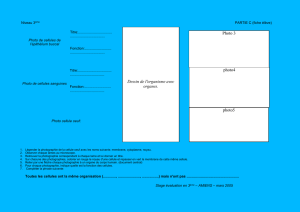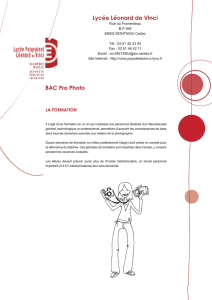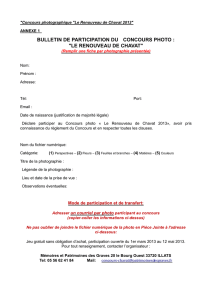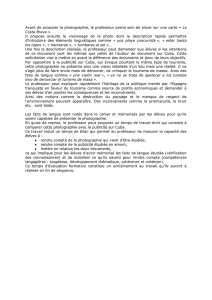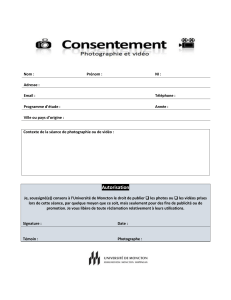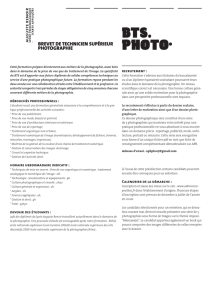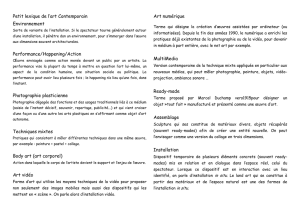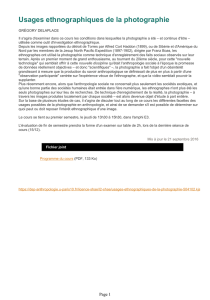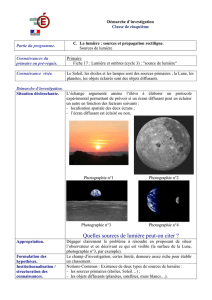Chanel Laurine Ergothérapie 2

Analyse de l’activit´e photographie en vue de son
utilisation aupr`es des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
Laurine Chanel
To cite this version:
Laurine Chanel. Analyse de l’activit´e photographie en vue de son utilisation aupr`es des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. M´edecine humaine et pathologie. 2015.
HAL Id: dumas-01219442
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01219442
Submitted on 22 Oct 2015
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,
´emanant des ´etablissements d’enseignement et de
recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires
publics ou priv´es.
Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0
International License

Institut Universitaire de Formation en Ergothérapie
- Auvergne -
U.I. 6.5 - Mémoire
d’initiation à la recherche
Juin 2015
Laurine CHANEL
ANALYSE DE L’ACTIVITE
PHOTOGRAPHIE EN VUE DE SON
UTILISATION AUPRES DE PERSONNES
ATTEINTES DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER

Remerciements
« Sous la direction de Sonia MARTIN –ROSSET, psychologue à l’Association pour une
Vieillesse Heureuse (AVIHE). »
Je tiens d’abord à remercier tout particulièrement Sonia MARTIN-ROSSET, maître
de mémoire pour son encadrement, sa disponibilité, son écoute, son soutien et ses conseils
tout au long de ce travail.
Je tiens à remercier également Mylène GRISONI, ergothérapeute et cadre de santé
qui s’est intéressée à mon travail, l’a suivi et m’a grandement aidé.
Merci à Delphine BANCEL, ergothérapeute à l’AVIHE pour son soutien et son
énergie.
Un merci particulier à ma maman, mon frère, Elodie V., Elise C. et Marie C. pour
leur patience et leur présence, dans le meilleur comme dans le pire tout au long de ma
formation.
Merci à mes camarades de promotion, sans qui ces trois années n’auraient pas été si
mémorables, ainsi que pour leur aide, leur soutien et leur humour tout au long de ces années
et de ce travail.

1
SOMMAIRE
INTRODUCTION ................................................................................................................. 2
1. PROBLEMATIQUE PRATIQUE........................................................................................ 3
1.1 La démence ............................................................................................................ 3
1.2 L’ergothérapie ....................................................................................................... 8
1.3 La photographie ................................................................................................... 13
2. PROBLEMATIQUE THEORIQUE ................................................................................... 17
2.1 Le Modèle de l’Occupation Humaine ................................................................. 17
2.2 Le concept de l’identité ....................................................................................... 22
3. L’ETUDE ................................................................................................................... 27
3.1 Méthode ............................................................................................................... 27
3.2 Analyse d’activité ................................................................................................ 28
3.3 Discussion ............................................................................................................ 36
CONCLUSION ................................................................................................................... 45
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES

2
Introduction
Le secteur de la gériatrie est en pleine expansion du fait de l’évolution
démographique de la population de personnes âgées en France. Ce phénomène est
principalement dû au pic de naissances observé après la Seconde Guerre Mondiale et à
l’augmentation de l’espérance de vie corrélée à l’évolution technique et technologique de la
médecine. En effet, l’INSEE estime qu’en 2050, la population des personnes de plus de 60
ans représentera 32% de la population totale (Robert-Bobée, 2006).
C’est à l’occasion d’un stage en Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) lors de ma seconde année d’études que j’ai pu aborder la
pratique de l’ergothérapie auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. J’ai pu
me rendre compte que cette maladie pouvait atteindre des tranches d’âges très variées et que
les retombées de la maladie en termes de vie quotidienne, de loisirs et d’estime de soi étaient
importantes.
Pratiquant moi-même la photographie et constatant que les images sont
omniprésentes dans le quotidien, je me suis alors demandé quelle pouvait être la place de
l’activité photographique dans la pratique de l’ergothérapeute en gériatrie.
Afin d’aborder cette problématique, mon étude s’appuie sur trois axes de travail. Pour
commencer, je définirais les domaines de ma problématique pratique en basant mes propos
sur une recherche bibliographique. Cette première partie me permettra de faire un état des
lieux de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et de l’utilisation actuelle de la
photographie. Je pourrais alors dégager ma question de recherche et par la suite, apporter un
cadre théorique et conceptuel à mon étude. J’exposerais enfin le protocole de cette étude,
puis détaillerais les implications thérapeutiques de la photographie, les limites de l’étude et
les pistes de réflexion apportées par ce travail.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
1
/
79
100%