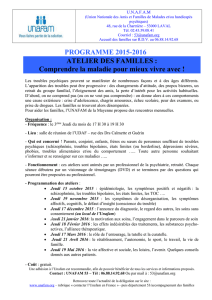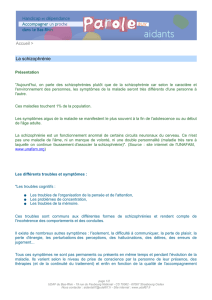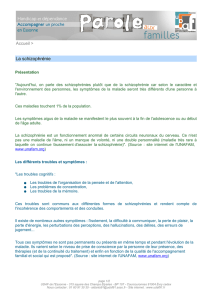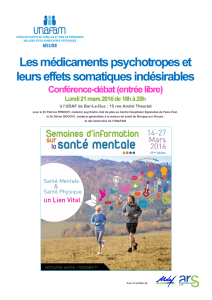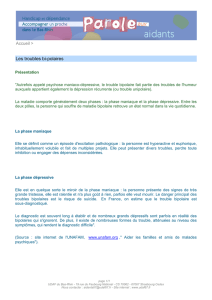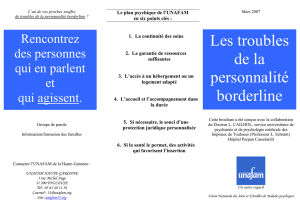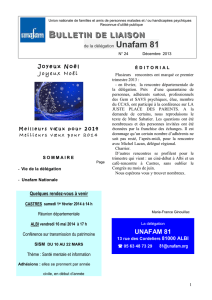Voir - Unafam

Actualités
UNAFAM 92
UNAFAM Délégation des Hauts-de-Seine - 4 rue Foch - 92270 BOIS-COLOMBES
Courriel : 92@unafam.or g / Site : www.unafam.org/92-Hauts-de-Seine.htlm
Téléphone, répondeur, accueil familles : 01.46.95.40.92 - Secrét. Admin. : 09.62.37.87.29
La rélocalisation des lits de psychiatrie dans les Hauts-de-Seine :
de nouvelles étapes annoncées
Il faut rappeler tout d’abord que sont encore localisés à Clermont dans l’Oise (60) les lits
d’hospitalisation de Courbevoie et Neuilly-sur-Seine ; à Moisselles dans le Val d’Oise (95),
les lits de Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Asnières, Clichy et Levallois-Perret, et à
Villejuif dans le Val de Marne (94) les lits de Vaucresson, Garches, Saint-Cloud, Boulogne-
Billancourt, Marnes la Coquette, Ville d’Avray et Sèvres : soit 8 secteurs de psychiatrie sur
les 20 qui couvrent le département des Hauts-de-Seine.
Monsieur Christophe DEVYS, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’IDF, a
annoncé à la Conférence de Territoire des Hauts-de-Seine les étapes fixées à ce dossier
« Relocalisation » :
- Avant le 1er janvier 2018, relocalisation du secteur de Courbevoie à l’hôpital Max-
Fourestier de Nanterre (1), et du secteur de Neuilly-sur-Seine à la clinique de la MGEN à
Rueil-Malmaison.
- L’étape suivante sera la relocalisation des 4 secteurs de Moisselles (Gennevillers, Ville-
neuve-la-Garenne, Asnières, Clichy et Levallois-Perret) pour lesquels l’ARS et la préfecture
unissent leurs efforts afin de trouver un terrain où construire un établissement regroupant
ces 4 secteurs. Les villes de Gennevilliers, Clichy, Asnières sont activement prospectées.
Dans le même temps, l’ARS demande aux établissements liés aux secteurs Nord des
Hauts-de-Seine (2), de bâtir un projet d’organisation de la prise en charge des personnes
concernées par les troubles psychiques tant en structures hospitalières qu’en structures
de proximité (3), indispensables pour une prise en charge sans rupture.
Ce travail est malheureusement ralenti par la création des groupements hospitaliers de
territoire (GHT) concernant tous les hôpitaux publics quelle que soit leur spécialité, prévue
dans la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016
- Enfin, la troisième étape annoncée, concerne le lancement dès juin 2016 de l’étude con-
crète de relocalisation des secteurs encore dans le Val-de-Marne (Vaucresson, Garches,
Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, Marnes la Coquette, Ville d’Avray et Sèvres ). En effet,
lors de l’étude réalisé pour le Nord du département, l’ARS a reçu des offres de contribu-
tions excédant largement les besoins pour répondre à l’objectif. La complexité des diffé-
rentes démarches liées aux règles de l’urbanisme, demandes d’autorisation,…, étant très
chronophages, nous incite à la plus grande vigilance pour le suivi de ce dossier.
Il faut retenir que Monsieur Christophe DEVYS confirme la priorité que constituent ces
étapes dans le projet régional de santé et nous savons que ses services travaillent active-
ment dans ce sens.
Chacun d’entre nous peut participer aussi à cette action en ne manquant pas d’évoquer le
sujet auprès de ses interlocuteurs municipaux qui doivent aussi se préoccuper de cette
forme de maltraitance des patients et des familles que constitue l’éloignement, dans une
discipline qui se conçoit dans la proximité.
(1) Où se trouve déjà les secteurs de Nanterre et Bois-Colombes/ La Garenne Colombes. Ce dernier
étant géré complétement par Roger Prévot de Moisselles./ (2) L’hôpital Roger Prévot (à relocaliser),
l’hôpital Louis Mourier (Colombes), l’hôpital Max Fourestier (Nanterre) et la clinique de la MGEN
(Rueil-Malmaison). /(3) Ont été aussi associés, mais dans une moindre mesure, Espérance Hauts-de
-Seine (EHS) et les Amis de l’Atelier.
•
Participation de l’Unafam 92 au Colloque :
« CLINIQUE DES PASSAGES : DE L’ADO-
LESCENCE A L’AGE ADULTE »……..
Michel Girard
Président délégué
Atelier d’entraide Prospect Famille : les 18, 19 & 20 Novembre 2016 à Bois-Colombes
Animés par des bénévoles formés par l’Unafam, les Ateliers d’entraide Prospect Famille permettent aux partici-
pants d’échanger leurs expériences face aux difficultés qu’ils rencontrent et de construire ensemble des savoir-
faire efficaces. Ces Ateliers ont pour objectif d’aider les familles à prendre du recul, à développer un réseau
d’entraide et à développer confiance en soi. Composés de 10 modules, ils durent 20 heures et sont ouverts à
toute personne touchée par les troubles psychiques d’un proche, qu’elle soit adhérente ou non à l’Unafam.
Pour vous inscrire : au 09.62.37.87.29 ou par mail : 9[email protected]g.

Page 2 Actualités UNAFAM 92 Mars 2015 - N°8 Page 2 N° 12 - septembre 2016 Actualités UNAFAM 92
Projet Associatif de l’UNAFAM : résultats de la consultation
Dans le cadre de l’élaboration de son projet associatif 2017–
2021, l’UNAFAM a engagé une démarche de consultation de
ses adhérents et bénévoles, afin de recueillir leurs avis sur
quatre thèmes qui concernaient le positionnement à venir de
l’association. Le questionnaire a été diffusé à plus de
14 000 personnes. Il y a eu 2 000 réponses.
Comme annoncé dans notre précédent bulletin, la délégation
UNAFAM du 92 a souhaité organiser une réunion-débat avec
ses adhérents, en avançant notre assemblée annuelle au 9
avril dernier, afin de clarifier les enjeux autour de ces quatre
thèmes. Une soixantaine d’adhérents ont participé à cette réu-
nion, nous les remercions, ceci a permis des échanges animés
dont les résultats apparaissent ci-dessous :
Le premier thème sur l’élargissement du périmètre de
l’UNAFAM aux personnes malades a obtenu une réponse
nuancée : négative quant à l’élargissement pur et simple aux
personnes vivant avec une maladie psychique (l’UNAFAM reste
dans une logique de soutien aux familles par l’entraide de pair
à pair), positive quant au soutien à apporter aux associations
de personnes malades sans famille, à la rue, en prison. La ré-
ponse de la délégation est ainsi à l’inverse du résultat de la
consultation au niveau national (60% des réponses sont en
faveur de l’élargissement du périmètre).
Le deuxième thème qui portait sur l‘organisation de la gouver-
nance (union ou fédération) a obtenu une réponse à l’unanimi-
té en faveur de l’union (81 % au niveau national). C’est donc le
statu quo qui l’emporte largement : une union avec des déléga-
tions départementales et une représentation régionale adaptée
à la nouvelle organisation territoriale.
Le troisième thème concernait la position de l’UNAFAM vis-à-vis
des structures sociales et médico-sociales. Bien que ce thème
reste le plus clivant auprès des adhérents, 90 % des per-
sonnes présentes à la réunion ont souhaité que l’UNAFAM de-
meure une association qui ne gère pas de structure (73 % au
niveau national) ; 100 % qu’elle appuie fortement leur création
(94 % au niveau national) et 90 % qu’elle veille aux bonnes
pratiques dans les établissements (71 % au niveau national).
Et enfin le dernier thème, sur l’action en justice de l’UNAFAM,
c’est-à-dire la possibilité d’ester en justice, a obtenu à la quasi-
unanimité des personnes présentes une réponse favorable (93
% au niveau national).
"Le processus d’élaboration du projet associatif se poursuit
avec d'autres éléments concernant les valeurs à privilégier par
l'UNAFAM, les axes prioritaires d’actions , etc. Ces éléments et
les nuances que montrent les différents résultats de la consul-
tation vont être pris en compte dans un début de trame du pro-
jet.
Différentes étapes auront encore lieu avec plusieurs consulta-
tion des délégués régionaux et départementaux. Ceux-ci pour-
ront en débattre avec les adhérents. La lettre de la présidente
assurera aussi un relais des réflexions. Le conseil d'administra-
tion en viendra à l'adoption du projet associatif qui pourra alors
être soumis à la ratification de l'assemblée générale de 2017.
ANNE BOUZEL, infirmière en psychiatrie et psychologue, rejoint l’Unafam 92
C e t t e a n n é e ,
l’UNAFAM 92 a eu le
plaisir d’accueillir
parmi ses bénévoles
Anne BOUZEL, qui
vient d’achever sa
carrière à l’hôpital
Sainte-Anne en tant
qu’infirmière psychia-
trique . Avec un par-
cours enrichi par deux
autres diplômes—
Psychologie clinique et pathologique (Paris V) et un Diplôme
Universitaire « L’Attachement : concepts et applications » (Paris
VII), elle se dispose à aider les familles de l’Unafam en assu-
rant :
Une permanence sur R.-V., à partir d’octobre 2016, de 11h
à 16h tous les 3ème jeudi du mois à la Mairie Annexe répu-
blique - 100, rue de la république à Suresnes. Cette perma-
nence aurait pour objectif d’informer les familles qui le sou-
haitent sur l’organisation des soins psychiatriques. Les R.-V.
sont à prendre à la délégation du 92 au 09.62.37.87.29.
L’animation d’un groupe de parole dans nos locaux à Bois-
Colombes (au 4 rue Foch), le 3ème jeudi du mois , de
18h30 à 20h30. Pour toute information et inscription à ce
groupe contactez-nous : par téléphone au 09.62.37.87.29
ou par mail : 92@unafam.org.
Anne Bouzel a connu l’Unafam dans l’exercice de son activité
professionnelle et par son époux, psychiatre hospitalier inter-
venant à des conférences organisées par l’Unafam 91.
Après avoir rencontré notre délégué sur sa commune, elle a
participé à une des réunions mensuelles d’information et
d’échange entre familles animée par Michèle BARREAU, res-
ponsable de l’antenne sud de l’Unafam 92.
Anne témoigne de cette rencontre : « J’ai été très touchée par
les échanges des personnes présentes, des échanges très
riches, très intéressants. Après plusieurs années dédiées à
écouter les patients et ponctuellement leur famille, c’est un
autre point de vue et d’une certaine manière une autre partie
de la réalité que je découvre. J’ai eu envie de m’engager et de
travailler de plus près avec ces familles. J’espère pouvoir con-
tribuer en apportant un point de vue professionnel aux ques-
tions que les familles peuvent se poser».
Nous la remercions vivement pour cet engagement et lui sou-
haitons la bienvenue !
Eliane Collombet
Le Bureau de l’UNAFAM 92
« L'avenir tu n'as pas à le prévoir, tu as à le permettre. »
Antoine de Saint-Exupéry

Page 3 N° 12 - septembre 2016 Actualités UNAFAM 92
Atelier Son-Vidéo au CMP Guy de Maupassant de Colombes :
Une aventure réussie!
L’année dernière, nous avons assisté à la Salle du Tapis Rouge à Colombes, à la projection des deux films
de l’Atelier Son et Vidéo réalisés par Victor GAMBARD avec les patients du Centre Médico-Psychologique
Guy de Maupassant de Colombes. Cet atelier, démarré en 2012 comme un atelier de musique, a évolué
vers l’Atelier Son et Vidéo depuis maintenant deux ans.
Enchantés par la qualité technique de ce travail et par le plaisir exprimé par tous les participants dans les
extraits du tournage, nous sommes allés à leur rencontre pour une interview !
Nous avons été reçus par Gilles, Hélène, Josette, Philippe, et
Shahdad, des participants de l’atelier Son-Vidéo; Victor Gam-
bard, musicien qui anime l’Atelier; Khadija Hsaine, infirmière,
et le Dr Véronique Charlot, responsable médical du CMP.
Autour d’un café, ils nous ont raconté l’histoire de cette belle
rencontre et d’une grande aventure qui dure depuis 4 ans :
Unafam 92: Comment ce projet a-t-il démarré ?
Victor : « Il y a 4 ans le Dr Charlot m’a proposé d’animer un
atelier musique au CMP. La première année, nous avons tra-
vaillé en partenariat avec l’atelier « écriture » animé par Jo-
hanne Valente, psychologue. Nous avons écrit des chansons,
nous les avons interprétées, enregistrées, et produit des CD.
Pendant cette première année, nous avons fait un premier
petit film avec quelques images en noir et blanc et puis nous
avons tenté aussi quelques séquences de doublage avec un
extrait de dessin animé.
L’année sui-
vante, nous
avons conti-
nué à faire de
la musique, à
produire des
chansons, et
pendant toute
l’année nous
avons filmé les déroulements des séances : l’enregistrement
des chansons, mais aussi toutes les séquences de doublage.
Comme je suis encadré par des infirmières ou des psycho-
logues au cours des séances, tout le monde a filmé un peu, et
cela a donné le film « Chut ! ».
Comme cela amusait beaucoup tout le monde, nous avons
changé le projet l’an dernier, et nous nous sommes dédiés
presque uniquement à la vidéo, en créant cette petite chaîne
de « télé virtuelle » qui s’appelle « HDJ T.V ». Cela ouvre des
perspectives plus larges, c’est-à-dire qu’on n’est plus limité à
faire que de la musique, la vidéo est un outil assez excitant et
créatif ! Cette année, nous avons produit la deuxième saison
de HDJ T.V. qui est en phase de finalisation (elle sera prête
vers la mi-septembre).
Pendant les tournages tout le monde a partagé toutes les
tâches liées à la production de la vidéo: tenir le micro, la camé-
r a … L ’ é q u i p e
(infirmières, psycho-
logues) a participé
aussi (maquillage,
habillage,…), et
elles jouent dans
c e r t a i n e s sé -
quences. Par ail-
leurs, le dr Charlot
a joué aussi !
Hélène : « Ce n’était pas toujours facile, mais finalement ça a
bien marché ».
Khadija: « C’est un atelier ouvert. On peut recevoir des per-
sonnes tout au long de l’année : parfois les patients partent
et reviennent après, en fonction de leur situation familiale ou
de leurs projets personnels (des patients qui reprennent du
travail, par exemple). Il reste donc ouvert à tous les patients
du CMP Guy de Maupassant, de l’hôpital de jour mais aussi
du CATTP. C’est un des rares ateliers où l’on peut vraiment
intégrer tout le monde, toucher le plus de personnes, et tous
sont très intéressés. »
Gilles : « C’est que Victor est patient. C’est difficile de dire le
texte la première fois, il y a des termes qu’on prononce mal,
alors il nous fait répéter plusieurs phrases. Il faut vraiment de
la patience parce que ce n’est pas évident… ».
Dr Charlot : « Vous aussi vous êtes patients alors, vous accep-
tez de refaire, de répéter … »
Josette : « On essaie parce qu’on apprécie ce qu’on fait ! Il y a
le contentement de soi aussi. Il faut aller jusqu’au bout.»
Gilles : « Ça nous fait passer une journée tranquille, comme ça
on oublie nos soucis… pour cette nouvelle saison on essaie de
faire mieux , et j’espère qu’on refera encore l’année pro-
chaine. »
Khadija: « C’est vrai que c’est beaucoup de travail pour les
patients, tout ce qu’on leur demande… pour les avoir vu tra-
vailler, ce ne sont pas des conditions toujours faciles : ça peut
durer plusieurs heures, il y a les projecteurs, on a chaud, on
est fatigué et il faut rester debout, se concentrer … mais mal-
gré tout ils y tiennent beaucoup ! C’est vrai que Victor les en-
courage et les valorise énormément !
Victor : « En fait c’est passionnant, c’est un plaisir… J’ap-
prends beaucoup aussi. La vidéo, c’est nouveau pour moi, j’ai
toujours aimé mais je n’avais pas le temps de le faire, il y avait
d’autres priorités, et le fait que ce soit devenu l’objectif du
travail d’une année… j’ai franchi le cap ! Peut-être que je vous
semble patient mais je prends énormément de plaisir à faire
ce travail ... Il y a une confiance qui s’est installée entre nous
et à partir du moment où ils acceptent de faire quelque chose
que nous avons décidé ensemble, il y a un vrai investisse-
ment, un engagement, et tous vont au bout du tournage
même si parfois c’est difficile. »
UNAFAM 92 : Qu’est-ce qu’on va voir dans « HDJ T.V» 2ème
saison ?
Victor, Josette, Hélène : « On va retrouver la plupart des émis-
sions qui étaient déjà dans la première saison : la présenta-
tion du journal, la météo, des reportages à l’extérieur, des
chansons,…, mais encore une émission littéraire, un jeu télé-
visé (type « question pour un champion ») ». « C’était un gros
travail ! » . « Nous avons vu l’exposition PICASSO-MANIA au
Grand Palais avec un guide rien que pour nous. Après, on est
revenu pour interviewer les personnes à la sortie de l’ex-
po. C’était très bien ça! »

Page 4 N° 9 - Septembre 2015 Actualités UNAFAM Page 4 N° 12 - septembre 2016 Actualités UNAFAM 92
Unafam 92: Qui est le destinataire de vos productions ?
Victor : « Déjà nous, c’est un projet commun et le vrai objectif
est de le faire pour nous-mêmes; après, depuis que nous pro-
duisons des vidéos, nous avons eu la chance que ça puisse
être projeté, notamment au Tapis Rouge à Colombes, mais aus-
si dans le cadre des premières Rencontres VIP (Vidéo Imagi-
naires en Partage) organisées par le CATTP de Levallois Perret.
Quatre ateliers ont participé : Montrouge, Asnières, Levallois et
nous, de Colombes.
C’est important de pouvoir, à un moment donné, partager le
travail pour avoir un retour, parce que c’est valorisant et parce
que ça motive, on en a besoin pour continuer, mais ce n’est
pas toujours facile pour tout le monde de l’accepter… participer
c’est une chose, être devant la caméra c’est déjà un gros tra-
vail, mais être vu par tout le monde, accepter que ce soit diffu-
sé c’est une autre chose…
En même temps, ce n’est que depuis une petite année qu’on
commence à
m o n t r e r
notre travail,
on com-
mence petit
à petit à
prendre l’ha-
bitude que
ce soit proje-
té… C’est un
long chemin
pour accepter tout ce que cela implique, mais ça progresse.
Dr Charlot : « Tous les ans il y a les « Rencontres en santé men-
tale » organisées à « La Villette ». Ce festival projette des pro-
ductions comme la vôtre venant des CMP de toute la France.
Si vous souhaitez y participer, nous pouvons nous inscrire. »
Unafam 92 : Après ça, ce sera Cannes !! (Rires !)
Khadija : « Pour le grand public, c’est vrai qu’il y a encore la
crainte de la stigmatisation de la psychiatrie et nous le respec-
tons totalement. Par contre, les participants sont d’accord pour
que les films soient diffusés dans le cadre du réseau de soins,
comme un outil d’échange avec les professionnels d’autres
CMP, par exemple. »
Unafam 92 : « Nous sommes ravies de vous rencontrer et de
voir la dynamique que vous inspire ce travail. Soyez les bienve-
nus pour une projection exclusive pour nos adhérents qui,
nous sommes sûres, vont apprécier vivement vos films. Nous
vous souhaitons beaucoup de succès et à très bientôt ! »
Le Dr Anne Perret, responsable médicale du service de psychia-
trie pour adolescents à Louis-Mourier, propose une prise en
charge pluridisciplinaire adaptée à la psycho-dynamique de
l’adolescence en tenant compte des dimensions familiale, pé-
dagogique et sociale. Le projet de soin, centré sur une pratique
clinique et institutionnelle, est couplé à des ateliers artis-
tiques .
Soutenu par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, ce
nouveau dispositif répond aux besoins des adolescents du nord
du département du 92 âgés de 12 à 17 ans. Ce territoire est
jusqu’à présent confronté à de grosses carences en matière de
prise en charge des patients de cette tranche d’âge en particu-
lier en terme de lits d’hospitalisation de psychiatrie adoles-
cent : pas d’aval des urgences, longs délais d’attente pour une
hospitalisation, inadaptation des lieux d’hospitalisation actuels,
difficulté d’accès aux soins des adolescents ne consultant pas
spontanément dans les structures classiques.
L’unité d’hospitalisation qui doit ouvrir ses portes en sep-
tembre 2016 comprendra 12 lits d’hospitalisation complète,
pour des séjours de 3 semaines à 3 mois, ainsi que 2 places
de jour. Elle accueillera les adolescents pour les pathologies
nécessitant un cadre de soin spécialisé et contenant : dépres-
sion, épisode psychotique aigu, psychose émergente, réactiva-
tion aiguë de certaines pathologies infantiles, anorexie,
troubles de la personnalité, troubles narcissiques, troubles post
-traumatiques, addictions…. D’accès rapide, elle proposera des
modalités d’hospitalisation diversifiées en aval des urgences,
après évaluation : hospitalisations programmées, hospitalisa-
tions pour évaluation, hospitalisations séquentielles, hospitali-
sation de jour et de nuit.
Cette unité constitue une partie d’un dispositif plus large qui
propose une offre de soin à géométrie variable adaptée à
chaque moment de la trajectoire du jeune et qui associe une
équipe mobile et une équipe de liaison actuellement fonction-
nelles :
- L’équipe mobile constituée du Dr Joachim Getzel, psy-
chiatre, d’Isabelle Tur, infirmière et de Mathilde Harmand,
éducatrice constitue l’interface entre la ville et l’hôpital. Cette
équipe a une fonction de coordination du travail de réseau et
de facilitation de l’accès aux soins (jeunes déscolarisés, cloi-
trés à domicile..). Elle vise à retisser de la continuité dans la
trajectoire de soin. Les interventions se situent au plus près
du milieu de vie des jeunes et peuvent être directes (visite à
domicile, consultations en milieu scolaire, éducatif…) ou indi-
rectes (équipes éducatives, foyers, milieu scolaire, équipes
judiciaires, équipes de prévention…). L’équipe mobile peut
également intervenir dans les hôpitaux du territoire, aux ur-
gences, en pédiatrie, en psychiatrie adulte. Elle évalue et pré-
pare les hospitalisations et assure les relais en post-
hospitalisation, ce qui permet d’asseoir l’amont et l’aval de la
future unité d’hospitalisation de psychiatrie adolescent. Elle
est particulièrement adaptée aux adolescents souffrant de
problématiques psychosociales complexes.
- L’équipe de liaison avec le Dr Victoire Vierling, psychiatre et
Margot de Rochefort, psychologue, intervient aux urgences et
en hospitalisation pédiatrique pour les pathologies réaction-
nelles de l’adolescence et pour les pathologies à intrication
somatopsychique (tentatives de suicide, somatisations,
troubles des conduites alimentaires, pathologies somatiques
chroniques, maltraitance…).
Un nouveau dispositif pour les adolescents du Nord des Hauts-de-Seine :
L’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents à l’Hôpital Louis Mourier
Dr Joachim Getzel
Equipe Mobile pour adolescents
Hôpital Louis Mourier
Michèle Barreau, Eliane Collombet & Danièle Comparin

Page 5 N° 12 - septembre 2016 Actualités UNAFAM 92
« LA PLACE DES FAMILLES »
Nous devons commencer par préciser de quelle famille nous
parlons : si nous pensons, comme le font les thérapeutes fami-
liaux, le patient dans sa famille, il est, en ce sens, aussi « la
famille » ; mais si nous pensons le patient et sa famille, la fa-
mille prend la forme de « l’entourage familial ». Cette question
se pose d’emblée à notre écoute selon notre profession et l’ins-
titution qui encadre notre rencontre avec le « patient ». Aussi,
elle est au cœur des réflexions que j’aimerais vous apporter
aujourd’hui à partir de mon expérience de psychologue travail-
lant avec une équipe d’une cinquantaine de bénévoles - tous
concernés par les troubles psychiques d’un de leurs membres
(d’un proche) - au sein d’une association de familles (UNAFAM)
dont la mission principale est d’accueillir d’autres familles
(entourage familial) en quête d’information et de soutien.
Mon propos portera aujourd’hui, plus précisément, sur la place
à accorder (ou non) à « l’entourage familial » dans la prise en
charge du patient : sachant que les positionnements adoptés
découleront, nécessairement, des représentations que nous
avons de la participation de cet entourage dans l’origine ou le
maintien des symptômes du patient.
Or ces représentations ont subi des changements importants
au cours du siècle dernier. Très schématiquement, nous (1)
avons synthétisé cette évolution en 4 grandes étapes permet-
tant une mise en perspective des différentes représentations
de la famille au cours de l’histoire de la psychiatrie contempo-
raine.
Cette histoire commence dans l’après-guerre, moment où s’ini-
tie le glissement des soins de l’hôpital vers la cité avec le déve-
loppement de la politique de secteur dans les années 1960.
1. Dans ce moment de l’après-guerre, la famille est considé-
rée comme un milieu pathogène dont il faut extraire la per-
sonne malade, le thérapeute viendrait réparer les torts d’autre-
fois. Ainsi, pour soigner la personne malade, il faut alors l’iso-
ler de sa famille.
2. Cette représentation va évoluer, dans le contexte d’une
époque contestataire où la famille, comme la plupart des insti-
tutions, sera perçue comme un lieu enfermant, aliénant. C’est
le mouvement de l’antipsychiatrie. Dans cette approche, pour
soigner la personne malade il faut soigner la famille. C’est le
début des thérapies familiales.
3. Dans un troisième temps, une approche plus complexe com-
mence à se mettre en place, la famille pouvant être à la fois
fragilisée et aidante. La notion de « thérapie avec la famille »
plutôt que « thérapie de la famille » a permis de sortir d’une
vision essentiellement pathologique des liens familiaux et
d’être attentif aux ressources de ces liens pour la personne
malade (c’est la notion d’alliance thérapeutique). Pour soigner
la personne malade il faut soutenir la famille.
4. De nos jours, les familles de patients souffrant de psychoses
graves sont considérées comme des familles « normales » con-
frontées à une maladie ou un ensemble de maladies d’origine
cérébrale. Cette approche fait rentrer les troubles psychia-
triques dans le champ de la médecine générale : pour soigner
la personne malade, comme dans la majorité des maladies au
long cours, la famille doit participer et dans une certaine me-
sure, prendre le relais des soins. Nous arrivons ainsi à la notion
d’aidant familial.
Force est de constater qu’entre la première et la dernière étape
nous assistons à un véritable changement de paradigme en ce
qui concerne la place de la famille ! Selon le sociologue Nor-
mand Carpentier, « historiquement, la famille est d’abord consi-
dérée comme la « cause » des problèmes de santé avant de
devenir, dans un contexte de désinstitutionalisation de la psy-
chiatrie une « solution » pour maintenir la personne dans son
milieu … (la famille) passe d’un modèle pathologique à un mo-
dèle de compétence (…) et la maison familiale devient le pre-
mier lieu de relocalisation du patient psychiatrique : 60 à 70%
des personnes présentant des troubles psychiatriques vivent
dans leur famille. (2) » Quelles conséquences cette évolution et
ce changement de paradigme ont-ils produit dans le rapport
entre les professionnels et l’entourage familial ?
En vérité, nous le savons, ces conceptions n’ont pas évolué de
façon linéaire ni homogène. Nous retrouvons ces différentes
approches coexistant dans presque toutes les institutions. Con-
crètement, dans la psychiatrie « post-moderne », le recours à
l’entourage familial (de plus en plus fréquent) peut se faire par
conviction, par manque d’option, et parfois par imposition insti-
tutionnelle à partir de directives guidées par des plans ministé-
riels, sans forcément y retrouver, de la part des intervenants
directs, ni une prise en compte des difficultés particulières vé-
cues par cet entourage ni l’adhésion aux notions de famille
« aidante » (avec des fragilités mais aussi des compétences) ou
« d’alliance thérapeutique tripartite ».
L’entourage familial peut alors se retrouver confronté à des
discours et des pratiques contradictoires et discontinues, sans
parler du changement presque radical auquel il doit faire face
entre les dispositifs faisant partie de la psychiatrie infanto-
juvénile et ceux de la psychiatrie adulte. Nous recevons fré-
quemment à l’Unafam des situations ressenties par l’entourage
comme très ambivalentes, voire paradoxales. Un véritable tirail-
lement dans la nébuleuse des intervenants qui, en difficulté
pour communiquer entre eux, peuvent prendre des décisions
sur la prise en charge du patient à partir de leur seul périmètre
d’action - la complexité et la contextualisation du/des symp-
tômes pouvant être éludées. De plus, les efforts de l’entourage
pour échanger et partager des informations peuvent être reçus
(interprétés) de manières totalement différentes à l’intérieur de
cette cacophonie de représentations de la « famille ».
Pour illustrer mon propos, je vous présenterai ici le cas d’un
jeune homme de 22 ans - que nous appellerons Thomas - dont
la mère est venue nous rencontrer il y a quelques années.
Participation de l’Unafam 92 au Colloque :
« CLINIQUE DES PASSAGES : DE L’ADOLESCENCE A L’AGE ADULTE »
Notre dernier bulletin (N° 11— mars 2016) vous a informé de l’organisation du Colloque : « CLINIQUE DES PASSAGES : DE L’ADO-
LESCENCE A L’AGE ADULTE » par le Collège de Psychiatrie Publique de l’Adolescent des Hauts de Seine (CPPA 92), le 22 janvier
2016 au Château d’Asnières. Dans le programme, l’atelier intitulé « LA PLACE DES FAMILLES » a été animé par le Dr Laurent
James, psychiatre et thérapeute familial à l’Espace Famille 92 et Eliane Collombet, chargée de mission psychologue à l’Unafam 92.
Eliane Collombet a préparé un résumé de son intervention qui fera partie d’une brochure à diffuser auprès des professionnels des
structures présentes au colloque. Cette réflexion nous concernant tous, notre comité à décidé de la partager avec nos adhérents et
partenaires.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%