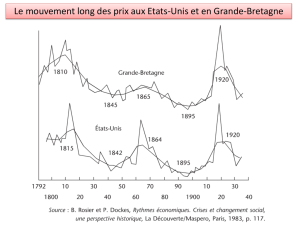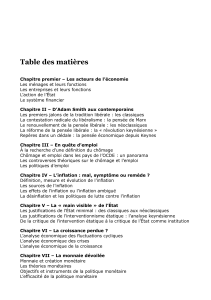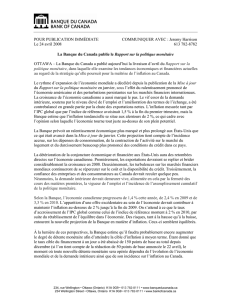courbe de phillips néo – keynésienne hybride

1
COURBE DE PHILLIPS NÉO – KEYNÉSIENNE HYBRIDE : RÉSULTATS
EMPIRIQUES POUR LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET
MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC)
Oscar KUIKEU
1
Résumé : L’objet de cette contribution est d’évaluer, en zone CEMAC (Communauté
Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale), le degré de persistance de l’inflation (dont la
connaissance, pour la conduite de la politique monétaire, est fondamentale) ; et plus généralement
d’apprécier, à l’égard des prix, les principales implications sur le comportement d’agents au sein
de cette zone. A cet effet, conformément à la méthodologie initiée par Gali et Gertler (1999),
l’on examine les paramètres associés à la courbe de phillips néo – keynésienne hybride. D’après le
résultat des estimations, au sein de la sous-région CEMAC, l’on révèle un degré de persistance
avéré de l’inflation ; lequel, contrairement aux résultats obtenus sur les principales économies
industrialisées, est resté invariant à l’environnement économique.
JEL Classification : C22, E31.
Mots-clés : Courbe de Phillips Néo-keynésienne, Méthode des Moments Généralisés, critique de
Lucas.
Abstract : The aim of this paper is to access, in CEMAC (Central African Economic and
Monetary Community) region, the degree of inflation persistence. For this purpose, following
Gali and Gertler (1999), we estimate hybrid phillips curves, which include both backward and
forward-looking components. The estimation performed, using the Generalized Method of
Moment technique, reveals in CEMAC region an important degree of persistence in inflation,
which, unlike the results obtained on the major industrialized economies is remained invariant to
the change in economic environment ; in other words, the parameters estimated present with
respect to the Lucas critique some immunity.
JEL Classification : C22, E31.
Keywords : Néo-keynesian Phillips Curve, Generalized Method of Moment, Lucas critique.
1
CATT, Centre d’Analyse Théorique et de Traitement des données économiques, Université de Pau et des Pays de
l’Adour.

2
1. INTRODUCTION
Au sujet des performances réalisées en matière de stabilité des prix, en Afrique Sub-
Saharienne (ASS), la zone franc doit certainement représenter l’exemple à suivre (voir tableau 1
ci-dessous).
Tableau 1 : Taux d’inflation moyen (en pourcentage) comparés en Afrique Sub-Saharienne
1975-1985 1986-1993 1995-2007
Zone franc 11.2 1.1 3.37
Autres pays 17.8 22.0 15.59
Source : FMI
Afin de préserver cette stabilité des prix, présentée comme atout relatif de la zone, ses Etats
membres usent à la fois de mesures réglementaires et de mesures discrétionnaires (Devarajan et
Walton (1994)) :
1. Les mesures réglementaires ; qui concernent principalement la règle en vertu de laquelle
les concours de l’institut d’émission aux trésors nationaux ne peuvent excéder 20% des
recettes fiscales (BCEAO) ou budgétaires ordinaires (BEAC) encaissées lors du dernier
exercice budgétaire ; relèvent des accords de coopération monétaire, du 23 novembre
1972 et du 4 décembre 1973, passés entre la France et les Etats membres de la zone.
2. Les mesures discrétionnaires, qui concernent le contrôle de la liquidité bancaire, sont
celles qui relèvent de la compétence de la Banque Centrale.
Par rapport aux mesures discrétionnaires de la discipline macroéconomique, « la BEAC,
comme la plupart des Banques Centrales, pour formuler son diagnostic et décider de l’orientation monétaire à
mener, recourt à une large gamme d’indicateurs économiques et financiers » (BEAC (2007, p.114)). L’objectif,
de cette étude, est d’enrichir cette gamme d’information ; à cet effet nous avons choisi, à l’aide
d’une courbe de phillips néo-keynésienne hybride, d’évaluer le degré de persistance de l’inflation
2
au sein de la zone. Comme la connaissance du degré de persistance de l’inflation
3
est un élément
important, pour la conduite de l’action monétaire, les Banques Centrales de nombreuses
économies ont estimé, pour le compte de leur gouvernement, les paramètres associés à une
2
La persistance de l’inflation est le terme utilisé pour désigner le fait que les autocorrélations d’ordre 1 de l’inflation,
entre la période courante et la période antérieure, sont assez proches de l’unité ; autrement dit, une inflation forte
(respectivement faible) observée sur une période est plus susceptible d’être suivie d’une inflation également forte
(respectivement faible) à la période suivante.
3
En effet, conformément à Ball (1994a, 1994b), la persistance de l’inflation implique qu’une réduction souhaitée du
taux d’inflation, ou politique de désinflation, envisagée à une période donnée ne portera ses fruits qu’après un délai et
au prix d’une contraction immédiate mais transitoire de l’activité ; autrement dit, la persistance de l’inflation rend
l’objectif de stabilité des prix, poursuivi par la Banque Centrale, plus délicate à réaliser.

3
courbe de phillips néo-keynésienne. Cependant, dans la mesure où le champ couvert par ces
études est assez restreint aux économies industrialisées, de vastes chantiers restent encore à
réaliser pour le cadre des économies émergentes, dont notamment celles d’ ASS
4
, d’où l’intérêt
porté à cette étude.
Cette contribution sera organisée ainsi qu’il suit : Après avoir rappelé le principe, de
construction, de la courbe de phillips néo-keynésienne (section 2), nous envisagerons
l’investigation empirique de ses paramètres et nous en déduirons les principales implications en
matière de conduite de la politique monétaire (section 3); nous avons restreint, tout au long de
l’étude empirique, la zone franc à la sous-région CEMAC (Communauté Économique et
Monétaire de l’Afrique Centrale). En outre au regard des reformes monétaires entreprises, au
courant de la décennie 1990
5
, au sein de la sous-région, ainsi que du changement de la parité en
1994 et de l’adoption de l’euro en 1999, il nous a semblé pertinent de tester la critique de
Lucas
6
(section 4) ; selon laquelle : les agents, en raison de l’hypothèse de rationalité, ajusteront
leur comportement en réaction aux modifications, dont notamment celles relatives à l’orientation
de la politique économique, qui affecteront leur environnement. Enfin, en guise de conclusion,
nous présenterons une synthèse des principaux résultats obtenus (section 5).
Encart : Brève présentation de la zone franc
La zone franc, qui constitue un espace monétaire, rassemble les quatorze pays d’Afrique Sub
– Saharienne qui signent en 1972 et 1973 des accords de coopération monétaire avec la France.
Huit de ces pays sont en Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina – Faso, Côte – d’ivoire, Guinée –
Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Les six autres en Afrique Centrale : Cameroun, Congo,
Gabon, Guinée-équatoriale, Tchad, République Centraficaine.
La zone dispose d’une monnaie commune, le FCFA – Franc de la Coopération Financière en
Afrique en Afrique Centrale et Franc de la Communauté Financière Africaine en Afrique de
l’Ouest –, émise par la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) en Afrique
de l’Ouest et par la BEAC (Banque des Etats de l’Afrique Centrale) en Afrique Centrale. Le
4
Excepté les travaux de Kisinguh, Maana et Maturu (2006), pour l’économie kenyane, aucune autre étude relative
à ce sujet n’a été consacrée au cadre des économies d’ASS.
5
Ces réformes s’opèrent principalement en quatre étapes : Le 16 octobre 1990 avec la création de la Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), le 17 janvier 1992 avec l’adoption de la convention portant Harmonisation
de la Réglementation Bancaire en Afrique Centrale, en juillet 1991 avec l’adoption de la programmation monétaire,
en juillet 1994 avec la mise en place du marché monétaire.
6
Lucas (1976).

4
quinzième membre africain de la zone franc, la République islamique des Comores, a sa propre
monnaie et sa propre banque centrale.
La coopération monétaire avec la France s’articule autour de quatre axes principaux : La
stabilité, la convertibilité, la transférabilité, la solidarité. La stabilité résulte de l’existence d’une parité fixe
entre le FCFA et le franc français (FF). La convertibilité du FCFA est réalisée à travers le
mécanisme dit du « compte des opérations » ; compte, domicilié auprès de la direction française
du trésor, où les Etats membres sont tenus d’y verser au moins 65% de leurs avoirs extérieurs. La
libre transférabilité est illimitée entre les membres de la zone. Enfin, la solidarité est garantie entre les
membres par la mise en commun de leurs réserves de change.
La parité du FCFA par rapport au FF est restée inchangée, jusqu’au 12 janvier 1994 ; date à
laquelle, le FCFA a été dévalué de 50% pour s’établir désormais à 1 FF pour 100 FCFA et le franc
comorien, dans le même temps, de 33,3%. A l’issue de la dévaluation des francs cfa (FCFA) en
janvier 1994 la volonté d’approfondir le processus d’intégration régionale, en zone franc, se
traduit : par la signature au sein de la zone d’émission BEAC, le 16 mars 1994 à N’djamena au
Tchad, du Traité qui institue la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC) et au sein de la zone d’émission BCEAO par la signature, le 10 janvier 1994 à Dakar
au Sénégal, du Traité qui institue l’UEMOA (l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine).
Depuis l’avènement de l’euro, en janvier 2002, les différents francs y sont rattachés au taux de
1 euro pour 655,957 FCFA, soit 1 euro pour 6,55957 FF, et ils continuent de bénéficier de la
garantie illimitée du Trésor français.
2. Dérivation de la courbe de phillips néo – keynésienne hybride
7
La courbe de phillips néo-keynésienne est une relation, entre l’inflation et l’activité réelle, qui
renseigne, à l’égard des modes de fixation des prix, sur le comportement d’agents.
Le point de départ pour la mise en évidence de cette relation, qu’est la courbe de phillips néo-
keynésienne hybride, est un environnement, de concurrence monopolistique, où le prix devient
pour la firme une variable d’ajustement ; contrairement aux modèles, de concurrence parfaite, où
la firme agit sur les quantités vendues et considère le prix du produit comme une donnée. Au sein
de la littérature néo-keynésienne récente, un modèle standard, de concurrence monopolistique,
est Blanchard et Nobuhiro (1987). Sous certaines hypothèses, relatives à la technologie
7
Sauf indication contraire, tout au long du paragraphe,
p
désigne le niveau général des prix et
*
p
le prix optimal.

5
disponible aux firmes, ces auteurs établissent qu’à chaque période
t
du temps la firme i établira
son prix relatif comme une marge ajoutée fixe sur le coût marginal réel :
tt
*
it
ψpp ⋅+=
ϕ
(1),
où
*
i
p
représente le logarithme du prix d’équilibre de la firme i,
p
le logarithme du niveau général
des prix,
ψ
le coût marginal réel.
Cependant une caractéristique importante des négociations salariales et des contrats de prix,
au sein des économies modernes, est leur étalement dans le temps (Fisher (1977), Taylor (1980))
; cet échelonnement dans le temps, des prix et salaires, a pour conséquence d’empêcher, à chaque
période du temps, les firmes de fixer leur prix optimal défini en (1).
Au sein de la littérature, sur cette idée d’ajustement peu fréquent des prix
8
, l’on distingue
habituellement deux catégories de modèle :
o Pour la première catégorie, qualifiée de time dependent, les agents économiques ajustent les
prix, d’une manière ad hoc, à l’aide une règle statistique ou déterministe.
o Tandis que pour la seconde catégorie, qualifiée de state dependent, la décision des agents est
tributaire de l’environnement économique.
Comme les modèles state dependent supposent que les agents mènent une analyse coût-
bénéfice, d’un point de vue économique, ces derniers sont clairement plus attractifs. Cependant,
pour des raisons techniques de résolution des modèles, la plupart des travaux récents sur la
dynamique des prix relèvent de la première catégorie. Au sein de la littérature les contributions
considérées majeures, dans cette catégorie, sont Taylor (1980) et Calvo (1983). Roberts (1995)
montre que ces modèles résultent en une relation, entre l’inflation et une variable réelle, qualifiée
dans la littérature de courbe de phillips néo-keynésienne
9
.
8
Cette évidence d’ajustement peu fréquent des salaires et des prix est généralement qualifiée, au sein de la littérature,
de rigidité nominale.
9
Pour mettre en évidence cette relation il suffit de préciser, à côté de l’équation de prix optimal, l’équation de prix
effectivement appliqué par la firme et l’équation du niveau général des prix au sein de l’économie. Chez Taylor
(1980), modèle à deux périodes, le prix fixé par une firme est
(
)
(
)
*1
*
21
+
+⋅=
tttt
pEpx
et le niveau général des prix
(
)
(
)
1
21
−
+⋅=
ttt
xxp
; tandis que chez Calvo (1983) le prix fixé par une firme est, une moyenne pondérée des prix
optimaux actuels et futurs,
( )
*1
0
1
+
∞
=
∑
−⋅=
tt
j
j
t
pEααx tandis que le niveau général des prix est, une moyenne
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%