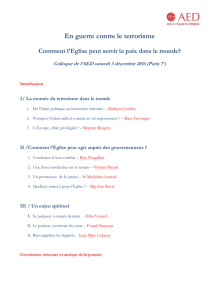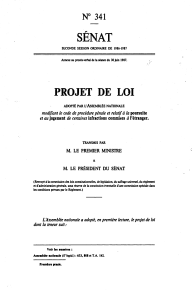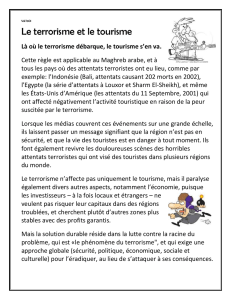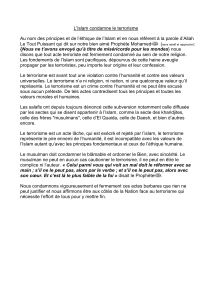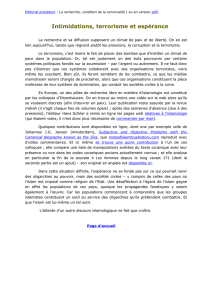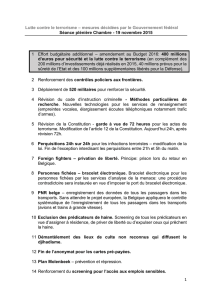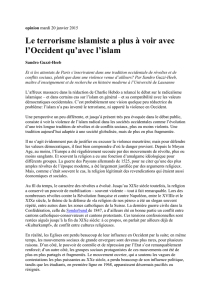Le concept de « terrorisme » est-il pertinent pour écrire l

Le concept de « terrorisme » est-il pertinent pour écrire l ’ histoire
des « années de plomb » ?
Cette intervention part d'un constat assez simple : la plupart des ouvrages qui traitent de la violence
en politique dans les années 1970 en Italie utilisent de façon récurrente l'appellation de "terrorisme"
afin de définir le recours à l'usage de la force qui a pu être l'apanage des formations armées, souvent
sans prendre le temps de revenir sur cette notion et de l'expliquer. Couplée à l'idée « d'années de
plomb », elle forge un véritable paradigme interprétatif des années 70, renvoyant seulement à une
violence extrême. C'est pourtant un concept multiforme, mouvant, dont l'usage a pu être contesté
par des chercheurs. Mais est-il pour autant éclairant et adapté pour parler de cette période ?
•Origine du terme et renversement de sens
Pour s'attacher à décrypter la notion de terrorisme et comprendre l'usage qui en est fait,
revenons à son acte de naissance. Ce terme est de création récente, puisqu'il apparaît à la fin du
XVIIIe siècle, aux lendemains de la Révolution française, lors de la Convention thermidorienne qui
entend condamner le système de gouvernement jacobin qui l'a précédé. Dans sa première acception,
le vocable désigne un régime du type de celui en vigueur entre septembre 1793 et la chute de
Robespierre le 27 juillet 1794. Le terrorisme se définit alors comme l'ensemble des moyens de
coercition politique ayant pour but de maintenir des opposants dans un état de crainte, en se basant
notamment sur un ensemble de mesures d'exception à même d'imposer ce régime de Terreur. Le
concept de terrorisme tire ainsi son origine de l'emploi de la violence par les détenteurs du pouvoir à
l'encontre de la population civile. La Terreur désigne ainsi une forme de violence interne à l’État
moderne, qui se distingue de la guerre, entendue comme exercice de la force tournée vers
l'extérieur, dans le conflit avec d'autres États.
Pourtant, au cours du siècle suivant, on assiste à une « mutation sémantique radicale » (I.
Sommier) et à un « renversement de perspective » (Fischbach) qui bouleverse profondément le sens
de la notion, pour acquérir son sens moderne, c'est-à-dire celui « de stratégie violente
principalement dirigée contre l’État au moyen d'assassinats et d'attentats visant à créer un climat de
terreur. » (Sommier) Bien qu'il s'agisse toujours de nommer un usage de la violence à des fins
politiques, le terrorisme n'est donc plus cette violence qui vient « d'en haut », mais représente une
volonté de désordre qui cherche à attaquer et à détruire tel ou tel ordre politico-culturel. Cela va
permettre de nommer les régicides, les assassinats politiques commis par des groupuscules ou des
individus provenant des cercles anarchistes ou des rangs des nihilistes russes, c'est-à-dire des sujets
qui sont « à distance de l’État » (Neyrat). Ce renversement de sens s'appuie sur une tradition
philosophique qui modifie les relations que l’État entretient avec la violence, tradition que l'on peut
faire remonter à Hobbes. Dans le Léviathan, Hobbes en appelait à une monopolisation de la
violence par l’État afin de pacifier la société civile. Sans le Léviathan, « l'Homme est un loup pour
l'homme ». Cette idée a notamment été reprise par Max Weber qui parle quant à lui du « monopole
de la violence physique légitime » de la part de l’État. Cela représente selon lui une caractéristique
essentielle de l’État en tant que groupement politique. Toute violence qui n'émane pas de ce dernier
peut donc être renvoyée dans le champ de l'illégitime. Le terrorisme, terme péjoratif, peut alors
opérer sa mue pour disqualifier ceux qui osent contester à l’État ce monopole.
•Tentative de définition.
La notion de « terrorisme » a donné lieu, surtout depuis les années 1970, à un ensemble
assez disparate de définitions puisqu'il en existe au moins plus d'une centaine, parfois
contradictoires, et souvent peu éclairantes sur le phénomène. Pour certains, comme Gérard
Chaliand, spécialiste des conflits armés, « le terrorisme est avant tout un instrument ou, si l'on
préfère, une technique », idée reprise dans des définitions sociologiques qui le présentent, comme le

rappelle Donatella Della Porta, comme « une méthode, ou une théorie qui réside derrière la
méthode, à travers laquelle un groupe organisé ou un parti affirme ses objectifs principalement au
moyen d'un usage systématique de la violence ». Pour Jean Baudrillard, au contraire, le terrorisme
se situe essentiellement dans une sphère symbolique. Historiquement, des chercheurs comme
Chaliand ont voulu faire remonter les origines du terrorisme aux sectes d'assassins du 11ème siècle,
tandis que pour d'autres, il s'agit d'un phénomène caractéristique du second après-guerre, dont
l'existence serait impensable sans la diffusion des moyens de communication de masse (Della
Porta). Des tentatives de synthèse des principaux critères qui seraient révélateurs d'un acte terroriste
ont pu être proposées, comme celle de Tanguy de Swielande, pour qui il existe cinq composantes
majeures qui définissent un geste terroriste : un usage de la violence, dirigé contre une cible non-
combattante ou contre des biens matériels, ayant pour but d'influencer des comportements,
représentant donc un objectif politique et cherchant à « terroriser ». Si l'objectif consistant à susciter
la terreur semble bien spécifier l'action terroriste, l'aire de plus en plus vaste recouverte par tous ces
critères nous met néanmoins face à un double problème. D'une part, « la multiplicité de critères est
révélatrice de la difficulté à sérier le phénomène autrement qu'au cas par cas » (Sommier) ; d'autre
part, avec l'extension conceptuelle du terme, on peut désormais classer sous le label « terroriste »
une organisation clandestine, un mouvement révolutionnaire, une guérilla rurale, un groupe radical
religieux,... et des modes d'action extrêmement divers : l'assassinat politique, entendu comme "le
meurtre d'une personnalité publique pour un mobile politique", le complot ou la conspiration, la
guérilla ou encore l'insurrection. Bref, un ensemble très hétérogène, un véritable « fourre-tout », qui
n'a souvent en commun qu'un recours à la violence à des fins politiques, mais qui n'a pourtant pas
de cohérence politique, sociale ou historique. D'ailleurs, il existe bien d'autres organisations qui ont
également recours à cette violence mais qui ne sont pourtant pas cataloguées comme étant
« terroristes » (par exemple la mafia). Nous devons donc faire face à un terme utilisé sans
discernement et de manière uniforme, aussi bien par des hommes politiques ou des journalistes que
par des chercheurs, ce qui rend la compréhension de phénomènes historiques et politiques
spécifiques de plus en plus complexe.
Or, si le terrorisme reste difficile à définir avec une précision satisfaisante, c'est peut-être
parce que, comme le dit le philosophe Frédéric Neyrat, « Avant même d'être l'objet d'une définition,
le terrorisme est un nom, le produit d'une dénomination aux effets redoutables ». Le premier de ces
effets est de tendre à disqualifier et dépolitiser « pêle-mêle toute forme de contestation ou de
résistance à l'ordre établi. », selon l'analyse de Mike Davis. Cela tend à évacuer le fait de penser
« d'autres dénominations possibles » (Neyrat) : à propos d'autres contextes historiques, ne parle-t-
on pas de « résistants » ou de « révolutionnaires » pour désigner les auteurs d'actes facilement
référençables comme étant terroristes. Si l'on s'accorde avec Carl Schmitt pour dire qu'« Est
politique tout regroupement qui se fait dans la perspective de l'épreuve de force », alors il nous faut
reconnaître cette qualité aux différents groupes organisés qui décident de se lancer dans des
épisodes de violence à l'encontre de l’État, des institutions ou des équilibres politiques d'un pays,
d'une région,...
Mais il est vrai que l'accusation de terrorisme est devenue tellement lourde de sens qu'il est
difficile de la critiquer sans craindre d'être aussitôt rangé aux côtés desdits terroristes. Comme le
disaient Bigo et Hermant, « Le terrorisme est en effet considéré comme un corps étranger, une
perversion, un fléau à éliminer à tout prix. Il n'est donc pas un simple objet de rhétorique : il faut
avant tout le combattre. Refuser de se placer sur le terrain de l'affrontement, c'est se désigner
comme « franc-tireur social », être immédiatement soupçonné de faire le jeu de l'adversaire et de
brouiller volontairement les pistes. » Pourtant, il n'est pas besoin d'être un partisan des Brigades
rouges1 pour être saisi d'un soupçon devant l'accusation de terrorisme : pour le dire encore avec
Neyrat, « le nom de terrorisme ne serait-il qu'une appellation stratégique, un nom épouvantail, une
1 Organisation armée italienne d'extrême-gauche née en 1970 et officiellement auto-dissoute à la fin des années 1980.
C'est le plus important groupe armé de cette période, avec plusieurs milliers de militants, des groupes répartis dans
tout le pays, avec la plus grande longévité. Au fil des années et d'une radicalisation croissante, les brigadistes se sont
rendus coupable de plusieurs assassinats politiques, notamment celui d'Aldo Moro, chef de la Démocratie
Chrétienne, en 1978. Certains membres des Brigades rouges sont toujours en prison aujourd'hui.

simple combine sémantique masquant des intérêts politiques ? » Il apparaît en effet que ceux qui
sont rangés dans cette catégorie sont dans la majorité des cas ceux qui contestent à l’État son
« monopole de la violence légitime » selon l'expression wéberienne, ceux qui s'attaquent à sa
légitimité, à ses lois, à sa souveraineté. Nous osons alors rappeler cette hypothèse, déjà formulée
avant nous « que « terrorisme » est un nom d’État, donné, produit, façonné, en quelque sorte garanti
par l’État. » (Neyrat) Nous pouvons donc reprendre le constat de Charles Tilly lorsqu'il range le
« terrorisme » dans ces termes qui « ne servent pas à indiquer des réalités sociales cohérentes »,
mais qui « indiquent plutôt le comportement des observateurs envers des actions qu'ils
désapprouvent. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des instruments utiles pour l'analyse
sociale, si ce n'est en tant que moyens pour comprendre les idées des détenteurs du pouvoir ».
•Années 70 et terrorisme .
Un mot « anathème »
Dans les années 1970, le terme de terrorisme fait l'objet d'une véritable bataille entre l’État
et ses institutions, et l'extrême-gauche, qu'elle ait fait le choix des armes ou pas. C'est que le mot
n'est pas neutre, loin de là ; on peut même dire qu'il possède une force d'accusation, qu'il « jette
l'anathème » et renvoie celui qui en est affublé dans le champ de « l'inacceptable, l'illégitime, voire
l'inhumain » (Sommier). Mais les dits terroristes sont, dans la majorité des cas, loin d'être dupes de
cet usage et s'efforcent de rejeter ce qualificatif pour désigner de la même façon leurs accusateurs,
« sur le mode du retour à l'envoyeur ». On peut retrouver cette idée dans les propos de Renato
Curcio, un des fondateurs et leaders historiques des Brigades rouges, lorsqu'il dit qu'en « Italie le
terrorisme à des fins politiques a été pratiqué par les autres. Par ceux qui, par exemple, ont mis les
bombes de la piazza Fontana, de la piazza della Loggia, sur les trains ou à la gare de Bologne,... En
ce sens, je crois que l'on peut dire qu'en Italie le terrorisme des années 70 a été le fruit d'une greffe
entre la culture fasciste jamais vaincue et certains appareils d’État. » De la même manière, la
gauche extraparlementaire s'empare du terme pour attaquer l’État suite à la bombe de Piazza
Fontana. Lors de la campagne en faveur de la libération de Valpreda et des autres anarchistes
accusés de l'attentat, le Comitato nazionale di lotta contro la strage et une large partie de l'extrême-
gauche accuse l’État d'être lui-même le « terroriste » et d'avoir provoqué le massacre de la Banca
dell'agricoltura. Dans l'ensemble des cas, le « terrorisme » renvoie au « passage en force de l'idée
politique. » dont parle Neyrat. Comme un retour à l'origine de la notion, l'extrême-gauche, sûrement
involontairement, renvoie le terrorisme dans le champ d'action de l’État et essaye de s'en
démarquer, comprenant bien qu'il s'agit d'un stigmate déshonorant.
Un terme dés-historicisé
Nous avons vu que le terme terrorisme est employé en mettant sur un même plan une grande
variété d'organisations, d'actes et de séquences historiques qui ont tous leurs spécificités propres. Il
tend ainsi à aplanir les particularités sociopolitiques dans lesquelles s'inscrivent et prennent racines
les différents types de violence. On assiste alors à la dés-historicisation d'un phénomène qui n'est
plus étudié comme le résultat d'un processus social et politique mais qui en est réduit à être
l'incarnation d'une idée. Pour le dire avec I. Sommier, la question du terrorisme nous « renvoie ainsi
à l'historicité du recours à telle ou telle forme de violence contestataire. Historicité dont ne rend pas
compte, selon nous, le terme « terrorisme », puisqu'il désigne des modes d'action hétéroclites
pouvant s'inscrire dans des stratégies classiques autant que d'autres formes de violences. » Ramener
les assassinats politiques commis par les BR ou Prima Linea ou les attentats aveugles de l'extrême-
droite italienne sous la même bannière conceptuelle que des détournements d'avions ou des attentats
suicides ne nous renseigne que peu sur la surgissement de cette violence, les fins poursuivies par les
auteurs et la spécificité du contexte. Ainsi, en déclarant « terroristes » des actes comme l'assassinat
de personnalités politiques ou un attentat dans un lieu public symbolique, qui sont après tout des

« invariants de la violence politique » (Sommier) et relèvent du répertoire d'action traditionnel, on
ne cherche pas à faire émerger une singularité historique, on déclare surtout la guerre à de tels actes.
Un terme « performatif »
Enfin, nous pensons que la notion de terrorisme est performative dans le sens où elle ne se
borne pas à décrire un fait mais qu'elle « fait » elle-même quelque chose, c'est-à-dire qu'elle porte
en elle des conséquences qui dépassent la simple description d'un phénomène. Le terme de
terrorisme, nous l'avons vu, jette l'anathème sur ce qu'il prétend décrire, il charrie avec lui une
condamnation politique et morale que l'on chercherait en vain à évacuer. Cette « performativité » ne
s'exprime pas seulement dans le champ scientifique, mais se traduit en acte, sur ce même terrain
politique et historique que le champ scientifique cherche à comprendre : c'est en effet là que se
déploie la lutte « antiterroriste », avec son cortège de lois d'urgence, qui ne sont jamais sans impact
sur les processus démocratiques et sur la limitation des libertés individuelles. Ainsi faut-il savoir, au
nom de la « démocratie » et « donc » contre le « terrorisme », sacrifier certains droits, accepter un
éventail de mesures d'urgence, se plier à des décrets liberticides, de la legge Reale (toujours en
vigueur aujourd'hui) aux décrets Cossiga. Les années 70 sont éclairantes sur ce point là : au nom de
la lutte antiterroriste, ce ne sont plus seulement les « terroristes » qui sont visés, mais aussi dans un
usage extensif, tous ceux que l'on suspecte de leur accorder une sympathie ou un soutien
quelconque : avocats, intellectuels, ouvriers trop radicaux.
•Chercheurs et scientifiques face au choix des mots.
Le « terrorisme » est donc une notion difficilement définissable, floue et qui s'adapte mal à
la description de situations historiques particulières, d'autant que c'est un concept particulièrement
chargé d'affects. Citant le sociologue Anselm Strauss déclarant : « un nom est un vase dans lequel
celui qui nomme verse ses évaluations conscientes ou inconscientes », Isabelle Sommier nous
mettait en garde « contre les préjugés », et nous invitait « à leur substituer une définition rigoureuse
qui permette d'échapper à l'arbitraire des émotions et à l'évanescence des impressions. De toute
évidence, le terme « terrorisme » ne répond à aucun de ces deux impératifs qui garantissent la
neutralité axiologique du chercheur. Il est à l'inverse éminemment polémique et passionnel. » En
effet, cette notion place les événements qu'elle est censée décrire sous une perspective
essentiellement morale. Or, voilà bien le terrain le plus glissant qui soit pour un chercheur ou un
scientifique, qu'il lui faut fuir au plus vite s'il ne veut manquer ce qui doit être sa tâche : comprendre
et expliquer les phénomènes, et non les juger. De la même manière que l'on ne dit pas grand chose
du nazisme si l'on se contente de le décrire comme une monstruosité de l'histoire, on n'éclaire pas la
spécificité de la violence politique en Italie en la cataloguant d'office sous la bannière du terrorisme.
Pour le dire avec Neyrat, on pourrait même ajouter que « Le terrorisme est un attrape-monde, une
éponge conceptuelle qui absorbe les problèmes, les angoisses et les impasses de notre époque. »
Pour prendre un exemple, cette citation de Gianfranco Pasquino est tout à fait symptomatique de
cette porosité entre des jugements moraux et une analyse historique : « le terrorisme de droite et
surtout de gauche en Italie a-t-il été un bubon arrivé à maturation inévitable, une simple parenthèse
dans l'histoire de l'Italie républicaine, ou bien une maladie qui pouvait être prévenue ? » Le parallèle
avec la maladie montre sans ambiguïté le jugement porté par le sociologue sur la violence des
années 70, ramené à un simple phénomène pathologique. On trouve chez Pasquino l'illustration de
ce que disait Isabelle Sommier : « En raison de la charge émotionnelle attachée au terme terrorisme,
les auteurs ont souvent tendance à construire leur définition à l'aune de critères d'inhumanité ou de
barbarie qui reflètent avant tout leur propre échelle de valeurs, même si l'absence de voix
discordante tend à les faire passer pour universels. La perspective éthique paraît, en ce domaine,
indépassable. De là, sans doute, le travers fréquent qui consiste à appliquer le stigmate terroriste à
toute entreprise violente qui ne reçoit pas l'assentiment moral et /ou idéologique du chercheur. » En
tant que chercheurs – évidemment traversés par des sentiments et des positions politiques – nous
devons cependant tendre vers cette « neutralité axiologique » dont parlait Max Weber dans Le

savant et le politique. De plus, les discours que nous contribuons à élaborer ont une incidence sur la
réalité que nous vivons : ils appartiennent aussi au champ social et politique et dépassent un simple
cadre universitaire, d'où la nécessité de ne pas relayer avec une caution universitaire des termes
aussi polémiques.
« I'll teach you differences »
Wittgenstein, citant un passage du Roi Lear de Shakespeare qui déclarait « Je vous
enseignerai les différences », nous rappelait la nécessité de s'attacher aux distinctions et aux
spécificités pour éviter des analogies trop faciles qui manquent des écarts réels et profonds entre
certains phénomènes. C'est justement le travail du chercheur que de ne pas tomber dans ce genre de
piège. L'usage de la violence n'est pas une catégorie en soi : il y a bien des usages de la violence qui
répondent à des motivations, à des méthodes, à des visées et à des contextes d'une grande diversité.
Un mafieux qui veut empêcher un magistrat de poursuivre ses investigations, une voiture piégée qui
explose dans Jérusalem ou un brigadiste qui assassine un homme d'état ne renvoient l'un à l'autre
qu'à travers une vague analogie, mais qui masque tout un ensemble de différences historiques,
politiques, sociales, culturelles. L'analogie s’essouffle vite et révèle la faiblesse conceptuelle de
cette notion. Cette dénomination de violence terroriste est non seulement critiquable sur un plan
théorique puisqu'elle reste assez floue et sert de « fourre-tout » pour finir par englober un ensemble
d'actes qui n'ont pas de cohérence entre eux, mais est aussi bancale sur un plan pratique, puisqu'elle
relève plus de l'accusation qui peut se renvoyer d'un camp à l'autre. Nous y voyons, pour reprendre
l'expression de Frédéric Neyrat, un « concept piégé » pour des chercheurs car il est devenu une
sorte de catégorie en soi, rendant inutile toute réflexion (parce qu'elle serait indécente) et accuse à
l'avance celui qui est étiqueté comme tel : au pire il est coupable, au mieux il est suspect. Il nous
faut donc conserver cette vigilance devant l'emploi des mots aussi chargés que celui de terrorisme,
au sens où le pensait Neyrat : « Quand il est question de terrorisme, la vigilance qu'il nous faut avoir
concerne d'abord le langage, les mots à employer. Vigilance quant aux contextes politiques, aux
réseaux de significations, aux acteurs en présence. »
Pour autant, il ne s'agit pas de sombrer dans un relativisme douteux où tout ne serait
qu'affaire de représentation, et il n'est pas question de « nier, sous prétexte de déconstruire les
mécanismes qui donnent naissance au stigmate « terrorisme », qu'il existe des modes d'exercice de
la violence ayant pour objectif spécifique de semer la terreur. » (Sommier) L'enjeu réside plutôt
dans le fait d'arriver à penser à ce que recouvre le terrorisme avec d'autres termes, plus à même de
saisir les spécificités historiques. Cette intervention se veut donc une invitation à penser autre chose.
Sans les bons outils, nous ne pouvons aboutir à des résultats qui ont du sens. Nous avons donc
besoin de garder une autonomie de jugement et une distance critique avec des termes aussi
connotés, e rappeler qu'il existe d'autres concepts, sur lesquels il ne faut évidemment pas cesser de
s'interroger ni de questionner les limites, mais qui sont probablement moins marqués
idéologiquement et politiquement. Ainsi, même si le concept de violence demeure également
problématique pour les sciences sociales – il a donné lieu à des théorisations différentes parmi les
chercheurs – il nous semble préférable, comme l'a dit Federica Rossi, « dans une acception très
large qui permet de le mettre en relation avec l'univers symbolique et pratique des acteurs qui
l'utilisent, à celui de « terrorisme » qui est l'objet d'usages multiples, souvent à des fins politiques. »
C'est pourquoi, à l'instar d'Isabelle Sommier nous pourrions parler sobrement de "violence
révolutionnaire" pour désigner les différents usages de la violence dans les années 70. Cette
violence est "révolutionnaire" en ce qu'elle cherche à attaquer le pouvoir d’État suivant une
idéologie de changement social radical. Cette violence n'est pas l'apanage des groupes d'extrême
gauche, on la retrouve aussi chez certains groupes d'inspiration fasciste. Nous pouvons également
parler de "violence politique", au sens où Ted Honderich l'a défini, y voyant un “usage considérable
et destructif de la force contre des personnes ou des choses, un usage de la force interdit par la loi,
visant à un changement de politique, de système, de territoire de juridiction ou de personnel
 6
6
1
/
6
100%