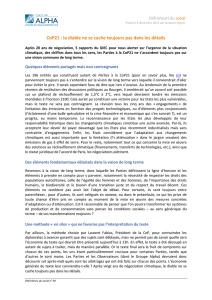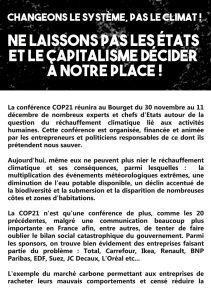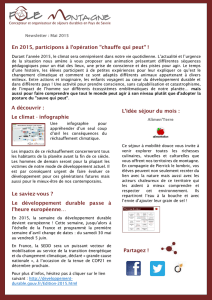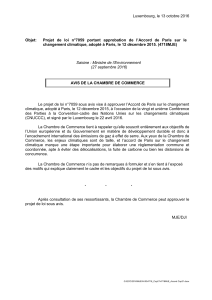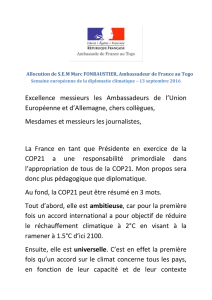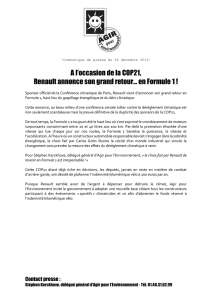COP21 : réparer l`injustice climatique en afrique

Les Notes
de La FeP
#
par , chargée de plaidoyer Climat à l’ENDA-
environnement et développement du tiers-monde
par , agro-pasteur, représentant de la
Coordination nationale des organisations paysannes du Mali
par , secrétaire générale du African Network
for Environmental Journalists (ANEJ)
par , secrétaire général de la Coalition
restauratrice de l’Etat démocratique en Guinée équatoriale
par , secrétaire exécutif de l’ONG Brainforest
par , ancien ministre de l’Environnement et de la
Pêche du Sénégal

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, les représentants de
196 « parties » se réunissent à Paris pour tenter de limiter le
-
-
(CCNUCC).
Cette « COP21 », 21e Conference of Parties – conférence des parties,
-
-
-
duction alimentaire ne soit pas menacée et que le développement
1. Or, les
2 -
-
3.
4.
pas les moyens économiques de mettre en œuvre les mesures néces-
-
-
-
France, qui a bâti une part de sa prospérité sur des ressources natu-
1. Convention-cadre des Nations unies
article 2.
-
Maplecroft’s Climate Change and Envi-
ronmental Risk Atlas, 2014).
3. « Changements climatiques 2013 : les
éléments scientifiques
4. Voir notamment le rapport « Global
Estimates 2014 – People displaced by
disasters -
Council, septembre 2014.

5. 55 pays industrialisés en 1995, plus
-
relles, notamment africaines, un levier de croissance mondiale, sou-
France, puissance diplomatique qui accueille la COP21, va se retrouver
Comment donc faire en sorte que la COP21 marque un tournant pour
5, paient une part de
tendance pour enclencher un développement faiblement carboné au
-
-
-
Ces luttes, souvent efficaces, ont rencontré chaque fois des résis-
multinationales asiatiques ou occidentales qui créent de la valeur

1. Le dernier rap-
-
sources en eau, mais aussi pluies tardives avec des conséquences sur les rendements
-
la notion de « dette climatique » : dans leur transition vers une croissance durable, les
pays développés. Cet appel a été partiellement entendu sur le plan formel à travers la
-
ciations en cours sur le climat se focalisent délibérément sur les émissions actuelles
2 dont ils sont les plus responsables.
business as usual3
que de les éviter dans le futur, et surtout de lutter contre la pauvreté en développant
soumis des contributions en ce sens, fondées notamment sur un fort développement
4
-
-
Depuis sa création en 1972 à Dakar
et développement du tiers-monde,
pour la diversité culturelle et pour
le développement durable, en inter-
des intellectuels et des décideurs.
COP21, elle analyse la situation et les

annoncé dans sa contribution pour la COP21.
-
-
-
-
5-
-
-
-
-
-
-
Maplecroft’s Climate Change
and Environmental Risk Atlas 2014.
2. Ou émissions cumulées depuis le début
la comptabilisation se situe entre 1750
et 1850 selon les statistiques disponibles
dans les pays industrialisés).
3. Les pays en développement (hors
émissions par rapport à un scénario de
croissance économique classique basé
5. La CCNUCC (Convention-cadre des
-
-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%