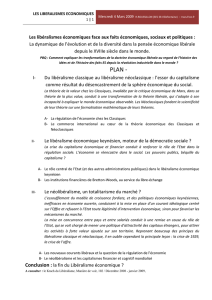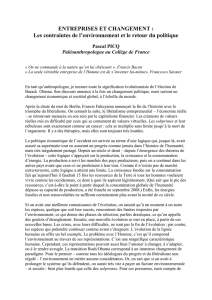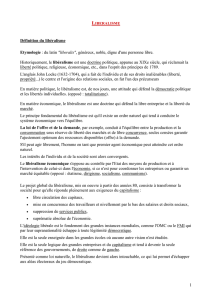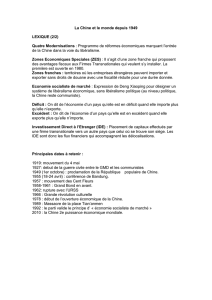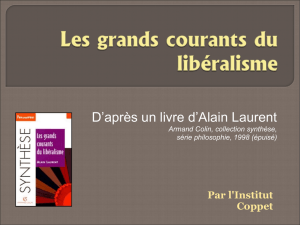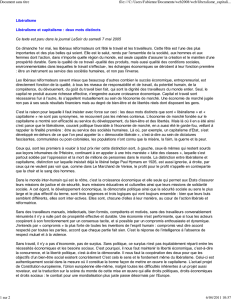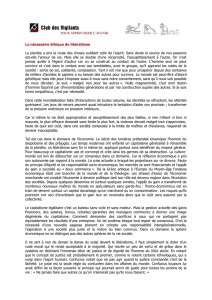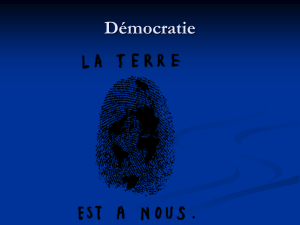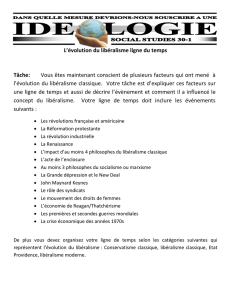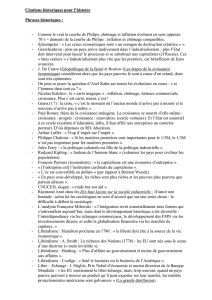Pour un libéralisme rénové

50 • Sociétal n°78
Où en est le capitalisme ?
Pour un libéralisme
rénové
marC CraPez
Chercheur en science politique associé à Sophiapol (Paris X)
La crise de 2008 a permis de redécouvrir la lune : des règles auxquelles on ne
peut indéfiniment déroger. Un mauvais procès fut fait au capitalisme et à la notion
d’efficience des marchés. Favoriser l’innovation technologique pour monter en gamme
dans la chaîne de la valeur ajoutée est une condition nécessaire mais non suffisante
de sortie de crise. Mais croire que la rupture avec le capitalisme soit une condition
suffisante et de plus en plus nécessaire est absurde.
La crise de 2008 n’a eu qu’un impact limité sur les mentalités. Le libé-
ralisme en est ressorti d’autant plus affaibli qu’il était fragilisé aupara-
vant. L’onde de choc n’a fait que dupliquer les rapports de force antérieurs.
L’antilibéralisme a redoublé d’intensité. L’idée s’est imposée que la crise
était l’aboutissement d’une entreprise de dérégulation et d’accroissement des iné-
galités inaugurée sous Reagan. C’est oublier mille autres causes, et le fait que cette
même dérégulation avait produit une période de prospérité sans précédent.
Le libéralisme recouvre quatre dimensions : libéralisme politique, économique, intellec-
tuel et culturel (ou libéralisme des mœurs). Toute prédilection exclusive pour l’une de ces
dimensions au détriment des autres cède au despotisme éclairé de son principe et tombe
sous la dépendance de sa propre logique. Le libéralisme actuel est menacé de rompre son
équilibre interne au profit d’une utopie futuriste, non spécifiquement libérale, et de son
corollaire, le mythe du gagnant-gagnant, qui l’entraînent sur une voie de garage.
Le gagnant-gagnant est une idée juste. L’économie n’est pas un jeu à somme nulle.
Elle est riche de lois et de métaphores dynamiques, qu’il s’agisse de menaces (spirale
de l’inflation, engrenage de l’endettement, cycle récessif, marchés qui dévissent) ou a
contrario d’enchaînements vertueux (l’emploi crée l’emploi car le marché de l’emploi
n’est pas un gâteau à répartir).
1-Societal 78_interieur.indd 50 04/10/12 16:50

4eme trimestre 2012 • 51
Pour un libéralisme rénové
Mais cette règle du gagnant-gagnant pèche par
esprit de système si elle oublie qu’elle ne s’applique
que dans certains cas, dans une certaine mesure et
sous certaines conditions de donnant-donnant. Le
mythe du gagnant-gagnant promeut l’idée d’une
rencontre bénéfique pour toutes les parties pre-
nantes. C’est une variante de la théorie du ruissel-
lement qui n’opère plus en cascade, verticalement,
mais par tache d’huile, horizontalement. Seulement le gagnant-gagnant n’a qu’un
temps. Tout le monde ne tire pas son épingle du jeu par une sorte de jaillissement
puis de ruissellement global des richesses.
Sous un feu nourri
De Paris à Valparaiso, de l’intellectuel à l’homme de la rue, de l’homme de bonne
volonté au spécialiste, on entend critiquer le néolibéralisme. Un « fanatisme du mar-
ché » braderait les valeurs humanistes. Ce chorus médiatique mondial fait écho aux
voix des Américains Joseph Stiglitz, Paul Krugman et James Galbraith. En France,
après un Livre noir du capitalisme, puis un Livre noir du libéralisme, se succèdent des
titres qui donnent le ton : Dépasser le libéralisme, Résister au libéralisme, Libéralisme et
pornographie…
Cerise sur le gâteau, il se publie des livres de « confessions » scandaleuses sur la
cupidité des traders, parfois pimentés de révélations de call-girls assorties d’un par-
fum de délit d’initié, en vue de faire croire que la faillite de Lehman Brothers aurait
été manigancée par le réseau d’une banque rivale. En réalité, ce fut, selon le titre
d’un livre publié en 2009, A Colossal Failure of Common Sense. Alors que la banque
Goldman Sachs était sortie du crédit subprime en précurseur, Lehman est resté
englué dans les CDS et connecté avec de nombreux hedge funds.
Certains principes sensés ont été perdus de vue. Dès 2005, dans un article intitulé « Le
développement de la finance a-t-il rendu le monde plus risqué ? », Raghuram G. Rajan
préconisait de réduire la prise de risque en demandant aux professionnels d’avoir une
portion de leur patrimoine investi dans les fonds qu’ils gèrent. Lors de son audition
aux États-Unis, l’avocat Byron Georgiou estime que l’orgie de titres hypothécaires
n’aurait pas eu lieu si leurs émetteurs avaient dû « goûter à leur propre cuisine ».
Le mythe du
gagnant-gagnant
entraîne le
libéralisme sur une
voie de garage.
1-Societal 78_interieur.indd 51 04/10/12 16:50

52 • Sociétal n°78
Où en est le capitalisme ?
Un discours futuriste
La crise résulte d’une accumulation excessive de dettes assortie de l’espoir que
« cette fois, c’est différent 1 » (Carmen Reinhart). Ce nulle part ailleurs postule que
le monde n’est plus le même, autrement dit que plus rien ne fonctionne comme
auparavant. Dick Cheney, par ailleurs célèbre pour sa brillante stratégie irakienne,
regardait péremptoirement comme prouvé par A plus B que « deficits don’t matter ».
Des auteurs de toutes sensibilités s’accordent à
reconnaître que la perfection mathématique avait
obscurci le bon sens, la « réalité nue des faits 2 », la
« banale réalité », la « vérité basique » de la saine
gestion 3 et autres « tristes repères » de la vieille
économie 4. L’accoutumance aux taux bas avait
engendré un « esprit de facilité » et « le sentiment
que la rigueur est d’un autre temps » 5.
À l’image du titre d’un livre paru en 1999, Dow 36 000, un « optimisme géné-
ral » guettait l’avènement d’un « monde nouveau » fait d’une « nouvelle convention
boursière » 6 oublieuse de « l’application des règles simples du monde capitaliste
traditionnel concernant le partage des rôles et des responsabilités entre créanciers et
actionnaires 7 ».
Règne un discours futuriste composé de « nouveaux paradigmes de la croissance »,
« paradigme de la nouvelle économie » et « grande transformation à l’œuvre », impli-
quant qu’il « faut être le plus ouvert » en ayant une « régulation permissive » 8. En
ce sens, l’exigence de capital minimum ou la démonstration de la compétence des
acteurs « constituent des barrières 9 ».
1. Carmen M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff, Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Pearson, 2010.
2. Georges Pauget, Faut-il brûler les banquiers ? Lattès, 2009, p. 69, 107.
3. Élie Cohen, Penser la crise. Défaillances de la théorie, du marché, de la régulation, Fayard, 2010, p. 237, 115.
4. Jean-Paul Betbèze, Crise : par ici la sortie, PUF, 2010, p. 36.
5. Christian Stoffaës, « La capture des banques centrales », in Jean-Hervé Lorenzi (dir.), Qui capture l’État ? PUF, 2012.
6. Élie Cohen, op. cit., p. 129, 100, 15.
7. Jean-Marc Daniel, Ricardo, reviens ! Ils sont restés keynésiens. Essai sur la prospérité économique, Bourin, 2012, p. 62.
8. Élie Cohen, op. cit., p. 14, 237, 226, 136, 118.
9. Georges Pauget, op. cit., p. 156.
La crise résulte
d’une accumulation
excessive de dettes
assortie de l’espoir
que « cette fois, c’est
différent ».
1-Societal 78_interieur.indd 52 04/10/12 16:50

4eme trimestre 2012 • 53
Pour un libéralisme rénové
Un aveuglement embarrassant
Les établissements de crédit parapublics eurent une responsabilité dans le krach de
2008. Les argumentations qui minimisent ce rôle sont entachées non seulement
d’omissions et d’inexactitudes factuelles, mais aussi de bizarreries et de contradic-
tions internes révélatrices d’un embarras. Certains auteurs réagissent brutalement,
regardant ces questions comme « parfaitement absurdes » ou « complètement erro-
nées » ou de « pure fantaisie » 10, comme pour couper court au débat. En 2002,
Stiglitz n’avait-il pas remis un rapport sur ces agences, ironisant sur une probabilité
de défaut qu’il jugeait infinitésimale ?
Le raisonnement de Krugman laisse pensif lorsqu’il affirme que ces agences n’ont
joué qu’un « rôle mineur » dans l’épidémie de crédits douteux, car elles n’en avaient
pas accordé autant que le privé, même si elles « en avaient quand même accordé
quelques-uns [sic] », ce qui accuserait unilatéralement « l’inconscience du risque qui
animait le secteur privé » 11. Pour Jean Tirole, au contraire, ces agences qui étaient
des « anomalies » n’ont pas peu « contribué » à la crise. Leur régulateur spécifique
était incompétent et intéressé ; leurs gains étaient privatisés et les pertes nationali-
sées (leurs profits ne bénéficiaient pas à la puissance publique alors qu’elles étaient
garanties par l’État sous forme de lignes de crédit auprès du Trésor et jouissaient de
la perspective d’être renflouées) 12.
Quant à Élie Cohen, il laisse filtrer quelques contradictions. N’évoque-t-il pas la
« créativité comptable » de ces agences, sans expliciter cet euphémisme qui signifie des
maquillages ? Il rejette la faute, en théorie, sur une privatisation de ces agences inter-
venue dans les années 1980, tout en exposant, en pratique, comment la Chine achetait
les titres presque adossés aux bons du Trésor de ces agencies au « statut quasi fédéral ».
Sous la corne d’abondance du financement grâce aux marchés financiers internatio-
naux, ces agences ont « monopolisé » le marché du crédit immobilier, ce qui a « attiré
les banques privées, qui pouvaient difficilement concurrencer les agences fédérales sur
la titrisation classique » 13 et qui utilisèrent une titrisation plus tarabiscotée 14.
10. Joseph E. Stiglitz, Le Triomphe de la cupidité, Les liens qui libèrent, 2010, p. 48 ; Paul Krugman, Pourquoi les crises
reviennent toujours, Seuil, 2009, p. 170 ; Jacques Mistral, in Pierre Dockès et Jean-Hervé Lorenzi (dir.), Fin de monde
ou sortie de crise ? Perrin, 2009, p. 97-99.
11. Paul Krugman, op. cit., p. 171, 182, 187.
12. Jean Tirole, Leçons d’une crise, Toulouse School of Economics, décembre 2008, p. 12, 23.
13. Élie Cohen, op. cit., p. 56, 55, 113.
14. Béchir Bouzid, « Titrisation des emprunts hypothécaires et bulle immobilière aux États-Unis : les origines d’une
débâcle », Revue d’économie financière, mars 2010, n° 97, p. 114.
1-Societal 78_interieur.indd 53 04/10/12 16:50

54 • Sociétal n°78
Où en est le capitalisme ?
Se profilent les effets domino et de contrepar-
tie d’une fusée à plusieurs étages. Si des établis-
sements privés se sont lancés dans le subprime
(et les Alt-A guère moins dangereux), c’est parce
que la titrisation des prêts immobiliers avait
été précédemment inventée par Fannie Mae
et Freddie Mac (et Ginnie Mae, un troi-
sième larron au statut d’entreprise publique)
sous forme d’ancêtres de CDO (les
MBS, Mortgage-Backed Securities, qui devinrent de plus en plus risqués)
et que ces agences avaient d’ailleurs fini par placer leurs fonds propres dans des CDO.
Les établissements privés furent incités non seulement par un procédé mais par un
système d’appel d’air qui les adossait à des agences elles-mêmes adossées au Trésor,
en cumulant cette sécurité avec la poule aux œufs d’or d’une meilleure rentabilité.
Rouage dans la genèse de la crise, ces agences en constituent ensuite un relai. Elles
figurent parmi les sources de la crise, avant d’y jouer un rôle d’accélérateurs. C’est
notamment le scandale de ces agences, et leur sauvetage les 13 juillet et 7 septembre,
qui poussèrent les pouvoirs publics à faire un exemple avec Lehman le 15 septembre.
Un mauvais procès
Renvoyer dos à dos deux « dogmes » qui seraient, respectivement, le comportement
rationnel des individus et l’efficience des marchés 15 est problématique. En effet,
l’efficience ne signifie ni prescience ni perfection présente, mais ajustements en fonc-
tion d’informations nouvelles qui infirment en permanence les précédentes. Si l’effi-
cience a pu avoir un impact négatif, c’est parce que cette hypothèse heuristique était
mésinterprétée en loi normative 16.
Cela n’empêche pas le libéralisme d’être malmené. Nicolas Baverez se révèle aussi
keynésien que les économistes sociaux-démocrates. La crise marquerait l’effon-
15. Olivier Mongin et Marc-Olivier Padis, « Une crise qui n’est pas seulement économique », Esprit, novembre 2009,
p. 8.
16. Philippe Trainar, « De l’utilité de la finance et de l’innovation financière », in Benoît Cœuré (dir.), Le Monde a-t-
il encore besoin de la finance ? Descartes & Cie, 2010, p. 97 ; j’ai également abordé ces questions, Marc Crapez, Un
besoin de certitudes. Anatomie des crises actuelles, éd. Michalon, 2010, p. 258, 232.
Les établissements de
crédit parapublics
figurent parmi les
sources de la crise,
avant d’y jouer un
rôle d’accélérateurs.
1-Societal 78_interieur.indd 54 04/10/12 16:50
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%