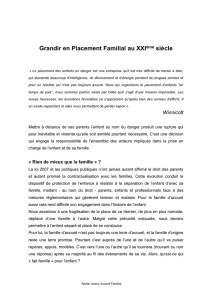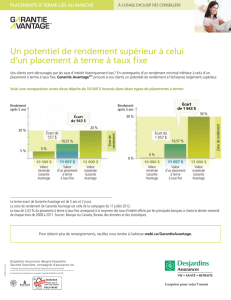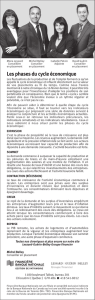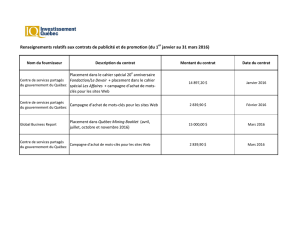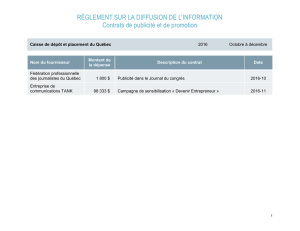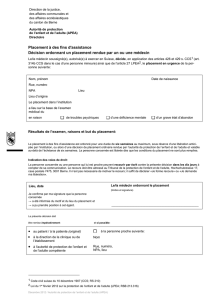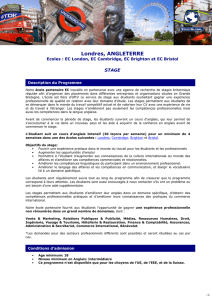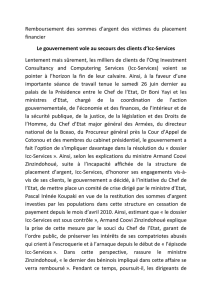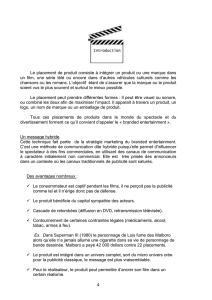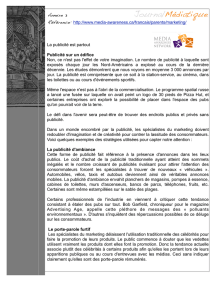Placement familial thérapeutique d™adultes : indications

Placement familial thérapeutique d’adultes : indications, aléas
Lysiane LAMANTOWICZ, assistante spécialiste, service du Dr Benoît - CHS Paul Guiraud, Villejuif.
Actualités psychiatriques n°2-3, 1993 (extraits)
(...) Les attentes à l’égard du placement familial d’adultes (PFA) sont variées. Elles vont du
fait d’offrir "une alternative à l’hospitalisation chez des sujets chronicisés qui, en dehors de
cette solution resteraient des hospitalisés à vie" jusqu’à la recherche d’une restructuration de la
personnalité grâce à un réapprentissage relationnel.
Le PFA fait donc parti couramment des moyens que se donnent certains secteurs de
psychiatrie adulte pour assurer un travail de prise en charge et de continuité des soins, rompant
avec l’enfermement hospitalier. (...)
Le PFA (Placement Familial d’Adultes) :
"Ne doit être réalisé qu’au niveau du secteur afin d’éviter l’éloignement provoquant la
rupture des relations affectives des malades, la désinsertion sociale et la transplantation dans
un milieu totalement différent.
I1 ne doit constituer qu’une étape dans la rééducation du malade permettant un soutien
temporaire et non être une impasse.
L’encadrement par le personnel soignant doit être beaucoup plus étroit.
Il ne doit pas constituer un palliatif aux insuffisances en moyens médicaux (hospices, foyers
de post-cure, etc.).
Une formation des familles nourricières doit être entreprise, permettant une meilleure prise
en charge."
Ce type de profession de foi dont s’inspirent les équipes de PFA est loin de répondre à tous les
problèmes liés à la prise en charge des pathologies lourdes et chroniques en psychiatrie.
Quoiqu’il en soit, en quelques années, le visage de l’accueil familial des malades mentaux
adultes s’est considérablement transformé. L’enthousiasme des praticiens et des équipes a
trouvé des issues positives dans un bon nombre de cas et même pour des patients déjà très
chronicisés. Dans notre expérience, des évolutions positives assez inattendues ont été
observées, "gommant" certains échecs, inévitables dans la mise au point de toute nouvelle
technique institutionnelle.
Types de PFA :
Aujourd’hui comme hier, les équipes psychiatriques ont toujours à s’occuper de ce qu’on
appelle le "sédiment asilaire". Celui-ci continue à se former, même si moins rapidement
qu’autrefois. Aussi chaque service comprend, outre les éventuels "chroniques"" hérités de
l’avant sectorisation, son quota de nouveaux malades de séjour prolongé. Il faut ajouter ici la
clientèle bien particulière des "anciens enfants", le plus souvent des autistes, qui à l’âge
fatidique de dix-huit ans passent d’un service infanto-juvénile en service adultes.
C’est dans cette brèche étroite entre désinstitutionnalisation et "nouvelle chronicité",
contingences économiques et objectifs thérapeutiques, travail de secteur de hospitalocentrisme
que se déploie une nouvelle pratique polymorphe dans ses indications, ses formes, ses
modalités. Pour rendre compte des types de placement familial, il est intéressant de reprendre
la classification de Schurmans. Cet auteur décrit trois formes de "Thérapie d’Accueil
Page
1
sur
6
Placement familial th
é
rapeutique d'adultes : indications, al
é
as
-
Famidac
30/01/2008
http://www.famidac.fr/article47.html

Familial" :
"Le PR (Placement Résidentiel), réservé aux handicapés à séjour prolongé, qui est une
version améliorée du placement familial traditionnel.
Le RSF (Réadaptation Socio-Familiale), où le placement est conçu comme un séjour de
post-cure : le principe thérapeutique est basé sur la participation active du patient à la vie
d’une communauté "normale" avec l’aide d’un service social actif.
La TFA (Thérapie Familiale en milieu d’Accueil) où l’on essaie d’utiliser le milieu
d’accueil lui-même comme instrument d’une thérapie relationnelle".
Ces trois situations correspondent à des ambitions thérapeutiques différentes et surtout à des
indications différentes. Mais au-delà des ambitions, dans la pratique, un placement défini
initialement comme thérapeutique pourra se transformer en placement résidentiel malgré les
efforts développés par l’équipe. Celle-ci sera devant le dilemme d’avoir à décider de
l’interruption ou non de ce placement. En effet, elle n’a pas obligatoirement d’autre solution
que le retour à l’hôpital.
A l’opposé, un placement dit résidentiel peut devenir évolutif sans que l’équipe maîtrise le
processus et comprenne les raisons de cette transformation. Ceci conduit à constituer des
équipes pluridisciplinaires (psychologue, psychiatre, sociologue, cf. Schurmans) qui tentent,
par une analyse multifactorielle, d’élaborer des modèles de compréhension des processus en
cours. Ces recherches vont offrir des indicateurs aux équipes pour dégager dans chaque cas la
conduite à tenir. Le but est qu’un placement soit pris dans un mouvement évolutif et ne se
transforme pas en une situation figée. Au-delà de cette recherche, on peut aujourd’hui dégager
un certain nombre des caractéristiques communes aux PFA (que ce soit au niveau des
indications, des facteurs de pronostic, que de l’organisation et des objectifs des équipes
constituées).
Évaluation des indications
Les critères de sélection des patients par les équipes sortent des cadres nosographiques
classiques. Ils s’articulent autour des axes suivants :
La carence du milieu familial d’origine. Ceci ne veut pas dire qu’il y a absence de celui-ci,
mais parfois impossibilité matérielle ou relationnelle d’assistance hors de l’hôpital. Alors
apparaît la possibilité et même souvent l’obligation de travailler avec ce milieu.
La capacité identificatoire du patient.
Ses capacités de communication et d’échange.
Sa tolérance à l’existence de relations interindividuelles.
Dans les cas, fréquents, d’une durée de séjour hospitalier prolongé, le sentiment d’impuissance
des soignants peut inciter ceux-ci à déclarer que les troubles de la communication des patients
sont dus aux effets nocifs engendrés par "l’Asile". Il est vrai que l’institution psychiatrique
classique semble régie par un modèle hyper homéostatique où les contrôles réciproques sont
intenses et où toute évolution prend l’allure d’une crise grave. Sous cet angle, c’est un lieu qui
se prête mal au travail de restructuration de la personnalité do psychotique lorsque s’installe la
chronicité hospitalière.
Pourtant, ce travail est le but officiel inscrit au programme des équipes. On se souviendra à ce
propos des observations de Goffmall sur la "structure totalitaire" de l’Asile ou de celle de
Stanton et Schwartz concernant les processus aliénants induits par l’institution au sein de
laquelle "les scissions intra-institutionnelles reflètent en miroir la structure de la psychose et
sont donc sources de troubles chez les patients hospitalisés".
Page
2
sur
6
Placement familial th
é
rapeutique d'adultes : indications, al
é
as
-
Famidac
30/01/2008
http://www.famidac.fr/article47.html

Dans l’idéal, le patient "devrait" changer, une fois placé dans un milieu familial chaleureux
dont les transactions sont régies par l’objectif de l’épanouissement de la personnalité de ses
membres et de la compréhension des mouvements affectifs de ceux-ci.
Cette idéalisation ne résiste pas à la pratique. En fait, l’hôpital psychiatrique est le lieu qui
offre aux psychotiques la possibilité de régler eux-mêmes la distance objectale à son niveau
minimal. Alors que la vie dans une famille va les obliger à une implication relationnelle et
affective qui ne sera pas toujours supportable pour eux. Contrairement à l’institution, les
distorsions de la vie sociale sont d’autant plus difficiles à supporter dans le vase clos qu’est la
famille.
Ce leurre est d’autant plus entretenu que certaines pathologies mentales, telles que la
schizophrénie, ont tendance à se stabiliser sous l’influence des thérapeutiques modernes avec
une diminution des manifestations cliniques bruyantes au profit des aspects déficitaires tels
que perte de l’initiative, apragmatisme... à laquelle l’hôpital psychiatrique se prête très ou trop
aisément.
Ainsi certaines s’étonneront qu’un patient stabilisé ne réponde pas favorablement à
"l’ambiance affective proposée", négligeant par la même que cette stabilisation s’est faite au
prix d’une prise de distance devenue insurmontable. Sur le plan nosographique concernant les
indications, on peut dont dégager un certain consensus entre les équipes sur :
les psychoses chroniques de l’adulte,
et les psychoses infantiles parvenues à l’age adulte.
Nous aurons conscience de la difficulté de ce travail avec les jeunes psychotiques dont la
famille reste très présente. Chez elle, le placement va réveiller des sentiments de culpabilité
enfouis grâce l’hospitalisation. Mais les possibilités évolutives et favorables vont dépendre à la
foi :
De l’âge du patient au moment où l’on envisage le placement (avec la crainte que plus le
patient est âgé, plus il sera difficile de rendre la situation de placement évolutive) ;
De la durée de l’hospitalisation antérieure et de la pathologie asilaire surajoutée
(dépendances, absence ou perte d’autonomie).
Pierre Sans retient une contre-indication formelle, le risque suicidaire, bien sûr trop difficile à
faire supporter à la famille d’accueil. Les autres contre-indications retenues par les équipes
sont :
l’alcoolisme chronique non sevré ;
les troubles du comportement type fugue, vol, impulsivité ;
la psychopathie, la perversion.
L’opposition ou le manque de coopération des familles d’origine, évoqué plus haut, constitue
un obstacle difficile à contourner.
Dans notre expérience, l’alcoolisme non sevré ne constitue pas un obstacle. Au contraire, on
assiste, sous l’effet des remaniements relationnels, à la disparition ou à l’aménagement du
symptôme. En ce qui concerne la famille d’origine, les difficultés sont apparues quand il a été
impossible de travailler avec celle-ci du fait de l’éloignement géographique. Par contre avec
une famille réticente, le fait de pouvoir la rencontrer a permis que puissent s’exprimer les
sentiments de culpabilité enfouis et réveillés à cette occasion. La crise a alors été
heureusement surmontée.
Organisation et aléas
Page
3
sur
6
Placement familial th
é
rapeutique d'adultes : indications, al
é
as
-
Famidac
30/01/2008
http://www.famidac.fr/article47.html

(...) notre service étant situé à Villejuif, notre aire géographique définie va de 25 kilomètres à
40 kilomètres autour des lieux d’implantation des structures sectorielles (Boulogne - 92) et /ou
de l’hôpital.
On peut, à cette occasion, évoquer les difficultés de recrutement des familles dans les zones
urbaines et ou socialement aisées. Le nombre de places géré par la même équipe est limité,
allant de 5 à 25. L’équipe est, soit totalement individualisée (au sein du secteur ou
intersectorielle), soit comprise dans l’équipe extrahospitalière du secteur.
Dans notre cas, participent des soignants de l’intra et l’extra pour une partie de leur temps
hebdomadaire. En général, les équipes s’entendent sur le fait qu’elles doivent être de petite
taille afin que les responsabilités soient clairement assumées. La différenciation des rôles
limite les effets pervers des clivages intra-institutionnels. Il faut assumer le travail de suivi qui
correspond en moyenne à une visite à domicile tous les quinze jours par placement. Cette
description assez floue nous fera évoquer les difficultés signalées par de nombreuses équipes
s’occupant du placement familial.
Il peut être difficile pour les intervenants de se différencier par rapport aux structures
hospitalières et extrahospitalières préexistantes déjà bien définies.
Les structures de placement familial, contrairement à d’autres structures de
"l’extrahospitalier", en quelque sorte plus "animées" par l’autonomie, même altérée, de leurs
patients, sont amenées à prendre en charge essentiellement des patients au long passé
d’hospitalisation. Le fonctionnement de l’équipe de placement familial, implanté dans des
zones indépendantes de l’hôpital, crée dans les équipes hospitalières un sentiment de
dépossession.
Le patient, à sa sortie, leur échappe. Or, il avait souvent acquis, au fil des ans, un statut un peu
particulier, celui de "compagnon" certes dévalorisé, mais réel.
On sait que les patients ne sont pas les seuls à se "chroniciser" ; chez les soignants aussi existe
une adaptation au long cours à une réalité mise à part du monde extérieur avec ses règles
propres, adaptation qui devient parfois difficile à remettre en cause passées quelques années...
A l’opposé, l’unité soignante qui gère le placement familial s’adressant principalement aux
patients "chroniques" va fréquemment se sentir le "parent pauvre" d’une psychiatrie de secteur
"de pointe". Le souvenir des colonies familiales reste une référence repoussoir dans bien des
esprits.
Le placement familial peut continuer à être envisagé dans une perspective de
désencombrement, et apparaît souvent comme un pis-aller, ou plutôt un "mieux aller" minimal
pour des patients dont l’absence quasi complète d’autonomie ne permet pas d’envisager une
autre structure "alternative".
Une autre question non résolue est celle du vieillissement du patient et des familles d’accueil.
Quelles que soient les intentions de ses protagonistes, le placement familial reste une solution
de longue durée, si ce n’est définitive. Il est douloureux d’envisager le retour à l’hôpital d’un
patient devenu trop âgé, représentant alors une trop grande charge pour la famille d’accueil. Ce
problème peut être évoqué aussi dans le cas où c’est la famille d’accueil qui a vieilli.
Objectifs
La définition des objectifs des placements familiaux d’adultes va dépendre de deux éléments :
Un facteur d’ordre pratique : quelle est la population présente dans tel secteur ? Quelles sont
les autres structures dont dispose le secteur ?
Page
4
sur
6
Placement familial th
é
rapeutique d'adultes : indications, al
é
as
-
Famidac
30/01/2008
http://www.famidac.fr/article47.html

Un facteur d’ordre théorique : Qu’est-ce qui fait de l’accueil familial un instrument
thérapeutique ? Qu’est-ce qui nous permet de penser qu’une famille inexpérimentée pourrait
réussir là où des professionnels ont échoué ?
Le facteur d’ordre pratique nous semble fondamental. Le placement familial va être utilisé en
priorité pour les patients désinsérés de longue date, sans autre perspective de réinsertion socio-
affective : il s’agira au mieux "d’offrir au patient très désinséré des conditions d’existence
moins ségrégatives qu’à l’hôpital psychiatrique".
A la différence de la colonie familiale, il n’y aura pas déracinement du patient et l’intégration
à la vie de famille sera réelle. Alors, le placement familial, sans perdre sa raison d’être, ne peut
plus se prévaloir d’un caractère proprement thérapeutique. Le placement pourra s’adresser à
des sujets dont l’évolution paraît moins compromise. Il jouera un "rôle de passerelle ou de
tremplin entre l’hospitalisation et une autre forme de vie à l’extérieur de l’hôpital". Mais les
équipes s’entendent pour reconnaître que l’évolution vers une réelle autonomie sociale et
affective est rare. Les attentes envers le placement familial vont donc être :
Offrir des conditions de vie plus humaines et sécurisantes que dans un hôpital psychiatrique
ou dans un foyer. Le patient fait l’expérience qu’il est possible de vivre en dehors des murs
de l’hôpital tout en éprouvant une stabilité d’environnement et la possibilité de (re)faire
l’expérience d’une certaine sécurité relationnelle ;
Proposer un autre statut au patient considéré alors comme une personne à part entière même
s’il est "un peu bizarre" et ce à travers la capacité qu’aura la famille de "redonner au
symptôme sa valeur relationnelle sans culpabiliser le patient".
Permettre un travail de rééducation dans la vie quotidienne par l’accompagnement dans les
démarches administratives, par le dynamisme stimulant d’un exemple de travail quotidien,
obligation de suivre une logique rigoureuse dans l’accomplissement d’une tâche
quotidienne". En effet, il sera toujours demandé au patient au minimum de participer à la vie
quotidienne et parfois d’y occuper une place active, en fonction de ses désirs et de ses
capacités.
Offrir un contexte de vie chaleureux qui permet l’émergence des ressources affectives et
intellectuelles du patient, et mobiliser ses capacités d’évolution tout en sachant les limites
d’efficacité de cette "chaleur".
Reste à savoir pourquoi cela doit se faire dans une famille, pourquoi ces tâches ne pourraient-
elles pas être remplies par toute autre structure ? Qu’est-ce qui fait de la famille le lieu
privilégié de cette restructuration ? Pourquoi après l’avoir rendue responsable de mille maux
(pathogénie de la psychose, porteuse des valeurs traditionnelles oppressives de la société), la
famille devient-elle la structure idéale pour le traitement de la pathologie mentale ? (...)
Commentaires
(...) Certains ont dénoncé le fait que ce type de formule ne permettait que de déplacer la
chronicité à moindres frais dans un autre milieu. En effet, de plus en plus de secteurs se dotent
de cet outil en apparence facile à déployer et offrant la possibilité de libérer des lits. Ceci est
relativement facile à la condition toutefois d’un travail très cohérent de l’unité fonctionnelle
créée dans ce sens et acquérant au fil des cas et du temps une expérience positive.
Au-delà du critère d’ordre économique, se pose donc la question de la qualité de ces
placements. En la matière, la pratique précède la théorie et les modèles actuellement proposés
ne sont que des tentatives de remise en ordre a posteriori d’un total empirisme. Tous les
intervenants s’entendent pour considérer que le placement en famille d’accueil va permettre au
patient de renouer des liens sociaux grâce aux possibilités réadaptatives qu’offre la vie dans
Page
5
sur
6
Placement familial th
é
rapeutique d'adultes : indications, al
é
as
-
Famidac
30/01/2008
http://www.famidac.fr/article47.html
 6
6
1
/
6
100%