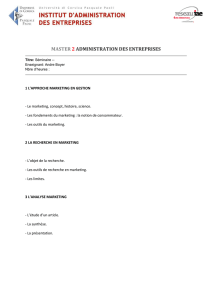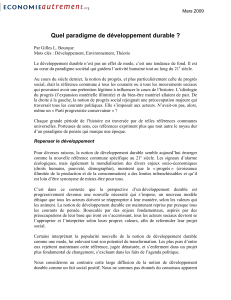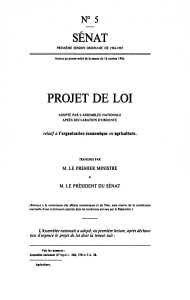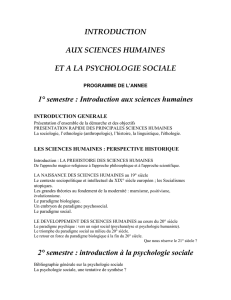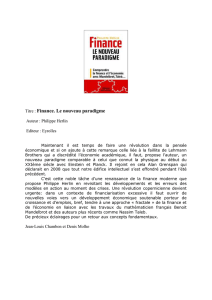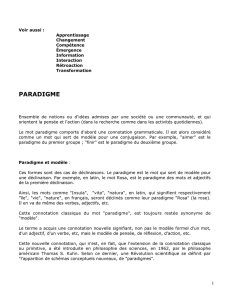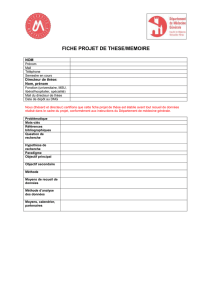une question de paradigme - Société Française d`Economie Rurale

1
Démantèlement et pérennité des offices de commercialisation :
une question de paradigme ?
Annie Royer1, Jean-Michel Couture2, Daniel-Mercier Gouin1
La pérennité des offices de commercialisation agricoles canadiens contraste avec le
démantèlement massif de ces organisations partout ailleurs dans le monde. Cet article propose
d’analyser les raisons sous-jacentes aux démantèlements des offices laitiers de Grande-
Bretagne, Nouvelle-Zélande et Australie afin de mieux comprendre pourquoi les offices
canadiens perdurent. L’analyse des divers cas est faite à l’aide d’une grille d’analyse construite
à partir d’une revue de littérature néo-institutionnaliste et politique des changements de
paradigme. Les résultats montrent que les démantèlements ont tous été effectués au cours ou à
la suite d’un changement de paradigme économique. Les offices canadiens n’auraient pas
connu le même sort, notamment parce que le paradigme qui soutient ces organisations n’a
toujours pas été remis en question dans ce pays pour des raisons de pragmatisme économique
et politique, et que les offices n’auraient pas connus de dysfonctionnements pouvant mener à
d’importantes inefficacités.
Mots-clés : paradigme économique, offices de commercialisation, secteur laitier, Canada
JEL : H00, D02, Q13
1. Introduction
Certains auteurs mentionnent que les récentes réformes et changements en matière de
politiques agricoles sont l’aboutissement d’un changement de paradigme économique
(cf. notamment Coleman 1998). Les politiques ne seraient plus modelées par le modèle
de l’exception agricole et de l’état interventionniste, mais par celui du libre marché.
D’autres auteurs argumentent que les réformes sont plutôt programmatiques et qu’elles
ne constituent que des changements à l’intérieur du même paradigme (Skogstad 2008
b.). Ainsi, les réformes des années 90 et 2000 ont modifié le type d’instruments
politiques utilisés, mais le paradigme de l’État interventionniste serait toujours
dominant dans le paysage des politiques agricoles.
L’analyse des démantèlements des offices de commercialisation au cours des années 80-
90 représente un cas de figure intéressant dans le cadre de ce débat. Au cours des années
1970, on retrouvait des offices de commercialisation des produits agricoles dans la
plupart des pays du Commonwealth, ainsi qu’en Europe du Nord, en Afrique et en Asie.
Or, depuis le milieu des années quatre-vingt, ces offices, plus souvent connus sous le
terme anglais de marketing board, ont commencé à perdre de leur importance. Dans
plusieurs cas, ils ont même été purement et simplement démantelés, tout
particulièrement au sein des pays du Commonwealth. Ces démantèlements ne semblent
pas être des ajustements ou des modifications de politiques à la marge, ils présentent des
signes d’un changement radical d’orientation de la coordination de la mise en marché
des produits agricoles.
À l’opposé, au Canada, la commercialisation des produits agricoles se fait toujours en
grande partie par le biais d’offices de commercialisation bénéficiant de toute une
panoplie de pouvoirs afin d’ordonner la mise en marché. De fait, peu d’offices de
1 Université Laval, département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation.
2 Groupe Agéco, Québec.

2
commercialisation y ont été démantelés au cours des années récentes. Il y subsiste
encore six offices fédéraux et environ 90 offices provinciaux et régionaux (Royer 2009).
De nouveaux offices ont même été créés au cours des dernières années, notamment au
Québec, et certains offices acquièrent encore ponctuellement de nouveaux pouvoirs.
Ce contraste en matière de réglementation des marchés agricoles est tout
particulièrement frappant dans le cas du secteur laitier. Au Canada, ce secteur est
aujourd’hui encore encadré par l’une des formes les plus achevées de ces organisations
de mise en marché, ses pouvoirs allant du prélèvement de contributions obligatoires
pour financer l’administration de l’office, la recherche et la publicité générique, en
passant par la négociation de contrats collectifs permettant une discrimination des prix
payés par les transformateurs laitiers et une péréquation des prix aux producteurs,
jusqu’à la gestion au niveau des producteurs individuels du système de contingentement
de la production. A contrario, la plupart des pays qui s’étaient dotés d’une
réglementation comparable dans ce secteur, tels le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande
et l’Australie, ont opté pour l’abolition de ce mode d’intervention. Le démantèlement
des offices du lait dans plusieurs pays et leur pérennité au Canada soulèvent plusieurs
questionnements, surtout que le Canada, comme tous les autres pays susmentionnés, a
été et est toujours soumis au même environnement économique international. Dans ce
contexte, il est pertinent de se questionner sur les raisons de cette différence et d’évaluer
en quoi les conditions qui ont conduit aux démantèlements dans de nombreux pays ne
sont-elles pas réunies au Canada.
Ce travail propose donc d’analyser trois cas de démantèlements d’offices de
commercialisation dans le secteur laitier – le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande – à partir d’une grille d’analyse des conditions de changement de paradigme et
de déterminer en quoi le cas canadien diffère des autres. L’utilisation du concept de
paradigme politique nous semble approprié pour traiter de cette question puisqu’il a été
utilisé dans plusieurs études pour expliquer des constats semblables (Coleman 1998),
notamment les différences de politiques entre l’Europe et les États-Unis (Skogstad
1998).
Les résultats de l’analyse montrent que tous les cas de démantèlement analysés ont pour
dénominateur commun des dysfonctionnements dans le paradigme de l’État
interventionniste et un changement graduel ou radical vers des politiques publiques
influencées par le paradigme de libre-marché. Les démantèlements d’offices de
commercialisation dans les trois pays examinés seraient donc bel et bien le résultat d’un
changement de paradigme économique. La persistance des offices canadiens serait entre
autres expliquée par le fait qu’ils n’auraient pas soufferts des échecs du paradigme
interventionniste de façon aussi évidente que dans d’autres pays, ni de
dysfonctionnements causés par des chocs domestiques ou internationaux.
L’article est construit comme suit. La deuxième section présente brièvement la nature et
les objectifs des offices de commercialisation. La troisième section examine les
principales intuitions de la littérature sur les conditions de changement de paradigme
économique et élabore une grille d’analyse. La quatrième section examine les cas de
démantèlement des offices laitiers en Grande-Bretagne, en Australie et en Nouvelle-
Zélande à partir de la grille d’analyse élaborée dans la section précédente. La cinquième
section examine le cas de résilience canadien. La dernière section conclut.
2. Les offices de commercialisation

3
De façon générale, les offices de commercialisation sont des institutions disposant de
pouvoirs délégués par l’État leur permettant de commercialiser les produis agricoles au
nom des producteurs, et donc de s’interposer dans l’échange du produit agricole brut
entre producteurs agricoles et acheteurs. Veeman définit les offices de
commercialisation canadiens comme des « institutions obligatoires de
commercialisation définies et encadrées législativement qui accomplissent les
différentes fonctions de commercialisation au nom des producteurs d’un produit
agricole particulier » (Veeman 1987: 992).
Les offices de commercialisation sont apparus dans la première moitié du XXème et ont
connu leur apogée au cours des années 1960 et 1970. Plusieurs caractéristiques de ces
organisations les distinguent des autres formes d’intervention en agriculture. Tout
d’abord, les offices sont définis sous l’égide d’une législation et jouissent de pouvoirs
délégués par l’autorité gouvernementale. Deuxièmement, ils sont obligatoires, ce qui
signifie que tous les producteurs visés par les activités de l’office pour un produit et une
région spécifiques doivent se conformer obligatoirement aux règles de l’office lorsque
ce dernier devient opérationnel. Troisièmement, la motivation pour mettre en place un
office provient généralement de la volonté des producteurs eux-mêmes et leur processus
de mise en œuvre peut comporter un référendum tenu auprès de tous les producteurs
concernés. Dans un tel cas, le seuil d’approbation requis est relativement élevé; par
exemple au Québec, la moitié des producteurs doivent avoir exercé leur droit de vote et
deux-tiers des votants doivent s’être prononcés en faveur du projet d’office. Enfin, les
opérations courantes des offices sont financées par des contributions obligatoires
versées par les producteurs généralement au prorata du volume individuel de production
commercialisé.
Outre ce cadre général, il existe plusieurs types d’offices ayant divers impacts sur la
commercialisation et les prix des produits agricoles. Ceux-ci se distinguent selon les
pouvoirs mis à leur disposition par le cadre législatif duquel ils relèvent et du choix
qu’ils font d’utiliser tout ou partie de ces pouvoirs. Royer (2009, p. 29) relève que la
littérature distingue ainsi quatre types d’office qui se différencient selon leur niveau
d’intervention dans la commercialisation du produit agricole visé: les offices
promotionnels, les offices de négociation, les agences de vente centralisée et les offices
de contingentement de l’offre (Veeman 1987, Jean et Gouin 2001, Loyns 1980). Bien
que cette typologie relève de l’observation et de l’analyse des offices dans le contexte
canadien, elle correspond tout à fait à la réalité des offices du lait des trois pays à
l’étude. Dans chacun des cas à l’étude, tout comme au Canada, les offices du lait étaient
de ceux qui utilisaient le plus l’ensemble des pouvoirs disponibles.
3. Paradigme, Politiques Publiques et Institutions
Les politiques agricoles des pays développés ont connu d’importantes réformes au cours
des deux dernières décennies. Certains analystes parlent de changements radicaux basés
sur un changement de paradigme économique. D’autres auteurs parlent plutôt de
changements plus graduels, programmatiques, qui prennent place à l’intérieur du
paradigme existant (Skogstad 2008b). Le démantèlement presque simultané de
nombreux offices de commercialisation dans différents pays laisse présager que leur
disparition n’est pas due à un simple changement programmatique, les facteurs en cause
seraient beaucoup plus fondamentaux, voire paradigmatique. Différents facteurs
peuvent inciter à enclencher d’importants changements de politiques publiques. Ces

4
facteurs peuvent provenir de menaces internationales (accords commerciaux) ou
domestiques (crise majeure, inflation) (Skogstad 2008b). Bien que la pondération de ces
causes soit une question qui relève de l’analyse de cas, chacune joue néanmoins un rôle
déterminant et leur portée peut être significative dans le déroulement du processus de
changement. Cette section a pour objectif d’examiner la littérature portant sur les
facteurs explicatifs des changements d’orientation des politiques publiques
économiques, et plus spécifiquement des changements politiques découlant d’un
changement de paradigme économique. Cette revue de littérature permettra d’élaborer
une grille d’analyse des principales conditions d’un changement de paradigme qui sera
utilisée pour expliquer les cas de démantèlement en Nouvelle-Zélande, Australie et
Royaume-Uni ainsi que la persistance des offices laitiers canadiens.
3.1 Les paradigmes politiques et leur transformation
Toutes les politiques publiques se développent à l’intérieur d’un cadre interprétatif (Hall
1993), ou référentiel selon le vocable de Jobert et Muller (1995). Ce cadre interprétatif
est défini par Hall (1993) comme un ensemble de croyances normatives et cognitives
qui spécifient les objectifs des politiques publiques, le type d’instrument qui doit être
utilisé par ces politiques, et la nature des problèmes à résoudre. Cet ensemble de
croyances, qui forment un paradigme politique, sert de cadre dans l’élaboration de
politiques mais aussi établit qui pourra participer à l’élaboration de politiques et qui sera
mis à l’écart (Skogstad 2008a: 9).
Selon Hall (1993), un paradigme est, par définition, non quantifiable en terme
scientifique ou technique. Chaque paradigme possède sa propre vision du
fonctionnement du monde et chaque vision est différente, ce qui rend impossible un
accord sur une vision identique des faits entre les tenants de différents paradigmes.
Toujours selon Hall, cette situation mène à trois implications. D’abord, que le processus
de changement d’un paradigme à un autre est plus sociologique que scientifique (Hall
1993: 280), c’est-à-dire que le choix entre divers paradigmes ne se fait pas seulement
sur une base scientifique. Le changement de paradigme ne dépendra donc pas seulement
des arguments des groupes qui s’affrontent mais également de leur capacité à influencer
les décideurs politiques, que ce soit par leur avantage positionnel dans le cadre
institutionnel général, des ressources qu’ils peuvent mobiliser dans leur conflit avec les
autres groupes et des facteurs exogènes qui affectent le pouvoir du groupe à imposer
son paradigme.
Ensuite, que les questions d’autorité et de crédibilité seront centrales dans le processus
de changement de paradigme. Devant choisir parmi les opinions contradictoires des
experts, les politiciens doivent décider qui de ces experts a le plus d’autorité et de
crédibilité par rapport aux problématiques posées. Comme l’indique Shirley (2009), un
nouveau paradigme a plus de chance d’être accepté s’il est promu par des individus qui
sont perçus comme des experts crédibles, ajoutant que les experts gagnent en crédibilité
quand leurs idées sont partagées par une communauté d’experts reconnus.
Enfin, les dysfonctionnements et les échecs de la politique existante peuvent aussi jouer
un rôle dans le changement de paradigme puisqu’ils minent la cohérence intellectuelle
et les fondements du paradigme originel, sapant au passage l’autorité et/ou la crédibilité
de ce paradigme. Le paradigme alternatif sera alors vu comme étant plus pertinent pour
résoudre le problème perçu et gagnera en popularité auprès des décideurs politiques

5
(Shirley 2009). En résumé, les conditions d’un changement de paradigme (1993) sont,
selon Hall, 1) l’accumulation de dysfonctionnements du paradigme existant, 2)
l’existence d’un paradigme alternatif perçu comme viable d’un point de vue
économique et politique et 3) la présence d’acteurs en faveur du nouveau paradigme à
des postes décisionnels ou d’influence dans la structure gouvernementale.
D’autres auteurs ont argumenté que les discussions sur les changements de politiques
sont souvent confinées aux réseaux sectoriels et que ce sont plutôt des changements de
politiques négociés entre l’État et les organisations sectorielles qui seraient à l’origine
d’un changement de paradigme. Coleman et al (1997) argumentent que la transition
vers un changement de paradigme peut être beaucoup plus graduelle que ce que Hall
(1993) semble avancer et qu’elle peut également s’effectuer sur la base d’une
négociation entre l’État et les groupes d’intérêt sectoriels. Dans le secteur agricole par
exemple, les effets des politiques sont surtout visibles par les producteurs agricoles et
beaucoup moins par le public en général. Les politiques agricoles prédisposent donc à la
formation et l’institutionnalisation de groupes d’intérêt sectoriels, alors que les
politiques macroéconomiques, utilisées en exemple par Hall (1993), ne génèrent
généralement pas ce type d’organisation étant donné leur nature.
Coleman et al (1997) vont plus loin en mentionnant qu’il y aurait deux principaux types
de réseaux politiques dans le secteur agricole, les groupes de pression pluralistes
(pressure pluralism) et le corporatisme sectoriel. Les groupes de pression pluralistes
montrent généralement de faibles niveaux d’intégration verticale et horizontale,
poursuivent des intérêts concurrents, et agissent sur une base ad hoc. Des changements
significatifs de politiques ont peu de chance d’être opérés en présence de réseaux
politiques pluralistes puisque ces derniers poursuivent généralement des intérêts
concurrents. Ces groupes sont également plus réactifs qu’anticipateurs, et ne remettent
pas en question le paradigme dominant. Les groupes corporatistes, au contraire, sont
souvent des monopoles représentationnels institutionnalisés qui participent
régulièrement à la formulation de politiques publiques qui visent leurs membres. Ces
groupes ont pour objectif de protéger les intérêts collectifs à long-terme et sont donc
plus enclins à négocier les changements de politiques avec l’État, ce qui peut avec le
temps mener à un changement de paradigme. La présence de groupes corporatistes dans
le secteur agricole peut donc avoir des conséquences sur un changement ou non de
paradigme.
Une autre explication des changements d’orientation des politiques publiques basée sur
le concept de synchronisme a été développée par Jobert et Muller (1987). Ces auteurs
avancent que le paradigme d’un secteur économique est défini en partie par le
paradigme économique présent dans la société globale. Le paradigme sectoriel porte
en lui-même certaines images de la relation entre le secteur et le reste de l’économie et
de ce que cette relation devrait être. Jobert et Muller appellent cette relation le rapport
global-sectoriel. Lorsque les autorités politiques perçoivent le paradigme sectoriel en
synchronisme avec celui de l’économie générale, le besoin de réformer ou de changer
les politiques n’est pas aussi impératif que lorsque le paradigme économique sectoriel
semble ne pas être en adéquation avec le paradigme de l’économie générale, en d’autres
mots, que le secteur traîne derrière l’économie générale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%