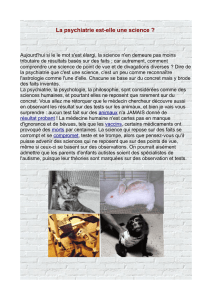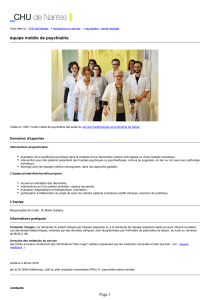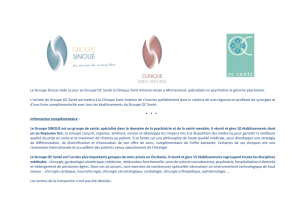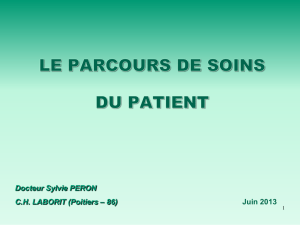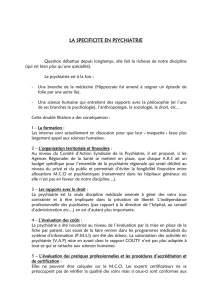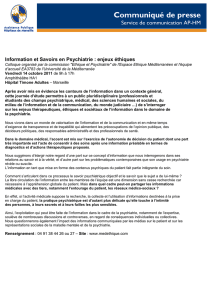LLPF-N°-227-Octobre-novembre-2014

La Lettre
de
P
sychiatrie
F
rançaise
N° 227 • octobre-novembre 2014
la lettre du syndicat des psychiatres français et de l’association française de psychiatrie
DE L’IDENTITÉ AU STATUT
DU PSYCHIATRE
L
e psychiatre à l’instar de chaque médecin, mais plus que tout
autre, se questionne de longue date sur sa place et ses repères.
Il sait la nécessité de rendre compte de ses résultats, mais il pense
que son exercice reste aussi un art. Il ne voit aucune
incompatibilité entre protocole, procédures, recommandations
de bonne pratique et permanence d’un soin personnalisé, fonction de chaque situation autour
d’une disponibilité éclairée tant pour les plus meurtris par la maladie que pour ceux, chez qui,
elle est en voie de constitution.
L’ identité du psychiatre est constitutive de cette posture médicale de soin, dans une
pratique qui ne peut être coupée de la psychothérapie, hormis parfois dans certaines situations
artificielles guidées par la recherche, l’expertise ou autre. Cette posture de soin infiltre toute
l’intervention du psychiatre, et ne le limite pas dans la possibilité qu’il a d’y inscrire une
psychothérapie structurée ou d’établir diverses collaborations professionnelles.
La succession des différents plans et lois de santé, spécifiques ou non à la santé mentale et à
la psychiatrie, fait planer le doute quant à la pérennité d’un exercice psychiatrique libéral,
autonome, indépendant, respectant le libre choix tant du patient que du psychiatre. Nous ne
sommes pas seuls sur ce radeau, où les autres spécialistes libéraux menacés de disparition se
voient aussi embarqués. Pourtant tout le monde parle d’économie de santé, de déficit abyssal
des hôpitaux, et surtout de l’intérêt et de la performance des pratiques ambulatoires. Les oublis
massifs concernant la psychiatrie dans le dernier projet de Loi de santé ne nous rassurent pas.
Si la question de la territorialisation de l’offre de soins nous intéresse, nous aurions aimé voir
soulignés le rôle et la place de chacun et en particulier celle des psychiatres libéraux.
La mise en mouvement des Agences Régionales de Santé laisse aujourd’hui entrevoir ce
que peut être une étatisation de la santé. Les concertations remplacent les négociations et les
assemblées républicaines, en raison de la représentation des parties qui les composent, sont
des chambres d’enregistrement de décisions prises par l’administration, assurée d’avance de
réunir une majorité. Le psychiatre risque ainsi de voir la fin de ses questionnements. La haute
administration lui dictera sa place et ses missions. Le psychiatre devra rejoindre le sillon de la
démarche médicale sans s’en éloigner. Il tracera ses actions : signes, diagnostic, et ne déviera
pas des traitements recommandés qu’il sera habilité à dispenser.
Ainsi dans cette atmosphère de démembrement de notre spécialité et de délégations de
compétence déguisées, nous voyons poindre les pièges que la reconnaissance d’un titre de
psychothérapeute, que nous avons accompagnée pour tenter d’infléchir la compétence vers le
haut, comporte. D’une part nous assistons à l’éclosion de psycho-praticiens et autres psy,
propice à entretenir une grande confusion chez les patients et d’autre part nous dénonçons le
risque d’un effet d’aubaine porteur de leurre quand est affirmé que l’accès aux psychothérapies,
sous-entendu à leur remboursement, va améliorer l’accès aux soins. Comment décider d’un
soin, aussi complexe que la psychothérapie sans au préalable s’être donné les moyens de
définir, de repérer, d’analyser, de comprendre et de diagnostiquer la difficulté ou la pathologie,
en question ?
Ce système qui s’attaque d’un côté à la question du libre choix sans autre imagination de
l’État pour maîtriser les coûts de santé, et qui permet de l’autre à des actionnaires capitalistes
d’encaisser les honoraires des psychiatres, ne nous satisfait pas. Si la grande braderie
commerciale est annuelle, nous assistons à une distribution du soin qui s’apparente à une
braderie quotidienne.
Nous n’accepterons pas un système qui matérialisera ainsi la psychothérapie en la coupant
du soin pour l’intégrer au soin. C’est bien parce que l’exercice de la psychiatrie est
psychothérapique que les psychiatres réagissent devant cette réduction de la complexité à une
forme de banalisation aux effets délétères annoncés. Les patients non plus n’accepteront pas. n
Maurice
BENSOUSSAN*
SOMMAIRE
pages
ÉditO
1
ABONNEMENt
2
ON EN PARLE
– Engagerons-nous le débat ?
Et si nous l’engageons,
saurons-nous mobiliser pour obtenir
un consensus autour de la parentalisation ?
3-6
SYNdiCAt
dES PSYCHiAtRES FRANÇAiS
– Le SPF avec vous
– Travailler après la retraite :
de nouvelles contraintes
7
7-8
ACtUALitÉS PROFESSiONNELLES
– Nouvelles professionnelles
– Adhérez au SPF 9-10
10-11
COLLOQUE
Soins études en psychiatrie de l’adolescent,
Paris, le 21 novembre 2014
12-14
PROFESSiON
Carnet de route d’un interne en psychiatrie 15
RENCONtRE
Billet d’impressions des 5èmes Rencontres
de Suze-la-Rousse – juillet 2014
16
LiBRES PROPOS
Concepts psychanalytiques
à l’usage des soins
17-19
GRAiNS dE SEL PSYCHiAtRiQUE
Le travail psychique avec René Angelergues 20
PAS dE diSCOURS SANS LECtURE
Ouvrages récemment parus 20
PEtitES ANNONCES
21
LES CHEMiNS dE LA CONNAiSSANCE
Rencontres, colloques et formations
22-23
POUR VOS AGENdAS
Semaines d’information
sur la santé mentale
(du 16 au 29 mars 2015)
24
* Psychiatre, Président du Syndicat des Psychiatres Français.

2
La Lettre
N° 227 • octobre-novembre 2014
de P
sychiatrie
F
rançaise
À NOS « GRACIEUX » LECTEURS
Nous vous rappelons que La Lettre de Psychiatrie Française vit essentiellement des abonnements !
Si vous êtes attaché(e) à sa lecture et si vous souhaitez la recevoir régulièrement, MERCI DE VOUS ABONNER.
Nous serions également heureux de vous compter parmi nos auteurs.
N’hésitez pas à nous adresser vos propositions d’articles.
BULLETIN D’ABONNEMENT
A retourner à l’Association Française de Psychiatrie : 6, passage Abel Leblanc – 75012 PARIS
TARIF
40 EUROS TTC – France métropolitaine
50 EUROS TTC – Hors métropole
Vos coordonnées :
Raison sociale (Institutions) : ..............................................................................................................................................................
Pour l’Union Européenne, N° de TVA intracommunautaire ...............................................................................................................
Nom* .......................................................................................... Prénom* .......................................................................................
Exercice Professionnel : ❒ Libéral ❒ Hospitalier ❒ Salarié
Mél. : .............................................................................................@ .................................................................................................
Adresse* .............................................................................................................................................................................................
Code postal* ................................................................................ Ville*.............................................................................................
Tél.* ............................................................................................. Télécopie ......................................................................................
* Champs obligatoires
Votre commande :
Abonnement à La Lettre de Psychiatrie Française
Ces tarifs ne concernent pas les membres de l’AFP et du SPF à jour de cotisation, qui bénéficient d’un tarif préférentiel.
Je confirme mon abonnement d’un an à La Lettre de Psychiatrie Française au tarif (France métropolitaine)
de 40 euros TTC.
Je confirme mon abonnement d’un an à La Lettre de Psychiatrie Française au tarif (hors métropole)
de 50 euros TTC.
Je bénéficie, pendant mon abonnement, de trois lignes gratuites pour une petite annonce en format ligne.*
Je demande un justificatif fiscal.
* Cette offre n’est utilisable qu’une seule fois par année, quel que soit le nombre de petites annonces communiquées à La Lettre de Psychiatrie Française.
Votre règlement : par chèque à l’ordre de l’Association Française de Psychiatrie.
Date :
Pour tout renseignement, merci de contacter l’AFP
6, passage Abel Leblanc – 75012 PARIS
✆ 01 42 71 41 11 – contact@psychiatrie-francaise.com
Cachet - Signature
ABONNEMENT

3
La Lettre
N° 227 • octobre-novembre 2014
de
P
sychiatrie
F
rançaise
EngagErons-nous lE débat ?
Et si nous l’EngagEons, saurons-nous mobilisEr
pour obtEnir un consEnsus
autour dE la parEntalisation
(1)
?
on En parlE
dEuxièmE partiE
1
(suite de la première partie parue dans le N° 226 de LLPF en
p. 3 à 5).
Pourquoi le consensus autour de la parentalisation est-il
si difficile à réaliser ? Notre hypothèse est qu’en faisant de la
parentalisation une capacité mentale pour accueillir et
guider l’infantile, c’est cette dernière notion, l’Infantile(2) qui
risque de déranger ! Le reconnaître, c’est accepter de le
découvrir... et l’infantile n’a pas d’âge !
Dans la position qui leur est propre, chaque adulte
concerné par les manifestations de l’infantile des enfants se
sent souvent mis à mal et dans l’impuissance face à certaines
situations. La défaillance n’est pas seulement du côté des
familles, elle nous concerne tous, elle concerne la société
toute entière ! Cette défaillance est liée au manque de recul
nécessaire pour aborder ces questions de l’infantile et à notre
difficulté à le mentaliser avant de réagir à ses manifestations
tout au long du développement de l’enfance et de
l’adolescence. Il ne s’agit pas seulement de « manque de
moyens », ni de « manque de formation », mais d’un manque
de parentalisation. Il s’agit avant tout d’un manque de
capacité à mentaliser nos infantiles respectifs et ceux de
nos enfants(3). Prendre conscience de cela relève de notre
(1) Dans cet article, j’entends la Parentalisation comme une capacité à
mentaliser les manifestations de l’infantile archaïque et de l’infantile
primaire pour agir et parler de façon à les guider vers du sens. (Voir la
première partie dans le n° précédent de la LLPF).
(2) « Étrange conglomérat historico-anhistorique, structure de base aux franges de
l’animalité humaine, creuset des fantasmes originaires et des expériences
sensori-motrices, l’infantile peut être considéré comme le lieu psychique des
émergences pulsionnelles premières et irreprésentables... l’infantile est le point
le plus aigu de nos affects... il fonctionne la vie durant, selon une double
spirale processuelle et signifiante... Irréductible, unique et par là même
universel, alliage de pulsionnel et de structural souple, qui fait que l’on est soi
et pas un autre, l’infantile est donc bien ce par quoi notre psychisme va
advenir... ». (En gras pour l’article.) Florence Guignard, Au vif de
l’infantile, Réflexions sur la situation analytique, paru en 2002 aux éditions
Delachaux et Niestlé.
(3) Florence Guignard, op. cit., p. 11 et 18 « Face à tant d’ineffable et pour se
repérer dans l’infantile, l’esprit humain ne peut que s’essayer à des
représentations et à des métaphores, au risque de se figer dans l’instantané de la
figuration métaphorique... alors qu’il s’agit d’une constellation mouvante,
à géométrie variable... qui interagit en permanence avec les autres
infantiles environnants. » (En gras pour l’article.)
responsabilité individuelle, qu’il s’agirait de partager ensuite
collectivement dans toutes les institutions où nous
travaillons, et ce afin de faire évoluer les mentalités autour de
ces concepts de parentalisation et d’infantiles, et ainsi
pouvoir nous entraider à pallier nos défaillances !
Les effets de l’infantile sont partout et chez tout le
monde. Les procédures administratives et les guides de
bonne pratique visent à les réguler mais, par définition,
l’infantile ne se laisse pas enfermer. Par ailleurs, ce n’est pas
en décrétant des lois sur les droits à la scolarisation que
l’infantile pourra s’élaborer, ni en énonçant des droits à la
compensation d’un handicap que l’enfant ne sera pas en
souffrance, pris dans son impulsivité. Malgré les progrès de
notre société moderne, la loi des hommes ne saurait être
au-dessus des Lois de la Nature et des forces pulsionnelles. Si
l’on ne veut pas tomber dans la spirale de la répression, de
l’impuissance et du désenchantement, on se doit alors de
développer dans le monde adulte une capacité à mentaliser
les effets de perversion polymorphe de l’infantile brut
(4) afin
de les prévenir. Ainsi, on pourra éviter d’être pris dans le
courant actuel d’une postmodernité que caractérise une
perte de confiance dans l’avenir et le refuge dans un présent
à court terme.
Pourquoi l’infantile de l’enfant serait-il seulement l’affaire
des psychologues, de la pédopsychiatrie ou d’autres
spécialistes, alors qu’il infiltre la société tout entière et
réclame une parentalité de la part de tous les adultes ? Seul
un projet collectif de parentalité sociétale pourra humaniser
l’infantile en agissant et en parlant de façon à le guider vers
du sens.
Guider l’infantile, c’est, quel que soit l’âge, accueillir ses
manifestations et les réfléchir avant d’en faire des
symptômes. Mais de quelles façons accueillir ?
Ceux qui s’engagent dans leur vie quotidienne auprès
d’enfants et d’adolescents connaissent bien les difficultés
d’un tel accueil.
(4) J’entends par infantiles bruts des infantiles élaborés sur un mode binaire :
oui-non, vrai-faux, bien-mal, ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, les
bons à garder et les mauvais à exclure... On sait depuis la moitié du
xxème siècle que ces infantiles peuvent chez le même individu cohabiter
avec de l’infantile raffiné et cultivé ! Aujourd’hui ces infantiles se
caractérisent par les effets de perversion narcissique qui sont
potentiellement et occasionnellement en chacun de nous !
Bertrand CHAPUIS

4
La Lettre
N° 227 • octobre-novembre 2014
de
P
sychiatrie
F
rançaise
Certes, les fonctions de la parenté sont multiples dans le
champ de la parentalité (5) mais plus encore que des fonctions,
Gérard Neyrand montre que c’est le processus même de
parentalisation qui est au cœur des parentés :
– « Institution des parents et parentalisation »(6) :
• « Rappeler cette institution des parents est primordial pour
comprendre la parentalité...
• ... cette institution constitue la condition du lien social par
l’interdiction de l’inceste qu’elle met en œuvre, et la mise en place
de la chaîne généalogique qu’elle permet...
• ... La parentalisation sociale constitue ainsi un processus
fondateur de l’état même de parent, qui justifie que des parentés
non biologiques soient dûment enregistrées comme telles...
• ... il s’agit d’un processus qui s’enracine dans le relationnel et
passe par des affiliations. »
Les parentés non biologiques, qui initient les enfants au
processus de parentalisation, passent parfois par des voies
insoupçonnées. Ce n’est souvent qu’une fois devenu adulte,
dans l’après coup, que nous réalisons nos affiliations de
parentés.
Malheureux celui qui n’a pas croisé sur sa route une
enseignante, un éducateur, un entraîneur, une assistante
sociale... qui, sans toujours le savoir, aurait pu lui donner
envie de se prendre en charge, lui permettre de se relancer
dans la vie et de retrouver confiance dans l’avenir. C’est en
s’enracinant dans une relation avec un adulte qui est
simplement lui-même, parce qu’il se parentalise lui avant de
parentaliser l’autre qu’un jeune éprouvera le sens de son
existence. Se parentaliser pour se responsabiliser n’est jamais
acquis, et nécessite une vigilance de tous les jours !
Lorsque l’enfant perd toute confiance dans le monde des
adultes et que se multiplient les ruptures de prise en charge,
son infantile se révolte et laisse tout le monde désemparé.
Créer alors les conditions d’un éclairage de la situation,
au point le plus aigu des affects, demande souvent
beaucoup de patience et de disponibilité. L’évocation des
événements et la réminiscence des éprouvés passés peuvent
prendre beaucoup de temps. Pourtant, seule la mise en mots
permet de donner une signification aux traumatismes. Une
fois mis en sens, l’infantile débloqué (puisqu’on évoque
souvent un blocage) peut être relancé dans la direction de
l’avenir et des apprentissages.
Pour beaucoup d’enfants, il aura fallu au préalable tenir
compte des positions de tous ceux qui interviennent auprès
de lui ; tenter de les concilier quand c’est possible, en faisant
valoir l’intérêt de l’enfant, tout en respectant les différences
de vue de chacun. Cela concerne les parents et le milieu
familial bien sûr, mais pas seulement. Très souvent les
conflits sont déplacés sur les enseignants, supposés mal
formés, et le milieu scolaire en manque de moyen.
(5) Ibid., p. 38 : Gérard Neyrand, citant les anthropologues Esther Goody et
Maurice Godelier.
(6) Ibid., p. 121 : paragraphe du sous-chapitre La sublimation du genre : déni ou
dépassement dans III. Implicites et contradiction de la parentalité.
Mais le plus préoccupant, ce sont les conflits entre les
différentes approches des soins. Face aux troubles du
développement de l’enfant, la prise en compte de l’infantile,
considérée à tort comme relevant de la psychanalyse, est
encore trop souvent opposée aux tenants des approches
instrumentales, comportementales et rééducatives. Pensons
à ces enfants nés grands prématurés ou porteurs d’anomalies
génétiques, infirmes moteurs cérébraux, dyspraxiques ou
pris dans un trouble envahissant des apprentissages qui
souffrent de dysharmonies développementales. Ils ont
souvent des emplois du temps surchargés, et malgré tous
leurs efforts, ils peuvent se décourager devant leurs
différences persistantes avec les autres. Chez tous les enfants,
mais particulièrement chez ces enfants fragilisés, si
l’entourage n’est pas à l’écoute de leur souffrance, un état
dépressif peut s’installer silencieusement ou être masqué par
des troubles du comportement, avec à tout moment, le
risque d’un passage à l’acte auto ou hétéroagressif.
La présence d’une équipe de pédopsychiatrie en CMP
dans le suivi de ces enfants permet d’être attentif aux troubles
de l’humeur et de les prévenir. Elle doit pouvoir coordonner
les différentes approches, au plus près des besoins de
l’enfant. Elle peut participer aux équipes éducatives en
milieu scolaire avec l’accord des parents, et faire tiers dans les
relations entre parentalité familiale et parentalité sociale, afin
de médiatiser les divergences d’éclairage au sujet des troubles
de l’élève et de ses handicaps. La parentalité des soignants
doit être la cheville ouvrière de la parentalité sociétale, entre
parentalité familiale et parentalité sociale de l’école.
Cependant, tous les jours nous sommes confrontés à
l’exigence, aux difficultés et aux impasses possibles, pire
aux effets pervers de l’engagement, si l’on ne prend pas
le temps de s’y arrêter pour en dénouer la complexité et
la polysémie.
Engager, s’engager... Engager qui ? Engager quoi ?
S’engager vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi ? Pour quels
objectifs et à qui rendre des comptes ?
Toutes ces questions touchent à l’ensemble des conflits
que l’engagement soulève et qui risquent de le mettre en
échec. À défaut d’avoir décodé les enjeux de l’engagement, la
répétition des incompréhensions et des malentendus risque
de nous laisser souvent découragés puis résignés, au risque
de l’indifférence. Essayons donc de décoder.
Engager, s’engager... distinguer les deux verbes permet
de prendre conscience de la réflexivité et de percevoir la
différence entre « j’engage » et « je m’engage ».
Différencier permet de « conjuguer ».
Commençons par engager !
Il s’agit de prendre l’initiative et de mobiliser une énergie
intérieure. Pour engager, il faut donc une motivation. Qu’il
s’agisse d’engager une partie, une discussion, une rencontre,
une relation, une démarche... nous n’avons pas tous une
motivation de même nature.

5
La Lettre
N° 227 • octobre-novembre 2014
de
P
sychiatrie
F
rançaise
Mais qu’il s’agisse d’engager un combat, nous aurons la
même motivation si notre vie en dépend : la motivation de la
survie ! C’est l’engagement de la génération de Stéphane
Hessel.
En outre, quelle que soit la motivation, engager nous
engage, et semble devoir se référer à autrui... mais pas
seulement, comme nous allons le voir.
Qu’en est-il alors de s’engager ?
Quelle que soit ma motivation, l’injonction de m’engager
sous la forme réflexive ne peut s’adresser qu’à la première
personne du pluriel : « Engageons-nous ! ». Comme si la
réflexivité singulière d’un engagement individuel n’existait
pas ou ne pouvait que s’adresser à autrui : « Engage-moi ! ».
Serais-je condamné à ne pas pouvoir m’inciter à
m’engager ?... à moins de m’adresser à moi-même par la voix
d’un autre qui me dirait : « Engage-toi ! » ?
Qui est cet « autre » ? D’où vient-il ? Comment
s’installe-t-il en moi ?
On pourrait croire que cet « autre » est le Parent. Ce n’est
pourtant pas si simple. Faisons plutôt l’hypothèse que cet
autre est de l’infantile capable de se parentaliser. Il peut tour
à tour exprimer de l’audace (infantile primaire), de la
bienveillance (infantile secondaire maternant), ou de
l’exigence (infantile secondaire paternant). Il faut donc un
infantile bien triangulé, intégrant de l’enfant, de la mère et
du père, pour pouvoir selon les circonstances, nous donner
les bons conseils.
En fonction de notre enfance, l’infantile se construit plus
ou moins bien sur ce mode triangulé. Depuis quelques
décennies, l’individualisation a permis de comprendre que
nous étions bisexués dans nos capacités émotionnelles,
capables d’éprouver du paternel et du maternel
conjointement. C’est cette fonction parentale bisexuée qui
permet d’accueillir les émergences pulsionnelles premières
du petit enfant pour les canaliser et les élaborer. Sans cette
dialectique de la bienveillance et de l’exigence, les couples
d’opposés ne peuvent qu’entrer en conflit (celui qui a raison
contre celui qui a tort), entraîner des ruptures, et entraver les
processus de transmission, empêchant souvent de faire
histoire avec l’enfant.
L’engagement réflexif est donc un processus
d’initiation et de transmission qui nécessairement passe
par un autre. Avant de pouvoir s’engager, il faut avoir
éprouvé l’engagement de quelqu’un vis-à-vis de soi. C’est le
temps où l’enfant doit être nourri de l’engagement des
adultes, ce qui nécessite de construire avec lui un lien de
confiance suffisant.
Si dans ce temps de l’enfance, les adultes conjuguent
l’engagement sous toutes ces formes, l’enfant sera initié et
deviendra un adulte capable de réflexivité intérieure pour
soutenir ses engagements personnels face aux autres et à la
collectivité. Si cela n’a pas été le cas, une fois devenu adulte,
les impasses des engagements (les siens et ceux des autres) se
chargeront de le guider vers ce long travail de mise en
réflexion.
Qu’est-ce que la réflexivité intérieure ? Une capacité
mentale à se poser ces questions :
Lorsque « je m’engage », quelle est cette part de moi que
j’engage ?
Ma volonté, ma tête, mon corps, mon cœur... et si toutes
ces parts sont engagées, le sont-elles partiellement,
intégralement, à quels degrés ?
Est-ce que je n’engage que des parts de moi-même que je
connais ?
Suis-je bien sûr de cerner les raisons, les motivations qui
me conduisent, me forcent ou seulement me susurrent de
m’engager ?
Stéphane Hessel a mobilisé un formidable élan autour
d’une motivation : l’indignation.
S’engager par indignation, c’est autre chose que de
s’engager par ambition avec la prétention de détenir des
vérités : on perçoit bien où risque de mener l’excès de
certitudes, surtout quand il s’agit de faire le bien d’autrui,
contre son gré, avec le risque de faire le lit des fanatismes.
S’engager par indignation, d’accord, mais pour
quelles raisons ?
Stéphane Hessel dit nous laisser le choix.
Visiblement on ne peut s’engager sans mobiliser cette
énergie qui concerne chacun au plus profond. Mais
aujourd’hui, pour la plupart d’entre nous, notre survie
est-elle directement menacée ? N’est-ce pas plutôt la survie
de nos enfants à venir ?
S’il y a une raison universelle pour que chacun s’indigne
individuellement, cela pourrait bien concerner toutes les
formes de défaillances de parentalité, car nos enfants sont
notre avenir.
Tout enfant, d’autant plus s’il est en souffrance, et
toute personne handicapée, fragilisée, est en droit
d’attendre une parentalité de la part des adultes qui
l’entourent.
Cela concerne les proches et les professionnels qui sont
en lien direct avec eux, mais aussi ceux qui réfléchissent au
fonctionnement des institutions et ceux qui décident des
financements. Il est dangereux de penser que les défaillances
de parentalité ne résultent que de la position des mères et
des pères dans les familles ; de n’invoquer que les excès des
uns ou les manques des autres ; de penser que l’exercice de
l’autorité remet de l’ordre durablement. L’autorité seule ne
fait qu’aggraver les défaillances en ajoutant soit de la
culpabilité et de la honte, soit de l’humiliation et donc le
risque de la colère et de la violence.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%