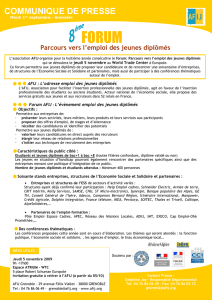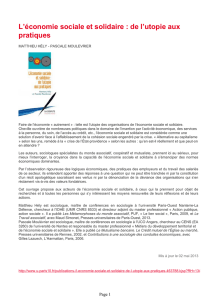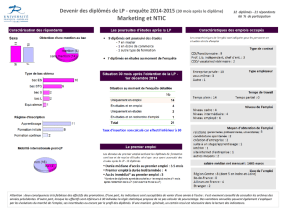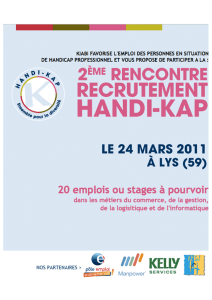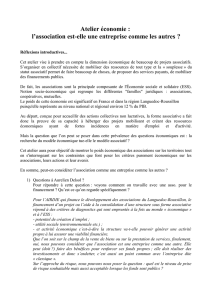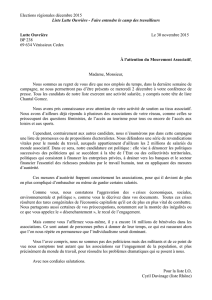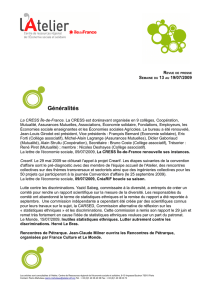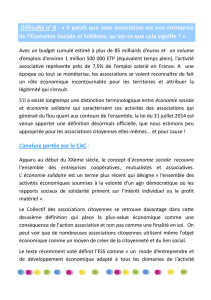Des JD dans le secteur associatif

L’emploi dans
l’économie sociale
Avez-vous envisagé
de travailler dans le
secteur de l’économie
sociale ? Beaucoup de jeunes sont tentés par un emploi
dans le secteur non marchand. L’économie so-
ciale est, tous employeurs, confondus (associa-
tions, mutuelles, coopératives, fondations, etc.)
un secteur économique important. Les seules
associations comptent plus de 176 000 em-
ployeurs et plus de 1,9 millions de salariés.
Les sondages confirment cet intérêt sachant
que les jeunes sont surtout sensibles au secteur
associatif. Leur curiosité et leur demande sont
réelles. Mais leur vision de la réalité est parfois
trouble : certains tendent à confondre le rapport
qu’ils ont avec les associations : bénéficiaires,
bénévoles, volontaires, salariés... Il est vrai que
nombre d’associations tournent sans salariés-
permanents.
Les Rencontres ou les Journées organisées par
l’AFIJ sur les emplois dans le secteur associatif,
sur tout le territoire depuis 2006, font le plein.
La seconde édition du « Forum national de l’Em-
ploi dans l’Economie Sociale et Solidaire » (qui
s’est tenu à Saint Denis les 3 et 4 octobre 2007)
a connu une grande affluence avec la visite de
milliers de jeunes (et des moins jeunes).
De toutes les formations supérieures des jeunes
diplômés se destinent à ce secteur ; de plus des
formations spécialisées se sont multipliées au
cours de ces dernières années (principalement
sur la gestion et le management de l’économie
sociale).
Les politiques publiques offrant à ce secteur
l’opportunité de contrats spéciaux (tel que le
CAE) ont encouragé l’accès de nombreux jeunes
à un premier emploi dans l’économie sociale.
Ce flux ne fidélise pas forcément les jeunes à leur
association. Nous constatons, chaque jour, que
les mouvements entre le secteur marchand et
non marchand sont fréquents : tel jeune em-
ployé dans une association rejoint une entrepri-
se après avoir acquis deux années d’expérience ;
inversement tel autre préfère intégrer une asso-
ciation après une période en entreprise.
Parallèlement, dans le champ de la création
d’entreprise, l’« entreprenariat social » est en
train de conquérir sa place avec des initiatives
comme celles de l’Avise qui touche toute sorte
de secteurs.
Mais la lisibilité du secteur associatif reste encore
imparfaite auprès des étudiants et des jeunes
diplômés ; il reste beaucoup d’effort à mener
pour favoriser l’identification de ces emplois :
donner des témoignages, insister sur leur spé-
cificité, etc.
Un effort inverse est à développer auprès des re-
cruteurs. Beaucoup d’entre eux ne connaissent
pas suffisamment le vivier des jeunes diplômés
(en partie en raison de la mauvaise lisibilité des
diplômes) dont ils auraient le plus grand besoin.
D’autres persistent sur des habitudes de recru-
tement propre à leur milieu sans aucune publi-
cation d’offres d’emploi : les bénéficiaires ou les
bénévoles de l’association constituent de fait le
vivier du recrutement de salariés.
Les mécanismes de recrutement en marché ca-
ché produisent souvent des effets indirects en
matière de discrimination à l’embauche.
Des progrès sont également nécessaires dans le
domaine du recours aux contrats d’alternance,
très faible dans certains secteurs, alors même
que la tendance générale est au renforcement
de l’apprentissage.
Coté recrutés comme côté recruteurs, l’articu-
lation entre l’offre et la demande a vocation à
être renforcée dans le secteur associatif.
Daniel Lamar
Directeur général de l’AFIJ
lamar@afij.org
Des JD dans le secteur associatif
Dans une association
Entre 2006 et 2007, de
plus en plus de jeunes
diplômés souhaitent
travailler dans une
association (+ 4 points)
ou une mutuelle
(+ 1 point). Ceux ne
souhaitant pas vouloir
travailler dans le secteur
de l’économie sociale
sont moins nombreux
(- 5 points).
L’identification de ce
secteur par les jeunes
diplômés issus de l’en-
seignement supérieur
s’est considérablement
améliorée, avec seule-
ment 33 % de person-
nes en demande de
renseignements ou non
intéressées, contre 47 %
en 2003.
Source : sondage AFIJ
réalisé en juillet 2007,
sur 667 réponses.
www.afij.org
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
la lettre des recruteurs des jeunes diplomés
Numéro 25 - Novembre 2007
Dans une mutuelle
Dans une fondation
1
2
3
4
5
6
Dans une coopérative
1
2
3
4
5
6
2007
22 %
11 % 52 %
3 %-
4 %
9 %
1
2
3
4
5
6
besoin de
renseignements
1
2
3
4
5
6
non

Présentez-nous la Direc-
tion de la vie associative,
de l’emploi et de la for-
mation ?
La direction de la vie asso-
ciative, de l’emploi et des
formations a vu le jour en
janvier 2006. Cette création
concrétisait la volonté du
gouvernement de dispo-
ser des moyens d’assurer
pleinement ses attributions
transversales en matière de
vie associative.
Concrètement organisée
en deux sous-directions
chargées respectivement
de la vie associative et de
l’emploi et des formations,
la Direction assure deux
missions : une mission
administrative et financière
et une mission d’étude,
d’observation et de don-
nées statistiques.
En matière de vie associa-
tive d’abord, la Direction
élabore, coordonne et
évalue les politiques en
faveur de la vie associative.
Dans ce cadre, elle pro-
meut le développement des
différentes formes d‘enga-
gement associatif, anime
et coordonne l’activité des
services déconcentrés de
l’Etat pour ce qui concerne
la vie associative, exerce
une fonction d’expertise
de la vie associative auprès
des autres administrations
et coordonne l’activité in-
terministérielle dans le do-
maine. Enfin, elle assure, en
concertation avec le milieu
associatif, le suivi et la ges-
tion du dispositif du Conseil
du développement de la vie
associative qui finance la
formation des bénévoles,
les études et les actions
expérimentales menées par
les associations.
En matière d’emploi et de
formation ensuite, la direc-
tion a la responsabilité des
politiques dans le domaine
de l’animation, du sport
et de la vie associative qui
concourent à la promotion
des filières économiques, à
l’aménagement du terri-
toire et au développement
durable dans une logique de
développement de l’emploi
: animation et coordination
de l’action des services dé-
concentrés et des établisse-
ments publics sous tutelle,
analyse des compétences et
qualifications dans le champ
de l’animation et du sport,
définition des orientations
nationales applicables, défi-
nition de la réglementation
relative aux diplômes et aux
formations et à la valida-
tion des acquis (…)
De manière générale enfin,
la direction, recueille et
exploite l’information et
les données statistiques et
mène les études nécessai-
res à la détermination des
politiques dans les domai-
nes précités.
Que pensez-vous de
l’action d’information de
l’AFIJ sur la vie associa-
tive?
Avec le soutien du ministè-
re, l’AFIJ réalise des actions
performantes de commu-
nication et d’information
sur l’emploi associatif et le
volontariat associatif.
Ces opérations permettent
aux jeunes étudiants de
connaître les différentes
possibilités d’engagement
associatif :
- un engagement citoyen à
court terme par la réalisa-
tion d’une mission d’intérêt
général dans le cadre du
volontariat associatif ;
- un engagement à long
terme en devenant salarié
d’une association.
Parmi ces différentes
formes d’engagement
associatif sur lesquelles
communique auprès des
jeunes diplômés et des
étudiants l’AFIJ, quel ave-
nir a, selon vous, le récent
dispositif du Service civil
volontaire (SCV) ?
Le service civil des jeunes
notamment dans le cadre
du volontariat associatif a
un avenir très florissant. En
moins d’un an, ce nouveau
dispositif a séduit près de
900 associations qui ont
reçu l’agrément du minis-
tère et peuvent accueillir
plus de 6.000 volontaires
sur tout le territoire fran-
çais ou leur proposer des
missions dans l’Union euro-
péenne. Les perspectives
sont encourageantes car on
peut prévoir 10 000 volon-
taires associatifs en 2008 et
12 000 en 2009.
L’Etat encourage fortement
cet engagement solidaire
des jeunes qui allie au sur-
plus un accompagnement
continu sous la forme de
tutorat et la recherche d’un
emploi ou d’une formation
qualifiante. Enfin, au fur et
à mesure, l’administration
simplifie les démarches des
associations et des jeunes.
Entretien avec...
2
■ Gérard Sarracanie
est Directeur de la vie
associative, de l’emploi
et des formations depuis
janvier 2006.
Il a été Délégué intermi-
nistériel à l’innovation
sociale et à l’économie
sociale, de novembre
2002 à janvier 2006,
et il est actuellement
adjoint au maire du 15e
arrondissement de Paris,
chargé de la santé et de
la famille.
Ministère de la Jeu-
nesse, des Sports et de
la Vie Associative 95,
avenue de France
75650 Paris Cedex 13
Tél. : 01 40 45 90 00
Site : www.jeunesse-
sports.gouv.fr
Gérard Sarracanie

Employeur conséquent de l’économie sociale,
avec près de 2 000 salariés permanents et en-
viron 5 000 temporaires chaque année, la Fé-
dération nationale Léo Lagrange (FNLL) voit
dans l’économie sociale « un modèle alterna-
tif permettant à l’économie d’être au service
de l’homme et de son environnement, où le
résultat du travail est au bénéfice de l’entre-
prise et de ses salariés, dans le respect du dé-
veloppement durable. »
Un modèle qui fait sens, chez Léo Lagrange,
tant dans l’objet de la structure et de sa phi-
losophie que dans son organisation même.
Ainsi, la fédération appuie son développe-
ment sur l’idée fondatrice de « donner du
sens à l’action ». « Travailler à Léo Lagrange,
c’est en plus de développer ses compétences
au quotidien, porter des valeurs et prôner une
certaine forme d’engagement pour que le
monde progresse », explique Vincent Séguéla,
délégué régional de l’Ouest. Ensuite, point de
vue organisation, la Fédération s’est dotée en
2003 de statuts régis par un contrat fédéral
permettant aux 400 associations affiliées, aux
adhérents, aux salariés ainsi qu’aux partenai-
res de bénéficier d’une meilleure représenta-
tivité. Enfin, des engagements en matière de
développement durable ont été pris à travers
la signature d’une charte.
C’est donc en toute logique que la FNLL a sou-
haité s’associer au deuxième forum de l’em-
ploi dans l’économie solidaire, organisé par
l’AFIJ les 4 et 5 octobre derniers, pour « affir-
mer, aux côtés des initiateurs et des autres ex-
posants, la richesse et la force » de ce secteur
(voir page 4). Elle fut ainsi le premier mouve-
ment d’éducation populaire à y participer.
La force d’une action ancrée dans le
territoire
Association de loi 1901, la Fédération Léo La-
grange intervient concrètement en proposant
à tous les publics des loisirs et des activités
« pour permettre à chacun de contribuer au
progrès social ». Le réseau s’articule autour de
12 structures régionales, comprenant 9 insti-
tuts qui développent des programmes de for-
mation pour les publics fragilisés, en difficulté
d’insertion sociale ou professionnelle. Plus de
400 collectivités locales sont partenaires de
la FNLL, qui peuvent ainsi déléguer la gestion
d’un équipement ou d’un dispositif, monter
une action ponctuelle, offrir des formules de
vacances... Elle dispose, ainsi que son réseau,
de différents agréments publics.
Des métiers diversifiés pour une impli-
cation multiple
Les filières d’activités de la FNLL sont essen-
tiellement liées à trois domaines : l’anima-
tion, la formation et l’administration. Ce sont
plus de 40 métiers différents qui sont ainsi
représentés au sein du réseau : psychologues,
agents d’animation, DRH, comptables... Assu-
rant la formation et l’accompagnement des
acteurs éducatifs, elle est aussi opérateur na-
tional de la prévention et de l’insertion sociale
et professionnelle, au travers des formations
publiques.
Au-delà de ses actions de terrain, la fédéra-
tion s’engage dans une réflexion sur certaines
problématiques telles que l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Elle vient par exemple de
rendre publique une enquête sur les discrimi-
nations dans l’accès au stage, dans le cadre du
projet Transfert qu’elle anime, financé par le
Fonds Social Européen, en partenariat notam-
ment avec le CJDES. L’enquête, menée auprès
de 4 000 jeunes, révèle « un réel sentiment de
discrimination illustré par des difficultés parti-
culières à trouver un stage chez les enfants de
parents nés hors de France métropolitaine ».
Une initiative qui n’est pas sans rappeler les
différentes études déjà menées par l’AFIJ sur
le sujet et qui trouve un bel écho dans la mise
en place par celle-ci d’une nouvelle action «
SOS stage » visant précisément à favoriser
l’accès aux stages de cursus de jeunes étu-
diants susceptibles d’être exposés à des ris-
ques de discrimination. L’impact des diverses
réflexions menées par l’ensemble des acteurs
de la vie associative et des nombreux disposi-
tifs qu’ils mettent en place sur le terrain mon-
tre bien l’importance sans cesse croissante de
leurs actions, complémentaires ou conjointes,
à tous les niveaux de la société.
Pour M. Séguéla, « le monde associatif est
l’un des piliers de la République ». A l’image
de la Fédération nationale Léo Lagrange, il
constitue, comme l’ensemble des acteurs de
l’économie sociale et solidaire, « une alterna-
tive économique crédible au ‘tout-public’ et au
‘tout-privé’ : nous remplissons une mission de
service public », conclue-t-il.
Acteur de l’économie sociale
Réseau d’associations d’éducation
populaire, la Fédération Léo
Lagrange s’engage à proposer
des loisirs et des activités pour
« permettre à chacun de rendre utile
son temps libre et de le mettre au
service du progrès social ». Depuis sa
création en 1950, elle s’inscrit avec
force dans l’économie sociale et
solidaire.
Portrait
3
■ La Fédération Natio-
nale Léo Lagrange est
née en novembre 1950,
fondée entre autres
par Pierre Mauroy,
avec pour mission de
mettre en oeuvre ce que
Léo Lagrange, figure
importante du Front
populaire, souhaitait en
son temps : « étendre
la culture et organiser
les loisirs des jeunes,
particulièrement par la
création des clubs de
loisirs ».
La Fédération bénéficie
de différents agréments
publics : Jeunesse et
Sports, agrément En-
vironnement, habilita-
tion générale pour la
formation des cadres de
Centres de Vacances et
de Loisirs, organisme
de formation, agrément
tourisme et Éducation
Nationale...
Fédération Léo La-
grange
153, avenue Jean Lolive
93695 Pantin cedex
Tél. : 01 48 10 65 65
Site : www.leolagran-
ge-fnll.org
Sommaire
Quisommesnous?
Lessalariésdel’unitééconomiqueetsociale
Laviedémocratiquedumouvement

La deuxième édition du forum national de
l’emploi dans l’économie sociale et solidaire,
a débuté le jeudi 4 octobre par un petit-dé-
jeuner consacré à la diversité. En compagnie
de représentants de l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances
(Acsé), de l’AFIJ, du Conseil des entreprises,
employeurs et groupements de l’économie
sociale (Ceges) et de la Macif, des échanges
avec la salle auront permis de balayer diffé-
rentes politiques de diversité mises en oeuvre
dans les recrutements. Les participants de la
réunion, qui ont tous souligné que la plu-
part des employeurs avaient désormais in-
tégré dans leurs process la notion d’égalité
des chances, ont pointé le besoin émergent
d’outils d’évaluation (voir ci-contre).
En deux jours, ce sont près de 3 800 visiteurs
qui se sont rendus à la manifestation. Tous
ont eu accès à plus de 3 000 offres d’emploi
proposées pour l’occasion. « Ce forum consti-
tue le premier rendez-vous régulier de l’éco-
nomie sociale », comme l’a souligné Christian
Charpy, directeur général de l’ANPE, selon
qui, ce secteur représenterait aujourd’hui
près de 10 % des emplois en France. Martin
Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités ac-
tives contre la pauvreté s’y est rendu afin de
saluer un secteur au « potentiel gigantesque,
à l’évidence sous-exploité » qui permet de
« combiner solidarité et travail, activité éco-
nomique et soutien
».
Les visiteurs, dont la plupart venaient d’’Ile-
de-France, ont pu découvrir les quatre es-
paces à leur disposition : un espace-emploi
(dédié aux structures qui souhaitaient re-
cruter), un espace-création d’entreprises
(proposé par l’Avise, Agence de valorisation
des initiatives économiques), un espace-in-
formation (regroupant différentes organisa-
tions et structures, ainsi que des universités
proposant des cursus dans ce secteur) et un
espace-échanges. Dans ce dernier, plusieurs
conférences se sont tenues. Il y fut notam-
ment question de faire carrière dans l’éco-
nomie sociale, des différences existantes
avec le secteur économique traditionnel et
de la place des cadres.
Au-delà du rendez-vous qu’il constitue pour
les jeunes qui souhaitent travailler dans ce
secteur, ce « forum tend à montrer la vo-
lonté des structures de l’économie sociale et
solidaire de se fédérer, de se structurer et de
se faire connaître, explique l’un des respon-
sables de la Fédération Léo Lagrange, pré-
sente sur le salon. Nous devons nous donner
une plus grande visibilité, être un peu plus re-
connus, notamment au niveau de l’emploi :
notre poids économique est important, plus
que celui de l’agriculture par exemple ».
Le secteur de l’économie sociale et solidaire
est en effet, aujourd’hui, en France, le pre-
mier secteur en termes de création d’em-
plois. Il représente près de 15 % du PIB. Il est
pourtant encore très mal connu du grand
public et des jeunes diplômés. Consciente
de la nécessité de communiquer de manière
optimum et continue sur ce secteur, l’AFIJ a
mis en place un site qui lui est entièrement
dédié :
www.jd-economiesociale.info
.
Le salon de l’économie sociale
Après le succès de la première
édition, l’AFIJ et le CJDES ont
organisé à Saint-Denis les 4 et 5
octobre, le deuxième Forum national
de l’emploi dans l’économie sociale
et solidaire. Alors qu’une édition
régionale aura lieu le 24 novembre
à Marseille, ce rendez-vous a déjà
permis de renseigner plus de 3 800
visiteurs.
Initiative
4
■ En ouverture du
deuxième Forum na-
tional de l’emploi dans
l’économie sociale et
sociale et solidaire, un
petit-déjeuner à desti-
nation des responsables
RH a été organisé sur la
manière de lutter contre
les discriminations à
l’embauche.
Naouel AMAR, directri-
ce déléguée de l’AFIJ est
ainsi venue présenter
le travail de réflexion
approfondie que mène
l’association depuis
1997 auprès des publics
susceptibles d’être vic-
times de discrimination.
L’association a ainsi
établi une série d’étu-
des, d’enquêtes et de
« diagnostics », visant à
identifier les caractéris-
tiques de ces jeunes et
les problématiques défi-
nissant leur situation.
L’AFIJ consacre juste-
ment une partie de son
site à destination des
recruteurs à la question
de la diversité dans les
recrutements. En plus
de la présentation des
actions de l’association,
les actes d’un colloque
sur l’accès à l’emploi
des jeunes diplômés
issus de l’immigration,
organisé en février 2007
au Ministère de la santé,
ainsi qu’une synthèse de
l’ensemble des travaux
réalisés par l’AFIJ sont
téléchargeables gratui-
tement.
Site : www.jd-recru-
teurs.info/diversifica-
tion/

Au travers des différents partenariats noués
avec les principaux acteurs de l’économie so-
ciale et grâce aux formations qu’il propose, le
CJDES forme un réseau permanent d’échange
et de réflexion pour tous les membres de ce
secteur. Il constitue en outre une précieuse
structure d’accompagnement et de parrai-
nage des jeunes créateurs d’entreprises et
des porteurs de projets. Pour mieux connaître
et comprendre les contours et les enjeux de
l’économie sociale, le CJDES met en oeuvre,
à Paris et en régions, des modules de sen-
sibilisation notamment destinés à ceux qui
intègrent une entreprise du secteur mutua-
liste, associatif ou coopératif. Il organise aussi
chaque année une université de réflexion, à
laquelle sont conviées des personnalités de la
vie publique et entrepreneuriale, pour témoi-
gner de leur expérience, imaginer et bâtir des
projets innovants.
Lieu de ressources
Véritable plate-forme d’échanges, le CJDES
met en ligne des documents pour se fami-
liariser avec l’économie sociale. D’après l’as-
sociation, les structures de l’économie sociale
se définissent selon trois critères : l’autono-
mie administrative, un processus de décision
démocratique (gestion démocratique) et la
priorité donnée aux personnes et au travail
plus qu’au capital dans la distribution des re-
venus. Les entreprises de l’économie sociale
peuvent ainsi se définir comme des « organi-
sations au sein desquelles se pensent de façon
équitable le partage du pouvoir et le partage
de la valeur ajoutée ».
Dispositif de promotion
Le CJDES s’est également fixé comme mis-
sion de promouvoir ce secteur économique,
plus particulièrement auprès des jeunes. C’est
ainsi, en toute logique, qu’il s’est associé à
l’AFIJ pour mettre en place le
forum national
de l’emploi dans l’économie sociale et soli-
daire (ESS) ; un succès qui « conforte le CJDES
dans sa démarche d’émergence de projets »
au sein du secteur. Souhaitant y favori-
ser l’insertion professionnelle des jeunes, le
CJDES propose sur son site Web une rubri-
que consacrée aux offres d’emplois, assortie
d’une candidathèque.
Outils d’évaluation
Le CJDES se positionne aussi en qualité d’ob-
servateur de la responsabilité sociale des en-
treprises. Depuis 1996, le Centre a structuré
une démarche globale, le « Bilan sociétal »,
pour permettre aux sociétés d’évaluer à la
fois leur performance économique, leur ef-
ficacité sociale et leur impact sur l’environ-
nement. Il s’agit concrètement d’une évalua-
tion composée d’une première partie faite de
450 questions par grands thèmes (déclinables
en fonction du secteur d’activité) et d’une
analyse globale de l’entreprise. Cet outil a été
mis au point après des tests menés dans une
centaine d’entreprises européennes dont une
soixantaine en France. Plus récemment, un
outil permettant une auto-évaluation des
pratiques en matière de discriminations a été
mis au point.
La dernière université annuelle du CJDES s’est
tenue à Rouen, les 25 et 26 octobre, sur le
thème de « l’économie sociale au coeur du
nouveau contrat social ». Il y fut entre autres
question de la gouvernance au sein des struc-
tures de l’ESS, mais aussi de leur représen-
tativité. « Réseau militant, parfois urticant
et provocant de l’économie sociale, le CJDES,
comme il se définit lui-même, a pour ambi-
tion de faire émerger les projets qui feront
avancer l’économie sociale de demain» .
Mutualiser les compétences et les
expériences de l’économie sociale
Le Centre des jeunes dirigeants de
l’économie sociale est une association
regroupant principalement les
acteurs et les jeunes créateurs
de l’économie sociale. Réseau de
compétences et d’accompagnement,
il constitue un lieu ouvert et
transversal de réflexion collective.
Focus
5
■ Afin de mieux faire
connaître l’économie
sociale et solidaire, le
CJDES propose tout
au long de l’année des
formations et des confé-
rences de sensibilisation
à ce secteur.
Il rejoint ainsi la vo-
lonté de l’AFIJ qui à tra-
vers son site www.jd-
economiesociale.info,
présente aux jeunes qui
souhaitent se familiari-
ser avec ce secteur, des
portraits d’acteurs im-
portants de l’économie
sociale, impliqués dans
différents domaines :
humanitaire, assuran-
ces, aide à la personne,
éducation populaire...
Centre des Jeunes Di-
rigeants de l’Economie
Sociale
24, rue du Rocher
75008 Paris
Tél. : 01 42 93 55 65
Site : www.cjdes.org
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%