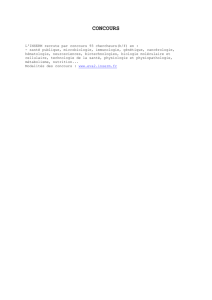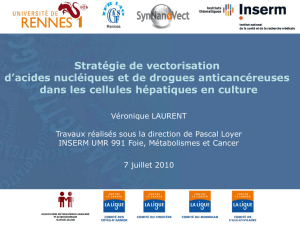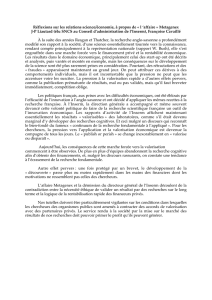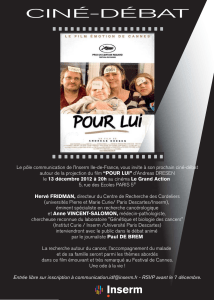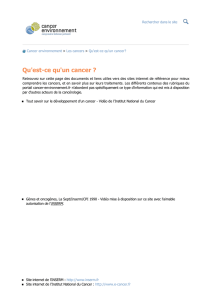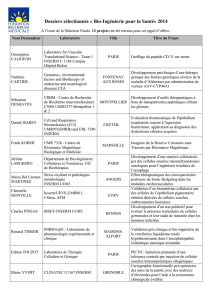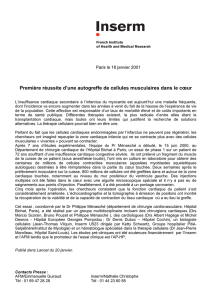résumés des posters

1ère Journée de l’Institut Claude Bernard
Mercredi 2 décembre 2009
UFR de médecine Paris-Diderot, site Bichat
*
*
*
R
R
RÉ
É
ÉS
S
SU
U
UM
M
MÉ
É
ÉS
S
S
D
D
DE
E
ES
S
S
P
P
PO
O
OS
S
ST
T
TE
E
ER
R
RS
S
S
*
*
*

1ère Journée ICB – 2/12/2009
G
G
Gr
r
ro
o
ou
u
up
p
pe
e
e
«
«
«
P
P
PR
R
RO
O
OT
T
TÉ
É
ÉO
O
OM
M
MI
I
IQ
Q
QU
U
UE
E
E
»
»
»
Présentateur
1er auteur
Résumé
De Jouvencel
id
P 01
Delaby (À la recherche…
id
P 02
Le Faouder
id
P 03
Léger
id
P 04
Mebazza
Lortat-Jacob
P 05
Paugam-Burtz
id
P 06
1ère Journée ICB – 2/12/2009
P 01
Protéolyse dans le thrombus de l’anévrisme de l’aorte abdominale : exemple d’un
fragment d’hémoglobine
Tiphaine de Jouvencel,1 Delphine Féron,2 Jean-Marie Piot,2 Jean-Baptiste Michel,1 Ingrid
Fruitier-Arnaudin,2 Olivier Meilhac,1
1. Inserm, U698, Univ Paris 7, Paris, CHU X-Bichat, Paris, France.
2. University of La Rochelle CNRS-ULR, UMR 6250, LIENSS, Univ La Rochelle, La
Rochelle , France.
L’anévrisme de l’aorte abdominal chez l’homme (AAA) se caractérise par une perte du
parallélisme des bords et la présence d’un thrombus mural. Notre objectif est d’identifier par
protéomique différentielle un marqueur du thrombus mural de l’AAA qui pourrait diffuser
vers le sang circulant.
Nous avons réalisé une incubation des échantillons d’AAA séparés en média et adventice
pour la paroi et en trois couches pour le thrombus (luminale, intermédiaire et abluminale)
dans du milieu de culture. Des incubats d’aorte saine, préparés selon la même méthode (média
et adventice), ont été utilisés comme contrôles. Les sécrétomes ainsi obtenus ont été analysés
en spectrométrie de masse après fractionnement sur différentes surfaces chromatographiques
(technique SELDI-TOF : Surface-Enhanced Laser Desorption/ionization Time of Flight).
L’analyse de milieux conditionnés par SELDI-TOF nous a permis d’isoler, sur barrette en
phase inverse (H4), le pic correspondant à la LVV-Hémorphine 7 (issu de la protéolyse de la
chaîne ! de l’hémoglobine par la cathepsine D). Sa séquence a été vérifiée en MALDI(TOF)2
(Institut Claude Bernard, IJM, Paris 7). Il décrit un gradient décroissant de la lumière à la
couche la plus interne du thrombus. Il est significativement plus exprimé dans la média des
aortes anévrismales en comparaison à des aortes saines. L’hémoglobine et la cathepsine D
suivent la même distribution. Sur des coupes d’aorte, les immunomarquages de LVV-
Hémorphine 7, d’hémoglobine, de cathepsine D et des cellules inflammatoires nous a permis
d’observer une colocalisation de LVV-Hémorphine 7 et de la cathepsine D, notamment
présente dans les neutrophiles. Un effet chimiotactique du peptide sur les neutrophiles a été
démontré et son dosage sérique est actuellement évalué.
Ce peptide reflète la présence de l’hémoglobine et une protéolyse intense dans le thrombus
d’AAA. Il met en relief le phénomène de convection du thrombus vers la paroi aortique où il
s’accumule. Ses possibles effets sur les cellules de l’adventice restent à évaluer.
Par ailleurs, il a été détecté dans les plaques d’athérosclérose hémorragiques en plus grande
quantité en comparaison aux plaques non hémorragiques et aux zones adjacentes plus saines.

1ère Journée ICB – 2/12/2009
P 02
A la recherche de marqueurs biologiques de la Porphyrie Aiguë Intermittente par une
approche protéomique
Constance Delaby,1*Joaquim Abian, 4 Jordi To-Figueras,2 Caroline Martin-Schmitt,1,3
Laurent Gouya, 1,3 Hervé Puy,1,5 Carole Beaumont,1 et Jean-Charles Deybach1,5
1. Inserm U773-équipe 4, CRB3, Faculté de médecine Xavier Bichat, Paris, France
2. Biochemistry and Molecular Genetics Unit, Hospital Clinic, IDIBAPS, University of
Barcelona, Spain
3. APHP, Service de Biochimie Hormonale et Génétique moléculaire, Hôpital Ambroise
Paré, Boulogne Billancourt, France
4. Proteomic unit, CSIC-UAB, University of Barcelona, Spain
5. Centre Français des Porphyries, APHP, Hôpital Louis Mourier, Colombes, France
De transmission autosomique dominante à pénétrance incomplète, la PAI est une
pathologie liée au déficit partiel de la 3ème enzyme de la chaine de biosynthèse de l’hème,
l’HMBS. Les crises aiguës caractéristiques de cette maladie sont en général révélées par des
facteurs additionnels au défaut génétique primaire (médicaments, hormones, jeûne…). Ces
crises résultent de la demande cellulaire accrue en hème, insatisfaite du fait du déficit en
HMBS et qui se traduit par une accumulation des précurseurs toxiques ALA et PBG. Le
traitement de ces crises consiste en l’administration d’arginate d’hémine (Normosang®)
permettant de restaurer le rétrocontrôle négatif normalement effectué par l’hème sur la
première enzyme de la voie de biosynthèse (ALAS1) et donc de limiter l’accumulation dans
l’organisme des précurseurs toxiques.
Les mécanismes physiopathologiques des crises aiguës restent mal connus et il reste très
difficile de prédire précisément quelle drogue va induire une crise aiguë chez un patient
particulier. De plus, le nombre croissant de patients PAI présentant des crises récurrentes est
préoccupant et les mécanismes du passage à la chronicité et de la dépendance au
Normosang® ne sont pas connus.
A partir du modèle murin de la PAI dont nous disposons au laboratoire, nous avons
entrepris de rechercher des marqueurs biologiques sériques du déclenchement des crises et de
réponse au Normosang®. L’approche protéomique développée est basée sur les techniques
d’électrophorèse bidimensionnelle couplées au MALDI-TOF. Nos premiers résultats révèlent
des variations significatives de marqueurs potentiels de la crise et de réponse au traitement et
indiquent la mise en place d’un processus inflammatoire chez les souris traitées de façon
répétée avec le Normosang®. Ces résultats seront confirmés par des approches additionnelles
et compléter par l’étude des protéomes urinaire et hépatique de ces souris. Cette étude devrait
nous permettre d’approfondir la caractérisation de la physiopathologie de la PAI mais aussi
d’explorer les conséquences de l’injection chronique de Normosang®.
Mots clés : porphyries – marqueurs biologiques – protéomique
Correspondance : Constance Delaby, Inserm U773-équipe 4, CRB3, Faculté de médecine
Xavier Bichat, Paris, France E-mail : [email protected]
1ère Journée ICB – 2/12/2009
P 03
Methodological development for hepatocellular carcinoma biomarker hunting, in tissue,
by MALDI Imaging
Julie Le Faouder,1 Miguel Albuquerque,1 Manuel Chapelle,2 Pierre Bedossa,1 Jean-Michel
Camadro,2 Valérie Paradis,1
1. INSERM U773, CRB3 Bichat Beaujon and Beaujon hospital, Clichy, France
2. Mass spectrometry facility, Jacques Monod Institute, Paris, France
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a major public health problem worldwide. It nearly
always develops in the setting of chronic hepatitis or cirrhosis related to various origins,
including hepatitis virus infection, high alcohol intake or metabolic diseases. Until now,
diagnosis of HCC has been made too late. Indeed, at the time of discovery, prognosis is poor,
with a 5-year survival rate of less than 5%.
Clinical proteomic consisting in biomarker hunting in biological materials is a promising
research field. A biomarker is defined as an indicator present in the body allowing
measurement of pathology progression, treatment effects or drug toxicity. Identification of
new biomarkers leads to develop new strategies for diagnosis and pathology treatment.
Our objective is to develop a new method for detection of HCC biomarker by MALDI
(Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization) imaging. This new approach will complete
currently used techniques which are neither sensitive nor specific enough.
MALDI imaging allows detecting numerous proteins and peptides, directly from a tissue
section, with a spatial resolution down to 50 !m. We report here, experimental (tissue
preparation, matrix solution) and instrumental (matrix application, MALDI measurement)
development which allow obtaining high-resolution images.

1ère Journée ICB – 2/12/2009
P 04
Research of plasma biomarkers of coronary disease by a proteomic approach
Thibaut Léger,1* Damien Lavigne,2 Luc Guerrier,3 Jeannette Fareh,2 Jean Baptiste Michel, 1
Laurent Feldman,1 Olivier Meilhac,1
1. Inserm U698, Paris, France
2. Sysdiag, UMR 3145, CNRS/Bio-Rad Montpellier, France
3. Bio-Rad Laboratories c/o CEA-SACLAY, Gif-sur-Yvette, France
Despite important advances in prevention and drug development, cardiovascular diseases
remain the main cause of mortality in western countries. Assessment of vascular risk in non-
symptomatic patients and of the response to medical therapy is a major challenge for
prevention of cardiovascular accidents. Our hypothesis is that differences in circulating
proteomes of patients with ACS (Acute Coronary Syndrome) versus stable effort angina
versus non-atherosclerotic patients can be detected by a proteomic approach. The presence of
high-abundance proteins in complex biological samples like plasma makes the detection of
medium- and low-abundance proteins extremely challenging. Therefore, we used the new
technique of double-equalization, based on the proteominerTM kit (Bio-Rad), to compress the
dynamic range of protein concentrations in complex biological samples (for example, albumin
and IgG in plasma). A differential proteomic approach has allowed us to unveil potential
biomarkers of acute coronary syndrome or atherosclerosis in human plasma. Identification
and validation (by western Blot and ELISA) of the potential biomarkers detected are ongoing.
Mots clés : Proteomics, cardiovascular disease, plasma.
*Correspondance : Thibaut Léger, CHU X. Bichat, secteur Cl. Bernard, 75877 Paris cedex 18
– France. E-mail : [email protected]
1ère Journée ICB – 2/12/2009
P 05
ProM22 un biomarqueur original de l’insuffisance cardiaque aiguë
Lortat-Jacob B, Vanpoucke G*, F Tournoux, Glasman P, J Guillemeau, D. Logeart, C
Delcayre, Cohen Solal A, Samuel JL, Mebazaa A
UMR-S942 Inserm 41 BD de la Chapelle, 75010 Paris, * Pronota Gant France
Résultats préliminaires non autorisés à diffusion
P 06
Identification de marqueurs plasmatiques d’infection après transplantation hépatique
(th) par analyse protéomique
Paugam-Burtz C,1* Albuquerque M,2 Janny S,1 Belghiti J,3 Bedossa P,2 Paradis V,2 Mantz J1
1. Anesthésie Réanimation, Hôpital Beaujon, CLICHY, France
2. INSERM U773, CRB3, Hôpital Beaujon, CLICHY, France
3. Chirurgie hépato-biliaire, Hôpital Beaujon, CLICHY, France
Résumé non autorisé à diffusion

1ère Journée ICB – 2/12/2009
G
G
Gr
r
ro
o
ou
u
up
p
pe
e
e
«
«
«
O
O
OS
S
S
&
&
&
A
A
AR
R
RT
T
TI
I
IC
C
CU
U
UL
L
LA
A
AT
T
TI
I
IO
O
ON
N
NS
S
S
»
»
»
Présentateur
1er auteur
Résumé
Ah Kioon
id
OA 13
Asensio
id
OA 14
Bensidhoum (Ostéogenic…
Sudre
OA 02
Bensidhoum (Comparison…
id
OA 01
Brun
Hamidouche
OA 06
Cambon
id
OA 19
Dieudonné
id
OA 09
Dugué
id
OA 07
Funck-Brentano (L’inhibition…
Kadri
OA 15
Funck-Brentano (Effet protecteur…
id
OA 16
Jehan
id
OA 04
Lemaitre
id
OA 08
Marion
id
OA 10
Miroir
id
OA 20
Nguyen C (Diversité…
id
OA 11
Nguyen C (Les variations…
id
OA 12
Ostertag
Marty-Poumarat
OA 17
Schiltz
id
OA 18
Severe
id
OA 05
Vandamme
id
OA 03
1ère Journée ICB – 2/12/2009
OA 01
Comparison of the bone forming capacity of different cell-based tissue-engineered
constructs in sheep
Morad Bensidhoum 1*, Véronique Viateau 2, Karim Oudina 1, Myrtil Valentin 1, Delphine
Logeart-Avramoglou 1 and Hervé Petite 1.
1 Laboratoire de Recherches Orthopédiques (B2OA) – CNRS UMR 7052 (ST2I),
Paris, France
2 Ecole nationale vétérinaire de Maison-Alfort, France
An animal ectopic model has been developped in sheep to test in a well controlled
environment the bone forming capacity of clinically relevant volumes of granular
biomaterials loaded with stem cells (Bensidhoum et al, Termis 2008). In this model, the
materials to be tested are placed in a pouch delineated by a subcutaneously PMMA induced
membrane. The purpose of the present study was to determine and compare in this model the
osteogenic potential of clinically relevant volumes of four different granular constructs
engineered from materials which are currently available for bone tissue engineering purposes
in the clinical setting.
Autologous-derived bone marrow stem cells (MSCs) were loaded onto each of four
different particulate materials (coral Porites, coral Acropora, b-TCP and bank-bone) prior to.
After 8 weeks, explanted pouches were analysed, with radiography and undecalcified
histology for evidence of material resorption and bone formation
Results.
Differences in the surfaces of the radio-opacity of explanted specimens were found between
biohybrids tested in the present study. Bank-bone and bTCP were the less resorbed
biohybrids.
Bone formation within control scaffolds was either minimal or absent. The adjunction of
MSCs to scaffolds consistently enhanced bone formation in Porites, Acropora and bTCP
scaffolds. However, no new bone apposition was observed within bank-bone loaded with
MSCs. When present, bone formation was found homogeneously distributed within
constructs.
Conclusion
Comparison of different biohybrids to their specific resorbability and bone forming capacity
allows to screen and to validate the more promising biohybrids into the relevant large bone
defect model.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
1
/
45
100%