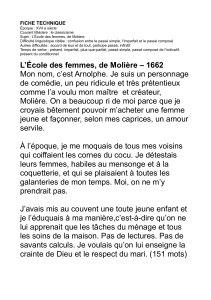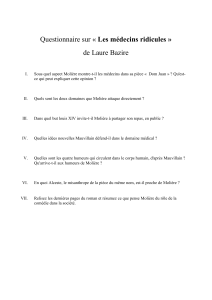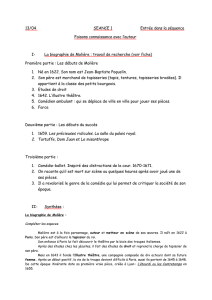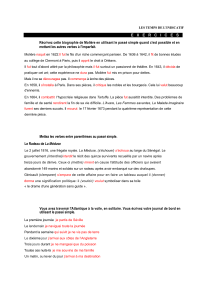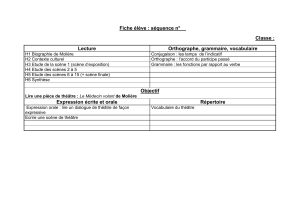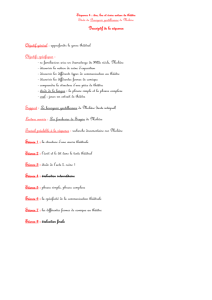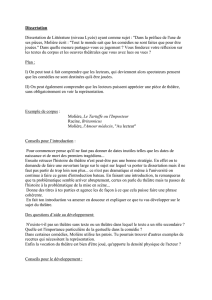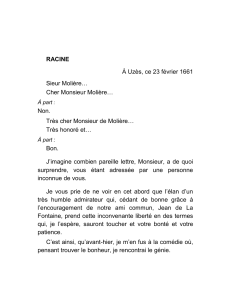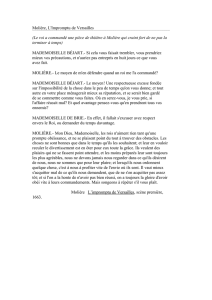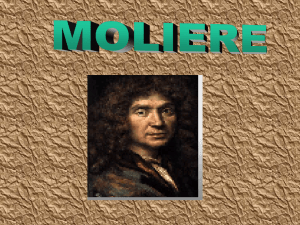Moliériste - University of Toronto
publicité

M-
\)I^}V.
OF
^-^^-^
/i
0^
Digitized by the Internet Archive
in
2010
witii
funding from
University of Toronto
Iittp://www.arcliive.org/details/moliristerevue04pari
LE
MOLIÉRISTE
QUATRIÈME ANNÉE
•"•
rni)&'
QUATRIÈME ANNÉE
LE
MOLIÉRISTE
%EVUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
Campardon,
J.
MM
Claretie, F. Coppée, V. Fournel,
:
J.
Guillemot
A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
J.
Loiseleur
,
L.
Molakd
Ch.
,
Monselet, E. Noël,
Picot
L.
de la Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,
Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu, etc.
Ch.
Nuitter
,
E.
,
PAR
Georges
MON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10, GALERIE
DU THEATRE FRANÇAIS, 10
1883
^b\.
^0
QUATRIÈME ANNÉE
NUMÉRO 37
AVRIL 1882
LE
MOLIÉRISTE
%EVUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
Campardon,
A. HoussAYE,
J.
J.
Claretie, F. Coppée, V. Fournel,
:
J.
Guillemot,
Paul Lacroix, H. de LAPOhLMERAYE, Ch.
LOISELEUR,
Ch.
MM
L.
Nuitter
,
MOLAN'D
E.
Picot
F.- P. Régxier, Ch.
Ch.
,
,
L.
MoNSELET
de la
,
E.
Livet,
NoEL
Pijardière,
de la Rounat, F. Sarcey,
Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry,
E.
Thoinan, A. Vitu, etc.
par
Georges
MON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMEDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10, GALERIE DU THEATRE FRANÇAIS, 10
1882
SOMMAIRE DU NUMÉRO XXXVII
QUATRIÈME ANNÉE
LES
TOMBEAUX DE MOLIÈRE ET DE LA FONTAINE,
présenté au Comité des Inscriptions parisiennes.
rapport
— G. Monval.
CORRESPONDANCE. — Paul Lacroix.
MOLIÈRE ET L'ÊDIT DE NANTES. — H. Moulin.
UNE QUESTION DE DROIT A PROPOS DE TARTUFFE.
— Ch.
Livet.
PAPILLON PARENT DE MOLIÈRE. — E.
PETIT QUESTIONNAIRE Wasili Teploff.
BIBLIOGRAPHIE. — Du Monceau.
BULLETIN THÉÂTRAL. — Mondorge.
:
Thoinan.
—
Claretie.
J.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
français,
2, place
tions,
:
— ÉTRANGER,
I
3
FRANCS.
UN FRANC 50 CENT.
du Théâtre
M. G. Monval,
manuscrits, communica-
à la librairie Tresse, io, Galerie
ou par mandat sur la poste adressé
de Vintimille, auquel
demandes
lettre affranchie.
et
les
à
réclamations devront être envoyés par
LES
TOMBEAUX
DE MOLIÈRE ET DE LA FONTAINE
Rapport présenté au Comité des Inscriptions Parisiennes
(Séance du Mercredi 28 décembre
1881).
Messieurs,
Chargé par
velles
les
sous-commissions des Inscriptions nou-
d'exécution réunies
et
des tombes de Molière et de
La
Fontaine,
de vous présenter d'abord
que de
question
Le mardi 21
nuit,
de restauration
projet
pensable
la
au Comité
soumettre
de
quelques observations relatives au
le
crois indis-
je
résumé
histori-
:
février
1673,
MoHère
était
au cimetière Saint-Joseph, aide de
la
inhumé,
de
paroisse Saint-
Eustache.
Le 14
avait
»
1695, La Fontaine,
avril
demandé
«
dans
le
Molière avait
vet,
quoique
selon Cailhava,
que ses reliques fussent déposées dans
tombeau où reposaient
terré
qui,
celles
de
son
ami,
»
cimetière Saint-Joseph, « à l'endroit
été
mis 22 ans auparavant,
l'acte
d'inhumation
fut
le
en-
même où
» dit l'abbé d'Oli-
du FabuHste désigne
LE MOLIÈRISTE
4
formellement
comme
de sépulture
lieu
le
Cimetière des Inno-
cents.
Mais admettons, avec
que La Fontaine
la tradition,
ait
été enterré à côté de Molière.
Dans quelle
nous
la
terre,
du cimetière St-Joseph placerons-
partie
grande tombe de pierre, élevée d'un pied hors de
que
veuve de Molière y avait
la
milieu du cimetière,
Titon du
»
où
une
croix, » dit
adressée à l'abbé
lettre
assisté
porter
du Parnasse
l'auteur
encore en 1732;
Tillet, la voyait
personne qui avait
fait
?
«
Au
français,
au pied de
«
la
Boy vin par une
aux funérailles de Molière.
Mais un autre témoin oculaire, ancien chapelain de
St-Joseph, prétendait que
tombe, mais
ce
pas
sous cette
dans un endroit plus éloigné,
attenant à
maison du chapelain,
la
le
« et c'est sur cette indication
les fouilles furent pratiquées,
loin, lors
de
comme nous
le
que
verrons plus
suppression du cimetière St-Joseph.
la
Autre version
l'on en croit Y Essai
si
:
De La Borde
de
corps n'était
(i)
sur la
Musique
on creusa, vers 1750, dans le cimeles deux cercueils, qu'on
une fosse où l'on trouva
tière,
transporta dans l'église «
A quoi
où
ils
étaient encore en 1780. »
M. Paul Lacroix répond que
les cercueils avaient
été remis à leur place primitive entre 17806! 1792, ce qui
s'accorde peu avec
On
sés,
peut
dans
lire les
le
le
Magasin encyclopédique de Millin
procès-verbaux qui
tome VIII du Musée
des
d'Alexandre Lenoir (p. 161 à 172)
(i)
(2)
1780, in-4,
3e
t.
année, an
IV,
V
p.
:
furent alors
Monuments français
Molière fut exhumé
252.
(1797),
tome
II,
(2),
dres-
page 548.
LE MOLIERISTE
le
5
6 juillet 1792, en présence de deux commissaires de la
du
section et
vicaire Fleury
pas au pied de
mais
exhumé que cinq mois
fut
au pied de
et pris «
En présence de
la croix »
cimetière,
de ces déplacements successifs,
que
ou contradicne nous
grand hasard
c'est
exhumées en 1792,
des cendres de ces grands
après, le 21
!
tant d'indications vagues
pas permis de dire
dépouilles
non
ses restes,
non pas au milieu du
la croix,
La Fontaine ne
toires, et
on chercha
d'une petite maison située à l'extrémité. »
« près
novembre,
;
se trouvait
il
hommes
pour vous
de vouloir bien écarter tout d'abord
prier. Messieurs,
les
une parcelle
et c'est
?
est-il
dans
si,
la
question d'authenticité qu'il m'a paru nécessaire de vous
rappeler qu'ici
la tradition était
constamment démentie par
les textes.
Cette question^
d'ailleurs,
mémoire,
très secondaire ? C'est la
grands hommes,
partie de l'égHse
de Corneille,
le
ne vous semble-t-elle pas
et
non la poussière des
convient d'honorer.
qu'il
Dans
St-Roch retrouver aujourd'hui
marbre placé sur
le
piHer des
remontant pas au-delà de l'année 1821
?
quelle
restes
les
orgues ne
De même pour
Racine, inhumé à St-Etienne-du-Mont, dans un endroit
très éloigné peut-être
corps de Shakespeare
une
église
repose
de campagne;
à
Stratford-sur-Avon, dans
son véritable
tombeau
qu'un cénotaphe, mais élevé à Westminster, dans
ture des Rois
— Le
de sa plaque commémorative.
la
n'est
sépul-
!
Nous ne pensons donc
tarder davantage à cette
pas que
le
Comité doive
puérile question
s'at-
d'authenticité,
LE MOLIÈRISTE
6
qui ne saurait
rigoureusement résolue que par
être
la
négative.
Tout
que
c'est
conservés aujourd'hui au cimetière d^
restes
« les
permis d'affirmer,
strictement
ce qu'il est
»
Père-Lachaise sont bien ceux exhumés en 1792, et que
»
l'on reconnut à cette
»
Molière
En
«
effet,
et
date, à
La Fontaine.
pendant sept ans,
mis en caisses
tort
ou à
restes,
les
étiquetés, furent
» et
raison,
bord dans un caveau de
chapelle
la
soigneusement
abandonnés, d'a-
En
octobre 1798,
il
fut question
puis
St-Joseph,
dans un grenier^ au-dessus du corps-de-garde de
tion.
être
»
la sec-
de transférer
les
cendres de Molière à l'école centrale de Panthéon, celles
de La Fontaine à Técole
donna pas
centrale des 4 Nations
:
on ne
deux corps continuè-
suite à ce projet, et les
rent à rester privés de sépulture.
Une
Lenoir, que notre collègue
lettre d'Alex.
M.
J.-J.
Guiffrey a bien voulu nous communiquer, appelait sur ce
l'attention
fait
Neufchâteau,
leur
du ministre de
et,
translation
date du 22 mars
à
la
à
l'Elysée
fit
din, avec les restes de
de
François
1799, demandait
Musée des Monuments
du
français, qu'il venait de créer.
16 avril suivant, les
l'intérieur,
Un
arrêté
du Directoire, du
transporter, le 7 mai, dans ce jar-
Turenne,
et
des
monuments
leur
furent élevés.
A
fet
la
de
suppression du Musée, en 1817, un arrêté du pré-
la
Seine,
M. Chabrol de
Volvic,
fit
transporter au
cimetière de l'Est, les restes le 6 mars, les sarcophages
le
2 mai suivant.
M. Anatole de Montaiglon vous
a
rendu compte, Mes-
LE MOLIERISTE
sieurs,
dans
la
précédente séance du Comité, de
que nous avons
dernier,
par
la
au Père-Lachaise,
faite
M. de Montaiglon, M. Mareuse
Nous avons
constaté, Messieurs,
à la vérité,
aucunement
méritaient
pitoyables, (i)
22 novembre
et
moi, délégués
serait porté à leur
mémoire;
l'état,
à notre
les
deux tombes
mais ne
les épithètes d' « affreuses
monuments,
» et de
La Fontaine de-
nul plus que nous
et
en accorder d'exceptionnels
nos prétentions sont modestes,
place et en
(jue
quelques réparations,
Certes, Molière et
»
vraient avoir d'autres
ne
la visite
le
sous-commission des Inscriptions nouvelles.
réclamaient,
«
7
c'est
;
mais
si
qu'on ne pourrait, sur
leur élever des
tombes dignes de leur
humble
monument
avis, le
de Molière
de La Fontaine doit ou dépasser absolument tous ceux
et
entraînerait, outre l'exhumation et le
du voisinage (ce qui
déplacement, des travaux et des dépenses considérables),
ou demeurer modeste,
comme
qu'on a longtemps appelés
le «
il
convient assez
Bonhomme
» et le
à
«
ceux
Contem-
plateur. »
En
1822,
française
le
sculpteur
70,000
fr.
Mansion demandait à
pour un projet qui ne
la
Comédie
fut pas accepté.
faudrait dépenser le double aujourd'hui; et tout l'effort
Il
de
n'atteindrait
l'artiste
pas peut-être
à la
simple élo-
quence de ces deux noms gravés à côté l'un de
D'ailleurs^
avons tout
un de nos honorables
lieu
l'autre.
collègues, que
nous
de croire bien informé (2), ayant déclaré
à la sous-commission
(1)
Lettre et note de
(2)
M. Castagnary.
des
Inscriptions
M. Hérold,
nouvelles que
préfet de la Seine.
le
LE MOLIÈRISTE
8
Panthéon
serait bientôt
mes, nous avons pensé
rendu au culte des grands homqu'il n'y avait pas lieu
maintenant de dispositions
titre provisoirCy
nies auxquels
Cinq
les
ils
monuments
pierres, placées
mieux remplir
actuels plus dignes des gé-
en arrière des tombeaux, parais-
celle
nous a semblé qu'on ne
il
:
du milieu, qui
sorte de trait d'union entre les
et
non seulement nous
croira
y
fai-
a paru tout à fait topique
la
meilleure,
—
on
le
50 ou 60 pièces de vers compo-
mort de Molière
sées après la
qu''en
Molière par La Fon-
de circonstance, mais qui est
sans peine, — des
en quelque
sert
deux tombes,
sant graver la célèbre épitaphe de
taine, qui
à
sont consacrés.
sent attendre des inscriptions
saurait
de demander
mais de rendre,
définitives,
:
Sous ce tombeau gisent Plante etTérence,
Et cependant
Leurs
Dont
Ils
le seul
trois talens
Molière y
gist.
ne formoieut qu'un
le bel art réjouissoit la
esprit
France.
sont partis! Et j'ay peu d'espérance
De
les revoir.
Malgré tous nos
efforts,
Pour un long temps, selon toute apparence,
Térence,
A
droite et à
et Plaute, et
Molière sont morts
I
gauche seraient deux plaques, d'une lecture
plus facile que les microscopiques inscriptions latinesgravées
sur les sarcophages, et qui seraient ainsi disposées
Jean -Baptiste
Jean
DE LA FONTAINE,
Né à Château-Thierry,
Baptisé à St-Crépin, le 8 juillet
1621,
Membre de l'Académie
Mort
française.
à Paris, rue Plâtrière,
le
13
:
avril 1695.
POQ.UELIN MOLIÈRE,
Né à Paris,
Baptisé à St-Eustache, le
1622,
1 5
janvier
Fondateur de la Comédie française.
Mort à
Paris, rue
de Richelieu,
le 17 février 1673.
LE MOLIERISTE
Deux médaillons de bronze,
extrêmes,
compléteraient
monument
restauré,
déjà
consacré
scellés
dignement
9
dans
la
les
panneaux
décoration
— d'aspect modeste, à
du
la vérité,
mais
par quatre-vingts ans de pèlerinages
non
interrompus.
G.
Membre du Comité
Secrétaire de la
MONVAL,
des hiscriptions Parisiennes^
Sous-Commission des Inscriptions Amiennes.
CORRESPONDANCE
M. Ch.
raire de la France
un
dans
Livet a publié,
de
et
article
remarquable,
h
sui'
et litté-
(n° 7, i8 février 1882),
l'étranger
de critique
Revue politique
la
intéressant
très
littéraire,
et très
Nouvelle collection moliéresque, du biblio-
phile Jacob. Cet article ne pouvant être reproduit dans le
où
Moliériste,
il
ferait assez
bonne
figure^
nous nous gar-
derons bien d'y chercher des sujets de polémique, relative
Mais nous croyons que M.
à Molière et à ses ouvrages.
Ch. Livet nous saura gré de relever une simple erreur
bibUographique et de mettre à néant une espérance
nous
donnée.
avait
Voici
l'erreur
M.
«
:
» apprendra peut-être
» faire
l'on vient
»
si
D
en vers,
»
Loret.
»
Rothschild
»
réimpression
»
»
si
Paul
Lacroix
pense
que l'on
que Boursault n'avait pas cessé de
guerre à l'auteur de Ylmpromptu de Versailles,
la
» recueil
qu'il
à
découvrir un exemplaire de la
qu'il publiait toutes les
Cet exemplaire,
qui
retrouvé,
l'a
des
:
a
on
n'y
Ga:(ette
façon de
donné place dans
de Loret,
lendemain
trouve
la
baron James
regretté
et lui
Continuateurs
paraissait le
prématurée
le
semaines à
même
pas
un
ce
de
sa
précieux
de sa mort
mot contre
Molière. »
Malheureusement,
le
savant
le
baron James de Roths-
LE MOLIÈRISTE
un exemplaire de
child n'a pas découvert
vers de Boursault, qui a dû
juillet
II
1665 jusqu'au mois de juin 1666;
une
seulement
datée du 19
libraire
ni
Thoisy, à
le
mois de
en
a trouvé
première,
la
1665, 2 feuilles in-folio^ sans
juillet
d'imprimeur, dans
la
il
peut-être
originale,
lettre
GaxeUe en
la
depuis
paraître
Bibliothèque
tome VIII
le
nationale
de
borné en
s'est
il
;
nom
du recueil
outre à reproduire, dans son admirable recueil des Conti-
fragments de cinq autres
nttateurs de Loret, les
que
lettres,
Boursault avait extraits de sa Gaxftte en vers et qui sont
de ses Lettres de
recueillis
à la fin
d'amour,
imprimées pour
réimprimées plusieurs
(^Paris Thêod.
Girard
y
première
la
en
fois
lééé
dans l'édition de
fois. C'est
que M.
in- 12),
d'obligation
respect^
le
et
et
1669
baron de Roths-
child a pris le texte incomplet et sans doute remanié des
six lettres qui
nous restent sur 24 environ que Boursault
avait distribuées,
à la
fît
à raison de
Galette en vers
deux
et à la
lettres par
Muse
enjouée,
paraître depuis, elles sont encore
dans
vertu
1665
le
directes
à découvrir, et c'est
premier de ces recueils périodiques,
d'un privilège du
et
roi,
dans
mois. Quant
que Boursault
le
publié,
en
cours des années
1666, que nous serions sûrs de trouver des attaques
ou
indirectes contre
Molière
;
d'autant plus que,
quatre ans plus tard, Boursault n'avait pas pardonné à ce
redoutable adversaire les épigrammes
Versailles,
sa
petite
puisqu'il
s'en
comédie de
la
de l'Impromptu de
prenait encore au Tartuffe dans
Satyre des Satyres, dirigée surtout
contre Boileau,
P.-L.
27 Février 1882.
JACOB,
bibUophile.
MOLIÈRE ET L'ÉDIT DE NANTES.
MM. SCRIBE ET VILLEMAIN A L'ACADÉMIE.
Les quelques lignes de M. L..., insérées dans
nier
numéro du
der-
le
ont réveillé chez moi des sou-
Moliériste,
venirs d'un demi-siècle, et m'ont reporté par la pensée à
la
M.
réception académique de
ma mémoire
c'était, si
Scribe.
en janvier 1836;
est fidèle,
un
plus aujourd'hui de survivant
assistais,
J'y
il
et
n'y a
seul académicien de
ce
temps-là.
Bien que près de cinquante ans se soient écoulés depuis
lors_,
vois
je
directeur.
discours
et
L'un
un
Rappelant
encore
j'entends
très
récipiendaire
le
trouver dans les galeries de Versailles
:
fort
«
toutes les illustrations qui m'entourent, dit
milieu de toutes les
rir
à
«
pompes
mes souvenirs ou
tonner
le plus, c'est
à
ma
littéraires
mes yeux,
a réussi
vent votre
nom
»
savait
milieu de
M.
Scribe, au
qui viennent
ce qui
ici s'of-
devrait
m'é-
répondit spirituellement
ici les
de vos comédies
Toute
cette
dire, fut
;
et
applaudissements qui sui-
sur tous les théâtres de
que de l'Europe.
M. Villemain
lui
comme une
vous venez de retrouver
étonné de se
Au
présence. »
Votre discours, Monsieur,
M. Villemain,
le
heureux début.
mot du doge de Gênes,
le
et
bien inspirés, eurent pour leur
et l'autre^
un
la
France
réponse,
petit
dite
et pres-
comme
chef-d'œuvre
de
I3
LE MOLIERISTE
de
délicatesse,
M.
grâce, et parfois de fine
ironie. « Jamais
Scribe n'avait été aussi finement critiqué,
aussi spiri-
tuellement loué. (i). »
Au
début,
mais bientôt
parler à
M.
la
main du directeur
la griffe se laissa
compagna
Quand
sa phrase
d'un
«
Monsieur
pardon,
sourire et les bravos de l'auditoire.
le
Monsieur
il
de ses guerriers^ de ses lauriers »
»
vint à
fiât
dit
entendu ni vu
Ce
,
il
ac-
qui pro-
»
«
pardon^
d'un ton, accentué d'un geste et d'un
regard, dont ne sauraient se rendre
ni
gantée de velours,
Scribe « de ses colonels en retraite, de ses vieux
et braves soldats,
voqua
était
apercevoir.
l'orateur, et
compte ceux qui n'ont
que seraient impuissants à
reproduire ceux qui l'ont applaudi.
M.
M. Villemain,
s'étonne que
I
et l'histoire littéraire et
l'histoire
qui
«
politique,
outre une excellente mémoire,
ait
mention
de Nantes.
J'ai
main,
très originale
l'édit
et j'ai
Mais
il
qui avait en
passé sous silence la
»
peu M.
eu l'honneur de connaître quelque
historique de
cité.
de
connaissait
Ville-
de bonnes raisons pour affirmer que l'erreur
M.
Scribe n'avait point échappé
était
homme du monde, bon
à
sa saga-
pour tous
ses
confrères, malgré la tendance de son esprit à l'épigramme,
indulgent
pour
les
torts
littéraires,
scrupule de donner à un confrère,
et
il
se
serait
fait
sur le seuil de l'Aca-
démie, une leçon d'histoire devant une assemblée sympathique, qui n'était venue que pour applaudir le nouvel élu.
Je m'étonne seulement qu'il ne
averti dans le tête-à-tête. Je
(i)
l'ait
m'étonne bien plus encore
Revue des Deux-DiCmdes 15 février i8j6.
,
pas charitablement
LE MOLIÈRISTE
14
qu'aucun des membres de
commission devant
la
laquelle le
récipiendaire avait lu son discours avant de le prononcer
en séance publique, ou
ou n'en
ait
C'était
n'ait pas
vu
grossière
la
une révélation qui devait apparemment
d'un ami, ou peut-être d'un ennemi. Toujours
ne
« la
de
sais plus
quel critique, et que
comédie de Molière nous
l'édit
de Nantes
? »
fut
lui
venir
est-il
que
semaines après la réception, par
l'erreur fut relevée, quelques
je
erreur,
pas prévenu l'auteur.
fameuse phrase
la
si
parle-t-elle
de
la
révocation
prononcée en pleine Académie,
et
textuellement imprimée dans les premiers exemplaires du
discours, des cartons réparateurs la
derniers,
où on
l'eût
firent disparaître des
vainement cherchée.
Meilleur et plus indulgent en vieillissant,
ac melior veniente senectâ, »
je
pardonne
Scribe cette violence à l'histoire,
lui faites à la
grammaire
—
« O^ollior
volontiers à
comme
toutes celles par
et à la poésie. Je les lui
pardonne
en faveur des jouissances que son théâtre a données à
jeunesse et à
mon
Le temps présent
pas trop oublieux des qualités
n'est-il
de l'auteur de Bertrand
et
Raton,
littérature, toute célébrité
durable est
?
trop
et
siècle
dur pour ce
Dans tout genre
«
un grand
donné à personne d'amuser impunément
pendant vingt ans de
C'est
M. Villemain
titre,
le
de
et
il
public
suite. »
qui a dit cela à
M.
Scribe lui-même,
qui pourrait aujourd'hui ne pas être de l'avis du
critique, et
ma
âge mûr.
grand amuseur de son
n'est
M.
ne pas partager son appréciation?
H.
MOULIN.
célèbre
UNE QUESTION DE DROIT
A PROPOS DU
TARTUFFE
«
»
Notre collaborateur M. Ch. Livet vient de terminer, pour
rie
la librai-
Paul Dupont, une édition du Tartuffe, précédée d'une notice, accom-
pagnée de notes sur tous
nombreux exemples
dans
pris
ont paru réclamer des éclair-
les points qui
cissements, et suivie d'un lexique où
les
il
s'est
appliqué à
contemporains,
justifier,
mots
les
par de
et tours
de
phrase employés par Molière.
S'agit-il
1
de
donation entière »
la «
faite
par
Orgon
à Tartuffe
:
176. Je ne veux point avoir d'autre héritier que vous,
Et
de ce pas, en fort bonne manière
je vais
Vous faire de mon bien donation entière.
Un bon et franc ami, que pour gendre je prends.
M'est bien plus cher que fils, que femme et que parents.
Voici
le
commentaire de M. Livet sur ces vers
lecteurs auxquels
il
est destiné,
il
;
suffisant
qui trouveront naturellement leur place dans notre Recueil
—
«
et
il
ne faut voir
comédie, une de ces conventions
ple,
Orgon
L'exhérédation de ses enfants par
possible en droit,
qu'un
là
comme
celle,
en vertu de laquelle un mariage décidé
tement conclu par
la
signature
pour
les
comporte quelques développements
du
contrat.
est
:
n'était pas
moven
de
par exem-
immédia-
Les exhérédations
ï6
LE MOLIÈRISTE
que
n'étaient pas arbitraires; elles ne pouvaient être faites
pour des causes légitimes
l'acte
et
exprimées dans
véritables
:
exhœres
Bis septem causis
Si
patrem
feriat
filius
aut maledicat
esto
:
ei, etc.
Aucune des quatorze causes d'exhérédation ne pouvait
s'appliquera Damis ou à Marianne.
Orgon eût-il eu, d'ailleurs,
des motifs légitimes pour les déshériter,
révoquer son acte
que
;
ne
l'eût-il
il
pouvait toujours
pas révoqué,
il
aurait suffi
réconciliation entre lui et ses enfants fût
la
connue
par sa conduite à leur égard, pour que l'exhérédation fût
nulle de plein droit. »
Plus loin
«
La donation
devant
les lois
En
»
:
entière faite par
dans
effet,
la
coutume de
devait réserver aux
vifs
c'est-à-dire
moitié
la
Orgon
n'était pas possible
du temps.
Paris, la donation entre
enfants au
de
la part
moins leur légitime,
héréditaire
de chacun
d'eux, part différente pour les cadets et pour l'aîné. Celui-
en
ci,
effet,
couronne,
outre
comme
les
fiefs
relevant
duchés, comtés,
directement de
marquisats,
revenaient en récompensant ses cadets,
préciput consistant dans
du
fief,
l'aîné
avait encore
un
château ou principal manoir
deux enfants, Damis par exemple,
de
du
tiers
suite,
donc d'un
la
reste des fiefs,
légitime,
tiers
Marianne au
ou demi-part de
avait
droit
tiers restant.
l'héritage,
était
pour Damis, d'un demi-tiers ou d'un sixième
pour Marianne ; de
vait
lui
avec cour, basse-cour, jardin; outre son préciput,
aux deux
Par
le
la
qui
plus,
Orgon, veuf
donner au delà de ce que
le
et remarié,
ne pou-
moins-prenant de ses enfants,
LE MOLIERISTE
I7
Marianne, par conséquent, avait à recevoir dans sa succession
:
de Marianne étant d'un sixième de
or, la légitime
fortune d'Orgon, celui-ci ne pouvait disposer de plus
la
de Tartuffe, déduction
d'un sixième en faveur
préciput assuré à l'aîné.
M. Loyal
Plus loin encore, lorsque
nouvelle remarque
:
Ni Orgon, Tartuffe ou
temps de
vient
Signifier l'exploit de certaine Ofdonnance,
1746.
«
du
faite
»
faire
insinuer,
le
notaire n'avaient
eu
de
c'est-à-dire enregistrer l'acte
donation, formalité sans laquelle
il
n'était pas valable
le
;
ni
Tartuffe n'avait eu le temps de faire rendre une ordon-
nance définitive permettant à un huissier de sommer Orgon
de
«
les
comédies,
vuider
il
Dans
».
d'ic}'
ce
passage,
comme
dans toutes
de convention que l'auteur supprime
est
les formalités légales.
»
par
Quant aux
le sergent, ils
garnissaires,
imposés au nombre de dix
auraient dû l'être en vertu d'un jugement;
mais ce jugement n'a pu être rendu que grâce aux conventions théâtrales. »
Enfin
:
« L'ingratitude
la
donation
:
«
de Tartuffe
venance des enfants
révocation pouvait
d'ailleurs, la
et
vifs,
nullité
pour cause d'ingratitude.
offrir à
de
quoique irrévo-
peuvent être révoquées par
»
la sur-
— Cette
Mofière un dénouement facile
donation entière n'avait été nulle de plein
droit, à cause des enfants qui
de leur légitime.
une cause de
Les donations entre
cables de leur nature,
si,
était
Si
ne pouvaient
donc Molière
être dépouillés
a adopté
un autre dé2
LE MOLIÉRISTF.
l8
nouement,
Roi
c'est
de dessein bien arrêté
du
l'intervention
:
sont donnés assuraient
et les éloges qui lui
la
repré-
sentation de la pièce
Molière abuse
«
français
Si veut
:
le
ici
de
la
maxime fondamentale du
^Koi, si veut la Loi
Quoe vult Rex
:
consona Legi.
sanctae sunt
fieri,
(Nov. 105,
de cette autre
et
:
Le Roi
«
de Livonière). Le
Molière prête au Roi de rompre
et Tartuffe
terme de
droit
contrat passé entre
le
ne peut s'expliquer que de deux façons
XIV, qui
reconnaissait, avec Louis
il
ad fin.)
cap. 2,
est le principe et le
toutes les justices. » (Pocqijet
tion dans ses Mémoires (Ed. Dreyss,
droit
I,
:
que
Orgon
ou bien
a émis cette préten-
209), que « les Rois
sont seigneurs absolus, et ont naturellement la disposition
pleine et libre de tous les biens, tant des séculiers que des
ecclésiastiques,
ou bien
il
fait
pour en user
ou baron, dont
les
qui
hommage,
il
comme
doit foi et
relèvent directement
fiefs
et qui
transmission à Tartuffe. »
—
dans l'intervention royale,
comme
même,
droit
Le
M.
à
soulever,
qu'il
remarquons
dans
la
donation elle-
théâtre, et
y
ait
ici
»
une contradiction
1783. Qui viendra seulement passer
M. Loyal
invitant
ses
non
une question de
Lo3^al,
Avec dix de
la
quelconque, inattaquable devant
Incidemment, mais sans
droit
;
du Roi, à
n'en accepterait pas
Parlement ou toute autre cour souveraine.
le
»
plus simple est de voir
un moyen de
impossible en droit,
l'application d'un
et
économes
sages
d'Orgon un seigneur, duc, marquis, comte
ici la
nuit
gens, sans scandale et sans bruit,
Orgon
:
entre
I9
LE MOLIÉRISTE
1790.
On
A
vuider de céans jusqu'au moindre ustensile.
comprend qu'Orgon ne
y
puisqu'il
a donation
coucher dans
puisse enlever ses meubles,
entière,
maison dix garnissaires pour
la
mais alors comment l'oblige-t-on
ustensile
que M. Loyal
et
à. vuider
les
fasse
garder
;
jusqu'au moindre
?
Sans nous arrêter à ce point incident, revenons à
question principale de
la
donation.
la
— Voici des considé-
rations nouvelles et des faits à l'appui des principes posés
plus haut
1°
La
En
:
donation devait réserver la légitime des enfants
1632,
juillet
il
à la seconde
fut jugé
:
chambre des
Enquêtes du Parlement de Toulouse qu'une mère ayant
fait
donation à son
de ses enfants
gitime,
la
légitime
la
donation
des enfants,
n'étant pas
suffisante
aux enfants sur
à la charge de payer à chacun
frère,
somme
de
six cents
somme
ladite
pour
le droit
de
les biens
Combolas, qui rappelle
la
de
que
la
père
la
—
de
d'Orgon
mère.
cette décision, fait
et
faite
remarquer,
par
«
le
père
quand
que
si le
le
»
de Tartuffe.
respect de la légitime des enfants était
la loi
la
livres
de propos déHbéré au préjudice de ses enfants.
C'était le cas
Le
lé-
nature donnait
mère, doit être entièrement révoquée
la fait
cents
six
d'accord avec Bartole, qu'une donation
ou
pour leur
livres
révoquée à concurrence de
serait
père, pour frauder son
fils,
tel
aux yeux
avait
vendu
tous ses biens, le contrat de vente pouvait être cassé jus-
concurrence de
qu'à
la
allait
même
la légitime
;
la
coutume de Paris
jusqu'à annuler en faveur des enfants l'aHéna-
20
LE MOLIÉRISTE
tion des biens
(Décisions
leurs pères ont reçus de leurs ayeux.
que
M. de Combolas,
Arrêts recueillis par
et
XXXII).
ch.
2° Nécessité de P insinuation ou enregistrement
Un
ayant
père,
fait
:
donation de ses biens à un
réserve faite de la légitime de ses enfants, était
d'avoir
insinuer (enregistrer)
fait
donation fut cassée
le
la
Grand'Cham-
fondait sur ce
l'arrêt se
;
donation n'était valable qu'à partir du jour de
la
sinuation, et que
En
exigée.
ont pensé
inipeiu
qu'une des raisons de l'insinuation
est ne qui^
sine-
judicio,
tanquam prodigus
pourquoy, ajoute Combolas
devant
elle se doit faire
le
{ouvr.
fait la
s'informer
ou
s'il
VI, ch.
ait
donation,, et qu'il puisse
forcé,
ou
donne volon-
s'il
qu'en donnant son bien
et afin
III),
qu'il
afin
il
ne
soit pas
»
A Paris,
où demeurait Orgon, l'insinuation ou enregis-
trement se
de voir
a esté induit
Voilà
donet.
liv.
cit.,
juge ordinaire,
connoissance de celuy qui
trompé.
elle était
Guy Pape
aliquo,
tairement,
le
Ferrières et
les jurisconsultes
effets
«
l'in-
de rigueur avant
l'insinuation était
décès du donateur, à cause du motif pour lequel
:
1°
faisait
que
au Châtelet
la
;
il
aurait été facile au juge
donation d'Orgon ne réservait pas
légitime des enfants, puisqu'elle était entière
;
était faite dans le but de dépouiller les enfants;
comprenait même, étant entière,
4°
tiers,
mort avant
de donation. La
l'acte
1630 en
24 janvier
bre du Parlement de Toulouse
que
—
VI,
liv.
qu'Orgon
gus dotiaverat;
les biens
et,
qu'elle
3° qu'elle
reçus des ayeux
impetu aliquo, sine judicio,
—
— 2"
—
la
;
tanquam prodi-
en somme, que pour tous ces motifs
réunis, la donation devait être annulée.
LE MOLIERISTE
Mais d'un autre côté,
l'enregistrement,
il
était
il
l'acte
21
n'ayant pu être soumis à
n'y avait pas à en réclamer l'annulation
Donc, toute
l'histoire
n'est qu'une convention
qui termine
de
la
donation dans
dramatique,
pièce devait être,
la
laissé à la libre disposition
et le
comme
un contrat, de
la faculté
qui restait à
révocation de sa donation,
du donataire;
le
— Donation
le
Tartufe,
dénouement
tout le
de l'auteur^ sans qu'il y
s'occuper du droit qu'avait ou n'avait pas
la
ait
reste,
même à
Roi de rompre
Orgon de demander
en invoquant l'ingratitude
et annulation, sont
également
des fictions dramatiques.
Ce
:
nul de plein droit.
qu'il fallait
démontrer.
Ch.-L. LIVET.
PAPILLON DE LA PERTE
PARENT DE MOLIÈRE
(Recherches)
Dans
le
n" 32 du Moliériste (i"
directeur faisait appel à tous les
cher quel pouvait être
les
le
Menus
plaisirs
moliéristes pour recher-
degré de parenté existant entre
Papillon et les Poquelin,
des
novembre 1881) notre
du Roi,
et cela parce
le
sieur
que l'intendant
Denis Papillon de
la
Ferté, s'était flatté d'appartenir à la famille de Molière. Je
ne puis, hélas
mais
!
élucider la question d'une façon définitive,
devoir fournir aujourd'hui quelques rensei-
je crois
gnements dont
par rapport au problème à résou-
l'utilité,
dre, ne se réalisera toutefois
que
vient à être reconnue
Du
consécration,
ment dénués
juste.
si
l'hypothèse proposée
reste,
mes renseignements ne
d'intérêt
puisque,
à
défaut de cette
seront
pas entière-
comme on
le verra, ils
touchent de très près à une parente par alliance du grand
comique.
Si Papillon était parent de
riage de Geneviève Béjart,
Jean-Baptiste Aubry,
Papillon,
taire
il
fils
Molière par
le fait
du ma-
belle-sœur de Molière, avec
de Léonard Aubry et d'Anne
faut avouer qu'il aurait
eu plus de
profit à se
qu'à revendiquer l'honneur de cette parenté.
Celle-
.
LE MOLIERISTE
ci,
23
passablement vague et d'ailleurs
en tout état de cause,
vait,
recherches sur
procurer qu'un bénéfice
lui
d'amour-propre assez mince,
tandis qu'au
origines de
les
s'exposait, pouvaient avoir
vertes très peu flatteuses.
ne de-
très éloignée,
contraire
auxquelles
famille,
sa
les
il
pour conséquence des décou-
on sera forcé de
C'est ce dont
convenir quand on aura lu ce qui
d'un Factum
suit^ extrait
du temps, plein d'informations sur
les Papillon
et surtout
sur les Aubry-Papillon qui s'allièrent aux Béjart:
Pour reprocher valablement Sébastien Aubry, vulgairement appelé,
«
le petit
Aubry^
trois
nom
n'y auroit qu'à dire son
il
adjouster aucune autre chose
nommer
;
mots un amas horrible de tous
petit
le
tout seul,
Aubry,
et sans
c'est
faire
y
en
reproches et de
toutes les
un maistre Paveur, qui
a toujours
les
infamies
Son
fait
assez
Aubry)
père, (Léonard
paroistre
d'honneur selon
ny de plus grand
et qui après tout n'eut
déplaisir
en vivant
veu dans sa nombreuse famille deux de
en avoient toujours
mort dans
sa condition, qui est
ceux de sa connoissance,
sion
estoit
beaucoup de probité dans son employ, qui
et
ses
l'estime de tout
jamais d'autre confu-
en mourant, que d'avoir
fils
une de
et
déshonneur, l'opprobre
esté le
a vescu avec
et le
ses filles, qui
rebut dès les
premières années de leur plus tendre jeunesse.
La mère du
Anne Papillon,
roué, mais
malheur
a le
maistre d'escrime
nepveu de
Aubry, laquelle
petit
qui
et
est
encore en vie et qu'on appelle
honte d'avoir esté
la
sœur de
ce
Jameux
infâme gladiateur Papillon^ qui ne fut point pendu ny
mérita mille fois de
cet oncle
seulement selon
et la
mort,
la chair
et
et
l'estre
:
Le
Aubry
petit
est
digne
peut passer pour son image vivante, nonle
sang,
mais encore selon
les
moeurs
et
l'esprit.
Le
plus âgé de ses deux frères est maistre paveur,
Aubry,
dit des Carrières
Béjart) qu'il a autant
luy-mesme par
Le second
;
il
a espousé la
sœur de
la
déshonorée par son alliance,
on
le
nomme
Jean
Molière (Geneviève
qu'il
a esté difi"amé
cette prostituée.
frère
du
petit
Aubry
s'appelloit Nicolas
;
c'estoit
un dé-
bauché, un prodigue, un cruel d'indignation, un breteur, un brigand.
LE MOLlÈRISTli
24
un assassin de profession
très
misérablement dans
il
;
tué très justement, mais
l'ut
rencontre du
la
commirent eux deux ensemble sur
vol
et
il
mourut
de l'assassinat qu'ils
grand chemin de Chaillot au mois
le
d'Octobre de l'année 1669.
Marie Aubry
qui soit
est la seule
connue par
de toutes
ses désordres.
les
quatre sœurs du petit
Il suffiroit
pour
la
mement, de luy reprocher publiquement, que d'une
Aubry
reprocher
légiti-
part elle est
de Sébastien Aubry, c'est-à-dire du plus scélérat des
hommes
qui sont présentement à pendre ou à rouer, et que d'autre part
niepce de feu 'Papillon^ c'est-à-dire
ayent esté pendu ou roûei
teux et
les
;
du plus infâme de
car en effet voilà les
coule dans ses veines,
pas,
il
en
estoit
,
si
deux reproches
parmy
resté
Presque tout Paris
l'esprit
âme à
corps et son
tout le sang
les
plus hon-
une personne
corrompu qui
une seule goûte qui ne
pour luy former quelque pudeur sur
nue dans
elle est
hommes morts qui
tous les
plus forts qui puissent estre faits en justice contre
qui n'auroit eu garde d'y paroistre
le visage,
ou quelque
qu'elle
sçait
sœur
vivans,
le fut
rete-
a prostitué
des gens de tous âges, de tout sexe,
son
de tous pays,
de toutes humeurs et de toutes conditions, et cette notoriété publique
vaut bien autant qu'une preuve par
tre
et
écrit, etc....
Aubry soit le cadet de ses deux frères et de ses quasœurs, néantmoins on peut soustenir qu'en matière de scélératesses
Quoique
le petit
d'abominations,
méchant de
sœurs; Car
il
a pris le préciput et le droit d'ainesse sur le plus
deux
frères et sur la seule meschante de ses quatre
y a très peu de gens en France, qui entendant
parler du petit Aubry, ne s'écrient en mesnie tems, c'est un Imposteur,
un Calomniateur, un Assassin, un Voleur, un Blasphémateur, un Athée
c'est un homme qui^ a toujours eu les mains pleines du sang et du
ses
enfin,
il
;
bien d'autruy
;
en un mot
un personnage couvert de
c'est
de crimes, et sans aucune exception, ou pour
l'excellente
satiriques,
et
toutes sortes
cet endroit par
admirable expression du plus juste de tous
c'est
aucune vertu
finir
les
poètes
un monstre remply de toutes sortes de vices et sans
Sebastien Aubry est convaincu de vingt-trois diflfé-
rens vols et assassinats qu'il a
commis, tant de jour que de
sur les grands chemins qu'ailleurs, tant luy seul qu'avec
nuit, tant
d'autres gens
de sa trempe.... »
Cette diatribe très colorée est de Guichard.
reux avait
afFaij:e
à
forte
partie
;
il
se
Le malheu-
défendait contre
LE MOLIÈRISTE
LuUy dont
les
accusations mensongères, moins habiles
qu'impudentes, avaient
toutefois
chaîné toute sa fureur.
chercher à
et
n'est
Aubry-Papillon,
le
et
dé-
heu de
la
procédure tortueuse
seulement de savoir
s'agit
Il
si le
malheureusement pour
dit est vrai, et
il
ici
dans lesquelles son ad-
des machinations embrouillées
fonds de ce qu'il
pas
langage violent et fortement imagé
justifier le
l'enserrait.
sa verve
excité
Mais ce
d'un plaideur révolté et indigné de
versaire
2$
nous faut constater, après
que Guichard n'a rien inventé. Papillon
les
vérification,
maître d'armes,
le
Nicolas et Sébastien Aabry-Papillon, ainsi que leur sœur
Marie, furent bien
Si,
a dépeints.
tels qu'il les
en se faisant gloire d'un
avec Molière, Papillon de
lien
de parenté quelconque
Ferté s'appuyait sur ce qu'il
la
comptait parmi ses ascendants Papillon
neveux
dignes
et
sa
venir naïvement se brûler à la chandelle
l'intendant des
Menus,
celle
phces
dans laquelle
Espérons, pour
?
une autre
fa-
moins détestables
prenait ses
amis
com-
et
!
Enfin notons, pour
contre les
rières,
LuUy
ses
n'était-ce pas
qu'il appartenait à
mille de Papillon ayant des antécédents
que
bretteur,
le
peu vertueuse nièce,
finir,
qui
Aubry ne reproche
que
sa
triste
parenté,
si
Guichard dans sa haine
à Jean Aubry,
c'est
qu'à coup sûr
trouva pas autre chose à dire contre lui;
et l'une
Caril
ne
le
furent
de ses quatre sœurs.
Er.
ne
l'époux de Ge-
neviève Béjart fut donc plus estimable que
son oncle, ses deux frères
dit des
thoinan.
PETIT QUESTIONNAIRE
DEMANDES
—
28.
quiniste,
Wasili Teploff.
un manuscrit
— trouvé,
— une
J'ai
russe,
traduction des Fourberies de Scapin.
traduction est
cette
nom
les
Le
véritable titre de
Ruses de Scapin. L'auteur a pour
Wasili (ou Basile) Teploff. Je
une date
chez un bou-
copie, je crois, d'une
sur ce manuscrit
lis
1757.
:
Dans son
excellente et savante Bibliographie Moliéresque,
M. Paul Lacroix donne la liste des traductions russes de
Molière
Tartuffe, V Avare, l'Ecole des Maris, ÏEcole des
:
Femmes, par Ivan Kropotov;
le
Mariage forcé, TpurD. Lensky;
le
Misanthrope, par Fedor Kokoskin; Amphitryon, par Pierre
Svistunov, etc., etc.
Je vois
même,
une traduction des
figurer
Mais de
Smirnov.
Teploff,
il
Scapin,
par Basile
il
imprimées en Russie?
de Scapin ont-elles été
soumis
peintre, et
Fourberies de Scapin, par Ivan
cette traduction de
n'en est point du tout question.
Ces Ruses
J'ai
dans l'ouvrage du bibliophile Jacob,
le
mon
manuscrit à
me répond
:
«
ami B. Vereschagin,
La traduction
n'est point
le
du
tout mauvaise. »
Quelque moliériste russe
pourrait-il
renseignements sur Wasili Teploff
et
me donner
des
sur ses travaux de
producteur ou de traducteur?
Jules
CLARETIE.
BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESaUE
— La
Molière à la Librairie des Bibliophiles.
que
Bibliophiles,
M.
dirige
librairie
des
Jouaust, continue la publication
de sa belle édition grand in-8° du Théâtre de Molière, avec
de Louis
les dessins
Leloir,,
meng. Le tome Vil
a
gravés à l'eau-forte par Fla-
paru récemment;
il
'Bourgeois gentilhomme,
Tsyché et
On
devant paraître avant
comme
annonce,
juillet,
le
tome VIII
et
Comtesse d'Escarbagnas,
contient le
Scapin.
les Fourberies de
mois de
le
dernier, qui comprendra, avec la
Femmes
les
Malade
savantes et le
imaginaire, les deux farces attribuées à Molière, la Jalousie
du barbouillé
et le V^édecin volant.
Nous pouvons annoncer
très
prochainement,
pubHé dans
de Molière^
de
la
le
comme
aussi,
devant paraître
tome premier d'un
le
format in-ié,
Nouvelle bibliothèque classique, à
Cette édition sera précédée
de
la
3
autre Théâtre
et qui fait partie
francs le volume.
préface de 1682, aug-
mentée de notes importantes, par M. G. Monval.
La réimpression des T^ièces originales de Molière, faite par
de M. Louis Lacour, vient de se terminer par la
les soins
publication
Femmes Savantes; mais
des
ajouter le Malade imaginaire,
rapprochée de
la
va
y
dont l'impression a été
si
mort de Molière.
Il
se
l'éditeur
propose
même
de pubUer aussi individuellement chacune des pièces qui
ont paru pour
la
de 1682,
que
afin
première
les
fois
dans l'édition
collective
amateurs puissent avoir
ainsi
le
sous
la
théâtre complet de Molière en pièces séparées.
Enfin,
la Librairie
des Bibhophiles continue,
28
LE MOLIÈRISTE
direction de
M. Paul
collection inoliéresque
Veuve à la mode de
,
Lacroix,
publication de
la
la
Nouvelle
dans laquelle a paru récemment
De
la
Vizé, et qui s'augmentera prochai-
nement de Myrtil et Mélicerte^ précédé d'une notice de
M. Edouard Thierry sur ÏKélicerte.
—
—
GÉRARD DU BouLAN.
Saint-Remy,
de
M. Romuald Le
administrateur de
banques coloniales,
officier
de
la
Pelletier
l'agence centrale des
légion d'honneur, décédé
à Paris, le lé mars dernier, à l'âge de 73 ans, était l'au-
Y Enigme d'Alceste, qu'il avait publiée en 1879
pseudonyme de Gérard du Boulan.
On se souvient que notre collaborateur, M. H. de
Lapommeraye, a fait de cette étude sur le Misanthrope et
la société du temps le sujet d'une conférence à la salle
teur de
sous
le
des Capucines.
— RoTROU. —
D'intéressantes Notes critiques
et
biogra-
phiques sur ce précurseur de Molière, viennent de paraître
en une brochure in-8° de 44
p.,
13, rue de Médicis. L'auteur est
chez L. Cerf, éditeur,
M. Léonce Person,
pro-
fesseur au lycée Saint-Louis,
— M,
Auguste Baluffe poursuit, dans V Artiste,
ses très
curieuses recherches sur MoHère.
La livraison du 26 février renferme un article sur les
Homonymes de ses personnages comiques, précédé d'une
Armandc Bêjart, gravée à l'eau-forte par M. L. Courtois,
« d'après un portrait du temps », dont nous ne voudrions
pas garantir l'authenticité.
—
publie
La revue Slowinœ (le Slave), qui paraît à Raguse,
un certain nombre de traductions inédites de
Molière en croate, qui ont été représentées à Raguse au
siècle dernier.
Comme
il
arrive le plus souvent, ces tra-
LE MOLIERISTE
ductions sont adaptées aux
—
Le Journal
mœurs
29
et
usages du pays (i).
asiatique de janvier
intéressante notice de
1882 contient une
M. Barbier de Meynard
sur ÎSColière
que nous ne pouvons transcrire aujour-
traduit en turc,
d'hui, faute d'espace, mais sur laquelle
nous reviendrons
certainement.
—
Une
M. le D*^ H. Schweitzer
du 4^ cahier du Molière-Muscum,
grave indisposition de
a retardé la publication
que nous avions annoncé pour
seulement en
—
M.
le
du
lecteurs
de janvier.
Il
paraîtra
Mahrenholtz, de Halle, bien connu des
D"^
Moliériste^ vient
Leben und
ïMoliére's
la fin
avril.
de publier chez Henninger
Werhc vom Standpunste
des
:
heutigen
Forschens (Vie et ouvrages de Molière, d'après les recherches
les plus récentes).
— Le
—
Le tome III de la nouvelle
Molière-Moland.
Œuvres complètes de V^ColièrCy collationnées sur
originaux et commentées par M. Louis Moland,
édition des
les textes
vient de paraître à
la librairie
de Garnier frères, daté de
1880.
Le plan de notre
excellent collaborateur se dessine plus
nettement dans ce nouveau volume, qui contient
Amoureux en deux
Comédie
Don Garde
la
le
Dépit
actes, conforme aux représentations de
française, les Précieuses ridicules,
de Navarre,
Sganarelle et
accompagnés de notices prélimi-
naires et escortés, en outre, de Vlnteresse (la Cupidité) de
Nicolo Secchi, de
la
Déroute des Précieuses, mascarade, du
Récit en prose et en vers de la farce des Précieuses,
Jardins, des Véritables précieuses,
par M"* Des
comédie de Baudeau de
(i) Voir la note sur Bétondic, Jorgo et Tudisi, communiquée à
M. Paul Lacroix, par notre collaborateur M. E. Picot {'Bibliographie
niolièresqtie,
2'^
édit.
,
p. 189).
30
L1-;
Somaize
suivie
MOLIERISTE
du Dialogue de deux
Amours d'Alcippe
précieuses sur les affaires
de
et
très rares
pour
la
ou
les
Doneau,
François
par
Céphise,
c'est-à-dire des sources, parodies, suites
ments
ou
enfin de la Cocue Imaginaire
de leur communauté,
dérivés,
docu-
plupart et devenus indispensables
des œuvres et à leur histoire.
à la complète intelligence
La distribution originale des Précieuses donnée par
M. Moland n'est pas absolument exacte. Le rôle de
Madelon fut créé par Madeleine Béjart; celui de Cathos,
par
Catherine de Brie,
de Marotte, par [Marie
celui
et
Ragueneau, qui devint plus tard M"^ La Grange.
Le
côté faible
de ces volumes
est
l'illustration.
Les
éditeurs ont utilisé les anciennes compositions de Staal,
gravées sur acier. Leur belle publication des Chefs-d'œuvre
de la
réclamait une inter-
littérature française méritait et
en un
prétation à la fois plus artistique et plus exacte,
mot
plus conforme au goût du jour.
— Viennent de
paraître, à la librairie P.
tMémoircs de Samson
de la
dessiné par G. Jacquet,
trait
— Pour
frères, les
OUendorff,
fort vol.
i
in-i8,
Gombaut
de
et
fr.
3
50.
Charavay
paraître prochainement, à la librairie
Amours
les
Comédie française, avec un por-
de Macée, étude
sur
une
ancienne tapisserie française du musée de Saint-Lô, avec
4 héliogravures
et
10 fac-similé d'estampes anciennes, par
Jules Guiffrey, avec
« plus,
et
cette
une tenture de
épigraphe tirée
tapisserie des
de Y Avare
Amours
de
:
Gombaut
de Macée. »
—
Nous recommandons
lecteurs
la livraison
de
la
tout
particulièrement à nos
Revue des Deux
paraîtra le 15 avril. Elle contiendra
des
Femmes,
G. Coquelin.
intitulée
Mondes,
une étude sur
qui
l'Ecole
VArnolphe de Molière et signée
DU MONCEAU.
:
BULLETIN THÉÂTRAL
— Mardi 28
Comédie française.
(MM.
Les Précieuses Ridicules
cadet, Villain,
(MM.
—
Dimanche
:
M™"
J.
5,
le
Martel, Joliet, Villain, Truffier, Baillet,
Davrigny, Leloir, M"^ FayoUe).
l'Avare
mars
matinée:
Davrigny, P. Reney, Tronchet;
Samary, Bianca, Martin).
Mariage forcé
février et jeudi 2
Coquelin, Barré, Coquelin
(MM. Coquelin
— Dimanche
12, matinée
Boucher, Martel,
cadet,
:
Joliet,
M""
(MM.
Richard, Truffier, Le Bargy, Leloir, Tronchet;
Rei-
chemberg, B. Barretta, Bianca),
Thi-
ron, Mounet-Suliy,
M™"
de Féraudy;
Mardi 14,
le
D.
et
Joliet,
Félix,
Richard, Davrigny,
Samary,
J.
Dudlay).
—
Mariage forcé (Coquelin aîné joue Pancrace).
— Dimanche
Pancrace);
La Roche,
Amphitryon
le
19,
matinée
soir,
les
:
le
Mariage forcé QoXïqx. reprend
Fourberies
Scapin
de
(Coquelin
cadet).
— Mardi 28
amoureux. — Dimanche
5,
27' soirée
:
V Ecole des Maris.
—
28* soirée populaire
:
Tartuffe (Sicard).
—
29^ soirée populaire
:
Odéon.
avec
la
populaire
V
matinée
acte
Course des Apothicaires.
populaire
:
mars,
février et jeudi 2
l'Avare (Clerh,
M'»'^
:
de
—
le
Dépit.
M.
le
Dépit
— Lundi
Lundi
6,
13,
Lundi 20,
de Pourceaugnac,
Lundi 27, 30^
Raucourt).
soirée
LE MOLIÈRISTE
32
—
DE France.
CoLLi-:GE
Cours de M. E.
Mercredi i" mars, Don Juan
depuis
mystères;
les
Misanthrope
nages.
:
Coquelin aîné;
Rousseau;
suite
22_,
Timon de
le
du
acte
—
scène.
la
:
—
Mer-
Mercredi 15,
du Misanthrope: Plutarque,
une conférence
de Fabre
Philinte
le
l'hérésie de
ex-sociétaire de la
3''
sur
Shakspeare;
M. Schére^
Salle des Capucines.
le
Deschanel
fantastique au théâtre
modèles originaux des principaux person-
— Mercredi
Lucien,
statues
les
le
pour cause d'indisposition.
credi 8, relâche
le
:
—
Comédie
d'Eglantine;
de
J.-J.
(i).
Conférences de M. Talbot,
française
:
du Misanthrope; Mercredi 22,
Mercredi 8 mars,
les
4''
et
actes
5''
^Misanthrope.
Association PHiLOTECHNiauE (section du Lycée Fontanes),
— Lundi 20 mars,
à 8 heures
du
soir:
Don Juan^
dans Molière
et
M. Talbot,
professeur de rhétorique au Lycée Fontanes.
dans ïKozart,
« causerie
de 40 minutes
»,
par
MONDORGE.
(:)
Notre prochaine livraison sera presque entièrement consacrée à
article de M. Ed. Schérer, qu'a publié le
répondre à l'inqualifiable
Temps du 19 mars.
Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
— NoëlTexier.
QUATRIÈME ANNÉE
NUMÉRO 38
MAI 1882
LE
MOLIÉRISTE
%EVUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
MM
:
Campardon,
J. Claretie, F. Coppée, V. Fournel,
J. Guillemot,
A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye,
Ch. Livet,
L. Moland, Ch. Monselet, E. Noël,
J. Loiseleur,
Ch.
Nuitter,
E.
Picot,
L.
de la
Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la
Rounat, F. Sarcey,
Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry, E.
Thoinak, A. Vitu, etc.
PAR
Georges
MONVAL
ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10, GALERIE
DU THEATRE FRANÇAIS, 10
1882
SOMMAIRE DU NUMÉRO XXXVIII
QUATRIÈME ANNÉE
L'HÉRÉSIE DE M. SCHERER.
— La Rédaction.
AIMER MOLIÈRE. — Sainte-Beuve.
LE STYLE DE MOLIÈRE. — L
A GEORGES MONVAL. — Emile Moreau.
UN RÉFORMATEUR
LITTÉRAIRE.
PETIT QUESTIONNAIRE.
Du Monceau.
BIBLIOGRAPHIE.
Réponse.
— Th. Cart.
— E. Picot.
—
BULLETIN THÉÂTRAL.
LE PRIX D
— Mondorge.
ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
:
2, place
UN FRANC
I 3
FRANCS.
50 CENT.
à la librairie Tressk, io, Galerie
français, ou par mandat sur
tions,
— ÉTRANGER,
la
de Vintimille, auquel
demandes
lettre affranchie.
et
du Théâtre
M. G. Monval,
manuscrits, communica-
poste adressé à
les
réclamations devront être envoyés par
L'HÉRÉSIE DE M. SCHERER
Il
((
n'y a pas
que Molière
qu'on
les
du
a,
moyen de
Qst aussi
se
dérober à
reste, les qualités
thrope.
y
titre est
l'être-
lors-
tout. «
a des vices profonds dans la conception
Le
conviction
de fond qui dominent tout,
dons d'inspiration qui emportent
« Il
la
mauvais écrivain qu'on peut
du Misan-
faux; le caractère d'Alceste, exagéré et
inconséquent, burlesque et rebutant, ambigu, insaisissable,
inintelligible.
Cet individu
est
un fou pour lequel
il
impossible d'éprouver d'autre sentiment que celui de
pitié;
un maniaque
La conception de
à enfermer dans
l'artiste
lui
une maison de santé.
n'est pas vraisemblable.
Molière est un poète extrêmement négligé;
continuellement, horriblement;
dires inutiles,
la
a gauchi entre les mains.
L'amour d'Alceste pour Célimène
»
est
il
il
cheville
n'a pas seulement des
mais des répétitions fatigantes; ses phrases
ne constituent pas seulement des
redites,
suivent par voie de juxtaposition,
sans se
mais
elles
se
lier,
sans
se
combiner organiquement, ce qui donne au discours une
LE MOLlèRISTE
36
allure traînante; la lecture à haute voix des vers
grand comique
»
Molière, pour faire
synonymes
de notre
est tout à fait laborieuse et ingrate.
donne constamment des
vers^
le
oiseux de l'expression qu'il vient d'employer...
Ses équivalents et ses paraphrases alanguissent et alourdissent
Ce qu'on
style...
le
pourrait appeler le
tic
de
Molière est plutôt encore la négligence d'un écrivain trop
pressé de produire. Mais
seulement un
fecte pas
entiers, et
combien de
pesanteur qui en résulte n'af-
la
un
trait,
vers, elle gâte des passages
fois la prolixité
du
style, s'alliant à
du langage, ne produit -elle pas l'amphigouri!...
l'afféterie
Fénelon parle quelque part du galimatias de Molière (i).
Le mot
est
dur
l'est-il
:
Célimène reproche
»
les pièces
de Molière;
le
moments où
langage de Bélise
Et
les pires défauts
Sont ou
»
c'est
le
Les défauts reparaissent avec
pas vrai qu'il y a des
dans
l'une des
mieux
écrites
contraire qui est vrai.
premiers actes du Tartuffe sont beaucoup moins
trois
négligés.
du passage où
à Alceste ses soupçons?...
Le Misanthrope passe pour
parmi
Les
trop, en regard
le
le
quatrième. N'est-i]
l'on est prêt à s'écrier
:
de ce puissant génie
pléonasme ou
la
cacophonie.
Molière, en signalant ces deux vices du style, aurait-il
eu quelque soupçon que c'étaient précisément ceux auxquels sa manière de travailler l'exposait le plus?
(i)
La
citation
Lettre à l'Académie
simplicité ce
n'est pas exacte.
:
«
Térence
que Molière ne
qui approchent du galimatias.
dit
dit
»
Fénelon se borne à
en quatre mots avec
))
dire,
dans sa
la plus élégante
qu'avec une multitude de métaphores
LE MOLliRISTE
La pensée, chez
«
ne
lui,
37
développe pas en une
se
complexité organique, dans laquelle chaque idée et chaque
membre
d'idée s'ordonne
ou
se
subordonne; Molière ne
construit pas de période, parce qu'il ne conçoit pas les
parties de
ment
la
naturel.
4éveloppe
le
phrase ou du morceau dans leur enchaîne-
procède par réitération de l'expression;
Il
sens au
moyen
il
de synonymies, de tautologies
de paraphrases.
et
» J'ai dit
est
que
le style
inorganique, partant
pouvoir en accuser
monotone
la nécessité
permettait pas de
lui
de Molière, lorsqu'il écrit en vers,
et traînant,
et j'ai cru
de l'improvisation qui ne
concevoir avec plus de maturité ni
de rédiger avec plus de soin. Obligé d'écrire en alexandrins et en rimes plates, le poète ne parvient à satisfaire
les lois
de cette versification qu'à force d'explétifs, de sy-
nonymes
»
et
de pléonasmes.
Un parallèle
entre
MoHère
et
Racine, considérés
comme
écrivains, prendrait aisément quelque chose de cruel
pour
premier. Les procédés de l'un sont aussi variés que ceux
le
de l'autre sont monotones. Les mailles du discours sont
aussi serrées chez l'auteur de Phèdre qu'elles sont lâches
chez l'auteur du D^isanthrope.
»
*
*
Vous croyez, en
lisant cela, à
petit journal tintamarresque,
nir
»,
*
quelque
«
où quelque
fumisterie » d'un
«
poète de l'ave-
en quête de réclame, aura voulu s'égayer à vos
dépens? Point. Ces étranges révélations sont signées d'un
critique éminent,
M. Edmond Scherer,
et
occupent
trois
38
MOLlfeRlSTE
l'F.
colonnes du grave Temps {i), lequel compte parmi ses rédacteurs de
nombreux
MM.
moliéristes,
Legouvé, Sarcey,
Mézières, P. Régnier, Loiseleur, Claretie, Aderer, Ephraïm,
etc.
En
vérité^
c'est à
se
demander
si
vent de
le
folie qui
n'ébranle pas les têtes les
souffle par intervalles
mieux
équilibrées, et ne brouille pas les plus solides jugements!
Que répondre
à de semblables critiques?
Ouvrir son Molière au hasard
,
et relire à
haute voix
bien convaincre que
première scène venue, pour se
la
le
soleil éclaire toujours.
MM.
Henry Fouquier dans
Valery-Vernier
et
Janus dans
le
le
Le
Moliériste
qu'il reçoive
va
A.
Racot,
M.
Scherer.
ne pouvait donc garder
le
silence. Bien
avec beaucoup de philosophie cette excom-
munication majeure,
et l'on
Siècle^
Figaro, Ch. Bigot dans le
ont cru devoir répondre à
Siècle,
XIX^
lire la
il
a
fait
appel à ses collaborateurs,
réponse de plusieurs d'entre eux. Ce qui
chagrine surtout M.
Scherer,
c'est
le
culte,
l'adoration
superstitieuse dont Molière serait Tobjet de notre part,
qu'il
assimile
—
ou peu
des fakirs du jansénisme.
s'en faut
—
et
aux extravagances
Nous ne pouvons mieux
faire,
au début d'un plaidoyer pro domo nostrâ, que d'emprunter
à
un
(i)
illustre fervent
N" du 19 mars
de Molière, à Sainte-Beuve,
1882.
la
page
LE MOLIERISTE
39
toute vibrante d'enthousiasme que notre « saint patron »
lui inspira (i).
Nous nous
loppements
interdisons
ici,
de
littéraires, préférant
les petits faits
parti pris, les purs
déve-
aux généralités brillantes
patiemment découverts
et
scrupuleusement
contrôlés, ce qui n'est pas le propre des fanatiques; mais,
en présence d'une attaque aussi sérieuse, nous croyons
pouvoir emprunter au plus autorisé, au moins déclamateur
des critiques de notre siècle, une page écrite de génie,
que nous pourrions appeler notre Credo,
d'autre religion qu'une « violente
nous paraît
être
la
amour
»
si
nous avions
pour celui qui
plus complète incarnation du génie
français.
LA RÉDACTION.
(i)
Sainte-Beuve appelait: un
couplet,
cet
acte
d'amour où vibrent
l'enthousiasme et l'admiration sincère, sentiments rares chez Sainte-
Beuve, qui jugeait avec un sens parfait de toutes choses, mais qui admirait
peu, parce qu'il comprenait trop.
m^sm'^m^!m'mm!&AIMER MOLIÈRE!
Aimer Molière,
son cœur,
j'entends l'aimer sincèrement et de tout
une garantie en
c'est avoir
soi contre bien des
défauts, bien des travers et des vices d'esprit. C'est
aimer d'abord tout ce qui
est
ne pas
incompatible avec Molière,,
tout ce qui lui était contraire en son temps, ce qui lui
eût été insupportable du nôtre.
Aimer Molière,
pas de
la
à
jamais, je ne parle
basse et infâme hypocrisie, mais du fanatisme,
de l'intolérance
fait
être guéri
c'est
de
et
dureté en ce genre, de ce qui
la
anathématiser et maudire; c'est apporter un correctif
à l'admiration
même
pour Bossuet
et
pour tous ceux qui,
à son image, triomphent, ne fût-ce qu'en paroles, de leur
ennemi mort ou mourant; qui usurpent
je
ne
langage sacré et se supposent involontairement,
en main, au Heu
et sublimes,
vous
Aimer Molière,
et place
l'êtes
le
sais
quel
tonnerre
du Très-Haut. Gens éloquents
beaucoup trop pour moi
c'est être
également à
!
l'abri et à mille
lieues de cet autre fanatisme politique, froid, sec et cruel,
qui ne
rit
pas, qui sent
de puritanisme, trouve
tous les
les
fiels,
rancunes
et d'unir
et les
son sectaire, qui, sous prétexte
moyen
de pétrir et de combiner
dans une doctrine amère
jacobinismes de tous
ne pas être moins éloigné, d'autre
les
les haines,
temps. C'est
part, de ces
âmes fades
LE MCM-IÈRISTE
et molles qui,
4Ï
en présence du mal, ne savent ni
s'indi-
gner, ni haïr.
Aimer Molière,
de ne pas
c'est être assuré
dans l'admiration béate
qui s'idolâtre et qui oublie de quelle étoffe
et qu'elle n'est toujours,
et chétive nature. C'est
cette
quoi qu'elle
ne pas
on
se replonge
chaque
fasse,
donner
Humanité
elle est faite
que l'humaine
mépriser trop pourtant,
la
commune humanité dont on
laquelle
aller
et sans limite pour une
rit,
fois
dont on
est, et
dans
avec lui par une hila-
rité bienfaisante.
Aimer
et chérir Molière, c'est être antipathique à toute
manière dans
le
langage et dans l'expression; c'est ne pas
s'amuser et s'attarder aux grâces mignardes, aux finesses
cherchées, aux coups de pinceau léchés, au marivaudage
en aucun
au
genre,,
Aimer Molière,
style miroitant et artificiel.
c'est n'être disposé
à aimer ni le faux
bel esprit ni la science pédante; c'est savoir reconnaître
à première
vue nos Trissotins
et
nos Vadius jusque sous
leurs airs galants et rajeunis; c'est ne pas se laisser prendre
aujourd'hui plus qu'autrefois à l'éternelle Philaminte, cette
précieuse de
change
aimer
la
et
tous les
dont
santé et
comme pour
le
soi.
dont
temps,
plumage
le
la
forme seulement
se renouvelle sans cesse; c'est
droit sens de Tesprit chez les autres
— Je ne
que donner
fais
la
note et
le
motif; on peut continuer et varier sur ce ton.
Nous pourrions nous
établit, entre
Molière et
arrêter
les plus
ici,
car ce qui suit dans Sainte-Beuve
grands
parallèle tout à l'avantage de Molière
esprit d'exclusion, estimant que,
depuis
le
vieil
Homère
;
noms de
or,
notre littérature^ un
nous admirons Molière sans
dans l'universelle famille des poètes,
jusqu'à Victor
Hugo, notre contemporain, on
peut trouver matière à plusieurs admirations et
les
concilier
toutes.
LE MOLIÈRISTE
42
nommé
Mais M. Scherer a
Racine, en déclarant qu'il préférait
fection de l'auteur d'Àthalie au génie trop inégal de l'auteur
thrope.
Donc, empruntons encore quelques
concluons avec
«
lui
per-
Sainte-Beuve, et
lignes à
:
Aimer, au contraire,
et préférer
sans doute aimer avant tout l'élégance,
et la vérité
la
du Misan-
(au moins relativement),
Racine, ah
la
!
c'est
grâce, le naturel
la
sensibilité,
une
passion touchante et charmante; mais n'est-ce pas cepen-
dant aussi, sous ce type unique de perfection,
goût
troduire dans son
et
laisser s'in-
dans son esprit de certaines
beautés convenues et trop adoucies, de certaines mollesses
et
langueurs trop chères, de certaines délicatesses exces-
sives, exclusives?
Enfin, tant aimer Racine,
d'avoir trop de ce qu'on appelle en France
rend
si
le
c'est risquer
goût, et qui
dégoûtés, (i)
SAINTE-BEUVE.
(i) 'hiouveaux Lundis,
tome V,
p.
277-279,
LA VERSIFICATION
ET LE STYLE DE MOLIÈRE.
Je voudrais, dans les lignes qui suivent, discuter briè-
vement
l'appréciation de
de Molière.
et le style
M. Scherer
Il
me
sur la
semble, en
versification
qu'entre
effet,
toutes les idées émises dans le factiim intitulé par l'auteur
lui-même
a
une hérésie
que Molière
mal
faisait
la
les vers et
que
tique était « inorganique. »
ment^
et
plus saillante, c'est
littéraire, »
sa
Ce reproche
dépasse de beaucoup
l'appréciation
Fénelon. Les autres n'ont pas
été réfutés cent fois, ce qui
langue poéti-
est
le
même
neuf assuréfameuse de
mérite
ils
;
de les reprendre pour son compte, et de nous les
avec un sérieux de théologien,
comme un
doctrines aussi original et aussi hardi que
tions de Luther à la diète de
en deux lignes de
la
Worms.
Comédie,
nature humaine,
» la définition
en somme, n'existe point,
(i)
M. Scherer
raillait,
les
offrir,
corps
la vis
et
de
proposi-
Ainsi, l'exécution
« art limité qui laisse
côté les choses les plus profondes
la
ont
n'empêche pas M. Scherer
les plus élevées
d'un
mot
de
de
célèbre, qui,
comica (i), la reprise,
avec beaucoup d'esprit, dans le Temps
du
30 décembre 1881, ces amateurs de citations faciles, qui piquent dans
LE MOLlèRlSTE
44
médiocrement rajeunie, du réquisitoire de Jean-Jacques
contre
Misanthrope,
le
que Molière,
affirmation
cette
auteur, acteur et directeur, composait souvent très vite
et que,
par suite,
il
y a dans
ses pièces, bien
et des faiblesses, etc., toute cette partie
Scherer n*apprend rien à personne, et
commencer une besogne
est
vraiment neuf,
de
«
;
»
;
»
qu'il
y regarder, des bouts de
naire ni très neufs ni très authentiques.
niauvais gré de faire pljserver que ce
« cheville
Il
mais
parasites,
latin qui
ne sont d'ordi-
ne peut donc nous savoir
fameux
vis comica est peut-être,
On
en trouve
épigtamme
latine
les
éléments dans deux vers, que voici, d'une
de César sur Térence
Lenibus atque utinam
Comica
« Plût
au5
4e
moins
toutes les citations d'usage courant la plus conventionnelle et la
exacte.
qui
bien plus, que ses che-
ne sont pas de simples mots
leur prose, sans trop
Ce
Scherer,
mauvais écrivain en
extrêmement négligé
continuellement, horriblement
villes, à lui,
serait re-
comme M.
dire,
M.
de
travail
la réfuter
déjà faite et bien faite.
c'est
qu'en règle générale, Molière est
vers », « poète
du
des taches
scriptis
:
adjuncta foret vis,
ut cequato virtus polleret honore.
dieux,
son talent comique
que dans ses
écrits la force fût
brillerait alprs
d'un éclat égal
unie à
(à celui
la
douceur
;
des maîtres
grecs). »
Voilà
longtemps que
le
savant Meineke,
impatienté de voir
le
de son temps (1841) à tout propos et hors de
propos, prouva que, par la construction et le sens de la phrase, comica^
au lieu de se rapporter à vis, devait se joindre à virtus. Il n'est plus
vis comica déjà cité
aujourd'hui de latiniste qui n'entende ces vers
G.
t.
Guizot,
V,
p. 337.
Ménandre,
Notre savant
était, hii aussi, i^oqs
mune
385,
p.
et regretté
devom
{l'Esprit des autres.,
et
comme
Sainte-Beuve,
Meineke. Voy.
Nouveaux
lundis.^
collaborateur Edouard Fournier,
le recoxiaaître,
tombé dans
chap. VI, sixième édit., 1881,
l'erreur
p.
59).
com-
LE MOLlèRISTE
des vers, des tirades entières
que
traînante,
rend tout à
«
«
l'art
45
d'où une allure lâche et
;
de l'acteur déguise,
mais
«
à haute
laborieuse et ingrate la lecture
fait
qui
voix des vers de notre grand comique. »
Il
M. Scherer
faut rendre cette justice à
contente
assez
d'afilrmer
pas
;
longue dissertation grammaticale
paraît bien concluante
ma
que
«
si^
et
;
dit-il,
celle-ci
démonstra-
les
esprits....»
part, que^, sans parti pris
aucun,
de ce qu'avance M.
étonné que
le
beaucoup de
Scherer,
même phénomène
ses lecteurs.
Il attire
et
effet
Or,
la
la thèse
•
faire le vers,
il
M.
dit
Scherer,
qu'il vient
trouve
en ce que^
d'employer,
»
A
«
preuve,
:
où
est bien des endroits
Deviendrait ridicule
Serait-il
De
se
pour
donne constamment des synonymes oi-
seux de l'expression
Il
il
exemples invoqués ruinent
les
au lieu de l'appuyer.
Molière cheville,
ces vers
chez
une évidence
démonstration terminée,
que rien n'est étabU, car
pas
notre attention
sur des points qu'il prétend établir avec
irrésistible.
serais
soit produit
se
en
ne
je
je taie
du Con-
trouve après cette lecture fortement convaincu
traire
lui
ma
quelque doute dans
tion laissait encore
J'avoue, pour
:
ne se
qu'il
prouver par une
essaie de
il
à propos
et
d
de la bienséance
dire à mille gens tout ce
J'entre en
Qjiand
une humeur
ma
que d'eux on pense
part,
eux
les
dans
par M. Scherer, au Heu de
«
?...
un chagrin profond,
noire, en
je vois vivre entre
Je vois, pour
pleine franchise
la
serait peu permise....
hommes comme ils font.
les fins
de vers soulignées
synonymes
oiseux, »
une
.
LE MOLlfîRISTE
46
gradation ascendante très marquée. Dans les quatre premiers, c'est Philinte qui parle.
du monde, que
la
discrète,
mais peu
capable de provoquer des
protesta-
ridicuky
c'est-à-dire matière à raillerie
permise,
c'est-à-dire
des
tions,
scandales
des
éclats,
non-seulement
;
hors de propos, chose fâcheuse, mais
serait
rait la
bienséance,
homme
estime, ce parfait
Il
pleine franchise serait non-seulement
c'est-à-dire la loi
elle
elle
choque-
suprême de l'homme
bien élevé, plus respectable à ses yeux, plus sacrée que
toutes les considérations morales. Les deux derniers vers
sont du
rôle d'Alceste;
expliquer?
meur,
Le
même
nécessaire
ceux-là, est-il
de
les
dictionnaire seul nous apprend que Vhu-
un sentiment
noire^ est
plus
faible
que
le
chagrin: l'un est douloureux, l'autre n'est que désagréable.
M. Scherer
parle de l'art de
l'acteur, qui
sauverait ces
faiblesses; j'estime au contraire
que des vers
comme
là inspirent et
il
pour
«
portent l'acteur
:
n'a qu'à les
Une
répétition
M.
non moins fréquente chez MoHère,
Scherer,
est
du premier
celle
second reproduit sans y rien ajouter,
le
comprendre
les bien dire.
continue
en
ceux-
délayant et l'affaiblissant.
vers,
que
le
et,
par conséquent,
» Il cite,
comme exemple
de ces tautologies:
Une
telle action
ne saurait s'excuser
homme d'honneur s'en doit scandaliser
Je vous vois accabler un homme de caresses
Et
tout
Et témoigner pour
Mais, encore une
sursauter
le
lecteur;
lui les dernières tendresses...
fois, voilà
il
de ces exemples qui font
s'attend à
sur les neuf qu'on lui offre,
il
une preuve décisive,
et,
n'y en a pas une de pro-
LE MOLIÈRISTE
47
bante, pas une qui supporte l'examen. Peut-on admettre
que
le scandale,
c'est-à-dire l'éclat d'indignation bruyante,
dise
moins que
le
refus d'excuser?
quelqu'un
Qu'on
tendresse?
et aller
relise,
a-t-il
amour comme en
férence fort notable, en
caresser
N'y
pour
lui
dans La Bruyère,
style
le portrait
de
verra
si,
l'on
et
M. Scherer relève chez Molière encore
du
amitié, entre
gradation est mieux observée^
styliste, la
xité, le galimatias
l'afféterie, la proli-
amoureux. Mais
n'est-ce point-là
prendre une peine inutile? Qui songe à défendre
amoureux du grand
flammes, les
torches, les
cœurs de
et
le
jargon
les tourments,
siècle, les chaînes,
Côté périssable
etc., etc.?
dif-
jusqu'aux limites de la
Théognis, l'homme à démonstrations,
chez ce maître
pas une
les
tigre, les entrailles de rocher,
caduc d'une belle langue,
que ce jargon.
Du
reste,
de Molière
se
retrouve à toutes les époques et dang
il
;
il
n'est point particulier
au siècle
toutes les langues; partout et toujours l'amour a parlé
idiome spécial, souvent exagéré ou
cule, passager
comme
portait
comme
comme pour tous
il
rien de
l'homme
les
lui ?
Ne
un
jusqu'au ridi-
toutes les modes. Molière le parlait
habits de son temps,
et,
pour
lui
ses contemporains, cette défroque n'est
lui-m.ème.
Corneille et de Racine, qui
que
raffiné
Que
le
dirions-nous en effet de
parlent
sentez-vous pas trop
comme
plus
lui et
souvent à
la
lecture
de Racine cet affadissement du cœur que l'on éprouve à
un parfum ranci ?
Le reproche le plus sérieux que
respirer
fasse
M
.
Scherer au
style
de Molière, l'argument capital de sa démonstration,
c'est
que ce
dit-il,
style n'est « pas
organique
»
;
les
propositions,
y sont juxtaposées et non pas unies; Mohère
«
ne.
LE KBOLIÉRISTE
48
construit pas de période; » c'est là « une particularité dis-
manière d'écrire
tinctive de sa
pour compléter
la
»
ajoutons, avec Horace,
;
pensée de M. Scherer
:
Ut nec pes nec caput uni
Reddatur formœ.
Eh
(i)
bien! cette absence de période
qualité maîtresse
du
à
est,
de Molière,
style
mon
sens, la
cause de sa sou-
la
plesse et de sa variété, de son incomparable portée scéni-
que.
Ah
la
!
septième
période
siècle,
ce
!
du
ce fléau
neur
et
du
et
monotone du
pontife, cette
gnent La Rochefoucauld
Bruyère
et
roi,
du confident, du raison-
forme creuse
et Pascal, ce
le
Cid,
l'est
il
et vide
Test moins dans les Sermons que dans
sont
le
dans Agésilas,
s'
les
siècle
;
c'est
que notre théâtre classique a
il
Test
endort; Bossuet
Oraisons funèbres ;
Oui, cette pé-
moindres défauts
en dépit
été
d'elle et
grand
et
non par
fécond ;
c'est
qui a glacé celui du dix-huitième siècle et qui rend au-
elle
jourd'hui
les
les
La
vide ou la redondance, a souvent gâté la belle lan-
gue du dix-septième
elle
brise
Corneille n'est
!
Fléchier et Campistron le sont toujours.
dont
que dédai-
moule que
toutes les fois qu'il sommeille ou qu'il
riode flasque et cotonneuse,
ron-ron
ce
tragédie,
la
que Voltaire met en pièces
point périodique dans
dix-
mécanisme grammatical,
déplorable
qui soporifie l'oraison funèbre et
majestueux
français au
style
si
pénibles^
si
languissantes à la représentation
comédies de tous ces estimables Destouches, conscien-
(i)
On
nous permettra de
préciser
:
Art poétique, vers
8.
LE MOLIÈRISTE
cieusement
périodiques et majestueusement
Qu'est-ce en effet que
le
comique^ sinon l'image de
la
la familiarité, le
?
théâtre,
conversation
qui parle ont-elles la logique
voulu du discours
les interjections
tions,
rompent
être lu
et
périodi-
est-il
l'homme
l'enchaînement
régulière,
pour
écrite fait
l'imprévu,
colère de
la plainte, la
théâtre
Le comble de
?
langage parlé. Or, celui-ci
Le raisonnement,
ennuyeux.
surtout le
d'y reproduire la vérité, la souplesse^
l'art est
que
49
Les interrup-
?
coupent
parole; la
la
phrase procède non par enchaînement d'incidentes, mais
par petites propositions
les
unes sur
les autres.
courtes
Cette parole, qui arrive aux lèvres,
ne saurait ressembler au
Comme
le
qui passe par la plume.
style
rien de géométrique; elle est
geste, elle n'a
imprévue, soudaine, coupée;
Non qu'elle manque
enchérissant
vives,
et
elle jaillit
au gré de
de logique ou d'harmonie;
la
passion.
elle a cette
logique secrète et vivante de tout sentiment sincère et
harmonie qui règle
cette
lieu
la
cadence du vers comique, au
de s'y asservir.
Toutefois, qu'on ne se
méprenne point sur notre pen-
sée; nous haïssons, au théâtre, la période, mais
au bon sens du mot,
tirade,
«
le
chose toute différente. La tirade,
dialogue, une poussée plus vive,
Nul besoin de
et la force, ou
jet plus
nerveux de
la
celle-là,
plutôt
les autres
l'on veut,
un moment du
la tirade
l'élan
de tous
un
si
la
se sert de
la
comme
couplet, »
c'est, à
non
période pour donner à
pensée.
la
vif,
celle-ci
mécanismes grammaticaux, dans
juste mesure des besoins de
la
de Molière sont admirables pour
sont dans toutes les mémoires
pensée. Or, les tirades
la plupart,
et
beaucoup
:
4
LE MOLlèRISTE
50
Je VOUS épouse, Agnès, et, cent fois la journée...
livres éternels ne me contentent pas...
Il semble A trois gredins, dans leur petit cerveau...
Vos
Ah
!
pour
Non,
être dévot,
ce n'est pas,
on n'en
est pas
madame, un bâton
moins homme...
qu'il faut prendre...
Et tant d'autres, modèles achevés de
d'ironie, d'éloquence,
style,
organiques » celles-là,
«
corps sain et robuste, où tous les
membres
de pensée,
comme un
s'accordent
dans un ensemble parfait.
Encore une imprudence que de reprocher à Molière
tie
embarrassés.
point
la
tième siècle
de
cessent
avec
Le
que, répété jusqu'à la fatigue,
marque propre du
remarquer.
la période,
n'est-il
périodique au dix-hui-
style
Les grammairiens
?
le
les
et les
Pouvait-il
commentateurs ne
en être autrement
ses incidentes, ses replis, ses détours?
que en est le lien nécessaire; c'est l'anneau
Le
de laiton in-
dispensable à ces pièces ajustées, à ce squelette grinçant,
quel que soit
le
maître qui l'emploie, Racine ou Corneille,
Saint-Simon ou Bossuet.
Mais, tenons-nous en à Racine, ce « modèle de
M.
tion irréprochable, » selon
des poètes, dont
la
perfection
Scherer y compte bien
MoHère, considérés
:
«
Un
comme
il
se
le
phrase de
«
Tout
M.
écraser Molière,
entre
de cruel pour
M.
et
Eh
bien! retournant
Scherer, nous ne craignons pas de dire
vue,
le
Racine
prendrait aisément
parallèle entre Molière et Racine,
point de
la dic-
chœur
premier. » Et ce parallèle
garde bien de s'en priver.
la
le
doit
parallèle
écrivains,
quelque chose de cruel pour
cruel,
Scherer, ce maître du
prend
second.
:
quel que soit
nécessairement quelque chose
»
ractère, (soyons généreux),
Nous ne
qui,
parlons pas du ca-
pourtant, est
la
moitié
5I
LE MOLIÈRISTE
du
nous semble,
talent, ni de la peinture des passions, qui
chez Molière, autrement vraie, naturelle
de celle des mœurs,
fausse
ni
et franche,
dans
par essence
Racine,
chez qui ce n'est souvent qu'une admirable mascarade, où
se
mêlent
style.
casque
le
et le talon
N'y
rouge
a-t-il
chapeau à plumes,
et le
nous prenons seulement
;
dans
pas,
la
la
la
cothurne
langue et
le
langue de Racine, bien du
convenu, un abus fatigant des termes généraux, l'aversion
du mot propre, une
uniforme de noblesse, de
teinte
majesté fausse, du faux goût, de
dans cet
d'artifice
monie
!
art!
Que
que de contours
la fadeur,
de monotonie dans cette har-
effacés à force d'être polis
de mollesse souvent et de remplissage
vous,
fait
souvent
le
la
Que
etc., etc.?
Molière,
!
second vers parce
qu'il
a
que
!
ditesfait
le
premier, méthode, à tout prendre, assez logique ; mais Racine
ne
fait-il
pas,
quement parce
plus souvent encore, le premier vers uniqu'il
chez
a
fait le
que
second
?
N'est-ce
les constructions
pas un
du genre de
véritable
tic
celles-ci,
qui consistent à remplir, à l'aide d'un participe,
lui
un premier vers naturellement vide
:
J'en rends grâces au ciel, qui, m' arrêtant sans cesse,
Semblait m'avoir fermé le chemin de la Grèce...
Et, l'amour seul alors se jaisant obéir,
Vous m'aimeriez, madame, en me voulant
La langue de Mohère! Mais
ait
a
jamais écrite en France,
perfection
de quaUtés
mais
(i)
la
»
haïr?... (i)
c'est la plus originale
non
la
plus « parfaite
qu'on
»^
(la
suppose parfois plus de défauts évités que
saillantes, plus
de correction que de vigueur),
plus expressive et la plus
Andromaque^ acte
I,
scène I; acte
II,
riche, populaire jusque
scène
II.
LE MOLIÈRISTE
52
dans
toujours puisée aux sources vives
noblesse,
la
génie national: c'est
la
langue de chaque âge, de chaque
de chaque condition, de chaque
sexe,
Son
métier.
c'est la facilité
a dit d'une
très
si
c'est la
l'affaiblis-
manière définitive
n'allons pas surtout refaire contre Racine,
mirons
même,
Mais n'allons pas redire, en
que Sainte-Beuve
sant, ce
;
de chaque
art,
de toute manière,
style, c'est le contraire
distinguée qu'on la suppose
verve en action
du
;
que nous ad-
sincèrement, en dépit des adorations excessives
ou imprudentes, un autre factum,
fameux de
cet article
M. G. de Cassagnac, où il y avait en somme quelques vérités.
Résumons-nous. M. Scherer a soutenu par de pauvres
arguments une mauvaise cause. Entre
qu'il fait à
se
MoHère,
soutiennent pas
les uns,
;
les
un
homme
Cet
usé.
fort
l'auteur;
on
Nous
article
restera,
de
et
un paradoxe déjà vieux
malheureusement pour
rappellera dans l'occasion^
le
regrettons
d'un rare talent, d'un esprit vigoureux
sain, reprendre, sans le rajeunir,
et
reproches
examinés d'un peu près,
autres,
tournent au détriment de sa thèse.
voir
les divers
dénués de toute preuve, ne
comme exemple
d'erreur mémorable, à côté d'un passage analogue de la
de Jean-Jacques à d'Alem-
Lettre à V^Académie^ de la lettre
bert,
de
Quel
la diatribe
air est
donc
de Schlegel.
celui de
Genève pour que ceux qui
respiré s'en ressentent toujours
le
théâtre fut
croirait
un
le
a-t-il,
dans la
l'ont
ville
jugement en matière dramatique?
en voyant un écrivain
critique de grande race, se
par exception,
Y
où
longtemps maudit, quelque influence ca-
si
pable de fausser
?
il
si
On
le
français à tant d'égards,
tromper à ce point, lorsque,
en vient à parler théâtre!
l
A GEORGES MONVAL
Vous
Mon
qui devez aimer à rire,
cher ami, très fervent,
très
Aimant la vivante satire.
Honorant le rire vivant
;
Gardien du marbre de Molière
Où
A
La
use ses dents,
la bêtise
qui doit être familière
liste
de tous
les pédants,
Dites-moi, Monval, dans quel antre,
Dans quel refuge souterrain,
Quel Vadius au large ventre
Gonflé de bière d'Outre-Rhin,
(Quittant sa pipe en porcelaine,
Prit,
au
nom
La plume,
et
des sots mécontents,
tout d'une haleine,
fit,
Quatre colonnes dans
Pour prouver que
Ne
sait
Et que
le
ledit
Temps,
poète
pas écrire en Français,
la Gloire est
Et que deux
une
bête,
de succès
siècles
N'empêchent pas qu'on ne
se blase?
— L'art d'écrire tient en trois points.
mot, puis
Prétend-il
:
Faite d'un
mot ou deux, au moins,
le
Après quoi vient
le
la phrase,
paragraphe
Molière ignorait tout cela.
Molière bredouille
Au
:
il
hasard son alinéa
Il fait
agrafe
;
sa phrase inorganique
;
:
LE MOLIÈRISTE
54
Des mots,
Il
gnore
choisis sans art ni goût,
la
mécanique;
Son discours ne
debout;
tient pas
Sa rime, complaisante
fille,
Accepte tout accouplement;
Son
vers boîte bas
cheville,
il
;
Cheville épouvantablement.
Bref,
De
si
somme
l'on veut faire la
tous ses défauts sur ses doigts.
On
voit
que
le trait
Revient dans Tartuffe
Que
Ou
ses héros,
dans
Le pauvre homme!
«
:
six fois
;
la colère
l'amour, vont se répétant;
Qu'un
Vingt
mot
vieillard dit le
fois
:
galère,
de suite en un instant;
Qu'au second acte de l'Avare
Harpagon rabâche « Sans dotl
:
A dix reprises, le barbare!
Comme s'il n'était d'autre
Qju'jl
méconnaît
la
»
mot...
synecdoche,
Brave l'aUitération,
Met
les
chevaux après
Qu'il ose,
le
coche,
— abomination —
!
un emploi risqué du trope,
Abuser des termes égaux
Qu'Arnolphe et que le Misanthrope
Faire
:
Ne parlent rien qu'en madrigaux;
Que de sa verve mal hardie
C'est sans raison que l'on a ri;
Que
Qu'on
De
et pleine
tire
d'amphigouri;
un exemple
funeste
ce style par trop lâché
Qu'Amphitryon
On
comédie
finie est sa
Creuse
va...
doit faire très
;
que du reste
bon marché;
Qu'ils sont, eux seuls, des gens artistes;
Que
Molière,
Irait
trouver les Moliéristes,
s'il
revenait.
Et leur déclarerait tout net
»
LE MOLIÈRISTE
55
Qu'il s'en rend bien compte à cette heure
Qui trop embrasse mal étreint;
forme
Car elle
Si sa
n'est pas meilleure,
—
est
mauvaise,
La faute en est
Trop de soucis,
J'ai trop
mis
le craint,
il
;
—
à trop de hâte,
trop d'embarras;
les
mains à
la pâte
Nous sommes comme moi
:
des tas
Qui, pouvant mieux, avons
fait pire:
Moïse, Dante, Rabelais,
Cervantes,
Ouvrage
Homère
hâtif,
Shakspeare
et
:
donc mauvais.
Brûlez ces imparfaits volumes;
A
l'école les chevilleurs
Aux
!
jeunes qui s'arment de plumes
Montrez-leur
Dramaturges,
le
modèle
hommes
Dites-leur bien,
—
ailleurs
de
:
lettres,
c'est là le hic
1
—
Qu'il faut étudier les mètres
Sans aucun souci du public;
Que, dans l'âge d'or où nous sommes,
La vie étant un tourbillon,
Vouloir étudier
les
hommes
un mauvais sillon;
Qu'on connaît tout quand on s'enferme,
Et que soi-même on se connaît.
Et qu'on écrit beaucoup et ferme,
C'est creuser
Tranquille dans son cabinet;
Que
étude
le vrai but, la vraie
Est de commencer, dès vingt ans,
A
pondre avec exactitude
Qjaatre colonnes dans
le
Temps.
EMaE MOREAU.
^f>
UN RÉFORMATEUR LITTÉRAIRE
Moliéristcs, tremblez
saxon,
de
la
main sur
Drapé dans
!
En
robe du moine
la
conscience et prenant Dieu a témoin
un
vérité de ses paroles,
la
déclarés idolâtres.
si
la
criminels en fouillant
puissant critique nous a
nous ne nous croyions pas
vérité,
la vie, le
cœur
œuvres de
et les
Molière, en cherchant à comprendre et à analyser
le
veloppement de cet éclatant génie. Nous pensions
même
*aire
œuvre
forçant de
en nous
patriotique et digne de louanges
connaître
et
grandes gloires de notre
de
faire
dans Molière^
littérature. Si tout,
—
nous som-
également digne d'admiration
mes
de ses disciples pour ne pas savoir que
trop
monde,
et
»
—
moins, nous paraissait digne d'intérêt. Jamais un
semblait-il, n'est ridicule, encore
diant les
moindres
et gestes
faits
un des pères de
n'est-il
pas
Hélas
nous avions tort;
!
non pas en combattant
l'idole.
—
et
les
ef-
connaître une des plus
n'est pas
n'estimer rien qu'estimer tout le
dé-
«
c'est
tout,
fils,
du
nous
moins criminel, en étud'un père
l'intelligence
:
et
Molière
moderne
M. Scherer nous
le
?
—
prouve,
mais en renversant
idolâtres,
Pauvres innocents que nous étions de nous
imaginer qu'une œuvre n'est durable qu'à
d'être bien écrite et fortement pensée
!
la
condition
Rien de plus faux
Le Misanthrope, un chef-d'œuvre (M. Scherer veut bien
:
le
reconnaître), est une pièce mal conçue et écrite dans une
57
LE MOLIÈRISTE
!
— Donc, conception
Que
peut-il rester, sinon
langue, dans quelle langue, bon Dieu
également déplorables.
et style,
des beautés secondaires
Oh
ça
!
?
Monsieur Scherer, vous qui savez
Molière est avant tout
homme
posé plus souvent sur
les
de
travail,
bien que
si
com-
et qu'il a
planches que dans son cabinet
comment ne vous
ètes-vous pas dit qu'il
fallait,
avoir assez de force d'imagination pour
pour
le
sortir
de son cabinet
juger,
de théâtre,
et
représenter
se
ses
œuvres
Et
?
pourquoi, vous qui savez sans doute aussi que Molière a
vécu au XVn''
siècle,
appliquez-vous à sa langue les règles
d'une rhétorique qui n'est pas celle du XVII*
même
celle
du XIX^?
vous n'auriez pas
riez
siècle,
pas
vous aviez songé à ces choses,
Si
écrit votre article,
mieux compris Molière,
à
peut-être; vous au-
coup sûr
!
Mais non, cet eâort-là, M. Scherer ne
l'a
point tenu
pour nécessaire; juché au haut de son piédestal moderne,
d'un ton de réformateur
inspiré
que la raison finisse par avoir raison,
se
faire reconnaître! Cette raison,
MoHère
est
un méchant
il
et
a dit: Il
faudra
cette évidence, c'est
écrivain. Et
Examinons-les donc, ces preuves,
M. Scherer
et,
le
siècle et
que
— Et
toi^
que
prouve.
puisque notre héré-
tique le veut ainsi, restons autant que possible au
chez nous.
bien
que l'évidence finisse par
pauvre Mohère
!
XIX^
écoute ce
dit le maître.
Tout
d'abord, le
titre
de Misanthrope est faux;
c'est
le
bourru qu'il aurait fallu appeler la pièce, ou bien l'atrabilaire
amoureux.
Pourquoi? Parce qu'Alceste^ qui veut
dans un désert l'approche des humains,
misanthrope;
le
»
«
n'est pas
fuir
un
misanthrope étant, nous apprend M. Sche-
LE MOLIÈRISTE
58
rer, celui qui fuit ses semblables
En
outre,
pas
un
nccessairemciil
par une aversion générale
moralité
d'une
être
il
drait-il
nous persuader qu'un bourru
l'être, je
Molière, avant de changer
Après
tout, le titre
—
faite;
le titre
de
importe peu;
c'est la pièce qui
est
jusqu'aujourd'hui, nous avions cru inno-
la
était
un poëme
dra-
comédie peignait des caractères humains,
donc inconséquents,
thrope, et que
Attends encore, ô
ta pièce.
cemment qu'un poëme dramatique
matique, que
plus nécessaire-
est
—
ment moral qu'un misanthrope?
mal
Du
supérieure.
pense, et notre réformateur vou-
moins,
peut
!
parce qu'ww misanthrope nest
est faux,
le titre
une femme qui ne
le
de parfait misan-
qu'il n'y avait pas
MoUère ne
savait
que trop qu'on peut aimer
La comédie
mérite pas. Erreur!
de-
viendra traité de philosophie; ses caractères seront absAinsi le
traits!
M.
veut
Ah! que
Scherer.
n'es-tu
MoHère, pour recommencer sous sa conduite
mains
!
Scherer,
écrivains du
devrait au
mal que
n'ya
à
notre tour
sensible
si
XVIP
:
les
siennes
!
Et
s'expliquer
m'en
beauté du
des
à cet égard,
ne soignait
s'il
!
Car
il
autrement (outre
du misanthrope après
remarqué dans
la
les
M.
i" acte du Misanthrope manque
le
Comment
sa candide définition
Pour
de
!
conduites
que nous
métaphores, mais ce sont ses livres
« Je voudrais,
là,
ferais
gauchi entre
bon Dieu
aux métaphores mal
siècle, plus libres
pas de doute,
«
l'artiste lui a
quelle langue,
moins soigner
ses
son édition.
n'ait pas
de
« la conception
:
A
»
Tu
et le puissant critique fie^dirait plus
mieux, sans doute,
ton œuvre
!
la
le
poète), qu'il
scène P' ces mots d'Alceste
coûtât-il grand'chose,
fait
avoir perdu
ma
cause
!
»
:
LE MOLIERISTE
Au
misanthrope exprimer
le
compris
qu'il
du
son indignation eût été moins vive en en-
5® acte,
tendant
caractère.
avait là
y
—
et
désir. Il aurait
non changement
endurcis, ouvrez les yeux,
que
la raison finisse
Mais ce qui agace surtout M.
A
qu'un point,
c'est qu'il parle à
ce qui peut être juste
grammaire, ne
l'est
Scherer dans
ce propos,
dre à Molière ce que c'est que
il
l'art
la tragédie n'est
d'écrire.
n'oubUe
et
la
la
comédie
le style
de
comédie,
et
ne saurait
lui
:
cheville et la répéti-
la
que quand
deviennent cho-
elles
quantes pour l'auditeur, parce que, dans
et chevillons sans cesse.
conversation,
la
Les pensées n'ont
assez de cohésion pour pouvoir se passer de chevilles
dans
les écrits
que
point nécessairement d'une comédie.
tion ne sont des défauts
nous répétons
Il
un poète comique,
d'un ouvrage de philosophie ou de
pas celui de
comparé. Dans
Misan-
le
bon d'appren-
juge
L'art d'écrire n'est pas un, mais multiple
être
par avoir
!
thrope, c'est le style.
—
même
le
développement
O moliéristes
et sachez qu'il faudra bien
raison
59
mûrement
pesés
aussi
;
lecture
la
en
que
est
fatigante; cette absence de toute répétition, de tout point
de repos serait insupportable dans une
M. Scherer ne nous oppose
pas
pas d'ailleurs une comédie dans
S'il
cherche bien,
il
ici
le
comédie. Et que
V Amphitryon, qui n'est
sens ordinaire du mot.
y trouvera aussi ces répétitions qui
l'of-
fusquent (i), mais qui, en réalité, reposant et balançant
(i)
J'ouvre au hasard, acte
raison, etc. »
III,
scène V. Jupiter
:
«
Oui, vous avez
LE MOLliRISTE
$P
agréablement notre
sont des qualités du poète co-
esprit,
mique. Quant à une comparaison entre une tragédie de
Racine
et
une comédie de Molière,
qu'une chose
:
c'est
que
le style
de
elle
ne prouverait
tragédie n'est pas
la
celui de la comédie, (i)
M.
Scherer,
Molière
«
comme
tapageur
en formulant contre ceux qui parlent de
il
l'a fait,
», aurait-il
les
«
pédant
il
s'exposait le plus
faut-là,
M. Scherer
de
Peut-être.
?
mérite cependant un reproche encore plus grave
d'avoir lu Molière avec
» et
eu quelque soupçon que c'étaient
précisément ceux auxquels
Il
reproches de
une extrême
se corrigera sans peine,
connaître. Aussi bien, ce
n''est
point
De
légèreté.
il
:
celui
ce dé-
faut le
re-
en général par trop
de légèreté qu'il pèche. Mais qu'il y prenne -garde, un
réformateur ne peut triompher qu'à force de solides argu-
ments; ce
n'est pas par des accusations
jamais beaucoup d'hérétiques.
y songe aussi
:
Que
en
l'air qu'il fera
notre puissant critique
l'enthousiasme convaincu est une arme qui
gagne plus de prosélytes que
le froid
scepticisme
Th.
>i)
Comparez
Iphi^ètiie et les Plaideurs,
vous en aurez
!
CART.
la
preuve.
PETIT QUESTIONNAIRE
RÉPONSE.
28. Wasili
Teploff (IV, 26). En attendant que M. Cla-
retie puisse recevoir
sur
tanciés
Vasili
bibliographiques
pour
de Russie des renseignements circons-
Teplov,
sur
ce
les auteurs français
quelques
voici
qui
littérateur,
indications
paraît
avoir eu
une prédilection marquée.
Le catalogue Smirdin (1828) mentionne quatre
cations faites par Teplov, savoir
1° Histoire
de Cyrus
le
jeune
publi-
:
et
de
la retraite
des Dix
Mille [par Pagi]; traduite du français, Saint-T^étersbourg,
typographie de l'Académie des Sciences,
2°
Le Roman comique de Scarron,
Le
du
traduit
français.
de l'Acad. des
Se, 1763, 2
bibliophile russe dit à tort,
croyons-nous
Saint-Pétersbourg,
in-8°.
1762, in-S".
typ.
part.
:
tra-
duit de l'allemand.
3°
Grammaire
Restant;
traduite
française tirée de divers
du
français,
4*
édit.
auteurs,
par
Saint-Tétersbourg,
1787, in-8°.
J'ignore sous quelles dates parurent les trois premières
éditions.
4° Aventures de Gil Blas ds Santillane, par
traduites
du
typographie de
français.
Le
Sage,
Dernière édition. Saint-Pétersbourg,
l'Acad. des
Se, 1812-1815, 4
E.
part, in-12.
PICOT.
BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESaUE
Molière, poème-étude.
Dujon, qui a obtenu
a été
le
—
Cette poésie, de
M. Emile
i" prix au concours de Bordeaux,
imprimée à Cannes, chez L. Vincent, à 60 exem-
plaires
seulement.
regrettons
que
la
donc quasi
Elle est
inédite,
nous
et
longueur du morceau (212 vers) ne
nous permette pas de
lui
donner place dans notre
petite
revue.
Molière et Holberg.
—
Sous ce titre, M. le D' C.
Humbert (de Bielefeld) a repris l'excellente thèse de
M. Legrelle Holberg considéré comme imitateur de Molière,
:
publiée par la maison Hachette.
Epitre a Molière.
—
L'Académie des Jeux floraux
a
terminé l'examen de éoo ouvrages en vers ou prose présentés au concours de 1882. Parmi les treize prix adjugés
par
le
bureau général, une Epitre à Molière a obtenu un
œillet.
— Heureux début de M.
L'Arnolphe de Molière.
quelin
aîné
à
la
Revue des Deux-Mondes du
15
Co-
avril.
Excellente étude du rôle; compte-rendu très vivant et très
mouvementé de
la «
première
»
de VEcole des Femmes.
Il
n'est pas
de spécialiste mieux informé, plus exact, plus
spirituel.
Le
trouvaille.
—
«
Molière
Voilà
soufflé
M. Coquelin
par Rabelais » est une
classé
au premier rang
des moliéristes, et nous nous en réjouissons bien sincère-
ment. M. Buloz
une étude sur
aura-t-il la
bonne idée de
lui
demander
Tartuffe?...
DU MONCEAU.
BULLETIN THÉÂTRAL
— Dimanche
Comédie française.
trée de
Pâques Y^vare
:
(MM.
9 avril, pour la ren-
Leloir, Truffier, de Féraudy,
Boucher, Le Bargy, Martel, Joliet, Richard, Tronchet;
^mes Y)^ Féhx, Barretta, Frémaux).
Lundi de Pâques,
—
10, le
Mariage
(MM.
Misanthrope
JoHet,
M''^
(MM.
M"^ Amel, Arsinoé),
M.
Bianca).
ei
Leloir pour
—
—
la
i""^
La
Lundi 27 mars,
soirée populaire: Tartuffe
M"" Dyone
matinée populaire
:
et
avril
:
le
(M. Coquelin
(MM.
le
Got,
Misan-
le
30^
soirée
— Lundi
populaire
avril,
3
:
le
:
31'=
—
Misanthrope (M. Albert
— Dimanche
16,
Malade Imaginaire (M. Clerh),
V^Cariage forcé
aîné).
— Mardi
Géronte).
Flèche),
Marie Samary).
Théâtre Royal du Parc.
16
lui
;
Célimène,
(M. Sicard; M"'^ Raucourt).
10, 32^ soirée populaire
Lambert;
M""^ Broisat
fois
Jeudi 20,
fois,
V Avare (M. Clerh, M"'" Raucourt).
Lundi
i""^
18,
Baillet,
Médecin malgré lui (M"^ P. Oranger joue
25, X Avare (Coquelin cadet joue
Odéon.
la
Médecin malgré
et le
M"" Thénard
Martine, et
MasquiUier;
Tholer joue pour
thrope (d°), et le
— Mardi
Delaunay, Prud'hon, Boucher,
Reney, Tronchet^
P.
Gabrielle
Barré;
Martel, Joliet, Villain, Truf-
Davrigny, Leloir; M"* FayoUe).
fier, Baillet,
le
forcé
—
et
Jeudi
les
6
et
dimanche
Précieuses
ridicules
"
LE MOLlèRISTF.
64
Collège de France.
— Mercredi
29 mars, M. E. Des-
chanel continue sa revue rapide de l'œuvre de Molière
par
l'histoire
du
Tartuffe.
vacances de Pâques
credi
•
3
et celles
Le
—
Salle des Capucines.
française.
—
Mercredi
M. Talbot, ancien
Mercredi
19,
là
avril,
et la
— Mardi
de Molière, conférence sur V Ecole des
quelin aîné, qui retrouve
5
fragments
sociétaire de la
V Avare,
galère » des Fourberies de Scapin.
scène
Comédie
et
de
«
la
18, VArnolphe
Femmes, par M. Co-
son beau succès de
Revue
la
Deux-Mondes. Signalons quelques modifications
ditions,
les
mer-
le
mai.
de V Avare, par
des
suspendu par
cours,
du Sénat, reprendra
et
ad-
notamment un chaleureux éloge de son cama-
rade Delaunay-Horace, très vivement applaudi.
MONDORGE.
Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
— Noël Texier.
D
QUATRIÈME ANNÉE
NUMERO 39
JUIN 1882
LE
MOLIÉRISTE
%EVUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
MM
:
Campardok, J. Claretie, F. Coppée, V, Fourxel, J. Guillemot,
A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
J.
Loiseleur
Ch.
L.
,
Nuitter
,
Moland
E.
Ch.
,
Picot
,
Monselet,
de la
L.
E.
Noël,
Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,
Dr H. Schweit'zer, Ed. Thierry, E. Thoin'an, A. Vitu, etc.
PAR
M ON VAL
Georges
ARCHIVISTE DE LA
CO
HK
I
E
FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10, GALERIE
DU THEATRE FRANÇAIS, lO
1882
SOMMAIRE DU NUMERO XXXIX
QUATRIÈME ANNÉE
AUTRE RÉPONSE A M. SCHERER. — Ch. Marie.
LE PROCÈS DE MOLIÈRE ET D'UN MÉDECIN. — P. L. Jacob.
MOLIÈRE A VIENNE. — C. Brouchoud.
DOCUMENTS INÉDITS. — La maison de Meudon. — E. Campardon.
L'ÉCUSSON DES POQUELIN DE BEAUVAIS. — Chromo-lithoreprésentant les Armoiries des Poquelin de Beauvais.
graphie
—
Mathon.
UNE LETTRE INEDITE DE BÉRANGER.
BIBLIOGRAPHIE.
— Ernest A...
— Du Monceau.
BULLETIN THÉÂTRAL.
— Mondorge.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
français,
2, place
tions,
:
— ÉTRANGER,
UN FRANC
I3 FRANCS.
50 CENT.
à la librairie Tresse, io, Galerie
de Vintimille, auquel
demandes
lettre affranchie.
et
les
du Théâtre
M. G. Monval,
manuscrits, communica-
ou par mandat sur la poste adressé
à
réclamations devront être envoyés par
AUTRE RÉPONSE A
Bien que, dans
le
M.
SCHERER
et ailleurs,
Moliériste
pondu d'une façon probante à
été ré-
ait
il
M. Scherer, nous
allons
risquer aussi notre réfutation.
Avec une remarquable
s'en prend d'abord à la
qu'il dirige
contre celle de
s'appesantit
sur
Molière n'est
cette
inégalité.
un
il
de
reste,
«
faire
;
Car
puis,
entendre
—
il
que
On
au contraire, et l'on s'applaudit de
si
Molière
était
le
toujours égal à lui-
considérer que
comme
de grand talent, l'inégalité étant en quelque
sorte la pierre de touche
Au
MoUère en France
difficulté
n'y aurait plus Heu de
homme
et faire accepter l'attaque
pas toujours égal à lui-même. »
l'entend parfaitement
même^
du Temps
renommée de Goethe en Allema-
gne, uniquement pour atténuer
la
le critique
habileté,
du génie.
quoi qu'en dise
M.
Hté existe aussi bien dans les
Scherer, ce défaut d'éga.
œuvres de Racine que dans
celles
de notre auteur. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à
relire
avec attention un acte du tragique, ou simplement
l'article
pubHé
autrefois
contre
lui
dans
le
journal
des
68
Débats
M. Granier de Cassagnac,
par
naguère dans
supplément
le
Avant de passer à
littéraire
du
la critique
L'inconséquence,
lesque et rebutant
représenté
comme
tradiction
plus
même
style
noble et attachant. Mais
encore
;
amour pour Célimène. »
M. Scherer a oublié qu'au
de ravoir fait
ainsi
h
;
un grand
«
:
coup
de son
Rendre
le
génie
est
du.
»
coquette.
?
C'est Jean-Jacques Rousseau dans sa
sur
y a une con-
il
dernier,
siècle
n'était rien
amoureux d'une
Qui s'exprime
:
avait d'abord
veux parler
je
écrivain a dit, au sujet de l'amour d'Alceste
Misanthrope amoureux
du Misand'Alceste
ne se borne pas à rendre bur-
dit-il,
un caractère qu'on nous
criante
reproduit
article
du Figaro.
M. Scherer s'occupe du personnage
thrope,
«
MOLlèRlSTE
Li:
lettre
à d'^Alembert
(Amsterdam, 1768, p. 96).
on ne peut soutenir que J.-J. Rousseau
les spectacles.
Certes,
pour Molière une bien vive tendresse,
ait
eu
par conséquent,
qui est pour nous
son témoignage,
récuser
ni,
d'un grand
poids.
Passant au style du Misanthrope, l'éminent critique du
Temps
fait
coupable
d'école
l'abri
un
de
!),
bel et
bon procès
répétitions,
etc.
à Molière
et le déclare
de tautologies (quel vilain mot
Sous ce rapport,
le
pur Racine n'est pas à
du reproche. Prenons un exemple dans
«
Vous voyez de quel
« J'ai reçu de
œil,
ma mort
la
et
comme
le
:
indifférente,
nouvelle sanglante. »
(Acte
Mettons
Iphigénie
III, s.
VI.)
premier vers en présence d'un de ceux du
Misanthrope incriminés par
M.
Scherer, celui-ci
:
LE MOLIÈRISTE
à propos
« Serait-il
comparons.
et
De
y
S'il
d'un côté, n'y
a-t-il
a,
de la bienséance »
et
M,
suivant
que
le
impeccable que
Toutefois,
vers de Racine
donc tout à l'avantage de Molière
est
exemple démontre que Racine
seul
M. Scherer
?
— Non.
grammaticalement?
La comparaison
et ce
Scherer, tautologie
pas également tautologie de l'autre
plus, est-il possible de soutenir
soit construit bien
69
;
n'est pas aussi
donne à entendre.
le
rédacteur du Temps veut bien faire grâce
le
de ses reproches à
la
comédie
à'Amphitryon. Il accorde
dégagé des entraves de l'alexandrin, né se
qu'ici Molière,
répète plus et qu'il « se joue avec grâce de son sujet. »
M. Scherer pouvait
dire
cependant que cette comédie ren-
ferme un rare exemple de répétition accumulée, une sorte
de tautologie quadruple; ce qui n'empêche pas
d'être d'une
même.
remarquable beauté découlant de
C'est ce
joli
couplet de Sosie
le
passage
la répétition
:
Mais, de peur d'incongruité.
Dites-moi, de grâce, à l'avance,
De
quel air
il
vous
plait
que
Parlerais-je, Monsieur, selon
Ou comme
ceci soit traité.
ma
auprès des grands on
conscience,
le
voit usité ?
Faut-il dire la vérité,
Ou
bien user de complaisance ?
(Acte
Voilà
la perle tautologiqtie
III, s. I.)
que nous avions à signaler au
sévère Aristarque du Temps.
Si,
pour
Plaideurs
la
mesure des
comme
vers,
Racine avait
M.
Scherer
les
Molière Amphitryon, sa charmante co-
médie aurait encore gagné en grâce
lure,
traité
le
reconnaîtra.
et
en légèreté
d'al-
LE MOLIÈRISTE
70
Somme
toute, la critique
du savant rédacteur du Temps
ne nous apprend rien de nouveau
la gloire
Nous avons même
plume dans
l'article
ne retranche rien à
de Molière, sans ajouter quoi que ce soit à celle
de Racine.
la
et
le
seul
but de
la
conviction qu'il a pris
faire
la
de M. Granier de Cassagnac dont
contre-partie
il
de
a été parlé plus
haut.
ch. marie.
,
LE PROCÈS DE MOLIÈRE & D'UN MÉDECIN
de trouver dans quelque vieux livre un
est bien rare
Il
fait relatif
qui ne soit pas connu et qui n'ait
à Molière,
En
pas été recueilli.
voici
un, cependant, bien curieux
et
bien nouveau, que nous ne nous attendions pas à trouver
dans
le
Séjour à Paris ^ c'est-à-dire instructions fidèles pour
les
voyageurs de condition... durant leur séjour à Paris, par le
Nemestz,
sieur J.-C.
prince de
le
Waldeck
(à Leyde,
ouvrage que nous copions
une
que
la
Van Abcoude,
che^ Jean
1727, 2 vol. in-8°); c'est à la page
«
A. S. monseigneur
conseillier de S.
483 de cet intéressant
note suivante
:
Molière, demeurant, un jour, avec un médecin dans
même
les
maison, fut enfin obligé de
femmes de
la quitter, à
bien s'accorder ensemble. Peu de temps après,
la
femme
du médecin va prendre place dans une des premières
à la
Comédie; mais
ger d'elle,
la
lui disant
tendoit que
Madame
comme
il
étoit
Molière
la
juste
l'a
à
:
doctoresse en
un procès
,
sortît.
elle
en-
Les parties
que Molière perd
ce qui l'avoit mis
perpétuelle contre les médecins.
loges,
renvoiée, pour se ven-
Qu'étant dans sa maison,
:
vinrent ensemble
en
cause
l'un et de l'autre ne pouvoient jamais
en une haine
3)
Voilà un singulier procès, qui n'a jamais été signalé par
personne, et dont
les
les pièces existent peut-être
encore dans
anciens dossiers des archives judiciaires. Avis au savant
archiviste
M. Campardon^
découvertes sur
la vie
qui a déjà
fait
de
si
curieuses
de Molière, en fouillant avec per-
sévérance dans l'immense dépôt de nos Archives nationales.
P. L.
JACOB,
bibliophile.
MOLIÈRE A VIENNE
On
sait
que Molière
l'acte d'association
le
jeu de
et sa troupe, après la signature
du 30 juin 1643,
paume du Métayer
et
aménagé comme
fût
de
en attendant que
salle
de spectacle, se rendirent à Rouen.
On
les
trouve à Nantes en avril et mai 1648, à Fonte-
nay-le-Comte en juin de
même
la
Narbonne en 1650,
1649, à
et à
année, à Toulouse en
Lyon de décembre 1652
à avril 1655.
J'ai
que
indiqué, dans
c'est
pendant
mes
Origines du Théâtre de Lyon (i),
cette dernière période
avec sa troupe, des excursions à Vienne
Joua-t-il à cette
dit,
et
c'est très
époque
à
Vienne
probablement
plainte portée, le 25 septembre
de Vienne auxquels on
«
?
d'elle
Sa troupe
qu'il
s'agit
1654, devant
remonstre
fit,
les
s'y
ren-
dans
ville
»
dresser
»
mission à
l'époque
un
thé.itre à cest effect sans avoir
la
Police.
n'entendait
»
pas
Mais
laisser
l'autorité
consuls
P. 28, note.
et
demandé per-
municipale de
enfreindre
aussi décida-t-elle qu'il serait « inhibé et
la
a en ceste
qu'il
y
une troupe de comédiens qui désirent jouer
»
,1;
que Molière
et à Montpellier.
ses
ordres;
défendu auxdits
LE MOUERISTE
^
comédiens de jouer dans
»
théâtre sans au préalable en avoir
»
la
permission de
Et
comme
la
la
73
ni faire
ville
immédiatement après la notification de
la veille^
et
obtenu
police, (i) »
préparatifs n'avaient pas
les
dresser leur
demandé
la
été suspendus
délibération de
une autre délibération du lendemain 26 septem-
bre renouvela les
mêmes
défenses,
et
également
interdit
«
à tous charpentiers de
»
tous habitants et paumiers de leur prêter ni louer leurs
»
jeux de
»
20
paume
livres
» jusqu'à ce
leur
et autres lieux
d'amende contre
que
dresser ledit théâtre
ladite
le
pour cet
commencé à
de paume (2), de
»
ledit théâtre
»
tre
Tout porte
à peyne de
permission leur aura été accordée, et
enjoint à Guillaume Burlat qui a
dans
à
chacun des contrevenants
»
par terre sur
effet
et
le petit jeu
mesme
peyne.
dresser
le
à croire que, grâce à
la
protection de Ni-
choses s'arrangèrent, et qu'après
colas Chorier,
les
compUssement
d''une formalité
jours l'achèvement de
son
met-
»
qui retarda
de
l'ac-
quelques
théâtre, Molière put
donner
quelques représentations.
(i)
Registres des délibérations consulaires de Vienne.
(2) Il
y
avait à Vienne, au
nord de
l'hôpital Saint-Paul,
qui était si-
du débouché de l'ancien pont et à
100 mètres de distance environ, deux jeux de paume, l'un dit le grand,
et l'autre h petit. Leur emplacement est indiqué par celui de la place
tué sur le quai du
actuelle
le
Rhône, en
du Jeu de Paume.
face
J'ai
remarqué que
la
troupe de Molière
s'est
plus souvent fixée dans les quartiers placés sous le vocable de St-Paul,
et cette
j'ai
habitude a été
si
constante que c'est en en tenant compte que
pu diriger utilement mes recherches dans
paroisses.
les archives
df s anciennes
LE MOLIÉRISTE
74
même
Je serais
na à l'avantage de Molière
ami Chorier
grande
salle
lui
que
tenté de croire
que l'intervention de son
et
obtenir
fit
cet incident tour-
de jouer dans
droit
le
la
de l'hôtcl-de-ville. C'est à cette faveur qu'il
serait fait allusion
dans
la
délibération suivante, provoquée
sans doute par une troupe de comédiens qui aurait suc-
cédé à
celle
de Molière; car
grand comique
soit
février 1656, à
Lyon
«
Du
je
ne crois pas que notre
revenu de Pézenas, où
la
même
24
était le
il
année:
28 aoust 1656, a esté remonstré
commédiens qui
venu en
qu'il est
désirent de jouer en
»
ceste ville des
»
ceste ville et ont prié et requis lesdits sieurs consuls de
» leur
»
en donner
permission
la
et après sur ce
délibéré,
Dict a esté qu'il est permis auxd. commédiens de jouer
» dans lad. ville et dans la
» d'icelle où
les
»
charge
»
Dieu^ pour
les
de l'hôtel de
pauvres d'icelluy, tous
sieur maire a
»
led.
»
chever que pour ce
»
coustumé de
les
salle
donneront au sieur maire dud.
qu'ils
» joueront trois livres
Par
grande
ville
autres commédiens ont cy devant joué et à la
bailler
fixé sur l'époque et la
commencer
les
pour
registres des
certainement possible
10 sols tant pour
fait
autres
les
et
les
hostel
jours qu'ils
que
le théâtre
qu'il
fera para-
commédiens avaient
ac-
pauvres dud. hostel Dieu.
de l'Hôtel-Dieu,
recettes
d'élucider
ces
il
»
sera
questions et d'être
durée des séjours de Molière à Vienne.
C.
— Ne
BROUCHOUD.
une carte des péréserait-il pas possible de
P. -S.
grinations de Molière à travers la province ? Elle serait le résumé de
tout ce que l'on sait à ce jour sur ce sujet. Sous le nom de chaque
localité où ^lolière aurait séjourné, la date du séjour serait indiquée.
Ce serait comme un canevas que chaque moliériste serait invité à
garnir par de nouvelles recherches.
faire graver
DOCUMENTS INÉDITS
LA MAISON DE MEUDON
M. Emile Campardon
les
a découvert, aux Archives Nationales, dans
cartons des requêtes de l'Hôtel, deux pièces relatives à la maison
qu'habitait à
Meudon Mademoiselle Molière
,
récemment M. Dulaurier (i).
Remercions notre infatigable collaborateur
de ces documents au MoUériste.
Du
Entre
Béjard,
damoiselle
du Roi, de
officier
du décret volontaire
d'avoir offert la primeur
de Izaac-François Guérin, sieur
lui autorisée à la
qu'elle a fait faire sur elle
poursuite
en
la
cour,
requête de Jacques Guerry, conseiller du Roi, trésoet
payeur de ses gardes du corps d'une maison
jardin sise au village de
du
juin présent
main levée par
icelle
la
mois
à ce
demanderesse
qu'en conséquence de
la
14 du présent mois
et
le
passée par devant Gouret et Pencher,
Voir, dans
et
Meudon, demanderesse en requête
tabellion au bailliage dudit
(i)
mort
Armande-Grésinde- Claire -Elisabeth
femme
rier
est
veuve de Jean-Baptiste Pocquelin sieur de Mol-
Hère, et à présent
la
dans laquelle
22 juin 1683.
de Trichy,
à
et
Meudon, de
notaires et
l'opposition afin
le 'Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris^
de M. Dulaurier sur cette maison.
une note
LE MOLIÉRISTE
76
de conserver formée aux criées de ladite maison et jardin
par Pierre Demarne, lors marguillier en charge de l'œuvre
fabrique
et
laquelle
de
du
qu'elle sera rayée
greffier
quoi
dudit
l'église
demeurera nulle
il
17 mai
le
1677,
advenue
et
registre des décrets de la cour,
le
tenu de délivrer à
faire
Mcudon
comme non
la
faite
et
demanderesse son décret, à
contestation aux
sera contraint et en cas de
dépens, comparant par maitre Etienne Maugras, son procureur, d'une part;
Louis Duval
Cappron, mar-
l'ainé, laboureur, François
nom
chand cordonnier, demeurant audit Meudon, au
et
comme
marguilliers de présent en charge de l'œuvre et
fiibrique
de ladite église de Meudon, et Pierre Cappron,
procureur
d'icelle église, deffendeurs
comparant par maitre
Jean Lepage, leur procureur, d'autre part
La Cour, en conséquence de
la
main-levée donnée par
les
défendeurs,
fin
de conserver formée aux criées de
dont
le
est question,
:
14 juin présent mois, de l'opposition à
ordonne
la
maison
et jardin
du
qu'icelle sera rayée
des décrets de la cour et le décret délivré à la
registre
demande-
resse, à ce faire le greffier contraint.
Signé
:
Maugras; Lepage.
(Archives Nationales, V^ 561
Du
•)
6 août 1683.
Entre Isaac-François Guérin sieur d'Estrichy et damoiseile Armande-Grézinde-Claire-Elisabeth Béjard,
demandeurs en requête du
que
le
5' juillet
son épouse,
1683, tendante à ce
décret de l'adjudication qui leur a été
faite
en
LE MOLIÉRISTE
icelle le
sise
à
14 janvier dernier d'une maison et dépendances,
Meudon, pour
saisie et
77
le
mise en criée à
conseiller
du Roi,
somme
prix et
la
de
5400
livres,
requête de Jacques Guéhéry,
trésorier
payeur des gardes du corps
de sa majesté, sur ladite Béjard, lors veuve de Jean-Baptiste
Pocquelin sieur de Molière,
comme
l'ayant
acquise des
dame Laborye, leur
tenus de consigner ladite somme,
directeurs des créanciers des sieur et
sans être
soit délivrée
ni payer
aucun
droit de ladite adjudication, attendu qu'il
n'y a eu autre opposition aux dites criées que celle y for-
mée au
greffe
de
la
cour par
de
les marguilliers
de Meudon, de laquelle main levée a été
faite
la
fabrique
par sentence
de ladite cour du 22 juin 1683 et que lesdits demandeurs
ont
satisfait
aux causes desdites
saisie et criées
par maitre
Lepage, leur procureur, d'une part;
Et
ledit sieur
Guéhéry, défendeur, par maitre Etienne
Maugras, son procureur, d'autre
;
Et maitre Robert Sanson, receveur des consignations
de ladite cour par maitre Jacques Lemaire,, son procureur,
aussi d'autre.
Après
satisfait
défendeur a déclaré avoir été payé et
qu''icelui
somme
par lesdits demandeurs de la
de 1000 livres
portée par Tobligation de ladite demanderesse du i" avril
1676 pour laquelle
lesdites saisie et criées
ensemble des
et
frais
ont été
faites,
mises ordinaires et extraordinaires
desdites criées, et consenti, ensemble ledit Sanson, la déli-
vrance dudit décret au
prix de la maison
Appointé
est
moyen
de
la
consignation
faite
du
acte
de
;
que
la
ladite déclaration et, en
cour a donné
conséquence
et
donne
d'icelle et
de
la
main
LE MOLIERISTE
jS
levée de ladite opposition,
ordonné
;i
et
ordonne que
le
décret de ladite maison dont est question sera délivré aux
dits
demandeurs sans pour ce
autre consignation ni
faire
payer aucun droit de ladite adjudication aux receveur et
contrôleur des consignations de ladite cour.
Signé: Sanson; Lemire, pour Sanson; Maugras; Lepage.
(Archives Nationales,
P. S.
—
archiviste
«
La note suivante m'a
aux Archives Nationales
été
V"*
communiquée par M. Gerbaux,
:
Ordonnance de décharge de la somme de ^oo
Jacques Loire,
tapissier de
la
A
pour
lieu
et
Versailles, le i6' sep-
»
(Arch. Nat.
Il est
livres
Chambre, pourveu au
place de Jean Poquelin, dit Molière.
tembre 1682.
I377)-
regrettable
que
cette pièce
ne
O*
*
26
f"
313).
soit pas plus explicite.
Em.
CAMPARDON.
L'ÉCUSSON DES POQUELIN
DE BEAUVAIS
Les recherches sur
Molière que nous
de
famille
la
avons publiées en 1877, ont été continuées; nous avons
nom
réuni d'autres notes sur les familles du
qui,
pendant plusieurs
siècles, se
de Poquelin
sont perpétuées à Beau-
vais.
Les Aïeux de Molière à ^eauvaiset à Paris
que M. R. du
imprimer en 1879, sont venus confirmer
Mesnil a
fait
l'opinion
émise par nous
que
le
père de
MoHère
était
bien originaire de Beauvais. Ce généalogiste a mis large-
ment
à profit notre notice, et la description que nous lui
avons donnée d'un
vitrail
représentant les armoiries d'une
famille Pocquelin lui a facilité la représentation factice de
ces
armoiries,
ou plutôt armes parlantes; ces derniè-
res possédant toujours quelques figures,
bles qui font allusion au
Dans
l'escalier
cette ville
et
pièces
de celui qui
ou meu-
les porte.
d'une ancienne maison de Beauvais (et
en possède encore un bon nombre) se trouvait
une fenêtre à
temps
nom
petits
carreaux
verdâtres
entremêlés de verres peints.
Un
dépolis par
le
de ces derniers,
de II centimètres carrés^ représente un vase d'or à anse,
du commencement du XVII*
siècle,
dans lequel on voit
80
LE MOLlÉRlSTt
un bouquet de
analogues
Jin
en
fleur.
Des bourgeois
beauvaisines.
l'industrie des étoffes,
aux
Nous avons
plusieurs vitraux
avec des armes parlantes de plusieurs familles
se
en
livrant
cette ville
à
qui avaient une grande réputation
siècles précédents,
adaptant sur un
s'annoblirent en
Nous en voyons
ècusson ces sortes d'armes parlantes.
encore sur des boiseries, des pierres tombales à
l'église
de
Saint-Etienne de Beauvais, et sur des façades en bois (i).
La science héraldique
dans
rité
pour
et
soumise à une certaine sévé-
composition des armoiries,
la
pour
précises
est
émaux, parfois
les
aussi
les règles
pour
les
les objets figurés.
Les armoiries anciennes de Pocquelin
de Beauvais qui
sont figurées dans les Aïeux de Molière à Beauvais
une sanction complète aux
donnent-elles
ris
sont
ornements
modernes? L'auteur de ce
travail a
commis une
et
à Pa-
armoiries
erreur en
insérant dans son livre une gravure en couleur, représen-
un pot à
tant
fleurs
en
terre,
de forme toute moderne,
dans lequel est fichée une branche d'arbre à feuilles fine-
ment découpées
et s'alternant.
le lin, car cette plante est
du
Cet arbuste ne saurait être
à feuilles lancéolées,
s' élevant
sol.
Le
vitrail
certainement
Pot
dont nous donnons
les
ici la
reproduction offre
armes parlantes d'une famille Pocquelin
:
et lin.
(i)
Une
famille
du
nom
de La Fontaine sculptait sur des lambris une
fontaine jaillissante, ayant le
mot
Sur une pierre tombale d'un
écusson tracé au-dessus de
de à
nommé
la tête,
gauche
Pillon,
mot La
à droite.
et
le
on
voit figurer dans
un pilon tenu par une main.
un
Le
Moliériste
ARMOIRIES DES POQUELIN DE BEAUVAIS
d'après un ancien vitrail.
(Collection de
M MATHON
d-;
EeauvaisfOisel.
8l
LE MOLIÉRISTE
confirmé dans
J'ai été
la lecture
ou plutôt dans
l'inter-
prétation de ces armes^, qui se rapprochent du rébus, par
de M.
l'opinion
Caron de Troussures qui possède
le
beaucoup de documents snr
Beauvais;
nombreuses
étaient
mes
et celles
les
anciennes
qui portaient ce
et n'avaient
parlantes. Ainsi,
un
nom
de
familles
de Pocquelin
pas toutes adopté ces ar-
portrait de
Simonne Pocquelin,
Agée de 65 ans en 1592, que nous avons décrit (i), offre
des armoiries composées plus héraldiquement
ches de lauriers entourent
un écusson
parti
zur à la branche d'or, premier au faisceau de
en chef à senestre, au
dextre
la
;
monogramme A B
au second de gueules à
:
des bran-
au premier d'adards
d'or
d'or en pointe à
l'étoile d'or
en
chef,
à
gerbe d'or en pointe.
MATHON.
Beuavais, avril 1882.
(i) Catalogue
possédé aux
les vitraux
de cette
du musée de Beauvais, 1865, page 67, n" 49. Beauvais a
et XVIIe siècles une école de peintres sur verre, et
XVIe
d'Engrand-le-Prince sont toujours admirés dans
ville.
sa facture, ses
les
églises
Le vitrail de la famille Pocquelin est du XVII^ siècle,
émaux et le dessin l'indiquent bien, et la comparaison
avec les vitraux de cette époque complète cette attribution.
6
wmw$w^mW:Wm!&
UNE U'TTRE INÉDITE DE BÉRANGER.
On
dans
lit
Moniteur universel du 7 janvier 1844
le
«
PARTIE NON OFFICIELLE.
6 janvier.
» Paris, le
»
Un
nombre
certain
d'étudiants, qu'on peut évaluer à environ trois
cents, se sont rendus aujourd'hui, vers midi, cliez
Chambre
des députés,
rue Richelieu,
Molière
En
du discours
l'occasion
à
féliciter
ils
(i)
En
qu'il
a
à
diverses
M.
Laffitte,
pour
prononcé récemment à
passant devant le
ont poussé
monument
reprises
le
le
la
de Molière,
de
cri
Vive
:
!
sortant de chez
M.
Laffitte,
porter à Passy, au domicile de
devant
:
le
ils
ont pris
la résolution
M. Béranger. Arrivés
ministère des affaires étrangères,
ils
ont
de se trans-
sur le boulevard,
crié
:
A
bas Guizot
!
Ces clameurs ont immédiatement cessé sur l'injonction du commissaire
de police qui
veillait
sur le
rassemblement, dont une partie
s'est
dispersée.
Le rassemblement
il
s'est
rue de Passy,
le
n'a pas tardé à se reformer dans la rue Royale, et
rendu à Passy.
le
M.
Béranger
rassemblement, a été insulté
voies de
fait
n'était pas
chez
lui.
Dans
la
grande
commissaire de police, qui n'avait pas cessé de suivre
sur les agents
;
les
perturbateurs se sont portés à des
qui l'accompagnaient.
Alors une dizaine
d'arrestations ont eu lieu, et le rassemblement a été dispersé. » (2)
Les journaux du temps
nous apprennent que
diants, introduits dans la cour de l'Hôtel Laffitte,
(i)
Dans
la
détachè-
séance du 30 décembre 1843.
Le Monileur du 14 janvier annonce que les étudiants
individus arrêtés le 6 à Passv ont tous été condamnés.
(2)
les étu-
et
autres
LE MOLIÉRISTE
rent de leurs rangs
dans
lut
les
une dizaine d'entr'eux qui montèrent
appartements.
un discours à la
83
Un
étudiant en droit,
duquel
suite
l'illustre
M. Henri
L...,
député se montra
à tous les étudiants et les remercia.
un des
Cette visite rendue à
pendant son passage à
amers
ratif
le
présidence de
la
comme doyen
Députés
chefs de ropposition, qui,
gouvernement,
le
Chambre
des
discours sans doute aussi admi-
que Ubéral de M. Henri L...,
les cris
l'hôtel des Affaires étrangères contre
laire,
la
d'âge, venait d'attaquer en termes
poussés devant
un ministre impopu-
prouvent suffisamment qu'en se rendant à Passy, au-
près de Béranger, la jeunesse des Écoles songeait moins à ren-
dre hommage à Tauteur du Tartuffe, qu'à faire une manifestation politique.
demander au vieux chanson-
Elle allait
nier de se mettre à sa tête et d'assister à l'inauguration du
monument
En apprenant que Béranger était
vif. Le poè-
de Molière.
absent, elle témoigna
un mécontentement assez
réellement sorti
te était-il
dans son appartement?
main de
cette visite,
?
se tint-il
Nous
prudemment renfermé
l'ignorons
M. Henri
;
mais
le
lende-
L... trouvait à son hôtel,
rue de Verneuil, 25, une lettre qui a été précieusement
conser\'ée
dans sa famille,
prinieur à ses abonnés
dont
et
le
Moîiérigte
offre la
:
Passy, 7 janvier 1S44.
Monsieur,
Il
celui
n'est
que
pas d'honneur qui pût me
veut bien
Écoles de Droit
qu'il nest pas
et
me
flatter
davantage
que
décerner une partie de la jeunesse des
de V^Cèdecine
;
mais
je dois
vous confesser
d'homme qui convienne moins que nwi au
rôh'
4
s
MOLIÉRISTE
I.E
(jiie
honneur m'imposerait dans la cérémonie du ij.
cet
mes
caractère^
m'ont toujours tenu
?nes habitudes
^^oûls,
où
me
il
sérail impossible de proférer
donc^ Monsieur^
Aye:(^
loin
embarrassé de figurer
dis solennités publiques où je serais fort
et
Mon
une parole.
mes excuses
la bonté de faire agréer
à ceux de vos camarades qui avaient cru devoir me désigner
pour marcher à leur
convictions
à
et
prouveront,
et
pas
et
y fait encore
à votre génération, qui a si long tems
il s'est
sance
aux nombreux
ne-
m'y
être
que m'a causé la
tant.
A
mon
adoucir
les
pas trouvé
triste
résultats d'une
dites,
l'assurance de
ma
le
regret que
plus vif encore
démarche qui m'honorait
fai pu auprès
la fois conciliant
collision
reconnais-
pris la peine de
otit
regret bien
et le
et
de
juste,
M.
le
pour
que je déplore. xA ceux
Monsieur, combien je soufre d'avoir
du mal qui en peut
Recevez en particulier.
ma
leur expritner
issue d'une
homme à
qui en sont victimes,
été l'occasion
et
retour, j'ai fait ce que
maire de Passy,
qui
élèves des Ecoles
venir rendre visite à Passy
j'ai de
préoccupé
de la gloire de notre Patrie.
Foudre:(-vous bien aussi. Monsieur, exprimer
me
du
chansonnier resté fidèle à ses
à lui survivre, que jusqu'au dernier moment^
du bonheur
noir
coin
le
laisser
sympathies. Les rêves qu'il
ses
l'espère,
il
n'est
ciel
vieux philosophe
le
généreuse jeujiesse de
cette
qui grâce au
coin,
misanthrope,
jour de l'inauguration de la statue
le
à
Persuade^
de Molière.
dans son
tête
résulter
Monsieur,
et
pour eux.
mes remerctments
et
cordiale considération.
Votre dévoué,
BÉRANGER.
Dans
lettre
la
crainte de
ne pas vous rencontrer, j'apporte cette
avec moi, pour la remettre à votre portier.
LE MOLlÉftlSTE
La
monument
de l'inauguration du
veille
85
de Molière,
Messager annonçait que les élèves devaient se réunir
le
lundi
15, sur
la
place
l'Ecole de Médecine,
«
du. Panthéon et sur
pour
Cette nouvelle, ajoute
produit
le
aller assister à
le
la
journal dont l'article fut re-
lendemain malin par
Moniteur, a lieu d'éton-
le
cérémonie que
ou députations désignés sur
programme
le
le
Préfet de la Seine et qui a
Le lendemain, en
effet,
suivant l'ordre
faisait,
de
cipal (Préfet
de
sociétaires
été
officiel,
la
par
»
du Monument
devant
municipaux),
corps
les
arrêté
rendu public.
l'inauguration
la Seine, conseillers
conseillers
adjoints,
de
l'inauguration.
ner, puisqu'il n'y aura d'admis à la
M.
place,
le
le
corps
se
muni-
de préfecture, maires,
les
Comédie-Française,
5
la
Académies,
les
commission de
souscription, les députés de la Seine, les commissions des
auteurs dramatiques, de la Société des gens de lettres, des
dramatiques, et quelques fonctionnaires ou artistes
artistes
invités par le Préfet de la Seine.
Exclus de cette fête, un certain
partirent de la place
rendus rue de
la
nombre de jeunes gens
de l'Ecole de Médecine, et, s'étant
Tonnellerie, devant
la
maison où
l'on
croyait alors qu'était né Molière, saluèrent de nombreuses
acclamations
ajoute
le
de ce
façade
:
«
buste de l'immortel poète qui décorait
bâtiment.
Ils se
Le
Moniteur,
qui relate le
la
fait,
sont ensuite rendus au foyer du théâtre
de rOdéon, où l'acteur Monrose a lu une pièce de vers
analogue à la circonstance. Les jeunes gens l'ont accueillie
aux
cris
de
:
« vive
Molière
!
», et se
sont dispersèb en quiL-
LE MOLIÉRISTE
86
ant
théâtre.
le
seul instant.
Ainsi
11
L'ordre
pas été
public n'a
troublé
un
«
démonstration
politique
devenue simple manifestation
avait avorté, et était
littéraire
en l'honneur de
notre grand Comique.
Ernest A...
9^
—
Nous pouvons annoncer à nos
chaine publication d'un Théâtre
lecteurs la très pro-
choisi de T(plrou,
précédé
d'une importante étude de M. Louis de Ronchaud. La
nouvelle édition,
imprimée
par
collection des Petits classiques, se
mes comprenant
les
M.
Jouaust;,
dans
sa
compose de deux volu-
pièces suivantes
:
Hercule mourant,
Antigoney Saint-Genest, don Bernard de Cabrère,
Venceslas,
Cosroès.
—
Vient de paraître une Etude sur Molière, par M,
Alph. Leveaux, in-8 de 29 pp. (Compiègne, impr. H. Lefebvre). L'auteur
les
examine spécialement
Fourberies de Scapin.
le
Mariage forcé et
BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESaUE
Editions classiqjues.
mes de nos
— On.
lycées, Molière
sait
fut
que, sur les program-
longtemps représenté par
Misanthrope et par quelques extraits, plus ou moins
le seul
étendus, dans les recueils
qu'un
moins
esprit
de
DvCorceaux choisis. Depuis
timide préside à
la
études universitaires, une place plus large lui a été
Plan
le
d'études
supérieures,
du 2 août 1880
V Avare,
les
Femmes
savantes^ le
Tartuffe. Peut-être n'est-ce pas
et le
pour
prescrit,
des
direction
faite
;
classes
les
^Misanthrope
encore assez
;
nous
croyons que Ton pourrait mettre aux mains d'élèves de
comme
rhétorique, sinon tout Molière,
moins
la
mérite
tous nos
plus
courageuse,
en somme,
et
qui,
une
l'Université
mesure assez
espérons-le,
sera
com-
publiées pour répondre aux prescriptions du "Plan
ment
d'études-,
sont vraiment remarquables,
Moliériste,
La
Cependant,
partie.
remercîments pour
du
Quelques-unes des éditions de Molière, nouvelle-
plétée.
de
grande
tout Racine,
librairie
ces
et
pour
c'est,
le
un devoir d'en rendre compte.
Garnier frères a donné
publications,
avec
les
le
Femmes
premier exemple
savantes,
M.
de
Emile Person, professeur au lycée Fontanes; V Avare, de
M.
F.
Marcou, professeur au lycée Louis-le-Grand
Miiunlhropc,
de
M.
L.
Lcys,
professeur
au
lycée
;
le
de
LE MOLIÉRISTE
88
Montpellier,
M.
notre collaborateur
de
Tartuffe y
le
et
Louis Moland.
Les Femmes savantes
méthode
et
point de vue
au
Nous ne
louer
trop
origi-
abstention
de
pièce
la
philologique et dramatique.
historique,
saurions
éditions
approfondie
étude
admiratives,
notes
même
même
ou
nales, avec leur orthographe, sobriété
de
la
procèdent de
scrupuleuse des
reproduction
:
Y Avare
les
deux commentateurs
d'avoir ainsi compris leur tâche. Bien que l'orthographe de
MoUère, dont
peu d'attention à
accordait trop
est si rare et qui
l'écriture
la publication
de ses pièces,
n'ait pas la
précision et l'importance de celle de Corneille, par
ple, elle
a du
moins l'avantage considérable
thographe du dix-septième
sa
physionomie vraie
maire historique
objecté (i)
router
les
que
et
cette
élèves
et
(i)
les
la
gram-
exemples.
On
a
orthographe archaïque pourrait dédésapprendre
leur
ne leur
et, si
l'on
M. Maxime Gaucher, dans
dernier, à propos de
classique)
de tous
Torthographe
est pas familière à l'excès
:
deux pièces ne s'adressent qu'aux élèves des
classes supérieures,
avril
Tor-
d'être
de conserver au texte
de fournir à l'étude de
les meilleurs
usuelle, qui, paraît-il,
mais ces
siècle,
exem-
la
l'édition
ne
sait
Revue politique
pour laquelle notre directeur a annoté
»
littéraire
et
de Molière (Jouaust,
teur a conservé l'orthographe originale
qui traite de « pédantisme
l'orthographe
pas
;
la préface
cela «
irrite
cette façon d'agir. Voilà
du
15
^Bibliothèque
de 1682. L'édi-
»
M. Gaucher,
un bien gros mot,
arguments de M.
que ne justifient guère, nous devons l'avouer, les
Gaucher en faveur de l'usage contraire. Nous aurions la partie trop
belle si nous voulions parler, à notre tour, du
pédantisme » de la
v»
routine.
LE MOLIÈRISTE
en seconde,
la
Au
saura-t-on jamais?
l'orthographe de Joinville,
89
surplus, rajeunit-on
de Marot ou de Montaigne,
qu'on met aussi aux mains des élèves de rhétorique
et
de
notes admiratives, elles tombent
si
fa-
seconde
?
Pour
cilement dans
les
de s'en abstenir,
même
de ces éditions,
teurs
au contraire tout à
lorsqu'on a
spontanément.
elles naissent
ments
d'histoire théâtrale
les
poëmes
chaleur vivante,
la
;
où
une heureuse innova-
c'est là
comme
des
seulement pour être lus des chefs-d'œuvre
chaque pièce sont d'une science
qui précèdent
très sûre, très
résumé d'un cours
appropriées
nous a surtout paru
aussi à leur but spécial. Celle de V Avare
:
et
Félicitons les deux éditeurs
destinés surtout à être joués. Les notices
intéressante
sont
commentaire
élèves sont trop disposés à étudier
écrits
;
au-
les
elles
donné grande place aux renseigne-
tion
:
comme
lettré
leur place dans le
fait à
d'avoir, au contraire,
fait,
preuves de
ses
dont rien ne remplace
oral,
toujours prudent
la banalité plate, qu'il est
a
fait
M. Marcou,
alors professeur suppléant
Lettres, c'est
un excellent morceau de
la
Sorbonne par
à la Faculté des
critique, original et
neuf à bien des égards.
Dans son Misanthrope, M. Leys
opposée.
que
«
Estimant,
suit
au contraire de ses deux collègues,
l'orthographe est indifférente »,
original à l'orthographe
moderne
;
varié.
ramène
le
texte
d'autre part, son
com-
mentaire historique et philologique
moins
une méthode toute
est
il
moins nourri
Pour prendre un exemple, M. Leys
et
croit-il
avoir suffisamment éclairé (p. 21) ses lecteurs sur le sens
du refrain
«
J'aime mieux
ma mie
au gué,
»
(qu'il écrit
LE MOLIERISTE
90
ô gué!
«
»
),
disant
Cil
chanson composée
temps de Henri II?
de plus sur
des
le
>>
comme
style figuré
celle-ci
dont on
du bon goût, a
leau, le réformateur
Le Misanthrope
faute,
même
qu'il
pourrait
mique.
))
vaut pas
19), à propos
(p.
des
fait vanité^ etc.
Ce
en
été,
du Parnasse.
est
perdre
»
Son triomphe
son procès,
les
d'en imaginer de
ont épuisé,
esthétiques
à
Boi11)
:
hommes en
et
classe,
ne
Encore une
de ce genre que
il
est
bien
diffi-
après que tant de critiques
telles,
propos de Molière,
Lorsqu'on n'a pas à
citer
les
formules admira-
Saint-Beuve
Marc-Girardin, pourquoi ne pas laisser
orales
les
toujours la peine d'être imprimé.
remarques
délicate,
anticipé, à l'idée
excellent à dire dans une
qui est
si
extrêmement co-
est
lorsqu'elles sont tout à fait originales,
tives.
sûre et
si
même temps que
Ou cette autre (p.
heureux de prendre
à ses dépens.
on ne goûte
fois,
le
au
Loir,
le
Nous préférerions quelques détails
Gué et ses réunions joyeuses à
Molière, qui traçait, d'une main
«
les règles
cile
refrain vient d'une
du Gué, sur
:
Ce
«
Ce vieux
«
château du
explications
vers
:
au chilteau
ou Saint-
aux explications
du professeur ou au sentiment personnel de
l'élève
soin de signaler ou dégoûter ce qui est beau, spirituel,
etc.
est
.''
Au
une
contraire^ ce qui touche à l'histoire et à la langue
partie de la
critique assez
nouvelle encore pou^
n'être pas épuisée.
Nous n'avons
rien
Moland. Extrait de
à
cette
dire
du Tartuffe de
M. Louis
grande édition de Molière, que
connaissent bien nos lecteurs,
il
en a toutes lesquaUtés,
et
si
9I
LE MOLIERISTE
qu'en
réduction
la
d'après
les
Person
et
a
mêmes
principes
Marcou^
On
son excellence.
M. Moland
tirée
que
n'est pas
raison
a bien aussi sa
elle
ne peut que
le
établie
MM.
de
les éditions
d'être et
remercier de mettre à
portée des élèves de nos lycées les résultats de ses vas-
la
tes recherches.
La
librairie
des classes,
Ch. Delagrave a publié, également à l'usage
plusieurs comédies de Molière
nous ont aussi paru très dignes d'intérêt,
ces éditions
;
et
nous en par-
lerons prochainement.
Vente
—
Rochebilière.
vacation, seront vendus, à
Vendredi 2
à
juin,
la salle Silvestre, les n°^
la
3=
315 à
402 du catalogue de ce beau cabinet formé par feu M. A.
Rochebilière,
conservateur à
ancien
la
bibliothèque
S"=-
Geneviève.
Nous
signalerons
particulièrement aux moliéristes les
éditions originales de
VEcole des
Femmes, de
du
la Critique,
gré lui y du Sicilien, de
homme,
de Psyché, des
sçavantes
et
i" édition
Maris,
ïKisantrope,
de
YEcole des
du D^édecin mal-
G. Dandin, du Bourgeois GentilFourberies de Scapin, des
du rarissime Remercîment au Roy (1663);
originale
des
Œuvres (i66é);
l'édition
1682, précieux exemplaire contenant en double
VII
les
et
Femmes
VIII SANS
les
la
de
tomes
AUCUNE SUPPRESSION,
c'est-à-dire avant
ordonnés par
la censure; la tra-
cartons de remplacement
duction italienne de Castelli (Lipsia, 1740, 4 vol. in-12),
exemplaire de 'M"'^ de Pompadour,
plats
;
enfin de
avec ses armes sur
les
nombreux ouvrages du temps, documents,
LE MOLlèRISTE
92
études, mélanges et biographies, toute une bibliothèque
moliéresque.
Le
catalogue, excellemment rédigé par
M. A.
Claudin,
libraire-expert chargé de la vente, est précédé d'un avant-
propos de M. Alph. Pauly.
—
Molière und Seine buhne.
Molière-Museum a enfin paru
:
Le
4' f\iscicule
rieuses dans ces 176 pages; et d'abord, signalons
la
gravure originale en fac-similé, ainsi que l'autographe
M. de La
découvert à Montpellier par
mandes,
Pijardière.
sur
de 'Molière
tableau des représentations
(1877-79),
V Avare a été représenté 18 fois à Berlin,
extraits
du
édité par
pu
—
une longue analyse du
française
alle-
ans
Malade Imaet
importants
il
y
coûteux volume
a six ans.
— Enfin,
Moliêriste contient des éloges
dont
traduction nous ferait rougir.
Tous nos remercîments
D"'
le
De nombreux
se procurer le rare et
Comédie
la
scènes
les
de Lagrange rendront d'utiles services
'Registre
à ceux qui n'ont
Dans un
nous remarquons qu'en deux
ginaire 17 fois à Vienne.
la
aux rao-
texte français de VElomire hypocondre, précédé
lièristes le
de
de ce
y a bien des choses cu-
il
H. Schweitzer,
le
et
tous nos bravos au digne
persévérant directeur de cette pré-
cieuse publication.
L'Epitre
a.
Molière,
à
fîoraux a décerné un œillet,
Angoulême.
vers), ne
L'étendue
laquelle
est
bientôt dans
un volume de
prépare en ce
moment.
morceau
de ce
nous permet pas de
l'Académie des jeux
de M. Depiot, avocat à
le
pubUer
Fables
et
satirique
ici.
éptires
Il
(192
figurera
que l'auteur
LE MOLIERISTE
— M.
commence, dans
Achille Fouquier
de mai),
tattnique (livraison
Tenorio Je
don José
93
Zorilla,
la
la
traduction du
drame en deux
Revue
hri-
Don Juan
re-
parties,
présenté pour la première fois à Madrid en mars 1844.
—A
signaler, les Etudes littéraires sur
cine, de
Corneille
(i vol., Hachette), et les Essais
de critique
Victor de Laprade, où l'éminent poète,
aussi
!
la
comme un
comédie
rer
Ra-
qui
idéaliste,
par
regarde,
lui
genre inférieur, consacre de
bien curieuses pages à Molière.
nement
théâtre de
le
Molière, par M. Gustave Merlet
de
et
Nous reviendrons
certai-
sur ce livre, que les impatients pourront se procu-
à la librairie Didier.
Lire do.ns\a. Musique populaire, journal hebdomadaire illustré, l'intéressante
étude du rédacteur en chef,
Pougin
:
et
avril et
mai) sur
la
Molière
l'Opéra-Comique
M. Arthur
26, 28,
(n°'
à 33,
V Amour peintre, à propos de
M. Eug. Sauzay, que nous avons
le Sicilien et
récente partition de
louée en son temps,
— La
20
Bibliophilie publiée par le libraire
avïil dernier (n°
1 3
de
la série)
Ad. Labitte,
contient
article sur Molière et Louis de Mollier. Il
y
un
le
intéressant
est question
des
divertissements et ballets attribués au musicien-chorégraphe.
Disons, à ce sujet, que
le
curieux recueil de ces ballets,
formé par M. Bancel, vient d'être adjugé à M. E. Sardou,
de Bruxelles, pour
A
la
somme
quelques jours de
comédien du Vaudeville,
750
fr.,
là,
de 850 francs.
M. Ad. Dupuis,
l'excellent
se rendait acquéreur, au prix de
d'un portrait de Molière, par J.-B. Santerre.
DU MONCEAU.
BULLETIN THÉÂTRAL
—
Comédie française.
vantes
(MM.
chard,
Femmes
les
sa-
Got, Delaunay, Barré, Coquelin cadet, Ri-
Tronchet
Siivain,
Samary-Lagarde
Barretta,
2 mai,
Mardi,
M'"" M. Brohan, Jouassain,
;
et Fayolle).
(même
Jeudi 4, les Femmes savantes
distribution,
sauf
M"' Fayolle, remplacée dans Armande par Mlle Lloyd).
Vendredi
lin,
Malade imaginaire
12, le
Thiron,
Barré, Prud'hon,
(MM.
Tronchet; M""'*
Martel,
Aumont)
Jouassain, Barretta, Samary-Lagarde et la petite
amoureux
et le 'Dépit
Féraudy;
Meiningen
M""
Bianca
Thomas
:
le
— Jeudi,
— Dimanche
imaginaire
(MM.
naglia, Fréville
;
le
21,
(MM.
M""
dis-
remplacés dans
et Truffier).
Amaury,
Sicard,
Crosnier, Grivot et
Une
le
à
Amaury,
:
le
le
:
iKalade
Kéraval, Cor-
J.
Malvau).
Médecin malgré lui
fausse distribution
La France persuade
tre-Manche qu'elle a
Porel, Clerh,
Raucourt, Chartier, Hen-
soirée populaire
distribution).
journal
Coquelin,
Coquelin cadet
38' soirée populaire
Clerh,
M""
Lundi 22, 39^
(même
Le duc de Saxe-
18 mai, 37^ soirée populaire à prix
Médecin malgré lui
Kéraval, Boudier, Fréville ;
riot).
Reney, de
Malade imaginaire (même
MM. Got et
par MM.
sauf
Purgon
réduits
Joliet, P.
Frémaux).
et
et jeudi 18, le
tribution,
Odéon.
Boucher,
assiste à la représentation.
Mardi 16
et
(MM.
Coque-
Got,
donnée par
une honnête famille d'ou-
bonheur
d'applaudir
M. Got,
LE MOLIERISTE
M. Talbot
M"* Dinah-Félix dans Sganarelle, Géronte
et
et Jacqueline
Dimanche
!
28, 40' soirée populaire: Tartuffe.
29, 41* soirée populaire
Théâtre Rossini,
populaire
OpÉRA-CoMiauE.
le
:
—
— Lundi,
les artistes
Jeudi 27
M. Poise,
Demonbynne.
r Amour médecin, de
du prix
tié
du cours de M. E.
prise
29 mai, matinée
de l'Odéon.
mardi 2 mai,
avril et
qui vient d'obtenir la moi-
— Mercredis
Collège de France.
— Lundi
Dépit amoureux.
à Passy.
Tartuffe, par
:
95
10, 17 et
Deschanel
:
24 mai, re-
La question des
femmes dans Molière.
— Le surlendemain du jour où
d'œuvre de son répertoire, non
vingt ans.
madame
précédée,
été
française ac-
un salon des
Comédie un des petits
chefs-
représenté depuis quelque
Le Dimanche 14 mai,
brillante
soirée
chez
comtesse de Beaumont-Castries. M. Coquehn
la
une lecture du
a fait
de M.
Comédie
avec faveur une comédie de salon,
cueillait
plus parisiens empruntait à la
aîné
la
entrecoupée
et
Sicilien
suivie
ou V,Amour
peintre,
de l'excellente musique
Eug. Sauzay, dont une première audition avait
donnée,
il
y a quatre ans, à l'hôtel de
la
Présidence.
Cette réduction d'orchestre pour instruments à cordes
soutenus d'un piano a obtenu
le
zay conduisait lui-même
le petit
siciens, à la tête desquels
M.
Léon, Pagans
et
J.
plus vif succès.
orchestre de douze
Sauzay
Aublet ont chanté
M. Hermann-Léon
a
fait
valoir
M. Sau-
fils.
le
Tair
trio
de
mu-
MM. Hermanndu début,
l'esclave
et
turc.
LE MOLIÉRISTE
96
M"' Fonta, en délicieux costume
des esclaves et indiqué
le ballet
oriental, a dansé l'entrée
des Maures.
M. Coquelin a lu très simplement, avec une amusante
bonhomie et une merveilleuse variété d'intonations. Il a
comme Hali, jaloux comme don
Pèdre, amoureux comme Adraste, touchant comme Isidore, rusé comme Zaïde; enfin, rien de plus comique
été tour à tour subtil
que
la
Du
petite scène
Croisy,
le
du sénateur indiquée par Coquelin.
créateur du rôle,
n'a peut-être pas trouvé
cette note-là.
D'ailleurs, nul
commentaire
au texte de Molière,
de personnel l'habile
l'Ecole des
:
M. Coquelin
borné
s'est
nous savons ce qu'eût pu
et
dire
conférencier du Misa?ithrope et de
Femmes.
Lecteur, compositeur, maestro et exécutants ont été
chaudement applaudis
et bissés par
un auditoire
parmi lesquels nous avons remarqué
Détaille, Falguière,
duc
et
MM.
duchesse Decazes,
de Maroques, M. de Mondel, M"* Fuchs,
L.
Leloir,
d'initiés,
Emile Perrin,
M.
MM.
Monval,
Baudry, Paul Deschanel,
et M'"^
Hébert,
marquis
Philippe de Massa, Havard, de Lostalot, etc.
Mairie du XI^ arrondissement.
dans
la salle
—
Dimanche
7 mai,
des fêtes, matinée dramatique et lyrique
profit d'une école de jeunes
M. Ed. Lockroy, député
:
filles,
sous
la
Conférence sur Molière,
par
E. Ménorval, suivie du 3' acte de Tartuffe.
MONDORGE.
Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
au
présidence de
— Noël Texier.
M.
,
QUATRIÈME ANNÉE
JUILLET 1882
NUMÉRO 40
LE
MOLIÉRISTE
%EFUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
MM
:
Campardon, J. Claretie, F. Coppée, V. Fourkel, J. Guillemot,
A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Ln'ET,
J.
LOISELEUR,
L.
MOLAND, Ch. MoNSELET
,
E.
NoEL
Picot
L,
de la Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,
Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vrru, etc.
Ch.
Nuitter
,
E.
,
PAR
Georges
M ON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
PARIS
10,
LIBRAIRIE TRESSE
GALERIE DU THEATRE FRANÇAIS,
1882
lO
SOMMAIRE DU NUMERO XL
QUATRIÈME ANNÉE
MOLIÈRE ET SA TROUPE AU PALAIS-ROYAL (Suite)
L'ALEXANDRE DE RACINE (1665). — Edouard Thierry.
COTIN ET TRISSOTIN. - P.-L. Jacob, bibliophile.
LA MAISON MORTUAIRE. — Ch. Nuitter.
BIBLIOGRAPHIE.
—
Du
BULLETIN THÉÂTRAL.
Monceau.
— Mondorge.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
français,
2, place
tions,
:
— ÉTRANGER,
I3 FRANCS.
UN FRANC 50 CENT.
du Théâtre
M. G. Monval,
manuscrits, communica-
à la librairie Tressk, io, Galerie
ou par mandat sur la poste adressé
de Vintimille, auquel
demandes
lettre affranchie.
et
les
à
réclamations devront être envoyés par
MOLIÈRE ET SA TROUPE
AU PALAIS ROYAL
(Suite)
(i)
L'ALEXANDRE DE RACINE
(1665)
Mais nous ne sommes pas encore au Médecin malgré
nous en étions tout à l'heure au Grand Alexandre
rus; retournons donc sur nos pas, remontons
même
lui;
To-
et
au 8
novembre 1665, pour noter rapidement une seconde visite
du Tartuffe chez la princesse Palatine, toujours par ordre
de Condé, une de ces témérités réservées au Raincy, qui
retardaient d'autant l'autorisation de jouer la pièce au Palais-Royal.
Nous redescendons au vendredi 4 décembre.
jours (29
novembre 1665),
Il
y
a cinq
l'abbé Bossuet ouvrait la sta-
tion de l'Avent, dans la chapelle du Louvre, devant le
et
devant son frère; aujourd'hui,
pubHc
la
le
jeune Racine donne au
première représentation de sa seconde tragédie.
L'antagonisme de
la
troupe du Palais-Royal
troupe de l'hôtel de Bourgogne n'était pas
avant la fusion des deux théâtres en 1680.
fi)
Voir
Roi
U
Molièrîste,
t.
III,
p. 96 et 292.
La
et
pour
de
la
cesser
querelle des
100
LE MOLIERISTE
deux Mères
coquettes
épisode encore
croire,
en
plus
était
un curieux
ne s'imposait de toute
s'il
on
la force
demeure encore, malgré
testable, et qui
incident. Voici
auquel
singulier,
refuserait
d'un
fait
un
de
incon-
des amis de
le dire
Boilcau et de Furetièrc, malgré les Lettres en vers de Robi-
malgré La Grange lui-même, un fait inexpliqué.
Nous venons de voir les deux théâtres, comme deux
net,
joueurs,
jetant
avant, l'un la
Vizé, l'autre
chacun
sur le
carte
sa
mettre en
tapis,
Mère coquette ou les ,Amants brouillés de de
la Mère coquette ou les Amants brouillés de
Quinault.
Bataille de
La partie
dames
!
C'est le jeu.
continue. Le Palais-Royal, qui
(je le dis peut-être trop tôt
car
:
Le grand Alexandre ou Porus !
répond
bataille
Seulement,
»
—
de dames,
:
il
«
là-
carte en disant:
Alexandre
c'est ici la
de
bataille
Grand !
le
»
rois.
nouveauté du coup,
qu'on ne connaissait pas encore
reproduite
commence encore
une autre opinion
Bourgogne.
l'hôtel de
Après
y
a
une seconde
dessus), le Palais-Royal jette
«
il
et
n'y a pas deux rois,
qui ne
n'y
il
la
surprise
s'est
a
jamais
deux
pas
Alexandre. Le théâtre de Molière et l'hôtel de Bourgogne
n'en ont qu'un,
«
même
le
Alexandre, celui de Racine.
Alexandre, tragédie de
M. Racine,
Parfaict, (i) représentée sur le théâtre
celui de l'hôtel de
ou
le
Et
;i)
Bourgogne,
le
même
quinze du mois de décembre.
ils
ajoutent
Tome
:
«
IX, p. 386.
disent les frères
du Palais-Royal
jour, vers le
et sur
douze
»
Voici un exemple unique
;
une
même
10 1
LE MOLIERISTE
pièce jouée dans sa nouveauté sur deux théâtres à Paris.
Ce
fait,
quoique peu connu, se trouve rapporté dans
trois
différens ouvrages, le Bolœana, le Furctcriana, et les Lettres
Pour épargner au
en vers de Robinet.
lecteur la peine de
parcourir ces livres, nous allons transcrire les passages qui
regardent
la tragédie
ôl
M. Racine.
Alexandre de
du bolœana
Suit cet extrait
»
:
« Alexandre de Racine fut joué d'abord par la troupe de
Molière; mais ses acteurs jouant trop lâchement
la pièce,
l'auteur se rendit aux avis de ses amis qui lui conseillèrent
de
la retirer
l'hôtel
et
de
la
de Bourgogne;
donner aux grands comédiens de
elle
eut en effet chez eux
tout
succès qu'elle méritait, ce qui déplut fort à Molière
que Racine
plus
la
lui avait
débauché
fameuse de ses actrices
vir
dans
de
Molière
le rôle
et
Du
la
outre
Parc (i), qui était
qui depuis joua à ra-
et
d'Andromaque. De
de Racine,
;
le
là
vint la
brouillerie
qui s'étudiaient tous. deux à
soutenir leur théâtre avec une pareille émulation. »
Le passage analogue du
ni rien de
moins,
si
Fureteriana ne dit rien de plus
ce n'est en d'autres termes
:
Quoi, vous ne savez pas ce qui arriva à M. Racine,
«
au sujet de sa pièce d'Alexandre, qui
est
un ouvrage achevé
?
Ses amis l'avaient tous assuré de
la
bonté de sa pièce
;
ils
avaient raison. Lui, sur cette confiance, la
(i)
Delosme de Monchesnay
choses qui ne sont pas du
se trompe,
même
temps.
il
met sur
la
met dans
même
ligne
quitter la troupe de Molière avant la clôture de l'année théâtrale
1666, c'est-à-dire le 11
mars 1667 qui fut la
10 novembre 1667.
fin
avril
1666, et
deux
M"e Du Parc ne pouvait
elle
pas
1665-
dut y rester jusqu'au 29
de l'année suivante. Androinaque fut jouée
le
LE MOLIÈRISTE
102
les
mains de
pièce
la
belle
si
troupe de Molière. Qu'arriva-t-il
mauvais succès, s'en prend à ses amis qui
donné
«
bonne opinion.
si
Votre
cela
la
donnez
:
à jouer à
c'est
pour
mais donnez-la à
n'a pas réussi;
de Bourgogne, vous verrez quel succès
conseil fut suivi, et cette
en avaient
lui
comique;
le
si
amis répondirent
les
mais vous
jouer que
sait
cela seulement qu'elle
Ce
A
pièce est excellente,
une troupe qui ne
l'hôtel
Cette
?
tomba. M. Racine, au désespoir d'un
elle aura. »
donna une grande
pièce lui
réputation. »
Voilà
souvenirs qui restaient dans
les
amis de Racine. C'était
ainsi qu'ils parlaient
une génération nouvelle,
Mais ces souvenirs,
à
attentive
recueillis
pouvaient
qu'ils
opposaient,
comme
il
leurs
entretiens.
man-
de seconde mémoire,
quaient naturellement de précision;
parce
société des
la
du passé devant
l'être,
et
était correct
ils
étaient suspects
les frères
de
Parfaict
gnages contemporains notés presque au jour
leur
deux témoi-
le faire,
le !jour,
cha-
cun avec sa date authentique.
Il
est bien vrai qu'à quinze jours
de distance,
la Ga:(ette
de Robinet avait annoncé l'apparition de deux AlexandreSy
à l'étude chez les deux troupes rivales,
tions simultanées
Royal
les
de V Alexandre de Racine
ainsi qu'à la rue
Mauconseil
:
Le Grand Alexandre,
Lequel, après des deux mille ans
Qu'il fut fléau des Persans,
A
et
repris nouvelle origine
D'une poétique Racine
représenta-
au
Palais-
LE MOLIERISTE
Qui
le
même à la
produit
Sur deux des Théâtres
I03
fois
françois. (i)
C'était de quoi autoriser les frères
deux Ana que
contre les auteurs des
,
Parfaict à soutenir
la tragédie
cine avait été jouée pour la première fois le
sur le théâtre de Floridor et sur celui
quel était ce
au juger,
même
jour?
le
— Robinet, dans
sa lettre
même
jour
de Molière; mais
12 (2) ou
dimanche 14
qu'il est allé, le
de Ra-
le
décembre,
15
du 20 décembre, disant
(3), voir V Alexandre
du Pa-
lais-Royal.
Ce
qui a
manqué aux deux consciencieux
Théâtre-Français, c'était
raient
vu que
(i)Aux deux
la
citations de
Robinet,
y
du
au-
frères Parfaict
auraient
on
nom
(Puisqu'on
loue,
qu'au Palais-Royal
L'ouvrage est rare
seul
pu
:
de Bourgogne on joue
pièce que fort
De même
Son
les
moins connue, de Maïolas de La Gravette
l'hôtel
Une
Ils
première représentation du Grand Alexan-
ajouter cette apostille,
A
historiens
de La Grange.
le livre
et jovial
vous
l'intitule
le fait
;
(?).
comprendre
Alexandre)
;
Et, sachant celui de l'auteur.
Excellent versificateur,
Qia'on
Où
nomme
Monsieur de Racine,
la science s'enracine.
Je crois que vous ne doutez pas
Qu'il soit plein de force et d'appas.
(2)
Lire
le
13; le 12 décembre était
un samedi
et le
samedi
n'était
pas jour de spectacle.
(})
Je transcris le chiffre 14 d'après la copie des frères Parfaict
15, qui est la date
du dimanche.
;
lire
^^ MOLIÈRISTE
104
dre
et
Sortis au Palais-Royal avait eu lieu
1665,
même
4 décembre
le
Bourgogne
première à l'hôtel de
et la
le
du
18
mois, à quatorze jours d'intervalle. Les auteurs du
Bolœana
et
du Fureteriana ont donc
Contre Robinet
Maïolas de
et
la
raison.
Gravette
— Contre qui?
— Non pas
?
;
contre les frères Parfaict.
Etablissons bien les dates.
dans
C'est
la
Robinet annonce
Lettre
vers
29 novembre
du
deux Alexandres
les
céder aux deux Mères
jouait encore
en
comme
coquettes; celle
que
devant suc-
du Palais-Royal
se
:
Mais on attend deux Alexandres
Qui
leur feront bien faire Flandres,
Proverbe
Pour
et
façon de parler
dire faire détaler.
décembre que Molière donne
C'est le 4
première
sa
représentation de la tragédie, qui n'était qu'une comédie
héroïque.
C'est le
1 3
décembre que Robinet
assiste à la
quatrième
représentation, et dans sa lettre du 20 qu'il en rend
la
il
compte ;
première de l'hôtel de Bourgogne ayant eu lieu
pouvait écrire,
le
sait à la fois sur les
duisait
pour
Quant
la
20^ que
la
dire qu'elle s'y pro-
fois.
à la question de succès, qu'en faut-il penser
Le quatre décembre,
18,
pièce de Racine se produi-
deux théâtres sans
première
le
la
pièce
bien annoncée
?
par
le
théâtre et bien lancée par ses prôneurs, le public heureu-
sement prévenu par l'enthousiasme des amis du poète,
recette s'éleva au gros chiffre de
1294
livres,
mière de La Thébaïde n'avait été que de 370
—
livres.
la
la
pre-
LE MOLlèRISTE
.DOS
on ne
Si Teffet de la représentation fut médiocre,
chiôre du second jour
aperçoit guère au
s'en
(6 décembre),
qui est encore de 1262 livres.
Le
cause de
la
fête
de
neuve Saint-Honoré
de
et
superbes
cérémonies
vendredi,
la recette
A
?
13, le jour
quatre chiffres,
la
mais
;
rue
la
dit
ce qui ne
s''é-
remonte victorieuse-
vit
dans
neuvaine de
peut être. Le
livres,
elle
où Robinet
comme on
cette
rigueur, cela
la
de
l'église
magnifique procession hono-
descend à 943
carte pas encore de mille
le
A
cause de la transla-
du Roi qai termina
rée de la présence
ment,
A
de Saint-Roch en
des reliques
ce relâche ?
Conception? Mais l'interruption
la
de coutume ce jour-là.
n'était pas
tion
La Grange. Pourquoi
8, néant, dit
aux
spectacle,
le
les théâtres, et
mieux
encore avec 1165 livres 10 sous de chambrée.
C'est à la cinquième représentation que la
centue
faute
comme un
désastre
currence que Racine se
jette,
460
:
livres
10 sous; à qui
fait
à lui-même, du discrédit qu'il
de concert avec ses amis, sur
troupe du Palais-
la
Royal, et de l'autre Alexandre annoncé par
l'hôtel
A
tel
la
de l'étrange con-
recette subit le contre-coup
si la
baisse s'ac-
l'affiche
de
de Bourgogne?
la sixième,
378 Hvres; mais
de Bourgogne
tire
montre insolemment à
La Grange
fut surprise
le théâtre
tait faite
écrit sur
que
la
ses
la
son
moment où
Ménechmes de l'ombre
chandelle;
livre
même
c'est le
:
«
c'est le
Ce même
l'hô-
et
les
moment où
jour, la troupe
pièce d'Alexandre fût jouée sur
de l'hôtel de Bourgogne.
Comme
de complot avec M. Racine,
pas devoir les parts d'auteur audit
la
la
chose
s'é-
troupe ne crut
M. Racine,
qui en usait
I06
LE MOLlèRISTE
mal que d'avoir donné
si
et
apprendre
fait
pièce aux
la
autres comédiens. Lesdites parts d'auteur furent partagées
chacun des douze acteurs eut pour
et
Va pour
conque
ait été
et
donc
livres. »
47
quarante-sept livres, c'est une vengeance quel-
une consolation
surprise
Quoi donc
sa part
?
,
ce
voilà
Aucun des
lu l'apostille
mais que
telle quelle;
troupe
la
ne se comprend
qui
guères.
acteurs du Palais-Royal
de Robinet
n'avait
:
Mais on attend deux Alexandres...
Car Robinet
tre
y
l'avait
bien dit sans avoir
l'air
de commet-
une indiscrétion. La nouvelle méritait pourtant qu'on
garde
prît
les théâtres
On
On
et
qu'on
allât
sur le
champ aux
Tous
écoutes.
ont toujours eu une oreille Tun chez l'autre.
se serait bientôt
mis au courant de ce qui se
eût su que Floridor montait réellement
ce qui n'était pas autrement irrégulier
YtAlexandre de l'hôtel de Bourgogne
Royal, par un tour audacieux de
,
et
passait.
un Alexandre,
mais encore que
du
celui
Palais-
concurrence, ne
la
fai-
saient qu'un seul ^Alexandre.
On
négligea donc le soin le plus élémentaire
mais rien
;
ne s'explique, à vrai dire (i), dans cette obscure histoire.
(i)
En 1666, ou du moins
de 1665
et
pagnie des
sous cette date, peut-être donc vers la
au mois où nous sommes, parut, publié à Paris par
libraires,
un
petit
volume
in- 16 avec ce
titre
«
:
^Alexandre ou Torus, rot des Indes ^ tragédie représentée sur
royal de l'hôtel de Bourgogne. Pas de
nom
représentation, titre nouveau et calqué de
de Racine qu'on pouvait
lecture
du premier
vers,
le
on reconnaissait
le
théâtre
d'auteur, pas de date de la
si
prendre pour ce
fin
comLe Grand
la
près sur celui de la
titre
lui-même
;
pièce
mais dès
la
l'auteur, c'était l'abbé Boyer;
IO7
LE MOLIÈRISTE
Où
était
Racine, tandis que Robinet annonçait
KÂlexandres?
pétitions
qui est
Le voyait-on ou ne
du Palais-Royal?
le
voyait-on plus aux ré-
on ne
Si
l'y
des ne prenaient-ils aucun soupçon de
De
quel
il
:
?
ins-
14 décembre, quatre jours avant
le
les
?
première représentation de l'hôtel de Bourgogne,
tesse
parmi
une explication que chaque
tant pouvait rendre inévitable
Ajoutons ceci
faisait-il
S'il
une cruelle humiliation
préparait
air s'exposait-il à
camara-
et ses
son absence?
venait toujours au théâtre, quelle figure
comédiens auxquels
ce
voyait plus,
comment Molière
difficile à croire,
deux
les
d'Armagnac ayant l'honneur de
per auquel assistaient Monsieur et
traiter le
Madame
fut
com-
la
Roi,
la
le
sou-
précédé
d'une représentation du Grand Alexandre. La tragédie de
Racine n'avait donc pas
la
si
mal
réussi au Palais-Royal et
troupe de Molière n'avait pas
on reconnaissait
en
la pièce, c'était
disent les frères
1647,
Torus ou
si
mauvaise figure dans
la Générosité
imprimée
Parfaict,
d'Alexandre, jouée
in-40, chez
Toussaint
Qjiinet en 1648.
Pourquoi toutes ces supercheries? C'était
Boyer, on
le sait bien,
de théâtre,
et
qu'on
que son
nom
les reconnaîtrait
savait pas qu'elles fussent de lui.
anonyme
Il
la
prétention du bon abbé
seul portait
y
aurait
Il
y
l'avait
a
^
pièces
ses
si
l'on ne
peut-être là l'excuse d'un
maladroit que tardif; mais où est celle du
aussi
avec la circonstance aggravante d'un rusé plagiat
ou Parus
malheur à
pour des chefs-d'œuvre
:
changé
titre
Le grand Alexandre
à côté du Grand Alexandre et Parus?
et, il
y
a au, disent Figaro et le docteur Bartholo, mais
Boyer
inventé avant Beaumarchais.
Est-ce que, par hasard, quelque chose de cqs petites finesses n'aurait
manège de Racine
pas pu servir à cacher le
peut-être
même
de Bourgogne
à Robinet, que V Alexandre
était
une
reprise de l'abbé
et laissé croire
à Molière,
mis à l'étude par l'hôtel
Boyer?
LE MOLIÈRISTE
I08
que voulaient bien
rôles
ses
puisque
la
du
régal de la pièce? Quelle fut l'opinion
Dans tous
amis de
dire les
comtesse d'Armagnac donnait
Racine ne
les cas,
l'avait
Roi complimenta
tume de
les
On
roi ?
le
l'ignore.
pas attendue pour s'en
autoriser à passer par-dessus tous les usages
si le
l'auteur,
à Sa Majesté
du théâtre,
comme
comédiens,
il
et
cou-
avait
quel prétexte avait encore Racine pour
le faire,
poursuivre son incroyable procédé ?
Mais qui
l'auteur et
ce qui s'était passé, dans le cabinet, entre
sait
le
comédien directeur de
sa
troupe du Palais-Royal n'avait jamais eu
de Racine.
Il
ne
lui avait
de l'Hôtel,
de
c'est
avait retiré celle-ci
s'il
que l'Hôtel ne pouvait pas
pour son impatience. Après
la Thébaïde,
prédilections
pas donné sans hésitation et sans
regret la tragédie de la Thébaïdcy et
assez tôt
compagnie? La
les
la
représenter
médiocre succès
le
Palais-Royal n'avait pas dû se relever
le
comme
dans son estime. Toutefois,
il
le
encore en
en bons termes
délicatesse avec Floridor et qu'il restait
avec MoHère, dont
était
théâtre le retenait d'ailleurs par de
secrètes attaches, Molière dut recevoir la première confi-
dence de son nouvel ouvrage. Le manuscrit à peine
miné
passa, je suppose, entre ses mains.
de suite une distribution des rôles
— Cléophile,
Alexandre,
M"^ Molière
La Grange.
:
Il
était
Axiane, M"^
;
la lecture
Du
ter-
tout
Parc;
;
— Distribution jeune
prévenu,
Corneille l'avait blessé, et le
Après
esquissa
— Porus, La Thorillière —
naturellement indiquée, mais qui ne
sans défiance.
Il
il
mot
était inquiet.
restait
d'Alexandre, que
avait faite, l'illustre vieillard, loin
laissait
le
dans
jeune
et brillante,
pas Racine
Un mot
de
la blessure
homme
:
lui
de deviner dans l'auteur
IO9
LE MOLlàRISTE
un
futur rival, lui avait
conseillé de {s'appli-
ingénument
quer à tout autre genre de poésie où
—
rappelle des paroles connues,
ne
excellerait,
il
—
je
jugeant pas propre
le
au tragique.
Ce jugement, que Racine ne pardonna jamais
vivant,
devant
il
de
s'agissait
à Corneille
en donner un éclatant démenti
lui
Malheureusement, à l'exception de M"*
le public.
Du
Parc, qui était née reine de théâtre, les autres acteurs ne
le
MoHère
prenaient pas d'un ton aussi haut.
gnait qu'il n'y a pas deux principes de leur
On
du comédien.
pour
commun
modèle
vérité est le
surfaire
en dépit d'elle-même par
lisant les
louanges
Et
et
pour enfler
véhémence de
la
je le vis aussi
lui-même (Alexandre)
Mais beaucoup plus beau
Quand
l'univers
D'ailleurs,
Que ne
G
il
il
qu'il n'étoit
conquêtoit.
me parut
fut l'ancien
Mais à dire
plus tendre
Alexandre
;
la vérité.
jeune majesté
flamme
bien pour objet de sa
Une
la situation
En
ce qui faisait le cha-
comprend
Dedans une jeunesse extrême,
A
comme
leur débit.
:
Ici sa
la
mêmes que Robinet prodigue aux comé-
diens du Palais-Royal, on
grin de Racine
de l'acteur tragique
que
ne pouvait donc pas compter sur eux
personnages
les
leur ensei-
art, et
toute autre aimable dame.
justes dieux, qu'elle a d'appas
Et qui pourroit ne l'aimer pas
Sans rien toucher de sa
Ni de sa
?
coiffure,
belle chevelure,
Sans rien toucher de ses habits
Semés de
perles, de rubis
!
1
10
LE MOLIERISTE
Et de toute
la pierrerie
Dont
l'Inde brillante est fleurie,
Rien
n'est si beau, ni
Et
je puis dire
Qu'ensemble
D'elle ont
Amour
fait
si
mignon,
tout de bon
et la
Nature
une mignature
Des appas, des grâces, des ris
Qu'on attribuoit à Cypris.
Là Porrhus (sic) fait aussi son
rôle (i)
Et généreusement contrôle
Ce grand vainqueur de
même
Lors
l'univers,
qu'il le tient
aux
fers
:
Ainsi que la grande Axiane (2)
Brillante
comme une
Tant par
ses riches
Que
Qui
Diane,
vêtements
par tous ses attraits charmants
font que ce Porrhus soupire
Pareillement sous son empire.
Enfin
j'y vis,
sous des habits
Qui sont sans doute
aussi de prix,
Ephestion avec Taxile,
Et certes
De
il
(3)
est difficile
pouvoir rien trouver de
tel,
Si ce n'est peut-être à l'Hôtel.
Je laisse à penser, par parenthèse,
et si le « peut-être »
galité intacte entre la représentation
gogne
et celle
:
Le
(3)
sieur de la Thorillière.
Du
une chute
même
l'é-
Parc.
Les sieurs du Croisy
et
Hubert.
était plus
jeune
que l'Alexandre de Macé-
doine. L'autre (M"^ Molière) était
Mlle
laisse
de Thôtel de Bour-
L'un (La Grange)
et plus beau, plus tendre aussi
(i)
cela sent
du Palais-Royal; mais remettons-nous au
point de vue de Racine
(2)
si
du dernier vers ne
un abrégé des perfec-
III
LE MOLIERISTE
Vénus
tions de
beau ni
si
Vénus en miniature.
et
mignon.
Voilà
»
comédie héroïque; mais
Rien
«
charme, voilà
le
la tragédie,
elle
l'idylle
et la
n'y est pas. Ainsi
du Palais-Royal donnaient raison à
les acteurs
n'est si
la terrible
jwophétie du grand Corneille.
Pour que Racine ne
que
eût fallu
ses Frères emiemis.
aussi
eût fallu que le poète ne fût pas
Il
grand maître dans
qui était
le
de
l'art
la
ai
Alexandre,
retrouva
il
difficultés qu'il avait déjà
Les résistances commençaient
sa troupe,
pour
il
même
l'esprit
:
un
déclamation oratoire,
Dès
contraire de l'école de Molière.
mières études
mêmes
redouté d'avance,
pas
l'eût
Palais-Royal n'eût pas déjà représenté
le
les
pre-
certainement
eues avec
les
les
comédiens.
Molière prenait parti pour
de son théâtre. C'était un
point sur lequel Racine et lui n'avaient jamais pu s'accorder.
Admettons maintenant, pour suivre
ma
supposi-
admettons que Racine n'eût jamais
tion jusqu'au bout,
définitivement abandonné sa pièce à Molière, que les répétitions eussent été
moment où Racine
commencées
voulut retirer son manuscrit,
se fût toujours refusé à
un peu mieux,
raient
à titre d'essai, et qu'au
le
la
MoUère
rendre; les choses s'explique-
prétention de l'auteur et du direc-
teur à être chacun maître de l'ouvrage, Racine en querelle
avec
Molière
Royal,
ne remettant plus
et
la surprise
même
du moins que, tout prévenus
Racine,
cution.
ils
Quant
à
MoUère,
de Bourgogne
le
il
pieds au Palais-
qu'ils étaient
ne croyaient guères que
n'est pas douteux, car
les
dont parle La Grange, en ce sens
il
de
la
celui-ci la
menace de
mît à exé-
fut bien m-oins étonné,
se tut et
cela
ne contesta pas à l'hôtel
droit de jouer, contre l'usage,
une pièce
112
LE MOLléRISTÉ
en cours de représentation chez
lui et
qui n'était pas im-
primée.
Le coup
Racine.
tait la
était cruel et
même
entre eux et
pour toujours avec
brouillait
le
Quant aux comédiens de
l'Hôtel, la situation res-
Les deux camps ne pou-
lui.
vaient pas devenir plus irréconciliables.
mais
Mauconseil,
l'affiche
le
Œillets,
M^'''
Alexandre
la partie:
Floridor,
La Thoril-
M"^ Du Parc contre M"^ Des
MoHère contre
d'Ennebault. Jusque-là,
M"'=
ce n'était pas trop punir le déserteur
le reprirent-ils
par un autre côté.
aussi les
;
On
comédiens
décida que ses parts
d'auteur ne lui seraient pas servies. Elles formaient
déjà
une somme assez honnête, cinq cent soixante-quatre
La Compagnie
vres.
se les partagea, ce qui
douze comédiens quarante-sept
Aubaine d'assez mauvais
dant, surtout
tions,
elle
livres
pièce, qui n'avait eu
un
n'en eut plus que trois
dimanche qui
fut
fixa
le
une aubaine cepenque
six représenta-
nombre; mais
l'une le 20
décembre, un
jour où
le prix
le
livres
de
recette
Roi, séant en son
le
dimanche 27, où mourut,
entourée du respect universel, l'Arthénice de Racan,
d'Angennes,
l'illustre
la fondatrice
cieuses, Catherine
;
lit
des charges des cinq compagnies
souveraines; la troisième,
Rodanthe de Malherbe,
li-
à chacun des
certain
assez heureux, 597
mardi 22,
justice,
:
fit
pour son compte.
aloi, c'était
devait en avoir encore
l'autre, le
de
si la
si
Palais-Royal à supprimer
La Grange contre
contre Montfleury,
lière
le
Molière soutint résolument
contre Alexandre,
triomphait rue
triomphe eût été trop complet
de l'Hôtel eût obligé
la sienne.
On
mère de
la
la belle Julie
de l'ordre des véritables pré-
de Vivonne, marquise de Rambouillet.
Edouard THIERRY.
COTIN ET TRISSOTIN
Nous ne croyons
deux passages
ait
encore mis en regard
très curieux et très
importants du Mercure
pas qu'on
Galant de 1672, dans lesquels
savantes
et
question des Femmes
est
il
du personnage épisodique de
que
Trissotin,
Molière avait imaginé pour donner satisfaction à une de
ses anciennes colères contre l'abbé Cotin.
que Tabbé Cotin ne
mons
qui attiraient en foule la
des gens de cour. Voici
la
Il
société précieuse et
;
car
il
s'était,
époque, rapproché de Donneau de Vizé, qui
«
l'élite
à cette
un excel-
fit
compte-rendu des Femmes savantes dans son
Galant
ser-
première note, que Molière
pourrait bien avoir rédigée lui-même
lent
présume
est à
ménagé dans un des
pas
l'avait
V\Cercnre
:
Bien des gens font des applications de
Savantes, et
une querelle de l'auteur,
homme
lettres
de
il
la
comédie des Femmes
y a environ huit ans, avec un
qu'on prétend être représenté par M. Trissotin
donné
lieu à ce qui s'en est publié
justifié
de cela par une harangue
;
mais M. de Molière
qu'il
fit
est
,
a
suffisamment
au public, deux jours avant
la
première représentation de sa pièce. Et puis ce prétendu original de cette
agréable comédie ne doit pas s'en mettre en peine,
aussi habile
homme
que l'on
dit,
et cela
s'il
est aussi sage et
ne servira qu'à
davantage son mérite, en faisant naître l'envie de
ses écrits et d'aller à ses serraons. Aristophane
le
ne
faire éclater
connoître, de
lire
détruisit point la
réputation de Socrate dans une de ses farces, et ce grand philosophe ne
fut pas
moins estimé dans toute
La seconde
la
Grèce. »
note, qui n'a pas l'allure fine et malicieuse
8
LE MOLIERISTE
114
de
que
M.
mena,
de son journal naissant engageait h
l'intérêt
compter avec
«
Donneau de
première, ne saurait être attribuée qu'à
la
Vizé,
le crédit et l'influence
de l'abbé Cotin
:
l'archevêque de Paris, directeur de l'Académie française, la
ces jours passés, à Versailles, pour remercier le Roi de l'honneur
qu'il a fait à cette illustre et spirituelle
de Protecteur, qu'avoit feu M.
la place
de l'Académie,
est aussi
traita
compagnie, d'en vouloir prendre
le chancelier.
magnifiquement ce
..
M. Dangeau, qui
prélat avec tous les
académiciens ses confrères. M. Cotin n'étoit point de ce nombre, de
peur, dit-on, qu'on ne crût qu'il s'étoit servi de cette occasion pour se
plaindre au Roi de
contre
lui
comédie qu'on prétend que M. de Molière
la
mais on ne peut croire qu'un
;
premières personnes de
les
la
de son ami, puisse être cru
en
trait,
fait
qu'on
effet,
lui attribue
Paraphrases sur
dont
h
que Mademoiselle honore du
d'une
si
nom
sanglante satyre. Le por-
ne convient point à un
a plusieurs éditions; ce sont des jeux
qu'il
qu'on
sait qu'il le fait
On
fit
homme
qui a
où
il
s'amusoit,
profession qu'il a embrassée avec autant d'austérité
la
maintenant.
»
peut rapprocher de ces deux citations, datées de 1672,
citation d'une
empruntée
date bien postérieure, puisqu'elle est
à la Réponse, de Bayle,
aux Questions d'un Pro-
ouvrage de polémique qui ne parut qu'en 1704,
vincial,
à Rotterdam, en
5
volumes
in- 12
:
Cotin, qui n'avoit été déjà que trop exposé au mépris public par
les Satyres
de M. Despréaux, tomba entre
acheva de
le
risée
ait faite
souvent parmi
Cantique des Cantiques. Je ne parle point de ses Œuvres
y
il
avant
«
et
est
des ouvrages qui ont eu une approbation aussi générale que ses
galantes,
une
Cour,
l'objet
homme qui
de tout
deux ou
trois
les
mains de Molière, qui
ruiner de réputation, en l'immolant sur le théâtre à la
le
monde. Je vous nommerois,
si
cela étoit nécessaire,
personnes de poids qui, à leur retour de Paris, après
les
premières représentations des Femmes savantes^ racontèrent en province
qu'il fut consterné
comme
de ce coup; qu'il se regarda
et
qu'on
le
considéra
frappé de la foudre; qu'il n'osoit plus se montrer; que ses amis
l'abandonnèrent; qu'ils se firent une honte de convenir qu'ils eussent
eu avec
lui
quelques liaisons
et qu'à
l'exemple des courtisans qui tournent
115
LE MOLIÈRISTE
le
dos i un favori disgracié,
ils
firent
semblant de ne pas connoître cet
ancien ministre d'Apollon et des neuf sœurs, proclamé indigne de sa
charge
et livré
au bras séculier des satyriques. Je veux croire que c'étoit
on n'a pas vu qu'il ait donné, depuis ce temps-lâ,
des hyperboles, mais
nul signe de vie, et
roit
inconnu,
si
il
y
l'Académie françoise, ne
L'abbé Cotin, en
représentation des
ans,
il
s'était
a toute apparence que le temps de
la réception
sjl
mort se-
de M. l'abbé Dangeau, son successeur à
l'avoit notifié.
effet,
Femmes
»
survécut dix ans à la première
savantes; mais pendant ces dix
complètement
dans
retiré
probable que ces
la solitude et
dans
allégués par Bayle,
l'oubli.
Il
comme
des on-dit de la province en 1672, lui avaient été
est
communiqués par
l'avocat
faits,
Mathieu Marais, auquel
tant de renseignements littéraires intéressants,
fait
il
devait
dont
usage dans son Dictionnaire.
P.-L.
JACOB,
bibliophile.
il
a
LA MAISON MORTUAIRE
dans une de ses
des Inscriptions parisiennes s'est occupé,
en 1673.
Molière
par
habitée
maison
la
de
séances,
Le Comité
dernières
lecteurs des obserdevoir donner connaissance à nos
au Comité à ce
présentées
été
ont
qui
écrites que verbales,
Nous croyons
vations, tant
sujet par notre collaborateur,
M. Ch.
Nuitter
:
du lieu de mort
1844, une plaque commémorative
la Seine sur la
de Molière fut placée par la Préfecture de
maison de la rue Richelieu, portant le n° 34.
En
qu'habitait Molière
Cette maison n'était pas celle
dans laquelle
Depuis
on
lié,
la
sait
il
et
avait expiré.
publication des Recherches de
d'une façon certaine que
maison de Molière
le
M. Eudore Soupropriétaire de la
s'appelait Batidelet.
contemporain prouD'autre part, un document presque
Baudelet était beaucoup plus près de la
vait
que
la
maison
rue des Petits-Champs que
la
maison sur laquelle
était
placée l'inscription.
La
Bibliothèque Nationale possède
d'un précieux manuscrit dont
apprécier combien
il
»
Estât
et
chacun des
suffit
qu'un
pour
faire
de
cette
travail
:
Partition de la Fille
sei-e quartiers,
titre
serait désirable
importance pût être publié
«
le
deux exemplaires
et
fatixbourgs de Paris en
ordits quartiers dirigé sous les
II7
LE MOLIÈRISTE
»
dres de Messieurs
»
un
»
de sorte que l'on
»
roisses, Eglises,
les
Prévost des Marchands
quartenier assisté de ses cinquanteniers
» et maisons,
connoistre et voir
y peut
chapelles^ Monastères,
ensemble
nom
le
Eschevins, par
et
et di:(ainiers, divisé
le
nombre des Pa-
communautés,
hostels
propriétaires
des habitants^
et
du
»
principaux locataires des
»
premier jour de janvier mil six cens quatre-vingts quatre. »
D'après ce document,
let,
la
occupée par
la
dites maisons,
maison du sieur abbé Baude-
de Beauprez, est
le sieur
rue des Petits-Champs.
réduit
tout
le
Il
huitième par
la
arrive souvent, dans
les
re-
cherches de ce genre, que deux maisons ont été réunies
par un propriétaire postérieur, ou qu'un vaste immeuble a
été
dès lors,
divisé;
on ne
se retrouve
plus
dans
compte et l'on court le risque de désigner la maiscii
voisin.
Une
erreur semblable
à craindre en
n'est pas
qui concerne la maison mortuaire de MoUère.
ble appartient actuellement à la C'^
voulu donner communication des
montant au
Il
La
Foncière, qui a bien
appartenait à
que
la
maison n° 40 (malheuest
bien celle qui
René Baudelet.
La preuve se trouve
s'agit
MoUère, on a
trer
de propriété, re-
titres
reusement reconstruite de 1765 à 1768),
Quand
ce
L'immeu-
xvii^ siècle.
résulte de ces titres
il
le
du
ainsi faite.
de rendre un
cette rare
hommage
à la
mémoire de
bonne fortune de ne pas rencon-
de contradicteurs.
Il était
donc
inutile d'insister sur l'intérêt qu'il
à désigner exactement l'emplacement de la
laquelle
MoUère
a passé les derniers
y aurait
maison dans
mois de
sa vie.
Il8
LE MOLIÉRISTE
paraîtrait
Il
même
en
temps convenable que
tion placée par erreur sur la
Il
faut reconnaître
dans
M.
les
que
maison n° 34
hommages rendus
Jla
Le 9 mai 1876,
Seine,
la
membre
alors
avait invité l'administration à
dre les mesures nécessaires pour que le
mémoratif de
fût retirée.
n'a pas été heureux
à Molière.
F. Hérold, depuis préfet de
du conseil municipal,
on
jusqu'ici
l'inscrip-
pren-
monument com-
naissance de Molière existant sur la
son rue du Pont-Neuf, n" 31, fût transporté à
mai-
maison
la
rue St-Honoré, n° 96, et pour que l'inscription en fût rec-
conformément
tifiée
qu'on substituât à
comme
année de
à
la
la
la
vérité
date de
historique,
1620,
qui
naissance de Molière,
c'est-à-dire
donnée
y
est
la
date
réelle
de c^^Q naissance, qui est 1622. (i)
Ch.
(i)
La
NUITTER.
rectification n'a été faite qu'à moitié, et
ques mètres de distance, deux maisons natales
nous voyons, à quel-
(c'est trop
tume!), celle de la rue du Pont-Neuf (1620), celle de
1622)
!
Que
doivent penser
singulière mystification?
les
étrangers, qui
la
pour
la
cou-
rue St-Honoré
visitent Paris,
de
cette
G. M.
BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESaUE
Editions classiqijes.
nier bulletin
pièces de
Femmes
savantes
parlions, dans notre der-
publiées par
fait paraître,
de son côté,
et Y^Avare,
accompagnés d'un com-
le
Tartuffe,
professeur de
rhé-
au lycée d'Angoulême.
torique
Chacune de
biographique
toutes les
cheurs
La
Garnier.
la librairie
mentaire par M. Maurice Pellisson,
fit
nouvelles de
des éditions
bibliographique,
Molière,
maison Delagrave a
les
— Nous
;
son
ces trois comédies est précédée d'une étude
et littéraire sur
Molière. L'auteur a mis à pro-
découvertes récemment
étude est écrite
surtout est intéressant
:
avec élégance
c'est celui
par les cher-
faites
;
un
chapitre
où M. Pellisson
de nous représenter quelles étaient les
essaie
idées de Molière
sur son art.
La
notice sur le
Tartuffe
de l'hypocrisie, dans toutes
exactitude.
Le commentaire
reproduisant pas
le
—
c'est
M.
Pellisson s'est
là
une
texte
est
les
très
complète
est
des
éditions
gratuitement privé
faible.
En
En ne
son orthographe,
Delagrave,
d'occasions
pour des notes réellement instructives. Chez
mentaire philologique est
l'histoire
surtout littéraire.
original avec
infériorité
:
époques, y est traitée avec
lui, le
revanche,
les
—
utiles
comnotes
historiques et littéraires sont délicates, justes et piquantes.
120
LE MOLIÈRISTE
Quelques réflexions morales nous ont paru un peu har-
un commentaire destiné aux
dies dans
classes.
commentaire de
critique pourrait s'adresser au
La même
la
première
scène des Femmes savantes.
Un
t-il
reproche encore
pas
variantes
les
:
?
pourquoi M. Pellisson ne donne-
Une
édition
classique
contenir toutes. Elles permettent à l'élève
transformations par lesquelles
arrivée à sa
forme
quoi qu'en aient
cette
définitive, et
d'une grande netteté,
style est
forme
Fénelon,
dit
chez
de
suivre les
de l'écrivain est
pensée
la
devrait les
les écrivains
comme
dont
le
celui de Molière,
Rousseau
et
M. Scherer,
est toujours la meilleure.
Nous aurions voulu trouver encore dans les éditions de
M. Pellisson l'histoire de chaque pièce, première représentation,
jours
de
avec quel succès,
et
Restauration.
dans
depuis
etc.,
l'origine
jusqu'à
nos
eût été curieux, par exemple, de savoir combien
il
;
fois,
reprises,
Tous
les éditions
ces
de
le
Tartuffe fut joué sous
détails sont
MM.
Person
la
donnés, avec mesure,
Marcou. M. Pellisson
et
pourrait peut-être profiter d'une réimpression prochaine
pour compléter son
— M. G.
téraire
du 10
travail sur ce point.
Guéroult a pubhé, dans
juin,
Molière
librettiste,
sement
sentir.
un
la
Revue politique
article sur le Sicilien
dont l'urgence ne se
faisait
M. Guéroult, qui se porte garant de
M. Scherer », éprouvait le
rénité de
sa « préférence
ivlolière a
très
marquée pour ces
déployé, sinon
le
«
et lit-
de M. Sauzay
:
pas impérieu-
l'impassible sé-
besoin de confier
petites
plus pur, au moins
pièces où
le
plus ori-
tll
LE MOLIÈRISTE
ginal de
son génie.
que
roult,
Molière
son temps
Ah
fait
!
dans
«
était forcé
»
dix fois les
;
»
c'est
et
Femmes
œuvres
ses
de
donné ce
fois fait déjà
du
sique de
il
M.
ridicule
comme
et
!
)
des Vadius (J. Janin, lui
que M.
Car
Guéroult a
ne suppose pas
je
inédits le
Sicilien et
y a
six
rapprochement
du Barbier,
fâché
— M.
il
d'
M.
qu'il
vingt
les éloges
et
presse à la niu-
M. Guéroult
lui chétif (c'est
ont récemment éclaté sur
franchement,
la
écrit
des vers
la récolte
mois, par toute
Sauzay. Non,
qui parle) ne serait pas
«
»
C'est uniquement pour dire son
!
blancs qui fourmillent dans V Amour peintre,
décernés,
de
donnerait
«
pour V Amour médecin.
colonnes.
prétende donner
officielles,
littéraires
pourquoi M. Guéroult
savantes
voilà l'enclouure
ses cinq lourdes
classiques,
aux préjugés
sacrifier
à Tennemi des Trissotins
aussi, s'est
nous apprend M. Gué-
paraît,
Il
foudres qui
« attirer les
Scherer.
n'y a pas Heu de déranger
Eh
»
!
bien,
tonnerre
le
!
Arthur Pougin vient de réunir en brochure ses
articles sur Molière et
l' opéra-comique,
que nous avions
si-
gnalés lors de leur pubUcation dans
la
Cette plaquette, in-8° de éo pages,
imprimée en carac-
tères elzéviriens sur papier teinté,
trouve à
J.
se
Musique populaire.
la librairie
Baur, 9, rue Mazarine,
— La
Zeitschrijt
fur neufranxpsische Sprache und Literatur,
dont l'envoi nous a
été
supprimé depuis
le
jour où nous
avons eu l'impudeur de trouver mauvais qu'un
M. Pons,
« éreintât »
Victor
Hugo dans une
mande, a pubHé une intéressante étude
helm Mangold sur
le
critique
Misanthrope de Molière,
français,
revue
alle-
du D' Wild'après les
'
^^2
LE MOLIÉRISTE
travaux de
MM.
Despois,
Mesnard, Lavoix, G. du Bou-
lan et Coquelin aîné, (i)
— Notre collaborateur V.
brairie
Laplace
et
Fournel prépare, pour
Sanchez, une édition du
la li-
Théâtre choisi
deBoursault, qui sera précédée d'une
étude bio-bibliographique sur ce contemporain de
Molière.
—
tre
En
préparation, chez l'éditeur
Berger-Levrault, le Théâdu Marais aux XVIl^ et XFIIP
siècles, ouvrage
pos-
thume du
regretté baron
F.
de Marescot,
précédé d'une
notice par notre collaborateur
Jules Claretie.
—
Petite anecdote tirée de
l'intéressant ouvrage de
Welschinger
la Censure sous le premier
;
M. H.
Empire, qui vient de
paraître chez Charavay.
(2)
Vers 1801, un des employés de Félix
Nogaret adressa
au Ministre de l'Intérieur un long
rapport
«
où
il
proposait
de retrancher du répertoire du
Théâtre français Tartuffe,
« parce que cette pièce, alléguait-il, peut
déplaire au clergé
et que le Concordat, qui
vient de le rétablir en France,
a pour but principal d'étouffer
tous motifs de discorde qui
pourraient naître du pouvoir spirituel
en contact avec l'autorité civile. » Chaptal
communiqua ce rapport au Pre-
mier Consul:
naparte.
Il
«
faut
se nomme-t-il
Quel galimatias
que ce monsieur
? »
C'était
un de
!
observa
le
général Bo-
Comment
soit bien bête.
ces naufragés
de
pauvres diables faméliques, à qui l'on
abandonnait
délicate de juger en premier et
dernier ressort
les
(r)
(2)
In-So de 44 p. Oppeln, G.
Maske, 1882.
In-80 de 400 p.
4, rue de Furstenberg, prix
:
7
fr.
50.
lettres,
la
tâche
œuvres
LE MOLIERISTE
dramatiques
123
l'habitude
et qui avaient
d'écrire
s'écria le
la
premier Consul,
diatement. Encore une
il
est trop bête
»
!
professeur au Lycée Saint-Louis,
vient de publier chez Léopold Cerf, éditeur,
,
bien,
homme. Remplacez-le immé-
fois,
— M. Léonce Person,
Eh
une place d'inspecteur à
c'est
Halle qui convient à cet
rap-
leurs
ports sur le coin des tables des cafés borgnes. «
13,
rue de
Médicis, V Histoire du véritable Saint-Genest deRotrou (i), très
neuf
et très
curieux développement d'un chapitre de ses
Notes critiques
biographiques sur Rotrou, dont
et
— M.
Gabriel Désiré Laverdant, déjà connu des molié-
ristes par ses Renaissances de
'Don Juan, histoire morale du
moderne (2 vol. in-12, s.
en prose Don Juan converti (i vol.
théâtre
publié une Lettre à
M.
Littré
et
d.,
Hetzel) et son drame
in-12, Hezel, 1864,) a
aux
Positivistes
nous citerons seulement deux passages
«
nous avons
précédemment.
parlé
Qui donc, parmi
les petits enfants
(2) dont
:
philosophes superbes, a l'humilité de suivre
les
pour entrer dans
le
royaume
céleste de la Science ?
Marmot ignorantissime et ignorantifié, auraient ensemble répondu le
Dr Pancrace et le Dr Marphurius, il ne faut pas dire j'ai mangé, mais
M
:
il
me
semble que
confondue avec
comme Thomas
j'ai
mangé... D'autant
la figure.
—
Il
que
la
forme ne doit pas
être
faut savoir opérer dans les formes, et,
Diafoirus, pousser
un raisonnement jusqu'aux derniers
recoins de la logique.
Ah
!
que Molière, Vinspiré du Père Eternel, a donc bien
hors du Temple de
la
bonne Nature, à coup de verges
teurs de la science subtile, et vaine, et fausse, et ridicule
(i)In-i8de 103 pages.
vol. in- 18, Bar-le-Duc, typ. Philipona, 1881.
(2)
I
(3)
Pages 84-85.
fait
de jeter
riantes, les
!
(3)
Doc-
LE MOLIÈRISTE
124
Et plus loin (page 147)
psychologue
Littré,
ff
:
attentif, sait
que
spirituelle et le
l'Humanité. Si Molière est
le
qu'il a porté
personnages
ses
trope et
plus grand
au plus haut degré
Francisque
pauvre de
le
deux cents ans,
de
chef de l'école positiviste
«
:
les
donne dans
du Misan-
deux plus beaux caracrésumaient,
siècle, c'est qu'ils
du monde de
Sortir
Il
naturel. Si l'Alceste
double desideratum aujourd'hui
le
rôle
français, c'est
nos poètes
Don Juan sont
du théâtre français au XVIIe
tères
un
développement général de
comédie de caractère.
la
monnaie de l'Homme
la
caractères jouent
les
considérable dans l'activité
guerre, pour réaliser la justice et la paix...
il
y a
formulé par
l'iniquité et
{Révolution
le
delà,
positivisme^
et
502).
p.
Alceste s'écriait
:
]e vais sortir d'un gouffre
Et
chercher sur la terre
Où
d'être
C'est loin
forêt révèle
oii
un
triomphent
homme d'honneur on
du Monde, de
la
Cour
et
ait la liberté.
de
la Ville,
au courtisan impie, étonné de
l'homme d'honneur, de l'homme
les vices,
endroit écarté
libre.
la
que
tulé
:
:
le
Pauvre de
paraître pro-
Symbolisme du Misanthrope et un drame
Alceste consolé
ou
le
la
figure de
»
M. D. Laverdant annonce comme devant
chainement
le
rencontre, une
inti-
Désert d' Alceste, qui aura pour
suite le Paradis de Célimène.
Myrtil et Mélicerte, pastorale héroïque de N. A. M.
Guérin
le fils,
10^
qui forme le
collection moliéresqiie
,
volume de
vient de paraître
Bibliophiles, précédée d'une préface
M. Ed. Thierry
d'une notice de
et
à
la
la
muses ^ à St-Germain en
des
de M. Paul Lacroix
sur
pastorale ina-
la
chevée de Molière, Mélicerte, représentée dans
des
Nouvelle
librairie
Laye, en décembre
le
Ballet
1666, et
imprimée seulement en 1682.
Molière
Pourquoi
avait
le fils
écrit
deux actes
de sa veuve
a-t-il
eu
en vers
l'idée
de
alexandrins.
les
remettre
LE MOLIERISTE
en vers
libres
en y ajoutant un acte
Pourquoi surtout
n'a-t-il
de dire. Toujours
personnages.
et trois
pas conservé pieusement les stan-
ces exquises de l'entrée de Myrtil
aisé
I25
?
que
est-il
C'est ce qu'il est mal-
sa pièce,
d'abord à
lue
de Conty, fut représentée à
M""' la princesse douairière
Fontainebleau en octobre 1698, et à Paris, sur
l'Ancienne Comédie, rue
de
des fossés
Prés, le samedi 10 janvier 1699, sous le ûîre
par
Beaubour,
sieurs
les
Dufey,
Du
demoiselles
â-Q
Mélicerte,
Baron,
Dupérier,
Thorillière, Rosélis, Beauval, Guérin
le théâtre
St-Germain des
La
de Villiers, et les
et
Rieu, Raisin, Dufey, Dancourt, Beauval,
Godefroy, Beaubour
Duclos.
et
La musique
était
de
Lalande, La pièce eut w^w/ représentations (i).
M.
P. Lacroix ne serait pas éloigné d'attribuer à Molière
vers lyriques du prologue
certains
du
3=
tion
intermède de Myrtil
de
formelle
n'ai trouvé,
les papiers
ny
moindre
la
exécuter
projet à
!
de
M. de
idée.
trouvait
Si
Armande
aucun manuscrit
veuve
la
(i)
M.
le
la
déclara-
s'il
« Je
:
le
moin-
m'eût
laissé
»
Guérin
Béjart,
et
fils,
M.
P. Lacroix
papiers de
Molière,
parmi lesquels ne se
de pièce de son
premier mari.
de MoUère avait possédé une comédie,
même inachevée, N.
Bouillon,
malgré
Molière, ny
fameuse question des
revient sur la
quelques chansons
Heureux,
Et, au sujet de cette préface de
conservés par
et
Mélicerte,
l'auteur, qui dit dans sa préface
dans
dre fragment
quelque
et
A. M. Guérin, lettré, deux
fois
homme
prince d'Epinoy, le duc de Lesdiguières, le chevalier de
M. de
Cély, le
etc., assistaient à la
marquis
de
Villequier, le
première représentation.
duc de
la Ferté,
126
LE MOLIÈRISTE
de théâtre (puisqu'il
médienne
de
de comédien)
et
semblable aubaine
avait eu,
des pièces et était
faisait
comme on
fragment inédit de Molière, est-ce
dont
profiter la troupe
de vingt ans
moindre
le
fait
pendant près
Champ-
Est-ce que ses camarades Baron,
?
parti
n'en aurait pas
qu'il
fut le protagoniste
il
tirer
La Grange
si
entre les mains
dit,
l'a
de
aurait-il négligé
(i) D'autre part,
?
de co-
fils
meslé, Raisin Dancourt, tous acteurs-auteurs, n'en auraient
>
pas
bénéficier
fait
leurs
manuscrits de Molière
venus
?
—
jamais
moliéresques
la
— Aucun
n'a eu les
sont-ils de-
P. Lacroix et Jouaust d'a-
seconde collection
de Guérin
pastorale
Que
?
Nous devons remercier MM.
voir admis dans la
?
cela est évident.
:
le saura-t-on
comédies
des réimpressions
fils,
qu'il était fort
rare de rencontrer, et qui par suite était peu connue.
ne manquera pas, ne fût-ce que pour
la
copie, de relire la Mélicerte de Molière. Et
déon, qui annonce tant de
On
comparer à
sa
pourquoi l'O-
beaux projets pour
la saison
prochaine, ne remonterait-il pas ce fragment de chef-d'œuvre oublié
?
Ce
une
serait là
vraie nouveauté,
représentation à 216 ans de distance
tion nous semble toute
confié à
vrait-être
Rounat
et
Que
:
Le
!)
(une
seconde
la distribu-
rôle de Myrtil de-
une femme, à moins que
MM.
de
la
Porel ne découvrent un nouveau Baron, cheru-
bino di amore
(i)
indiquée
dont
!
Lycarsis conviendrait à Porel lui-même, qui
pouvait être, toutefois, cette comédie en
avec prologue et intermèdes
:
la
Psyché de
Village,
5 actes,
en prose,
qui n'eut qu'une
seule représentation (29 mai 1705), ne fut pas imprimée, et dont le manuscrit n'a, malheureusement, pas été conservé aux Archives du Théâtre français ?
llj
LE MOLIERISTE
a assez souvent
représenté
Molière dans
les
à-propos du
15 janvier
pour se charger d'un rôle créé par Molière.
Amaury
Rebel seraient Ménalque
et
Mélicerte, Eroxène
manqué de
et
Tirène. Quant à
Daphné, l'Odéon, qui n'a jamais
et
jeunes et aimables «bergères», n'aurait que
l'embarras du choix.
la
— M Paul Lacroix
vient de faire
Comédie
de
intérêt
française
pour
l'histoire
don aux Archives de
deux documents du plus haut
de Molière
:
la
photographie fort
rare, au tiers de la grandeur, d'un tableau détruit
cendie du 24 mai 1871, Molière évoquant
médie pour châtier
le
Vice
à^Mignard par Ingres,
élève
M'^''
Chéron
placards qui
rues de
fait
Lyon
;
et
l'in-
Génie delà Co-
démasquer l'Hypocrisie, attribué
par d'autres à Lebrun ou
et le fac-similé
à son
photographique de deux
furent \Taisemblablement colportés dans les
après la mort de Molière, et que nous avions
réduire par l'héUogravure
méro du
le
dans
Moliériste^
il
y
et
publiés dans le
i*''"
a trois ans passés.
DU MONCEAU.
nu-
BULLETIN THÉÂTRAL
Comédie
française,
—
Dimanche 25
(MM. Maubant, Dupont-Vernon,
Davrigny,
Martin).
les
—
juin,
Tartuffe^
Joliet, Richard, Bailïet,
M'"'^'
Samary, Lloyd,
Jouassain
Lundi 26, l'Avare (Leloir.)
Jeudi 29,
Leloir
—
;
Femmes Savantes (MM. Got,
etc.),
—
Gaiety THEATRE de Londres.
Vendredi 23 juin les
deux CoqueHn, MM. Boucher,
Silvain, Chameroy
M"" Barretta (Cathos), Amel (MadeIon) et Manvel (Marotte).
:
Précieuses IRJdicuks, par les
;
— Mardi
Odéon.
3 1
,
pour
la
30 mai,
clôture annuelle
Théâtre Rossini,
le
:
à Passy,
le
—
Misanthrope.
Mercredi
Dépit amoureux.
— Dimanche
18 juin,
le
en costumes de la fin du XIX^ siècle »
(sic), id est en habit noir pour les messieurs, en toilette
de soirée pour les dames, par MM. Garnier, de la Comédie
française, (Alceste), Mayer, élève de Got au Conservatoire (Philinte), Prade (Oronte), A. Lambert fils, élève
de Delaunay, (Acaste), Mary (Clitandre) ; M"" Defiresnes,
de rOdéon (Céfimène), Marie Samary, de l'Odéon, (Arsinoé) et Baretty, élève de Delaunay, (Efiante).
Misanthrope
«
La suppression du costume
de
rerie
cette
n'a pas été l'unique bizarreprésentation, organisée par M. Paul
il y a eu concert che^ Célimène (re sic), intermède
musical par M"^ Jeanne Fouquet, qui a chanté un air
d'Hérodiade, et M. Raoul Pugno, qui a exécuté sa Petite
valse et le nocturne en fa diè^e de Chopin. On ne s'attendait guère... à ouïr du Massenet dans le Misanthrope.
Qiielle figure pouvait bien faire le pauvre Alceste dans
Milliet
:
cette petite
débauche philharmonique
?
MONDORGE.
Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
— Noël Texier.
,
QUATRIÈME ANNÉE
AOUT 1882
NUMERO 41
LE
r
STE
%EFUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
MM
:
Campardon, J. Claretie, F. Coppée, V. Fournel, J. Guillemot,
A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
J.
LOISELEUR,
Ch.
Nuitter
L.
MOLAND, Ch. MoNSELET
E.
,
Picot
,
L.
de la
,
E.
NoEL
Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,
Dr H. ScHWEiTZER, Ed. Thierry, E. Thoinan, a. Vitu, etc.
PAR
Georges
MON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
DU THEATRE FRANÇAIS, 10
10, GALERIE
1882
SOMMAIRE DU NUMÉRO XLI
QUATRIÈME ANNÉE
LES ILLUSTRATEURS DE MOLIÈRE. — Un Icono-Moliérophile.
RACHEL INTERPRÈTE DE MOLIÈRE. — La Rédaction.
SUR DEUX VERS DE L'ÉWMIRE HY'FOCONDRE. — Anatole de
Montaiglon.
MOLIÈRE EN POLOGNE. — Charles Estreicher.
SUR « LE PROCÈS DE MOLIÈRE ET D'UN MÉDECIN.
»
— C.
Delamp.
PETIT QUESTIONNAIRE.
— RÉPONSE. — Wasili
Teploff.
—
A. Vesselovski.
LE CABINET DU MISANTHROPE. — C.
CORRESPONDANCE. — Un provincial.
D.
MOLIÈRE A CHATEAUROUX. — G. Monval.
BULLETIN THÉÂTRAL. — Mondorge.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
français,
2, place
tions,
:
— ÉTRANGER,
I 3
FRANCS.
UN FRANC 5O CENT.
à la librairie Tresse, io, Galerie
de Vintimille, auquel
demandes
lettre affranchie.
et
les
du Théâtre
M. G. Monval,
manuscrits, communica-
ou par mandat sur la poste adressé
à
réclamations devront être envoyés par
LES ILLUSTRATEURS
DE MOLIÈRE.
L'Iconographie Moliéresque a fourni matière à
lume de M. Paul Lacroix, dont
la
un gros vo-
meilleure part est con-
sacrée aux portraits, et quelques pages seulement aux sui-
de figures relatives aux comédies.
tes
On
en
sait
effet
que
la liste
des diverses séries d'estampes inspirées par le thé-
âtre de
Molière n'est pas longue
s'étonner qu'un sujet
si
fécond
davantage
n'ait point tenté
le
;
il
est
même
permis de
et si facile à l'illustration
crayon
et la
pointe de nos
artistes.
Quoi
riodes
lant
qu'il
en
soit,
on peut remarquer
dans l'iconographie moliéresque
comme
:
la
trois pé-
première
al-
de 1682
à la fin
à 1734; la seconde, de cette dernière date
du XVin^ siècle, et enfin la troisième commençant
vers le premier Empire.
Le premier
sart exécuta
et
essai d'illustration date des dessins
pour
l'édition publiée
Vinot. Le dessinateur
s'est-il
que
Bris-
en 1682 par La Grange
beaucoup préoccupé de
LE MOLIÈRISTE
132
du costume
l'exactitude
portraits
de
et a-l-il eu l'intention
faire
Les iiabitudcs du temps ne permettent guère de
?
supposer semblable souci. Les costumes (sauf pour
lui
des
les
estampes, copiées sur celles des éditions princeps) sont évi-
demment ceux
portés à
Cour
la
Pourquoi vouloir aussi que
traits
disparu depuis neuf années,
ment songé
à
placer
de ce type trapu à
à la tête d'une
le
même
de
en tête de ses
portrait
Le
la figure
pleine,
aux larges épaules
et
c'est là,
tout serait de savoir
en
le
si
un
effet,
fait
le
chef
incontes-
dessinateur n'a point
la figure
du comé-
?
portrait
en
tant est
si
:
c'est-à-dire
mais
le
si
nous
a
donné
le
du maître
qu'ils
comme
de ses ma-
sont encore à découvrir,
si
n'aient point à jamais disparu.
1692 que
(i) C'est seulement en
imprimant
Brissart
mais résignons-nous alors à penser
des portraits
qu''ils
que
l'on veut,
de Molière
est
nuscrits,
teur,
Œu-
grosseur anormale, représentant toujours
Théâtre,
Admettons,
qu'il
comédien
point seule-
n'a
fréquente, dans ces estampes,
songé au type dramatique plutôt qu'à
dien
l'illustre
qu'il
personnage dans un des rôles créés par
l'Illustre
table.
de
alors
son
La reproduction
vers 1680.
ville
Brissart se soit attaché à re-
présenter dans ses dessins les
vres (i)?
et à la
le
libraire
lyonnais). Lions, ré-
1682, y joignit, le premier, un portrait de l'aumaussade et d'une gravure si défectueuse que les traits en
texte de
sont à peu près méconnaissables. Mais
assez de soin par
rubrique de Lipsia, 1698,
semblance avec
les types
ver toute créance.
comme
Daucher pour l'impression
il
est facile
Nolin
et
il
a été regravé avec
italienne publiée sous la
de constater que son absolue dis-
Audran
est bien faite
pour
lui
enle-
133
LE MOLIÉRISTE
Dans tous
les seules à
de Brissart,
les figures
cas,
les
leur inpeu près contemporaines, conserveront toujours
gravoir
les
de
regretter
térêt. On ne saurait donc trop
vées d'une manière
si
inégale qu'on les croirait volontiers
Toeuvre de plusieurs mains.
Les dessins de Boucher, exécutés vers 1734 pour l'éouvrent une
dition in-4° publiée à Paris sous cette date,
nouvelle ère à l'illustration moliéresque.
Il serait
par trop
mais
téméraire aujourd'hui d'oser médire de ces estampes ;
étuplus
on accordera bien qu elles eussent gagné à être
On
diées.
retrouve en
effet,
dans ces figures, tous
fauts et certaines des quahtés
du peintre. Mais
bien les considérer à leur véritable point de
de
la
plus haute portée,
point frappé de ce qu'elles
il
vue, c'est-àet litté-
laissent à désirer.
En
fallait
une bonne
pour
partie de son
des Frankendaël qui
tites
inspirer le talent
Peu heureusement gravée
la
le
et gran'était
maniéré de Bou-
à l'origine, cette suite dut
réduisirent à merveille pour les pe-
éditions de Hollande, tandis que les graveurs français
y
la caricaturer.
avait près de quarante ans
cher avaient vu
la
à
succès à l'habileté des Punt et
s'acharnèrent trop souvent à
Il
eftet,
ou pastorales dont
caractère convenu devait plaire à son crayon facile
cieux, la veine franche et large de notre Molière
cher.
dé-
sera impossible de n'être
part certaines scènes m-ythologiques
pas ce qu'il
les
l'on veut
d'interprétation d'une oeuvre morale
dire à l'état
raire
si
le jour,
que
les dessins
de Bou-
lorsque les libraires associés pour
pubhcation du théâtre de Molière commenté par Bret
demandèrent à Moreau
leur édition.
le
jeune 34 estampes pour orner
Cette suite d'estampes, exécutée de
1768
à
^^ MOLIÉRISTE
134
1773, sans être
ter
parmi
comme
de constater
unes, en
chef-d'œuvre de Moreau, mérite de comp-
le
les jolies illustrations
effet,
et
les autres.
costumes,
modes des
les
XV. Le convenu
dans
donner
assez réalistes, peuvent
tions les plus précises sur les
nementation
de ce maître.
est facile
dominent au contraire
Les dernières, pour
le
plupart excellentes,
la
graveur a
Elles n'ont point vieilli
et s'éloignent
d'interprétation que
premières,
les
les indica-
mobilier, l'or-
le
dernières années de Louis
fantaisie
et la
sont en général celles que
le
mieux rendues.
moins de
la vérité
dans lesquelles
parfois assez difficile de reconnaître les types
si
Il
deux manières dans ces figures. Les
si
il
est
larges et
francs créés par le poète comique, dessinés par l'artiste
avec une élégance trop grêle et trop tourmentée.
Les figures de Moreau ont encore pour nous im autre
intérêt de curiosité
^ne
;
elles
idée assez exacte de
peuvent en
effet
nous donner
ce qu'était vers 1773 la repré-
sentation d'une comédie de Molière.
Nous nous croyons
plus sévères et plus exigeants que nos pères pour tout ce
qui touche à
costumes
et
la vérité
accessoires mis à
de penser que
lieu
de l'interprétation dramatique
les
l'ancien régime avaient
charment aujourd'hui
part,
n'y
a-t-il
;
mais
point tout
comédiens des dernières années de
mieux conservé que ceux qui nous
les
pures traditions du grand siè-
cle ?
Deux
séries de figures, voilà
donc tout ce que
le siècle
des illustrateurs a su donner à Molière^ et encore l'une
d'elles reste-t-elle
Au
reste,
il
antérieure
à l'âge
d'or de la vignette.
n'y a pas lieu de trop s'étonner de voir cette
pléiade d'artistes, dont
le
crayon pourtant
si
prodigue
« a
I35
LE MOLIERISTE
sauvé par
planches
les
» tant
d'œuvres mort-nées, rester
à demi indifférente devant une telle
et trop simple
mode,
à la
Ce
fut
pour l'époque,
œuvre
:
car trop vraie
en
elle n'était alors,,
effet, ni
ni populaire.
dans
premières années de ce siècle que
les
Mo-
reau produisit sa seconde série de figures pour les comé-
Beaucoup moins maussade que
dies de Molière.
productions de sa
gné
vieillesse, cette suite eût
cédente,
Mais
plus spirituellement gravée.
à être
loin d'atteindre au faire artistique et au
paraît
beaucoup inspiré de
s'être
le tenir
de transition où
pour
plus toléré le
De Moreau
les habitués
convenu de
vieilli
du
Le
s'en
ce
à
dour, trop cher au goût de
senne
est
la
être encore
du costume, n'auraient
y
eut-il
En
progrès
effet,
tant
? Il
pseudo-Louis XlV-troubaRestauration,
il
en général plus heureux. C'est ainsi
certain
même
serait
que ce der-
produit des
fort lai-
lorsqu'il lui arrive de sacrifier à la fantaisie.
possible de signaler, dans ses
un
très
deux
nombre de planches
jolies
si
le
On
d'une époque
estampes sans grande originalité et trop souvent
Mais
fidé-
dessinateur
représentation.
fidèle
théâtre, sans
à Desenne,
tient
pré-
l'âge précédent.
assez difficile de se prononcer.
artiste
la
l'interprète
bien exigeants quant à la vérité
des.
la
on y peut constater par compensation une
peut donc
nier
elle est
si
charme de
plus grande dans la traduction du texte.
lité
les autres
beaucoup ga-
suites
qu'il
De-
serait
pour Molière,
bien venues, qui seraient
graveur
se
fût
montré moins
lourd.
Il
eût fallu
nommer
et ses collaborateurs,
ici,
dont
avant Desenne, Horace Vernet
les
estampes ont quelque peu
LE MOLIÈRISTE
136
précédé
les siennes.
tout, plus
Mais
moderne que
faire
le
celui
d'H. Vernct
est,
après
du premier dessinateur.
Les figures qu'Horace Vernet a dessinées pour Molière
indiquent chez
des tableaux.
l'artiste
Il
ne
faire
comme
tant
mais
;
pas en eftet borné,
un ou deux personnages déclamant
d'autres, à dessiner
devant un décor
une préoccupation évidente de
s'est
il
a pris la peine de rechercher des
situations dramatiques prêtant à l'interprétation, et
enfin grouper avec
série
un grand
art ses
en
a su
personnages dans une
de compositions dont quelques unes,
santhrope
il
celle
du îMi-
méritent d'être signalées à l'imi-
particulier,
tation des illustrateurs.
C'est sur ces deux séries d'estampes (et encore sont-elles
incomplètes),
1860
(i).
Il
qu'a
surtout
vécu
la
de
librairie
convient toutefois d'ajouter à ce bilan les
nombreux croquis improvisés par Tony Johannot
pour une édition
C'était alors le
France. Aussi
nombreux
1820 à
illustrée
du théâtre de Molière.
moment où
fallut-il
la
xylographie renaissait en
employer à
graveurs, dont
vers 1835
un ou deux
la
taille
des bois de
à peine ont su rendre
mais un peu
avec quelque habileté l'œuvre ingénieuse,
hâtive, qu'ils avaient à interpréter.
Un aquafortiste
au
faire individuel
et original,
lemacher, après avoir d'abord gravé, vers
traits
(i)
M.
F. Hil-
1857, ^^^ por-
des comédiens de la troupe de Molière, publia, peu
Vaut-il la peine de citer
ici,
pour être complet, quelques figures
sans grande originalité de Riffaut, et
lâche et d'une élégance
éditeurs Garnier
?
même
les
estampes, au dessin
un peu banale, exécutées par
Staal pour les
I37
LE MOLIÉRISTE
œuvres du Maître, une
après, pour orner les
tites
eaux-fortes en tête
166
pièces et
de
complétée par
série
de pe-
composée d'environ
pages,
plusieurs
Bon
portraits.
de ses vignettes sont très réussies, la plupart bien
nombre
gravées, et cette publication vaut son prix.
Une
suite exécutée dans le
mat un peu agrandi
d'être
tiste,
et
M.
goût, mais d'un for-
d'une exécution plus achevée, vient
récemment gravée
lustration
même
à l'eau-forte par
Foulquier, qui excelle, chacun
brassent
point
s'étonner en
théâtre
le
même
dans
le sait,
jolis
de
complet
habile ar-
du grand
en miniature des classiques
L'on ne saurait assez regretter que ses
un
l'il-
siècle.
croquis n'em-
Molière, ni trop
temps de ce qu'aucun éditeur ne
s'est
encore rencontré pour demander à l'aquafortiste d'achever
ce qu'il a
bien
si
Avouons
commencé.
toutefois
que M. Foulquier, sans doute pressé
par le temps, n'a point
sure.
et
il
La correction de son dessin
lui
arrive
grands pour
le
me-
laisse parfois à désirer,
souvent de tenir ses
personnages trop
cadre étroit qui les enserre.
contre aussi, lorsque
il
toujours donné cette fois sa
le spirituel artiste a
Mais,
voulu bien
par
faire^
a su créer des eaux-fortes d'un ton exquis, et aussi de
charmants
petits tableaux. (Voir, par
destinée au
5*^
Comment
demander
à
tampes pour
nous bien
français.
un
Femmes
qu'en
arriva
de Molière,
M.
1807,
date
Lalauze, 34 es-
« chi lo sa ? »
une traduction du
Car, depuis
vignette
^" éditeur en vint à
de dire que cet éditeur
publier
la
savantes.^
1875
illustrateur émérite,
le théâtre
vite
songeant à
acte des
il
exemple,
était
un Anglais
grand
à laquelle
Hâtons-
comique
Renouard
LE MOLlèRISTE
138
commanda
Moreau
à
cette
deuxième
dont
suite
d'être question,
aucun éditeur français ne
coupable
pareille
d'une
Mais
profusion...
M. Lalauze pour proclamer
bien
haut
vient
il
rendu
s'était
revenons
à
qu'il s'est acquitté
de sa tâche avec un rare bonheur. Ses estampes semblent
bien étudiées
;
plusieurs sont ravissantes, témoin celle pour
Don Juan. Quelques-unes ont une grande
cuHer
deux
celle
du Misanthrope,
et c'est à
peine enfin
laissent à désirer. Cette suite est donc,
une œuvre
en parti-
allure,
si
une ou
en résumé,
sérieuse, tout à fait digne d'un artiste
dont
le
plus élégant encore que gracieux, a conquis tous
talent,
les suffrages.
Ces
belles
dont
relliste,
talent,
estampes étaient à peine publiées qu'un aquala
mode
commençait
— mais
a bien vite consacré l'incontestable
à dessiner, avec
cette fois enfin
une trop sage lenteur,
pour un éditeur
français,
—
une
nouvelle série de compositions destinée à un théâtre de
Molière en cours de publication. Ces estampes, et de préférence celles qui accompagnent les cinq premiers volumes,
méritent d'être louées à côté des précédentes.
M.
Leloir,
beaucoup
donne à
tout en
inspiré
se
laissant aller
à
la
On
sent que
fantaisie, s'est
aussi de la représentation; c'est ce qui
ses créations
un
caractère à la fois
traditionnel d'une originalité tout à
fait
préoccupé peut-être que son devancier de
bien grouper ses personnages,
le
nouveau
et
piquante. Moins
faire large et
de
peintre se complaît sur-
tout dans la vérité de l'expression et aussi dans les détails
du costume masculin
abuse-t-il
qu'il
excelle
à bien rendre. Aussi
un peu des personnages vus de
chète ce léger travers par un certain
dos. Mais
il
ra-
nombre de planches
LE MOLlèRISTE
véritablement achevées, témoins
femmes
et la Critique
mants
petits tableaux.
Or,
faire
un
139
pour VEcok
celles
des
qui sont, à tout prendre, de char-
but vers lequel devrait
tableau, c'est là le
Com-
tendre un illustrateur; mais combien en ont cure?
bien s'attachent à faire choix d'une scène capitale, dont
la situation
résume l'œuvre
mette en sailHe
entière,
les
principaux personnages et puisse fournir à leur crayon des
développements
pour
suffisants
Quiconque voudra
jolies eaux-fortes
se
consacrées à
contemporains ne pourra,
cornbien, en général,
tits
ils
avec
lutter
donner
le régal
le texte ?
de parcourir
Molière par nos
je crois,
manquer de
artistes
constater
ont mieux réussi à rendre
ouvrages du Maître que ses grandes créations.
rait qu'ils
les
les
pe-
On
di-
réservent pour ceux-là tout le charme de leur
pointe et de leur imagination, tandis qu'ils reculent devant
celles-ci.
Veut-on
par exemple,
Sicilien
s'édifier sur ce
dans
la
suite
de
point
M.
avec celle du Misanthrope.
Il
qu'on compare,
?
Leloir,
l'estampe du
est vrai
de dire que,
depuis Moreau, V^Aînour peintre a toujours réussi à inspirer les dessinateurs qui, sans doute
par respect pour
œuvre, un peu
tradition, se croient tenus de faire à cette
effacée, tous les
honneurs de leur talent
la
de leurs préfé-
et
rences.
Quoi
qu'il
en
soit, cette
peine d'être signalée;
de
l'art,
dans
elle
si
tendance de nos
grande
ne devrait jamais
la hiérarchie
soit,
en
artistes
effet,
aller jusqu'à
vaut
la
la liberté
méconnaître,
des œuvres intellectuelles, une certaine
proportion et une certaine mesure.
Cette proportion et cette mesure, les éditeurs sont, eux
LE MOLIÈRISTE
140
aussi, trop
tampes
enclins à
en prodiguant
l'enfreindre
et les vignettes
les
es-
à des ouvrages trop souvent sans
portée morale et littéraire, tandis qu'ils iront marchander
au Tartuffe
aux Femmes savantes une
et
Comme
ample qu'au Mariage forcé.
si,
plus
illustration
réduire
l'artiste le
plus original à une unique estampe, pour interpréter cer-
comédies de Molière, ce
taines des
condamner,
failliblement le
tones redites
et
presque in-
n'était pas
nous avec
lui,
Serait-ce donc, après tout, rêver l'impossible,
en
belle estampe,
tête
qu'espé-
chaque acte des comédies commenté par
rer voir enfin
une
mono-
à de
!
de page
et
que viendraient compléter une vignette
un
lampe ? Non,
cul de
là un desideratum justifié par
poëme dramatique, en deçà duquel
c'est
la
il
puisque
certes^
nature
même
du
n'y a pas, à tout
prendre, d'illustration possible.
La mode
est à Molière, et peut-être est-ce là
car la préoccupation trop exclusive de l'histoire
du roman de sa
vie
tend
faire
qu'on
n'ait point
et
celui
que
l'art
typo-
ce siècle, pour la gloire de Racine, et
du Louvre attende encore son pendant
temps cependant de voir enfin
peintre de
peut-il
iconographique français a su créer, au com-
mencement de
l'édition
se
encore tenté d'élever à son
honneur un monument comparable à
graphique
ou plutôt
quelque peu à reléguer au se-
cond plan son œuvre incomparable. Comment
donc
un mal;
mœurs
le
théâtre
? Il
que
serait
de notre grand
véritablement traduit et interprété par
main des maîtres contemporains, avec une recherche,
la
un
art et
Or,
un luxe dignes de
comme
il
lui et
est trop certain
de
la
France..
qu'aucun éditeur ne vou-
I4I
LE MOLlèRISTE
dra nous donner cette édition, pourquoi une société d'a-
mateurs
et
de moliéristes n'en
ferait-elle
point les
frais ?
Quelles spirituelles et charmantes estampes et vignettes
saurait
nous donner, par exemple, l'association de crayons
aussi souples et aussi éprouvés
Leloir et Foulquier,
si,
une édition de Molière
que ceux de
MM.
Lalauze,
justement honorés de collaborer à
et
bien convaincus que ce n'est
point trop de tout leur talent pour se maintenir à
teur de leur tâche,
ils
la
hau-
voulaient bien y travailler avec une
conscience égale à leur goût
!
UN ICONO-MOLIÉROPHILE.
RACHEL INTERPRÈTE DE MOLIÈRE.
M. Georges
d'Heylli vient de publier à la librairie des bi-
bliophiles, sous le titre de Rachel d'après sa correspondance^
un important
gédienne.
travail sur la vie artistique
Ce
travail
orné de quatre
et
il
de
la
grande tra-
forme un beau volume grand
portraits, gravés à l'eau-forte par
contient un
très
grand nombre de
dont plusieurs sont publiées pour
la
première
Nous emprunterons au volume de M.
curieux renseignements
relatifs
lettres
fois.
d'Heylli quelques
:
à la petite salle Molière
l'ancien tragédien St-Aulaire, et
Massard,
de Rachel,
aux rares personnages de
Molière que Rachel interpréta au théâtre
Pendant son séjour
in-8°,
où
que
elle joua,
dirigeait
de sa qua-
torzième à sa seizième année, trente-quatre rôles
les plus
divers de l'ancien répertoire, elle aborda cinq personnages
des pièces de MoUère, Marinette du T)épit amoureux,
nne du
Tartuffe,
puis Eliante
Le 30
Martine des Femmes savantes, Célimène
du Misanthrope.
avril
1839,
elle
joua Dorine à l'Odéon, dans une
représentation à son propre bénéfice (i).
(1)
Do-
L'Odion, par P. Porel et G. Monval,
t.
II, p.
187.
LE MÔLIERISTE
Sur
scène de
la
la
Comédie
I43
même, Rachel ne
française
joua qu'un seul rôle de Molière, Marinette du Dépit amoureux (i"
1844), dans une
juillet
néfice de sa famille,
où
elle avait
comédie du Legs complétait
sit
représentation au
bé-
d'abord joué Phèdre.
La
la représentation,
qui produi-
une recette de 11,082 francs, assez élevée pour
que. Rachel n'obtint
qu'un succès de curiosité
l'époest
il
;
évident que son talent et que son physique surtout ne se
aucunement à
prêtaient
Ce
brette.
Molière à
Le
la
fut
l'interprétation
d'ailleurs
Comédie
la
seule
d'un rôle de sou-
fois
qu'elle
joua du
française.
15 janvier 1847, elle concourut à l'éclat de la repré-
sentation donnée
en l'honneur de l'anniversaire de
la nais-
sance de MoUère en créant, dans un petit à-propos en un
M.
en vers, de
acte,
Molière,
rieuse
;
Jules Barbier,
un personnage qui
M"^ Aug. Brohan
était
Mercure
était
Molière
;
Maillard
représentait la
faisait
faisait
lui-même.
intitulé
la
L'Ombre
comédie
comédie légère
;
de
sé-
Got
un poète, enfin Provost
Rachel
et
Aug.
Brohan
ne
parurent dans cet à-propos, qui eut sept représentations,
que
le
Mais
premier soir seulement.
c'est à
Londres, pendant sa tournée de 1847, que
Rachel se montra dans
le
rôle de
Molière qui
lui
fil
le
plus d'honneur, paraît-il, mais qu'elle n'osa cependant ja-
mais jouer à Paris,
CéUmène du
Misanthrope. Elle raconte
elle-même, dans une bien curieuse
livre
de M. d'Heylli,
cette
lettre
intéressante
citerons la partie qui concerne sa prise
rôle de
Célimène
:
que reproduit
soirée
;
le
nous en
de possession du
LE MOLlèRISTE
144
A
'.-
Madame
Samsofi,
d
^f<^
Londres, 1847.
'':'
'
Chcrc Madame Samson,
Je
enfin passé, ce
l'ai
'
fameux jour qui annonçait
le
Misanthrope
:
joué Célîtnène. Mais de qui va sans doute vous étonner, c'est que
ai
obtenu un véritable
succèsr...
de nombreuses salves
me
scène des portraits a
fait
les conseils
mon
de
effet
;
presque
beaucoup
parfait
mais, à
mon
ici
me
je
professeur
;
la
m'allait à
quel changement
!...
suis rappelé,' de
La
mon
aussi rri'a-t-on rappelée
prude Arsinoé a produit
y avoir voulu être plus sapiquante. Les deux derniers actes,
;
tout a été pour le mieux, et vraiment je suis très satisfaite de
ce succès.
écrits
;
;
pu répéter avec M. Samson, peuvent gagner énormément
je n'ai
mais
mon costume
sens, je crois
vante et diseuse que mordante et
que
rire
;
jolie
La grande scène avec
après le second acte.
un grand
faisait
j'y
entrée en scène m'a d'abord valu
d'applaudissements
merveille et la coifiure
mieux
Mon
j'a
Les journaux dépassent
en anglais pour n'être pas
M. Samson
l'éloge, et
je suis ravie qu'ils soient
tentée de vous les faire
lire.
Mais
veut se mettre en tête de m'apprendre bien Célimène,
suis persuadée
que
j'aurai aussi
un succès
si
je
sur notre chère grande scène
française
RACHEL.
Rachel joua encore Célimène dans sa grande tournée de
1849 (à Tours); enfin, dans une de ses représentations en
Amérique, le 20 octobre 1855, elle joua le second acte du
Misanthrope.
Et
c'est
qu'elle parut dans
un
bien la
dernière
fois,
ce
jour-là,
rôle de Molière.
LA RÉDACTION.
SUR DEUX VERS
DE UELOMIRE HYTOCONDRE.
Dans
préface de l'excellente réimpression
la
que M. Li-
vet a donnée, en 1878, chez Liseux, de YEloînire hypocondre,
en
Lxxv)
citant (p.
scène de
l'acte
IV
les vers si
curieux de
première
la
:
...
Croy-moi, cher Mascarille,
Fais toujours le Docteur, et fais toujours le drille
Car
enfin,
Tu ne
Mais
si
est
il
temps de
;
te désabuser,
naquis jamais que pour faquiniser...
tu te voyois,
quand
tu
veux contrefaire
Un
amant dédaigné qui s'efforce de plaire:
Si tu voyois tes yeux hagards et de travers.
Ta bouche grande ouverte en prononçant un
vers,
Et ton col renversé sur tes larges épaules.
Qui pourroient
il
ajoute en note
:
«
à
bon
On
droit être l'apuy des Gaules,
a respecté,
dans cette
réim-
pression (p. 108), la leçon de l'édition originale, qui porte
Vapuy de gaules; celle que nous
offrir
A
un sens
coup
sûr,
donnons
ici
nous
paraît
plus satisfaisant.
Le Boulanger de Chalussay n'en
est
pas à
on
cela près d'une plaisanterie forcée. Si c'était son texte,
serait forcé
de comprendre
qu'il a raillé
Molière en en
fai-
10
LE MOLIÈRISTE
146
sant
un Atlas
de porter
ridicule, capable
mettait sur ses épaules; mais
il
France
la
si
simple de
serait plus
on
la
s'en
tenir au texte.
Epaules a peu de rimes exactes;
la
Dans
rien.
Molière a
foit
saules et
à propos de valets, épaules et
et
naturellement.
dans
Ainsi
une première
dire
y a Gaules,
Paules, gaules, et puis
VEiourdi,
fois à Mascarille
(acte
scène VII, vers 735-6):
Il
me falloit pas payer en coups de gaules
me faire un affront si sensible aux espaules,
ne
Et
et
comédie
la
s'appellent
gaules
II,
il
monnaie romaine qu'on appelle
une seconde
fois
Trufaldin (acte IV, scène V, vers
cà
1549):
...
D'un chêne grand
et fort,..
Je viens de détacher une branche admirable,
Choisie expressément de grosseur raisonnable.
Dont
Un
j'ai fait
Moins gros par
Propre,
Car
champ, avec beaucoup d'ardeur,
sur le
bâton a peu près, ouy, de cette grandeur,
est bien
il
l'un des bouts, mais, plus
comme
je
en main,
C'est du Molière,
que trente gaules,
pense, à rosser les épaules.
il
vert,
noueux
est vrai^ et
et massif.
de 1653^ mais Le Bou-
langer de Chalussay emploie aussi en 1670 les deux rimes,
en quelque sorte
rille
(acte
fatales. Il fait dire
scène
I,
I,
p.
par Isabelle
11-12):
...Apprenez qu'un valet
Qui
Et,
se
si
moque
d'un Maistre a souvent du balet.
vous ne voulez proscrire vos épaules,
Taisez-vous, et scachez que nous avons des gaules.
à
Laza-
LE MOLIERISTE
I47
Plus loin, vers la fin du premier acte, dans
d'Elomirc et de l'opérateur Barry,
...
il
fait
la
dire au
querelle
premier
:
Si ce n'estoit
Q.ue vous estes chez moy, le gourdin trotteroit...
l'orviétan.
Le gourdin
Tarte à
En même
trotteroit
crème
la
temps,
mire un tour sur sa
Dis donc sur tes épaules.
1
!
comme
ce tour de chapeau », s'écrie
Ah
!
transporté de colère à
!
A
:
moy, mes gens
!
Des gaules
!
fondons sur ces croque-crapaux.
Lazarille,
On en trouverait
temps, mais
teste
au chapeau d'Elo-
fait faire
il
tête, celui-ci, «
d'autres exemples dans les comédies
doit suffire de ceux
il
du
du Boulanger de Chalus-
say pour croire que, dans les trois passages, gaules n'a pas
sens que celui de bâton,
d'autre
sans
géographique française ni gauloise,
pourroient avoir Tappuy de gaules
malgré
méchant
le
français
«
:
Tu
et
i>
aucune allusion
que
:
« tes
épaules
veut dire simplement,
pourrais bien être bâ-
tonné. »
Puisque
rapproché des passages de V Etourdi
j'ai
lotnire hypocondre,
éclaircit
un de
Molière (acte
camarade
un
Ton
d'E-
autre passage de la seconde pièce en
la
première. Dans les éditions anciennes de
5,
scène
I,
vers 1677-78), Ergaste dit à son
:
Par
et
les soins vigilants
affaire alloit bien
de l'Exempt balafré,
;
le
drôle estoit coffré, etc.
LE MOLlîiRISTE
I4S
sans capitale à balafre,
nom
Dans
du Guet,
la liste
non pas un
des personnages cTElomire, après
se trouvent
Guet. C'est au
nom
qui paraissait ainsi,
propre, mais une épithète.
Le Balafré
dénouement
qu'il figure, p.
de Le balafré, La Balafre
Ayant mis nostrc fou dans
Avec son Lazarilc et nostre
et
la
Un
exempt
Sans-Malice, Exempts du
et
Balafré
119-26 sous
chambre prochaine
Balafré...
Les éditeurs modernes ont donc eu raison de suivre
dition de 1773, qui
donne pour
avec une grande lettre
sa qualité de
est très
nom
le
:
la
première
fois
initiale, laquelle affirme
l'é-
^Balafré
clairement
propre. L'Exempt à'Ehmire bypocmdre
certainement un souvenir volontaire et un rappel
moqueur de l'Exempt de
VEtourdi.
Anatole de
MONTAIGLON.
MOLIÈRE EN POLOGNE.
XVIIP
C'est vers le milieu du
à jouer aux théâtres
siècle
qu'on a commencé
polonais les pièces de Molière, et à
publier les traductions
polonaises de ses comédies, faites
pour ces théâtres.
Les Précieuses ridicules et
mières pièces qu'on
ait
le
Médecin malgré lui sont
les pre-
représentées en polonais au théâtre
de Nieswiez, résidence de
de Radziwill.
la famille princière
La princesse Françoise Ursule Radziwill pubHa
traduc-
la
tion de ces deux comédies en 1754, à Nieswiez.
A
dater de
cette
époque, MoHère
nais l'amour
du
théâtre.
pièces paraissaient l'une
en comptent plus de
XYin-^
est
dramatique qui exaltât dans
mier génie
devenu
le
le
pre-
puMic polo-
Les traductions polonaises de ses
après l'autre.
trente
Les bibliographes
imprimées avant
la fin
du
siècle.
Mais ce
n'est
que
le
XIX"
siècle qui enrichit la littéra-
ture polonaise des traductions classiques,
vers, des
comédies de Molière.
vingt, outre celles qui restent
en compte
plus de
en manuscrits dans
pertoires des différents théâtres.
très correctes,
On
en prose et en
C'est
qu'on joue aujourd'hui
sur ces
les
les ré-
versions,
pièces de
Mo-
LE MOLIERISTE
150
licrc
aux théâtres de Varsovie, de Cracovie, de Léopol,
de Posen,
etc.
Le plus distingué des traducteurs
incontestablement
est
François Kowalski, qui a
même donné
plètes de Molière traduites
en vers
lumes
in-S"
et
les
œuvres com-
composant VIII vo-
imprimés à Vilna entre 1847
^^ 1850. Cette
édition est précédée d'une savante biographie de Molière.
Charles ESTREICHER,
Directeur de
On
annonce
la
Bibliothèque publique de Cracovie. (i).
en Suisse, du poète polonais
mort,
la
Christien Ostrowski, qui a versifié l'Avare de
après
F.
Mailhol,
Deschamps
C'est
le
et
par erreur
traduction
C'^
de
S'-Leu,
Malouin, avant
que
polonaise
les
MM.
Rastoul,
Courtin
journaux ont
cette
imitation
Molière,
Esnault,
et
AUart.
donné comme
en
vers
français^
représentée à la Porte S'-Martin dans les matinées
raires de
M.
litté-
Ballande.
G. M.
(i)
Auteur de
la
Bibliographie polonaise du
extraites la plupart des indications
XIX^
siècle,
d'où sont
données par M. P. Lacroix dans sa
Bibliographie moliéresque (2me édit., p. 191-196).
SUR
«
LE PROCÈS DE MOLIÈRE ET D'UN MÉDECIN.
Le
n'est pas
découvert (v.
j^oliériste
le
Sa version
est,
M. Lacroix
a
un peu diôérente de
est vrai,
il
comédie
avec un
donné
venue à
la
Béjart lui envoya dire de sortir,
que susceptible de honte,
de payer sa place.
»
billet
aima mieux se
elle
M. Lacroix
Nous avions
résolu,
mes compagnons
De ne
i, se.
et
Vint pour nous voir jouer
»
Car
la
mienne
»
Luy
»
Comme
fit
aussi-tost
:
femme de
mais
comme
moy,
;
en étant
ce fat
elle prit
un
rat
:
avertie,
danser d'abord un bransle de sortie.
alors je croyois
» Je négligeay d'en dire
que tout m'estoit permis,
un mot à mes amis.
que
l'histoire
» Pourtant, soit à dessein de nous faire querelle,
»
avare
dedans.
jouer jamais, excepté chez le Roy,
» Soit par d'autres motifs, la
quand
et
là-
3),
» Devant ce médecin, ni devant sa séquelle
que
serait
retirer
:
Elomire [Elomire Hypocondre, acte
»
;
« plus
Point de matière à procès
Mais Le Boulanger de Chalussay raconte
l'auteur cité par
celle
La femme du médecin
recueillie.
sa
1705, pages 74 à 77],
Armande
«
de juin)
du tout inconnu. Grimarest en parle dans
Vie de Molière [Edition originale,
dit
M. Paul
bien nouveau et bien curieux » que
fait «
Lacroix croit avoir
«
LE MOLIÈRISTE
1^2
Las
»
»
»
!
j'aurois
prévenu par
là ce
que ce hère,
Pour venger cet affront, ne manqua pas de faire.
tandis ce raffiné
Je fis donc ce faux pas
Prévint toute la Cour dont je me vis berné.
Car par un dur arrcst qui fut irrévocable
On nous ordonna presque une amende honorable.
;
»
»
»
Le Nemestz de M. Paul Lacroix
mettre en prose
Il
celle
est inutile
faire
fait
qu'abréger et
remarquer que des deux versions
de Grimarest est
doute un
sa
de
n'a
de Le Boulanger de Chalussay.
le récit
fait vrai,
la seule admissible. Il y a là sans
que l'auteur à'Elomire bypocondre, dans
pour Molière,
haine
a
soucier de la vraisemblance.
mande
faveur;
Béjart
ait
fait
exagéré
On
expulser
la
et
sans
travesti,
se
comprend bien qu'Arporteuse d'un
mais une spectatrice payante, ce
serait
billet
de
un excès
d'impertinence incroyable, et impossible. Le procès dont
Le Boulanger de Chalussay, Nemestz
M. Paul Lacroix, n'a jamais pu avoir lieu.
parlent
après
lui, et
^Athènes, juin 1882.
C.
Mêmes
DELAMP.
observations de notre collaborateur
Vitu et de M.
le D""
M. Auguste
Mahrenholtz, de Halle.
G. M.
PETIT QUESTIONNAIRE
RÉPONSE.
La
28. Wasili Teploff. (iv, 26, 61).
vient de faire
M.
J.
Claretie, d'une traduction russe des
Fourberies de Scapin, a
nouveau théâtre
que
trouvaille,
un grand
intérêt
russe. Elle le doit
non
pour
l'histoire
du
à la personnaUtè
du traducteur, écrivain assez médiocre, quoique
très
stu-
de
la
Après une période assez longue de tâtonnements
et
dieux, mais surtout
aux circonstances
et à la date
première représentation.
d'apprentissage, le théâtre régulier fut
à St-Pétersbourg en 1756 par
de province.
talent,
lien'),
une troupe d'amateurs venue
homme
troupe,
de grand
Théodore Wolkoff (lui-même traducteur du
tremêlées de
divers
chefs-d'œuvre du
rivalisait ici jusqu'à la fin
Holberg, mais pendant
même
la
Sici-
forma son répertoire de quelques pièces russes en-
Molière
et
Le chef de
définitivement fondé
les
du
théâtre
premières années
en souverain absolu. Dans
le
étranger.
avec Lessing
siècle
courant
il
trônait
d'une seule
année (i^Sl^^ furent traduites et représentées les Fo^rè^nV^
de Scapin, Y Avare, V Ecole des
Maris, Tartuffe
et le
Misan-
154
thrope.
i^E
MOLIERISTE
D'après des sources authentiques, Scapin ouvrait
le
rang, et fut représenté le 25 septembre 1757.
C'était précisément la traduction faite par Basile Teploff,
que vient de découvrir M.
imprimée (on
l'a citée
Claretie,
cependant, au
le « Dictionnaire dra^natique »
et qui
ne fut jamais
siècle
dernier, dans
de Novikoff, 1787). Ce der-
nier détail explique aussi pourquoi cette
dans tous
les
œuvre
est
omise
index bibliographiques connus.
A.
VESSELOVSKI.
LE CABINET DU MISANTHROPE.
Le sens du mot
cabinet
Franchement,
«
il
est
dans
bon
fameux vers
le
à mettre au cabinet »
M.
est toujours contesté et le sera toujours.
Moliériste
même
meuble à
serrer des papiers,
(tome H,
vers de Robinet
»
»
Ces deux
l'opinion de
ce serait
rerais
p. 24e),
et
en trouve
Noble
M.
et
pour
tient
le
sens de
apporte à l'appui deux
le style
net
digne du cabinet. »
mon avis^, vont directement contre
Un sonnet à mettre au cabinet,
à
Picot.
un sonnet
d'un style net
«
un des deux
On
autres
sens,
jour, dans Vespitre
aux
^on de Discret (2^ éd.
français de Jannet)
et noble. » Je préfé-
de
cabinet
travail,
ou
mot
eût
a quelquefois contesté que le
déjà ce sens au XVII^ siècle^
mais à
beuriêres
tort.
Je
lisais l'autre
de Paris, qui précède V,Ali-
1664, réimp. dans V Ancien
passage suivant
le
un escu pour acheter
«
il
Picot, dans le
:
On
vers,
l'autre cabinet.
:
«
un
:
livre entier
«
théâtre
Tel qui n'a pas
en void du moins
quelque petite partie à bon marché, puisque vous en
«
donnez
a
que vous débitez
tousj ours
quelque lambeau par dessus
« d'argent qu'il ait,
;
et par ce
moyen
il
peut,
les
denrées
pour peu
gouster les charmants entretiens de
LE MOLIÈRISTE
l'yl'^
«
ces grands génies,
usage
« autre
un exemple
C'est
Lacroix,
me
si
j'ai
dès
le
elles
en
siècle
pas
la
et
;
curieux.
et,
M. Paul
c'est
le
qu'elle
prévue et
admettre une bien
part de Molière, qui, auteur et
mieux que personne combien
saisir
L'équivoque
du moment
à dire qu'elle était
contraire,
étrange inadvertance de
acteur, savait
de leurs œuvres a
à tous ceux que
des chercheurs
XVn=
le
Supposer
promptes à
sert
»
à ajouter
était possible, je n'hésite
voulue.
ne se
bonne mémoire, a réunis dans un volu-
de V Intermédiaire
était possible
s'il
datis le cabinet.
double sens des
les foules
mots, et
sont
comme
rient.
C. D.
L'abondance des matières nous oblige de remettre à
prochaine livraison un curieux
samment
intitulé
:
article
Question de cabinet.
sur ce sujet,
G. M.
la
plai-
2îi
CORRESPONDANCE
Monsieur
le JDirecteur,
M. Paul Lacroix
Votre savant collaborateur
dans
dernière livraison du Moliériste, à propos de Cotin-
la
Trissotin
«
écrivait,
:
Nous ne croyons
deux passages
pas qu'on
très curieux
et
Galant de 1672, dans lesquels
savantes
et
ait
très
il
encore mis en regard
importants du Mercure
Femmes
est question des
du personnage épisodique de Trissotin, que
Molière avait imaginé pour donner satisfaction à une de
ses
anciennes colères contre l'abbé Cotin. //
que l'abbé Cotin ne
mons
pas
l'avait
qui attiraient en foule la société
des gens
cour. Voici la
de
est
à présumer
ménagé dans un des
précieuse et
première note,
ser-
l'élite
Molière
qiie
pourrait bien avoir rédigée lui-même... »
Viennent deux
d'un troisième^ emprunté à Bayle.
suivis
Or,
la
extraits
aussi
empruntés au V^ercure galant^
extraits,
Vie
de
Molière
du Mercure galant
dans
la
par Taschereau reproduit
et
de Bayle, que l'on
notice consacrée à l'abbé Cotin par
L. Livet dans Précieux
et
les
trouve
M. Ch.
Précieuses.
Relevons, dans ce dernier ouvrage, un amusant passage
de Cotin appelant Molière à son secours pour combattre
Ménage
:
— Je
pensais,
dit-il,
que toute
achevée quand on m'a averti qu'après
jouer chez Molière
Ménage
la
ménagerie
les Précieuses
on
fût
doit
hypercritique, le faux sçavant
LE MOLlèRISTE
158
et le
pédant coquet
curieux détail
:
vivat
—
!»
Et
—
Cotin ajoutait,
Les comédiens ont mis dans leurs
«
:
affi-
ches qu'il faudra retenir les loges de bonne heure et que
tout Paris
grands
On
une
c'est
:
voit,
estre,
parce que toutes sortes
de gens^
mariez ou non mariez, sont intéressez au
et petits,
Ménage
s'était
y doit
plaisanterie de comédiens. »
par les lignes qui précèdent, que Cotin
ne
point senti atteint par les attaques de Molière con-
dont
tre les Précieuses,
raillé les
Ceci
travers.
Bibliophile
une
prière.
un
de nous
citer
allusion
à Molière,
seul
avait
il
lui-même plus d'une
fois
nous amène à adresser au savant
Nous
des
lui
une seule
Molière, un seul motif bien
saurions
un gré
infini
sermons de Cotin qui
plainte
de Cotin
authentique des
fasse
contre
colères
de
MoHère contre Cotin.
Nous
faisons
qu'il se trouvât
une réserve cependant
:
il
serait possible
quelques lignes hostiles à Molière dans
la
Critique désintéressée dirigée par Cotin contre le sieur des
Vipéreaux
— (Despréaux).
gré sa légitime
le nier,
autorité,
Taschereau
l'assure
nous n'osons
n'ayant pas sous les yeux
;
mais, mal-
ni l'affirmer ni
la Critique.
Sur ce point
nous nous en rapporterons à M. Paul Lacroix.
UN PROVINCIAL.
MOLIÈRE A CHATEAUROUX
Voici ce qu'écrivait, en avril 1874, M. le D^ Fauconneau-Dufresne dans son Histoire de Déols'et Châteauroux ; (i)
« Il résulte de documents trouvés par M. Guition, à la bibliothèque
du Panthéon, que l'ancien hôtel du Dauphin (dont les bâtiments sont
aujourd'hui occupés par MM. A. Nuret et fils, imprimeurs-libraires, 72,
rue Grande, à Châteauroux) a été le témoin des débuts de l'inimitable
Molière.
» Alors que ce grand auteur de comédies était chef d'une troupe
ambulante, il s'arrêta à Châteauroux et donna une représentation dans
une sorte de jeu de paume qui dépendait de cet hôtel et qui s'ouvrait
sur la rue du Tripot.
M II avait dit n'avoir pas eu à se louer des gens de Linu^es, mais
avoir, au contraire, été très satisfait de l'accueil de ceux à^ Argentan et
de Châteauroux. »
Les chercheurs seront-ils plus heureux dans ces deux
qu'à Limoges, où aucun document n'est
venu, jusqu'ici, confirmer la tradition locale ?
Qu'est-ce que M. Guinon ? quelle est la source à
laquelle il a puisé ces renseignements^ trop précis pour
n'avoir pas un fond de vérité?
Châteauroux était, comme Limoges, sur la route de
Toulouse, où l'on sait que Molière a fait plusieurs séjours,
et, aussi sur la route de Poitiers, où l'on croit assez généralement que rillustre-Théâtre a passé.
En octobre 165 1, Louis XIV, allant de Bourges à Poitiers, s'arrêta à Châteauroux et coucha à l'hôtel même
du Dauphin.
C'est précisément aux alentours de cette date qu'il
faudrait rechercher la trace du passage de Molière, soit
dans les livres de paroisses, soit dans les registres du conseil de ville.
,,
^
dernières villes
Georges
(i)
2 vol. in-8.
page 960.
Châteauroux, A.
Nuret
et
Mon val.
fils,
1873-74, tome
II,
BULLETIN THÉÂTRAL
Comédie française.
—
Dimanche 25
(MM. Maubant, Dupont-Vernon,
Joliet,
juin,
Tartuffe,
Richard, Baillet,
Davrigny, Leloir; M""" Jouassain, Samary, Lloyd
— Lundi 26,
tin).
Truffier, Davrigny,
chet;
M™"
Femmes
V Avare
Le Bargy,
savantes
(MM.
Samary, Fayolle).
Martel,
Tronchet
;
Martel,
JoHct,
Mar-
Richard,
Leloir, de Féraudy,
Trôn-
—
Bianca, FayoUe, Frémaux).
Jeudi 29, les
Got, JoHet, Richard, Silvain, Leloir,
Le Bargy, Tronchet;
(MM.
(MM.
et
—
Baillet,
Brohan, Jouassain, Barretta,
M"^^^
Mardi 25
Joliet,
juillet,
Truffier,
le l^Cariage forcé
Leloir,
Villain,
M"<= Fayolle).
—
Lycée Louis le Grand.
Concert du jeudi 20
let
La grande scène des Précieuses Ridicules, par M.
:
juil-
Co-
quelin aîné et M"«^ Reichemberg et Durand.
MONDORGE.
Les
fouilles
pratiquées à la suite de la démoHtion
Marché S'-Joseph ont amené
la
du
découverte d'une grande
quantité d'ossements provenant des
sépultures de l'ancien
cimetière S^-Joseph. Peut-être
y a-t-il là quelque relique à
jamais perdue de Molière, qui ira rejoindre
aux Catacombes
poussière des générations que son
génie a
penser.
la
Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
— Noël
fait
rire et
q^ ^^
Texier
QUATRIÈME ANNÉE
SEPTEMBRE 1882
NUMÉRO 42
LE
MOLIÉRISTE
XEFUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
Campardon,
MM
Claretie, F. Coppée, V. Fournel,
J.
:
J.
Guillemot,
A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
L. Moland, Ch. Monselet, E, Noël,
J. L01SEX.EUR
,
Ch.
Nuitter
,
E.
Picot
,
L.
de la
Pijardiêre,
Rounat, F. Sarcey,
H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu, etc.
F.- P. Régnier, Ch. de la
Dr
PAR
Georges
MON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
PARIS
.
10,
LIBRAIRIE TRESS1-:
GALERIE DU THEATRE FRANÇAIS, lO
1S82
SOMMAIRE DU NUMÉRO
XLII
QUATRIÈME ANKÉE
WXA/W
UN NOUVEAU DÉNOUEMENT DU TARTUFFE.
— Vinccns St-
Laurent.
BULLETIN THÉÂTRAL.
— Mondorge.
LES DERNIERS MOiMENTS DE MOLIÈRE, Statue de M. H.
Allouard, reproduction
tirée
hors texte.
LETTRE A M. HENRI MARTIN. — H. de Lapommeraye.
RÉPONSE A UN PROVINCIAL. — La Rédaction.
AUX INTERPRÈTES DE MOLIÈRE. — E. Legouvé et DupontVernon.
ICONOGRAPHIE MOLIÉRESQ.UE.
— Du
Monceau.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
français,
2, place
tions,
:
— ÉTRANGER,
I
3
FRANCS.
UN FRANC 5O CENT.
du Théâtre
M, G. Monval,
manuscrits, communica-
à la librairie Tresse, io, Galerie
ou par mandat sur la poste adressé
de Vintimille, auquel
demandes
lettre affranchie.
et
les
à
réclamations devront être envoyés par
UN NOUVEAU DÉNOUEMENT
DU TARTUFFE
L'extrait suivant, qui
occupe
les
Notice des travaux de l'académie
1808
(i), est
tionné par
si
peu connu
pages 387 à 402 de
la
du Gard pendant l'année
qu'il
M. Paul Lacroix dans
même men-
n'est pas
sa précieuse
Bibliogra-
phie Moliéresque,
Nous croyons
sans
avoir
voir la
devoir le réimprimer à
titre
Comédie Française
substituer
au dénouement de
Molière celui de M. Vincens Saint-Laurent
«
La poésie dramatique
gloire
de curiosité,
besoin d'affirmer que notre but n'est pas de
littéraire
de
la
:
est la plus belle portion
France
;
c'est
elle
qui
de
la
surtout
a
assuré à notre langue son triomphe et son universalité
c'est sur
et ce
nos théâtres que
pureté du goût de
sentiment exquis des convenances qui
temps distinguée,
les esprits
(i)
la
se font
éminemment
l'a
sentir.
la
si
;
nation,
long-
Aussi tous
raisonnables et cultivés, que n'aveugle pas trop
Nismes, Venis Belle, 1809, in-8.
LE MOLIÉRISTE
164
de haine ou de prévention, se
sont-ils,
dans tous
les
pays,
empressés de rendre à nos grands écrivains en ce genre,
un hommage pour
dire
ainsi
universel.
Naples, Milan,
Vienne, Berlin, Pétersbourg, Londres
même, ou
se sont
approprié leurs chefs-d'œuvre en
traduisant,
ou ont
les
élevé des théâtres et appelé des comédiens français.
de gens, depuis Tépoque brillante où ces grands
Peu
hommes
ont vécu, avaient osé leur contester leur gloire. Aujourd'hui
d'autres causes d'animosités
il
s'est élevé contr'eux,
grement
;
renforçant l'envie littéraire,
le
nord, une école
dédaigneuses
:
les
le
Schiller
génie sent
qu'il se présente à lui.
qui professent ces opinions
le
génie sous quelque habit
Shakespeare se fût agenouillé devant
même respect
anciens, même en
Corneille et MoHère, et leur eût rendu
que Lopez de Vega témoignait aux
abandonnant leurs traces
J'écris
Que
»
tés
en insensé, mais
j'écris
hoyau,
la truelle
Soyez plutôt maçon,
»
pour des fous.
ceux donc qui ne sentent pas
bêche ou
le
:
de nos grands maîtres jettent
la
de déni-
mais, à coup sûr, ce ne sont ni les Lessing, ni
Goethe, ni
les
dans
la
les
sublimes beau-
plume
prennent
et
le
:
si c'est
votre talent.
Parmi ceux de nos écrivains qui
se sont illustrés
dans
cette carrière difficile et brillante, Molière tient sans contredit la
première place dans l'opinion générale
comparer, avec raison, Sophocle
Racine
leur
et Voltaire, et
soit
:
on a pu
Euripide à Corneille,
nos voisins ne craignent pas de
égaler leur Shakespeare.
comique,
et
Mais Molière
ancien, soit moderne,
soit
!
quel poète
national,
soit
LE MOLIÉRISTE
165
étranger, oserait-on lui mettre en parallèle
sans rivale, sa
compatriotes
mais
»
Un
reconnue.
supériorité
Sa gloire
?
seul
est
parmi ses
contre ce consentement unanime,
s'est élevé
n'y a pas eu deux Erostrates littéraires.
il
Nous ne prétendons
pas pour cela, sans doute, que les
ouvrages de ce rare génie soient entièrement exempts de
défauts.
partage
En aucun genre l'infaillibilité ne fut jamais le
de l'homme l'estime qu'on fait d'un grand écri;
vain doit être le fruit d'un jugement, et
L'homme de
aveugle
:
lettres
preuve
talent,
lière
hommage
M. Vincens
Cet
culte.
ne voudrait pas d'une approbation
tout admirer, c'est n'admirer rien
critique est la
»
non pas un
et une
;
juste
garant d'un juste éloge.
et le
que
indirect,
le
goût acquitte envers
Saint-Laurent vient de
le
rendre à
le
Mo-
d'une manière bien ingénieuse, dans un morceau de
littérature qui a
pour
titre
Du
:
dénouement de la comédie
de Tartuffe.
«
On
reproché à Molière
la
plusieurs, en
sont uniformément
a, dit-il,
»
dénouemens
»
romanesques
»
pièces qu'ils terminent.
»
que l'homme de génie qui
:
et
effet,
défectuosité des
peu dignes des beautés
Il
est difficile
a
si
de ses
multipliées des
de se persuader
savamment combiné
»
toutes les
»
d'heureuses situations, mis en jeu un
»
d'admirables ressorts et produit des effets
»
variés, n'eût pas été
»
dite
»
si
»
empêché de soutenir jusqu'au bout
«
pour
autres
parties
si
assortir la fin
comiques
et
si
de fécon-
de ses comédies à tout
à
tant
grand nombre
doué d'assez de force
des causes étrangères
M.
'inventé
plans,
le reste,
son talent ne l'avaient pas
son essor.
»
Vincens Saint-Laurent trouve les causes perturba-
l66
LE MOLIÈRISTE
du
trices
de comédie, qui
travailler
pour
le
mettait souvent dans
que pour
sa troupe plus
commande
nécessité de
la
était
il
de se conformer
et
d'un prince absolu, accoutumé
à
et
tout plier
faire
prouvent assez que Molière,
comme
une comédie
la
comble de
l'art
et des caractères
!
en
donné tout
moyens
ses
le
comme
Misanthrope
»
et
Il
:
Oh!
ici le
Comme
On
ses idées
que
trois
le
paraît
du sujet
ainsi
dire
poète
s'est
combiner
de
et
pour moi. »
du dénouement de Tartuffe;
ne manquèrent
et la réflexion
point au talent, puisque l'ouvrage,
fut terminé
nous
sort
pour
déroule
finir
dénoue-
le
:
en parlant de sa comédie du
même
temps
il
voit qu'ici
celle-là, je l'ai faite
n'en est pas de
cependant
se
il
!
temps de mûrir
«
lui-même, savait
conduire
ces chefs-d'œuvre
aussi disait-il,
:
et la
cette partie.
^ans effort et de lui-même
du Misanthrope,
des Maris,
laissé à
nouer
ment surtout du dernier de
le
indé-
si
si libre.
Les dénouemens de V Ecole
»
encore,
aux or-
devant ses désirs, jusqu'au génie par lui-même
pendant
dans
sa gloire, et
non moins contrariante où
l'obligation
de composer de
dres
dans sa qualité de directeur
talent de Molière
ans après.
commencé en
On
1664, ne
a peine aujourd'hui à
démêler quels motifs ou quels dégoûts purent engager
Molière à produire, dans
l'état
d'un de ses plus beaux ouvrages.
le talent
Il
la
voyons,
ce n'est de Vart, du
le
la fin
semble impossible que
qui avait conçu et exécuté, avec une
qu'on n'a point égalée,
si
où nous
supériorité
premier des chefs-d'œuvre,
moins du
pas facilement trouvé et tiré de
génie
comique, n'eût
l'essence
du
sujet
un
LE MOLIÈRISTE
moyen, digne de
167
de punir l'imposteur
lui,
et
de sauver sa
victime.
»
Ce moyen
frir si
à la
paraît
même à M. V incens Saint-Laurent
naturellement à
ne peut avoir échappé
l'esprit, qu'il
vue du Maître, puisque lui-même en
première
s'of-
en
lecture réfléchie qu'il fut
fut frappé à la
état
de
faire
du
Tartuffe.
»
Laissons notre auteur exposer et développer lui-même
ses idées
ce
»
J'ai
:
longtemps repoussé
d'essayer de réaliser
comme un sacrilège
mon opinion
cette idée
moins d'oser porter une
»
jours été qu'à
»
sur les ouvrages de Racine,
»
littérature, d'entreprise plus hardie
»
aux comédies de Molière.
»
de nos jours (i)a heureusement
il
En
le désir
a
:
ne pouvait y avoir,
que
vain
tou-
main téméraire
en
d'oser toucher
un poète comique
des scènes con-
extrait,
»
fuses qui constituaient la Suite
du Menteur de Corneille,
»
une pièce réguUère, comique,
et
» plus d'éclat
»
où ne
brille
qu'avec
du premier auteur
ce qui a été conservé
;
en vain a-t-on élagué, au théâtre, un grand nombre de
de
des tragédies
Cimia,
du Cid
des
»
superfluités
»
Horaces, et donné, par ces retranchemens, plus de rapi-
»
dite à leur
marche,
»
d'unité
d'ensemble à l'action
»
tentative
» réussi à
»
pendant
(i)
et
plus de vivacité à
de mettre en vers
Thomas
trente
Corneille
ans,
Andrieux, en 1808.
à
:
le
;
en
et
l'intérêt,
vain
la
plus
même
Festin de Pierre a-t-elle
mes scrupules ont
l'appât
de
ces
résisté,
exemples.
lé8
LE MOLIÈRISTE
»
Chaque
fois
que
»
monter
mes
craintes,
»
me
mon
» écrivain
mis
désastreusement
que
» aussi les mutilations
en
(i);
estimable
d'ailleurs
sur-
d'Iphigénie
me
elle
montrait
sont quel-
se
» quefois permises sur plusieurs pièces de Molière,
» cri général de réprobation qu'avait excité
comme un
» audace, retentissait
et le
double
cette
présage à
sinistre
en
un
par
action
comédiens
les
de
prenait
imagination épouvantée
dénouement
ramenait aussitôt au
» Aulide, ^si
me
tentation
la
mon
» oreille.
»
On
ne risque rien,
» plutôt des
dit
beautés que
Winkelmann
des
défauts
de chercher
(2),
dans
ouvrages des
les
» grands maîtres. L'observateur en trouvera sûrement, ajoute»
t-il,
l'on ne
et
pourra pas dire qu
elles soient
» imagination y persuadée d'avance qu'elle
» beau est réel y
»
qui ne
l'a
pas
senti,
va voir du beau:
doit voir
Profondément pénétré de ce principe,
opposé aux critiques des chefs-d'œuvre
»
même
»
il
ou
à celles qui
ce
revoir
me
paraissaient les
a plus d'une fois servi à
toujours
dramatiques,
mieux fondées,
m'en démontrer
l'injustice
l'erreur.
» J'ai
mis
» cachées
»
et
je l'ai
»
» et
de son
ce qu'il l'aperçoive. »
jusqu'à
t>
et
l'effet
la
même
obstination à découvrir les beautés
du dénouement de
Tartuffe,
mais infructueuse-
ment. L'application du principe de Winkelmann n'a
» pas
(1)
produit
le
ici
même
St-Foix, en 1769.
(2) Histoire de l'art,
t.
I,
p. 315.
résultat.
Je n'ai
jamais
pu
LE MOLIÊRISTE
))
trouver aucune raison qui
dans
excusât l'intervention,
personnage subalterne, jusqu'alors
» la catastrophe, d'un
»
lG$,
entièrement étranger à l'action, ni
reconnu
la singulière fantaisie
dans Tartuffe un fourbe
»
du
»
renommé, de l'envoyer encore braver, insulter d'honnê-?
a
lorsqu'il
roi,
» tes gens, et
de ne
exécuter l'ordre de l'arrêter
faire
d'Orgon
» qu'en présence
de sa famille
et
» intempestif du monarque, qui, dans
» est
prononcé,
produit
l'effet
de
éloge
ni cet
;
moment où
le
froide
l'eau
il
un
sur
» corps brûlant.
» Je l'ai déjà dit
il
:
un expédient simple, natu-
s'offrait
du fond du
formant un
sujet, lié à l'action,
»
rel, naissant
»
trait
de caractère de Tun des personnages secondaires,
»
mais
essentiels,
»
sonnage en jeu d'une manière plus
de
la pièce, et
que
mieux^
»
bornât pas à donner avis à
» nace,
))
:
à
«
»
venue
dénouement
un rempart à
Quoi
idée
qu'il
en
se
moyen
présente
mes yeux, que
» dubitable qu'elle était
» faire
qui trouvât le
lui
cette
même, du moins
» préféré le
qui
et
;
se
me-
le
mais
d'éclairer la
de
faire
punir
?
« Je le répète
»
Orgon du danger
du prince, de sauver l'innocence
» le coupable
vaudrait-il pas
de l'accompagner dans sa fuite
et à l'offre
qu'en outre ce fût
» justice
le
Ne
dévouement de Valère ne
»
effet,
active, à accroître l'in-
du spectateur.
» térêt et la satisfaction
en
propre, en mettant ce per-
qu'il
je
bien
si
regarde
in-
aussi à Molière, et qu'il n'a
nous a
laissé,
que pour en
sa pièce contre ses ennemis.
soit, la
nouvelle
combinaison que
propose n'exige presque aucun changement dans
» position des scènes
d'elle-
comme
;
elle
je
la dis-
ne demande que quatre vers
lyO
LE HiOLlèRISTE
»
au premier acte, pour fonder
»
de Valère
une
;
» carrosse et apporte
succès de ses démarches,
»
de
»
amené.
»
long
Telle est
la
fait
panégyrique
Chaque
vieillesse,
la
et
de
XFV,
Louis
que
j'ai
lu
venue assiéger
dois
morale se ressent du voisinage^ puisque
»
blesse de
»
pas
;
je
m'en accuse
:
la
du
mal
ma
plus
Tartuffe, l'en-
mon
que
esprit. Je
mon
ma
eu
j'ai
conforce
la
fai-
m'en vante
tentation. Je ne
j'en fais, par
si
j'arrive sur les
croire
»
succomber à
récit
le
fois
je
amène un
par lui-même, à la place
constamment repoussée, mais
de
» fins
il
poursuit depuis
» vie d'en essayer l'effet est
» l'avais
scène où
me
pensée qui
» tendre jeunesse.
la
de l'argent à Orgon, et
»
ce
de l'action
possibilité
la
au lieu de
lettre
aveu,
amende
» honorable.
»
donc comment
Voici
« entreprise
»
Dans
» dire par
j'ai
mon
exécuté
audacieuse
:
la
scène sixième du premier acte, Molière
Géante
à
Orgon
fait
:
Vous save\ que Valère
Tour
»
être votre
gendre a parole de vous.
Entre ces deux vers j'en
» nière suivante
intercale quatre
de
:
Vous savez que Valère
Est riche, noble, sage et très considéré
due
Aux
la
;
faveur d'un oncle, à la cour fort ancré,
plus brillants emplois lui permet de prétendre,
Et que
même
déjà,
pour être votre gendre.
Cet aimable jeune-homme a parole de vous.
la
ma-
I7I
LE MOLlèRISTE
me
ce
assez,
» C'est
»
ment du cinquième
»
gemcnt
»
»
acte, et jusques-là
préparer Tévène-
aucun autre chan-
n'est nécessaire.
Au cinquième
acte^
de
au lieu
de confiance apporterait une
remettant à
Orgon
paraître Valère
faire
engager Orgon à
lui-même, lorsqu'il vient
» valet
»
semble, pour
fuir,
lettre et dirait,
:
Valère veut, monsieur, que, sans perdre un instant,
Je remette en vos mains ce billet important
Il sait
S'il
tous vos chagrins, et
ne vient pas encor
C'est que votre intérêt
le
le
;
sien est extrême.
témoigner lui-même.
demande
ailleurs ses soins.
pour vos premiers besoins,
Pour votre
sûreté,
Avec mille
louis qu'ici je
J'amène son carrosse,
il
vous apporte,
est à votre porte
:
Et dans un endroit sûr, qu'on ne soupçonne pas,
Mon
maître m'a prescrit d'accompagner vos pas.
Hâtez-vous.
ORGON.
Ciel
ma
!
fuite est-elle nécessaire ?
LE LAQ.UAIS.
Lisez, monsieur,
la lettre
explique ce mystère.
ORGON
Pour prix de vos
bienfaits et
Abusant d'un dépôt à sa
scélérat
vous
jette.
n'en pouvoir douter,
sais, à
Qju'au ministre
D'un criminel
de votre amitié,
foi confié.
Dans un danger pressant un
Je
lit.
il
vient d'apporter
d'état l'importante cassette
Dont au mépris,
dit-il^
Vous avei conservé
le
du devoir d'un
sujet,
coupable secret.
Partez, monsieur, partez sur l'heure
Qu'une impénétrable demeure
;
en
un
la
LE MOLlèRISTE
172
Vous dérobe
à l'affront de vous voir arrêter
;
a surpris Tordre et doit l'cxiicutcr.
Il ci;i
CLÉANTE,
Voilà ses droits armés,
De
par
c'est
et
traître
oii le
vos biens qu'il prétend cherche à se rendre maître.
i(j t..
ORGON.
L'homme
(Il
reprend
est, je
vous l'avoue, un méchant animal
continue de
la lettre et
:
lire)
Le moindre amusement vous peut
être fatal
:
N'écoutez point, monsieur, un imprudent courage
Je vous offre avec joie un asile assuré
Acceptez-le, tandis qu'ici je resterai
Pour
tâcher,
s'il
:
;
se peut, de conjurer l'orage.
Valère.
Las ! que ne
dois-je
pas à
Pour
l'en
Et
je
demande au
ciel
Pour
reconnaître,
un
Adieu
;
remercier
prcne\
le
il
ses soins obligeans
faut
de
!
un autre temps.
m' être
asse^ propice
jour, ce généreux service
:
soin, vous autres...
CLÉANTE.
Alle\
Nous
songerons,
mon frère,
à faire
» Ici entre Tartufe à la suite
» à
de l'exempt,
changer à cette scène jusqu'au
» silence
tôt ;
ce qu'il faut.
et
moment
il
n'y a rien
où, réduit au
par les raisonnements de Cléante et par les jus-
reproches du
T>
tes
»
l'exempt
reste
de
la
famille.
Tartuffe
dit
à
:
Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie,
Et
»
A
daigneu^ accomplir votre ordre, je vous prie.
ces mots, que
» sente à l'exempt
» s'écrie
:
Valère entend
un
pap.."r
qu'il
en accourant,
tient
à la
il
pré-
main, et
LE MOLIERISTE
Votre ordre,
Du
I73
Prévenu par Damis
un fourbe vous a mis,
le voilà.
trouble où dans ces lieux
Je vole chez
mon
ma
oncle, et, par
vive instance,
J'obtiens que son crédit prenne votre défense
Il
;
court chez le ministre, et dès ses premiers mots
Lui
fait
du
scélérat détester les complots.
Ensuite avec chaleur,
il
retrace,
rappelle
il
Le noble dévouement, l'infatigable zèle
Qu'en sujet, citoyen fidèle et généreux.
Vous avez signalé dans des temps malheureux
Et, l'indignation s'emparant de son âme,
Il
;
peint en traits de feu cet hypocrite infâme.
Suivant son intérêt complice ou délateur,
Et pour
dépouiller perdant son bienfaiteur.
le
On
s'enquiert quel
Ces
secrets
il est
on fouille ces registres,
documents qu'ont toujours les ministres,
;
Et sous un autre nom,
Un
Le
Le
il
se
découvre en
lui
en vain cherché jusqu'aujourd'hui,
scélérat
détestable auteur d'un forfait exécrable.
ministre aussitôt va de ce misérable
Faire connaître au roi les nouveaux attentats.
Justement révolté,
Que
Que
prince ne veut pas
le
d'une perfidie on profite
sans les visiter, sans les
;
il
lire,
commande
on vous rende
Ces papiers qu'un ami déposa dans vos mains
;
Et, sûr de votre foi par des garants certains,
De
ce secret dépôt vous pardonne l'offense.
Consultant l'équité non moins que
la
clémence,
D'un souverain pouvoir, il annuUe l'efiet
Du don qu'à cet ingrat votre tendresse a fait.
Il ordonne de plas qu'à l'instant on saisisse.
On livre le méchant aux mains de la justice
:
Je
me
charge de l'ordre, afin de l'apporter
Avant que
J'arrive à
Les
Le
le
fers qu'il
perfide
premier
ait
pu s'exécuter
:
temps malgré sa diligence extrême
;
vous portait vont l'enchaîner lui-même,
!
TARTUFFE.
Comment.,?
LE MOLIERISTE
174
l'exempt, à Tartuffe
Marchez sans raisonner.
L'ordre est
» TartuflFe
»
ques à
clair et n'a rien qui
emmené, Molière reprend
de
fin
la
ce
pièce,
la
que
» hasardé le travail
» sacrifier
j'ai
bien
! te
aucun autre de ceux où
» est
me
» propres
voilà, traître
le
yeux, que,
ma
si
j'ai
parfaits
mon
ouvrage qu'à
3>
reconnue vicieuse du
»
hors d'oeuvre et
que
» l'indulgence
je
n'ai
du moins
une longue déclamation
alarmée, et
conscience
de mes lecteurs,
de
la
c'est
contre
seule
la
bienveillance et de
qu'ils n'oublient
pas
commis un péché littéraire, peut-être irréje leur en ai fait un aveu sincère, mais sous
si j'ai
» missible,
» le sceau de
» révélée.
la
confession, et qu'elle ne
doit pas
être
»
L'académie du Gard n'a pas
vœu modeste
le
de mêler mes
dépourvue de tout mérite de
puisse attendre
je
mes
partie universellement
la
sien, qu'à
même
d'une
syndérèse
» grâce
ce
à
torts
Mais ces raisonnemens sont impuissans
» style.
que
génie profond de l'auteur
de MoHère,
plus
»
!
eu l'audace
» vers les
» que,
n'aurais
je
m'avait fallu
s'il
prose rimée aux conceptions et aux
» substitué
la
faire,
pour tâcher de diminuer mes
dis,
» faibles idées et
»
jamais
certes
et
osé
fortement empreint.
si
» Je
tous ses droits jus-
admirable du rôle d'Orgon:
trait
Hé
» ni
vous doive étonner.
goût,
de
M.
la justice, la
cru
devoir
répondre à
Fincens-St-Laurent. Elle a
vérité, les
progrès
de
pensé
l'art, et
LE MOLIERISTE
le
respect
même
I75
pour
qu'elle professe
plus
le
grand des
poètes comiques et le premier de nos philosophes moralistes, lui
imposaient l'obligation de donner au travail que
nous venons
digne.
d'extraire,
publicité
la
dont
il
semble
lui
»
BULLETIN THÉÂTRAL
Comédie française.
reux
(MM.
de Féraudy,
Bianca et Frémaux).
(MM.
— Jeudi
Joliet,
Davrigny, P. Reney,
— Dimanche
—
(MM.
;
9, le
Martel, Joliet, Truffier, Leloir;
M"^
et
Mercredi 16
(M. Delaunay,
—
Mercredi
M""" Bianca, Thénard
Fayolle).
Roger
Joliet, Truffier,
Frémaux).
M™"
Scapin
6, les Fourberies de
Coquelin cadet, Garraud,
Mariage forcé
août. Le T)épit amou-
3
et
Mardi 22,
M"^ Tholer)
et
le
le
Misanthrope
Médecin malgré lui
(M. Gor.)
Athènes, au théâtre Apollon, en grec
vare; 23, Lé Médecin malgré lui
;
:
22
VA-
juillet,
25, Le Bourgeois gentil-
homme.
Smyrne.
— Au
geois gentilhomme,
let,
M.
théâtre
en grec.
de PûurceaugnaCj
Alhambra, 27 juillet,
théâtre Eldorado
— Au
en
le
:
Bour-
23
juil-
turc.
MONDORGE.
MOMENTS DE MOLIÈRE
LES DERNIERS
Nous offrons à nos lecteurs la reproduction du Molière mourant^ de
M. Henri AUouard, qui a obtenu une seconde médaille au Salon de
cette année.
Notre collaborateur, M. Jules Claretie,
Salon en courant
l'a
jugé d'un
mot dans son
« tout à fait supérieur, bien drapé, saisissant. »
:
Dans la Revue des Deux-Mondss (i), le président du Jury de sculpM. Eugène Guillaume, de l'Institut, s'exprimait en ces termes
ture,
:
Cette figure, qui obtient un
«
si
beau succès,
est parfaitement pré-
sentée. Elle est très juste de caractère. Molière repose déjà
et
son corps se sont détendus. La paix
Qu'aurait-il à regretter? Artiste,
finie.
Homme,
il
théâtre
son esprit
meurt pour
ainsi dire
au
reste impassible. Ainsi donc, ni débats,
ni convulsions; rien
Nous
lière et
;
venue. La pièce est
de ses peines. Philo-
de ces agonies dont
«
il
est
c'est la fin
bruit des applaudissements.
sophe,
lui
félicitons
d'avoir
(2).
la scène
nous donne trop souvent
M. Allouard
traité
d'avoir
si
le
détail.
dignement représenté
Mo-
avec tant de mesure un sujet qui touche au
»
L'Etat vient de
commander
le
marbre à
l'artiste, et
nous espérons
qu'à l'un des Salons prochains l'œuvre définitive obtiendra la première
médaille, dont elle nous semble digne à tous égards.
G. M.
(i)
Le Salon de 1882
(2)
V Univers
droit
de cette
illustré
statue.
:
la Sculpture.
du
5
Livraison du ler juillet 1882.
août 1882 a donné une gravure du profil
:^I.
CORRESPONDANCE
Paris,
Mon
28
1882.
juillet
cher confrère,
Le Cercle de
dramatique
critique
la
charge d'avoir l'honneur de vous
lettre qu'il vient
M.
d'adresser à
le
et
me
musicale
envoyer copie de
M.
des inscriptions parisiennes, au sujet d'un rapport de
Nuitter dont vous avez pubHé
du I"
Le
résumé dans
le
chain
juillet.
numéro de
cette lettre
dans
le
pro-
votre journal.
Croyez à mes sentiments de vive
Le
Henri de
cordialité.
président,
LAPOMMERAYE.
Paris, le
26
juillet
1882.
Monsieur Henri Martin, sénateur, membre de P Académie
française, président
du Comité
Monsieur
Le Cercle de
j'ai
le Moliériste
Cercle de la critique dramatique et musicale espère
que vous voudrez bien reproduire
A
la
Président du Comité
la
des inscriptions parisiennes.
le Président,
critique dramatique et musicale,
l'honneur de présider,
me
charge de vous
que
communi-
l8o
LE MOLIÈRISTE
ru du Temps (i) (sans nom d'imprimeur
1667
eu
?) avait
de dire des comédiens
la sottise
» Je leur abandœine
donc
ma
réputation^
» m'obligent point à voir leurs farces.
» des
Que
Cum
nom
—
:
pourvu quils ne
peut-on répotidre à
les
loix,
même
des
?
crimine turpior omni
persona
Quoi que fassent
» donne;
date
peut-on écrire contre ceux à qui l'on ne peut
» rien dire de pis que leur
î)
Que
gens qui sont déclarés infâmes par
» payens ?
et sans
est.
de semblables
mais je ne sais
si
certains
Bouffons, je leur par-
descendus
braves^
des
» Simons en droite ligne, voudront bien leur pardonner. »
Et
M. Thierry
» Provocation^
guet-apens,
ajoute:
Molière
juste prix_, avec les
non
hypocrisie
insolence,
pas, quoi qu'on
lui
fit
intérêts
en
dise,
tout payer à
de
invitation
et
la fois,
l'arriéré sans
et
doute; mais
au taux de l'usure.
Voilà, Monsieur, cet extrait,
bon
au
»
qui vous réconciliera,
je
l'espère, avec notre cher bibliophile Jacob.
LA RÉDACTION.
(i) S. 1.,
63 p.
chezl'hermite de Paris, à
la
correction fraternelle, in-8 de
AUX INTERPRÈTES DE MOLIÈRE
la lecture
Jamais
désormais
la
à haute voix
diction,
si
ne
fut plus
longtemps négligée,
en faveur;
fait
partie de
l'éducation première; la ville de Paris a ouvert, pour ses
instituteurs et institutrices, des cours spéciaux, qui
fréquentés aussi par
bon nombre de gens du monde
de prononciation deviennent à
questions
sont
enfin d'innombrables ouvrages
la
mode
;
les
(i),
paru
ont successivement
sur la matière.
Parmi ces
derniers,
plus répandu
dit, le
VArt de
c'est
:
la lecture est,
sans contre-
justice, l'auteur étant
M. Er-
nest Legouvé, auquel revient l'honneur d'avoir popularisé
les
études de diction.
De
sa Lecture en action, qui complète
^uirtde la
lecture (2),
si
heureusement
quelques pages nous ont paru tout
particulièrement devoir être mises sous les yeux de qui-
conque
s'étudie à lire
Dans son
chapitre
ou
à réciter
V
(Autant d'époques,
du Molière.
autant
vains^ autant de ponctuations différentes), l'éminent
cien
remarque
matiquetnent
,
«
que
les
d'écri-
académi-
auteurs dramatiques ponctuent dra-
c'est-à-dire
que
les
signes
ponctuatifs
em-
ployés par eux sont l'image des sentiments exprimés par
leurs personnages. »
(1)
XiXe
(2)
Voir
les récents articles
de notre collaborateur M. Sarcey au
siècle.
2 volumes in- 18, chez Hetzel, 18, rue Jacob.
LE MOLIÈRISTE
l82
prend ces vers du [Misanthrope
II
:
PHILINTE.
Et
qu'à la cour de
je crois
Mon
flegme
est
même
qu'à
la ville,
philosophe autant que votre bile
ALCESTE.
Mais ce flegme, monsieur, qui raisonne
Ce flegme,
Philinte,
paisible,
si
bien,
pourra-t-il ne s'échauffer de rien?
M.
remarque
laisse
Legouvé,
l'homme
Philinte,
tranquillement échapper son vers sans
le
couper par aucun signe ponctuatif. Mais que répond l'im-
pétueux Alceste
Mais
?
ce flegme^
(virgule), monsieur, (vir-
gule), qui raisonne si bien, (virgule),
(virgule),
ce flegme,
pourra-t-il, etc.
Ces virgules répétées ne
«
de signes d'impatience
?
elles l'intonation
comme
autant
n'entendez- vous pas, en les lisant,
colère d' Alceste?
l'accent de
sont-elles pas
Ne
avec
portent-elles pas
des mots qu'elles séparent? Faites donc
attention, en lisant les auteurs dramatiques, à leurs signes
ponctuatifs
haut,
ils
:
car,
comme
ils
écrivent pour être lus tout
entendent ce qu'ils écrivent, et leurs virgules, leurs
points et virgules, leurs points d'exclamation, sont des indications de diction.
»
Plus loin, à propos de
la Poésie
dans
la diction
:
Molière n'est pas seulement un moraliste, un observa-
«
teur,
c'est
un poète. Les
ques-uns finiraient par
acteurs l'oublient trop.
me
faire haïr
ces beaux
Quel-
mots de
naturel et de vérité, à force de s'en servir pour en étouffer
un qui
les
vaut bien,
c'est le
mot
poésie.
Vous
venez-vous des premiers vers de l'Ecole des Maris?
sou-
LE MOLIERISTE
Ne
«
voudriez-vous point, par vos belles sornettes,
Monsieur
mon
frère aîné, car,
D'une vingtaine
Dieu merci, vous
l'êtes
d'ans, à ne vous rien celer.
Et cela ne vaut pas
Ne
De
I63
peine d'en parler
la
voudriez-vous point,
;
dis-je, sur ces matières,
nos jeunes muguets m'inspirer
les
manières?
M'obliger à porter de ces petits chapeaux
Qui
laissent éventer leurs débiles cerveaux
Et de ces blonds cheveux, de qui
Des
De
visages
humains offusque
;
la vaste enflure
la figure ?
ces petits pourpoints, sous les bras se perdants,
Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendants?
De
ces maiiches, qu'à table
on voit
tâter les sauces.
Et de ces cotillons appelés haut-de-chausses
De
ces souliers
?
mignons, de rubans revêtus,
Qui vous font ressembler à des pigeons pattus
Et de ces grands canons où,
On met
comme
tous les matins ses deux jambes esclaves.
Et par qui nous voyons ces messieurs
Marcher
Hé
«
ter,
?
en des entraves,
écarquillés ainsi
bien,
j'ai
vu des
dans ce passage,
les galants
que des volants
?
»
éminents se conten-
artistes très
d'être spirituels,
mordants,
sarcasti-
ques. Je ne pouvais pas m'empêclier de leur dire par la
pensée
:
« Mais, au
nom
du
ciel
!
donc peintres
soyez
aussi! Molière, dans ces vingt vers, a jeté là sur le papier
comme s'ils sortaient du
étincelants, comme s'ils sortaient
cinq ou six personnages, vivants
crayon de Callot, et tout
du pinceau de Rubens! Le visage,
peau,
le
manteau,
manches, tout cela
faites
leurs!
les souliers, les
vit,
remue,
cheveux,
canons,
les
le
cha-
collets, les
éclate, miroite, papillotte!...
donc entrer dans votre débit tout ce tapage de cou-
Que
votre
parole aussi étincelle
votre force de sarcasme
Tous
les
comique
s'en
et
flamboie!,.,
accroîtra d'autant.
les traits railleurs sortiront d'autant plus aigus
de
la
LE MOLIÉRISTE
184
bouche de Sganarelle que ce seront des silhouettes
non de
vantes, et
froides observations de moraliste!
Ces mêmes vers fournissent plus
loin,
au chapitre de
Mémoire j un ingénieux exemple de mnémotechnie
Rien de plus malaisé à apprendre,
«
que
cette description. Je
dit
Un
la
:
M. Legouvé,
m'y trompais toujours,
fondais sans cesse tous les objets.
vi-
»
jour, je
j'en
con-
remarque
que MoUère n'a pas assemblé ces objets au hasard ou selon
de
besoin
le
la
rime, mais qu'il a placé chacune de
ces parties de la toilette, à la place, et dans l'ordre qu'ils
occupent sur
aux
ensuite
le corps,
commençant par
cheveux, descendant au
pourpoint, etc. C'en était
je
le
ne l'oublierai
homme
jeune
moi de
plus.
Dès que
habillé par
aux pieds,
la tête
et
chapitre
passant au
morceau,
commençais à
MoUère
XIV, consacré aux
M. Legouvé remarque que
mon
se dressait
ma mémoire
quillement d'un objet à l'autre.
Au
je
chapeau, allant
collet,
savais
fait, je
le
et
le dire,
devant
descendait tran-
»
Oppositions dans la dictioUy
les professeurs
de chant, pour
assouplir le gosier de leurs élèves, leur donnent à faire ce
qu'on appelle des exercices d'agiHté, morceaux préparés
exprès,
où
se trouvent réunis, dans
un ordre méthodique,
d'arpèges, de
gammes, qui ont pour
des groupes de
trilles,
objet d'habituer l'instrument à toutes les difficultés vocales;
il
indique au lecteur,
des oppositions,
Lucrèce
le
comme
excellent exercice dans l'art
célèbre couplet
d'Eliante,
:
La pâle est au jasmin en blancheur comparable ;
La noire à faire peur, une brune adorable ;
imité
de
LE MOLIÉRISTE
Et
«
il
La
trop grande parleuse est d'agréable
Et
la
humeur,
muette garde une honnête pudeur.
ajoute
il
185
:
Quelle leçon de contrastes qu'un
morceau
tel
!
comme
vous force à sauter subitement d'un ton à un autre!
Toutes ces
figures, la maigre, la grasse,
ne font que passer devant vous
sage, les peindre avec
avec un
trait
ces figures
:
il
pâle, la noire,
le
poète les dessine
sons doivent être variés
comme
un timbre pour chacune
trouver
faut
la
faut les saisir au pas-
un son, comme
et tous ces
;
;
il
d'elles, »
Enfin^ pour extraire de ce traité pratique,
même
qui est en
temps un excellent ouvrage de critique
littéraire,
tout ce qui touche à notre MoUère, nous citerons ce pa-
ragraphe de
ranger
la
Le second
acte
du
mais ce chef-d'œuvre
est
«
Chanson
d'une
curieuse analyse
Dé-
de
:
amours de Marianne
et
Tartuffe
un chef-d'œuvre
est
;
un hors d'œuvre. Le tableau des
de Valère arrive
là
comme un
épi-
sode. Pourquoi cependant ne laisse-t-il pas de nous char-
mer
?
Parce que l'action n'est encore que posée,
engagée.
Mais transportez
amoureux au
3^
acte,
comme une
comme un temps d'arrêt. »
nous choquera
Peut-on mieux dire
ser avant d'exprimer
L'excellence
de
ce
quand on
et
déUcieux écho
non
et
du Dépit
en plein drame
est
;
il
dissonance, et nous gênera
mieux apprendre à
l'élève à
pen-
?
cette
méthode
a
été
reconnue
par
l86
LE MOLIÈRISTE
M. Dupont-Vcrnon, dont
comme
diés,
de diction
les Principes
Lecture en action, à Régnier,
la
(i), dé-
offrent
la
M. Legouvc.
Y^rt de bien
nous sommes heureux que
constante application des préceptes de
Le
succès de ce livre a dépassé celui de
même
dire (2),
du
l'analyse
raisonnée de plusieurs scènes de Molière nous
auteur, et
donne l'occasion de
à nos lecteurs.
le signaler
M. Dupont- Vernon
a fait
une étude toute spéciale de
deux rôles qui appartiennent à son emploi, Clitandre
interprètes de l'amant d'Henriette
homme
Voilà un
«
deux sœurs.
se
homme
Au
prononcer entre
elles
le
Et
Des vainqueurs
suis cherché, lassé
quatrième
(1) I
I
ton
:
»
Au
quel
?
»
me
les
met en de-
deux. Sur
sœur aînée
Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs
Vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs;
je
filles,
piquée au jeu et
perdu,
»
«
(2)
le terrain
doit-il parler à la
I" acte
deux jeunes
l'aînée. Cette dernière,
dans l'espoir de regagner
cet
:
placé entre
a reporté sur la cadette l'amour que lui a
Il
longtemps inspiré
meure de
et
donne aux
Tartuffe, et voici les conseils très sensés qu'il
de tant de peines,
humains
plus
et
de moins rudes chaînes. »
:
«
Appelez-vous,
»
Ce que m'a de
madame, une
votre
vol. in- 18, Paris, P.
vol. in- 18, Paris, P.
infidélité
âme ordonné
la fierté ?
OUendorf. Prix, 2
OUendorf. Prix,
i
fr.
fr.
LE MOLIÉRISTE
Mon cœur
»
court-il au change,
moi qui vous
» Est-ce
un
« Il n'est pas
pour
l'interprète
ton
du
dépit.
,
ou
187
si
Quelques-uns y mettent une
tant d'erreurs, autant de non-sens.
nuance de
dépit,
souffrir,
Vous avez
certes. Parlez
s'agissait
Or,
»
donc de
?
genre.
mais surtout froidement
d'un
toisie
vant
je
:
le
;
Fous tn'a-
«
vous jurais
une
Non
comme s'il
encore?
qui garderait quelque
soufferte.
Pas
d'accent
de
pas de sourire outré, aucune
dignement, librement,
Parlez
que votre ton
soit celui
de
l'indif-
plus profond, tempéré par la cour-
homme du monde.
Méfiez-vous du vers sui-
:
«
Mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez
J'ai fait dire
signifiait
nettement
homme
belle. »
successivement ce vers à vingt personnes,
toutes lettrées; une
quel
laisser
moindre
l'en remercieriez plutôt.
homme
triomphe, pas de persiflage,
férence et de l'oubli
la
Lui en voulez-vous de vous
Vous
!
déception
émotion d'aucun
expression
ni
dire
souffrez-vous
donc pas en
parlez
à
chassé,
d'autrui.
Par exemple
amertume d'une
le
moqueur. Au-
cette souffrance passée,
du tourment
avoir chassé
— Ne
mave^
votis
flamme immortelle.
péril
moindre accent de reproche, pas
ni le
de moquerie davantage.
^r^ fait
un
Vous ne devez
réponse à Armande,
votre
?
chassez? »
ton du reproche, sur
les dit sur le
tendre, d'autres les soulignent d'un sourire
percer, dans
poussez
l'y
me
qui n'offre
seul de ces vers
On
vous
ou vous qui
quitte,
vous
bonne moitié y mit une
:
«
Vous
fallait-il
inflexion qui
êtes bien dégoûtée,
donc
?
))
Vous
le
madame
;
voyez, ce
l88
LE MOLIÈRISTE
n'était pas cela
mot
un
est
du
Dans ce passage, presque chaque
tout.
écueil.
»
Cette méthode analytique et raisonnéc nous semble ex-
M. Dupont- Vernon
cellente.
heur au personnage de Tartuffe,
ment
On
tuffe
Comédie
à la
sait
même
l'applique avec le
bon-
fréquem-
qu'il joue assez
française.
qu'au 4" acte de V Imposteur ^ Elmire
Tar-
dit à
:
Mais comment consentir à ce que vous voulez
«
Sans offenser
le ciel
dont toujours vous parlez?
Et celui-ci de répondre
Si ce n'est que
«
Lever un
tel
:
obstacle est pour
y a au théâtre, à ce
« Il
mes vœux on oppose,
qu'à
le ciel
»
moi peu de chose.
moment
de
la
»
M.
pièce^ dit
Dupont- Vernon, un
jeu de scène dont l'effet
est infaillible. C'est,
pour l'acteur qui représente Tartuffe,
d'écouter,
Elmire
les
une
;
yeux
fois
disant
:
Voilà
le
Si
«
il
que de
lui
pubHc, par un
le
un sourire de dédain^
que
ce n'est
dernier de
bien forte
bien,
et
que
fait
entendue, de relever
en regardant
la
plus
la
moucom-
de se retourner vers Elmire en
incrédulité, enfin
plète
question
la
cette question
tête, et d'exprimer,
vement d'épaules
baissés,
sur le public
le ciel...
mes
faire
»
soucis
du ton dont vous
!
—
un grand
•
C'est
effet sur le
faut savoir résister à cette tentation
diriez
:
une tentation
;
pubHc
car,
en
eh
;
tra-
duisant ainsi le vers de Molière, ce n'est pas seulement
un
vers isolé que vous dites mal, c'est le caractère du principal
personnage que vous faussez,
c'est
l'œuvre
entière
de Molière qui disparait. Molière n'a pas voulu que Tar-
LE MOLIÈRISTE
tuffe jouât le rôle d'hypocrite,
bout, en tout
Que
dans l'âme.
ciel est
ciel
;
répond-il
il
lever.
dit
là ?
Il
ne
dit
au contraire
vous prouver que
bonheur.
et
le
mais bien
en toute
seul obstacle qui
le
très facile à
du
lieu
ciel
189
qu'il fût jusqu'au
Rien autre chose que
vous
« Je
me
:
si le
cet obstacle est
arrête,
Je
me moque
réjouis
de pouvoir
pas du tout
:
hypocrite
circonstance,
:
ne s'offensera pas de notre
»
Est-ce que ces réflexions ne vous paraissent pas pleines
de justesse,
et
ne semble-t-il pas que des rôles
ainsi
creusés, médités, approfondis doivent conduire au succès
le
comédien persévérant
et
lettré
qui
en
fait
son étude
constante et l'objet de ses leçons de chaque jour
?
G. M.
ICONOGRAPHIE MOLIÉRESaUE
—
On
Le Molière-Coypel.
venue rarissime et inabordable,
Coypel pour illustrer Molière.
jourd'hui de 6 à 700 fr. Nous
connaît peu la suite, dedes figures composées par
Complète, elle vaut auavions eu l'idée d'en faire
exécuter des réductions héliographiques pour k Moliériste,
mais c'était une dépense que notre petite revue ne peut encore se permettre, et nous en voilà dispensés par la charmante et très artistique publication que vient d'en faire
M"^ veuve LefiUeul, qui a eu le bon goût d'en confier la
M. T. de
Mare.
Charles-Antoine Coypel, Tami de Baron, grand amateur de spectacles et habitué de la Comédie-Française, où
réduction à Thabile graveur du Molière-Boucher,
il
de
avait ses entrées et venait de faire représenter ses Folies
Car dénia (30 décembre 1720)
série
d'esquisses des
(i), avait
entrepris
principales scènes de Molière.
une
Pour
raison n'a-t-il pas continué son œuvre ? toujours
que Joullain (2) n'en -grava que six, publiées en
1726, et que Coypel vécut encore vingt-six ans, pendant
lesquels il put voir son idée, reprise par Boucher, menée
à bonne fin pour la grande édition de 1734.
Mais si incomplète qu'elle soit, puisqu'elle ne donne
qu'une scène de cinq comédies de Molière alors qu'il y
en avait vingt-deux au répertoire, cette suite n'en est pas
moins extrêmement importante, tant par sa valeur artis-
quelle
est-il
(i) Coypel ne composa pas moins de 27 pièces de théâtre, qui n'ont
point été imprimées.
figures de VHistoire du
(2) Joullain est l'auteur des nombreuses
théâtre italien de L. Riccoboni, Paris, Cailleau, 1731.
LE MOLIERISTE
I9I
qu'à titre de document. Car Coypel a donné là
non-seulement le costume sous lequel on représentait
Molière au temps de la Régence, mais le décor, la mise en
scène telle que la tradition nous l'a conservée, et peuttique
être jusqu'aux portraits des principaux interprètes.
Son frontispice nous donne le dessin exact d'une partie
de la salle de l'Ancienne-Comédie, avec son rideau fendu
au milieu et surmonté des armes du Roi, ses lustres baissés
pendant l'entr'acteS;, les spectateurs sur le théâtre séparés
des comédiens par une balustrade, le parterre debout, les loges
d'avant-scène, et jusqu'à l'auteur regardant le public par
l'œil de la toile.
Le public, c'est à lui qu'est dédiée cette Suite d'estampes
des principaux sujets des comédies de Molière gravées sur les
esquisses de Ch. Coypel, et, en véritable homme de théâtre.
Fauteur l'a fait précéder de ce petit prologue ou compliment, sorte d'annonce gravée sur le rideau même
:
Très respectable et redoutable juge. Tu n'ignores pas
que c'est au désir de te plaire que les beaux-arts doivent
» leur naissance, c'est ce même désir qui nous porte à les
» cultiver et à lesperfectionner.Nesois donc point surpris
» de l'hommage que j'ose f offrir ; daigne
le regarder
» comme une marque de reconnaissance
que j'ay cru te
» devoir pour le/avorable accueil que tu as bien voulu
» faire aux Gravures de D. Quichotte. Mais tu me diras
» peut estre que je le dois plutost au fameux autheur qui
» m'en a fourny les sujets qu'aux faibles traits de mon
pinceau. Si tu le dis, je le croiray, car je fais Vœu de
» me soumettre toujours à tes décisions; quoy qu'il en soit,
ï tu ne ché?~ispas moitîs les ouvrages de Molière que ceux
de Michel Cervantes, ainsy je veux espérer encore que tu
» feras grâce aux desseins en faveur des sujets.
Je suis, avec tout le respect que te doivent ceux qui
» osent s'exposer à tes regards,
a.
»
j)
x>
j>
»
Ton
très
humble et
très
soumis serviteur.
Charles
Voilà l'estampe n°
La
toile
se
COYPEL.
i.
lève sur
l'estampe
n°
2,
qui
représente
LE MOLIÈRISTE
192
Horace, Agnès et Arnolphe, à la scène 3 du
V Ecole des femmes, dont le décor est charmant.
5" acte
de
L'estampe n° 3, que nous recommandons tout spécialement aux comédiens chargés du personnage de M. de
Sotenville, représente la dernière scène de George Dandin.
Le mari « confondu » est à genoux, son bout de chandelle à la main. Chaque personnage est admirablement
compris c'est un excellent tableau, d'un comique achevé.
M. de Pourceaugnac est représenté entre les deux médecins; l'apothicaire au fond. Les costumes sont à étudier.
Vient ensuite le chef-d'œuvre de cette suite, la scène de
Psyché « où l'Amour s'envole et le palais s'évanouit »
(acte IV, 3). L'artiste a pu donner là carrière à sa fantaisie
c'est une
adorable Psychéet à son goût décoratif:
Louis XIV (on sait que la pièce n'avait pas été représentée depuis la mort du Roi).
La scène du sonnet des Femmes savantes termine trop
tôt cette exquise collection qui, complète, serait sans rivale,
et que M™^ veuve Lefilleul a eu cent fois raison de répandre. C'est un véritable service qu'elle a rendu là aux
amateurs ; il faut la remercier surtout de l'avoir mise à la
portée de toutes les bourses: la suite avec lettre, hollande, coûte 18 francs, c'est-à-dire le tiers du prix d'une
seule des six pièces originales, et contient, en outre, un
beau portrait de Coypel, gravé par M. T. de Mare d'après Coypel lui-même.
:
DU MONCEAU.
L'abondance des matières nous oblige à remettre à la prochaine livraison la Bibliographie. Annonçons toutefois le
tome septième du Molière-Hachette^ qui vient de paraître.
Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
—
Noël Texier.
QUATRIÈME ANNÉE
NUMERO 43
OCTOBRE 1882
LE
rTMT"^
MOLIÉ
i:
%EVUE ^CENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
Campardon,
J.
MM
Claretie, F. Coppée, V. Fournel,
:
J.
Guillemot,
A. Houssaye, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
J.
L01SELEUR
Ch.
L.
,
Nuitter
,
MoLAXD
E,
Ch.
,
Picot
,
L.
Monselet, E. Noël,
de la
Pijardière,
Rounat, F. Sarcey,
H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu, etc.
F.- P. Régnier, Ch. de la
Dr
PAR
Georges
MON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMEDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10, GALERIE DU THEATRE FRANÇAIS, 10
1882
SOi\liMy\lKE
DU NUMliRO XLIU
QUATRIhME ANNÉE
LE SICILIEN.
— Ed. Thierry.
RÉPONSE A M. DE LAPOMMERAYE, — G. Monval
MOLIÈRE ET COTIN (suite). — Un Provincial
LE PÈRE DE Mlle DUPARC. — C. Brouchoud.
UNE RELIQUE DU CIMETIÈRE SAINT-JOSEPH.— La Rédaction.
—
BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESQUE.
Du Monceau.
BULLETIN THEATRAL. — Mondorge.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
français,
2,
— ÉTRANGER,
I3 FRANCS.
UN FRANC 50 CENT.
:
à la librairie
Tresse, io, Galerie du Théâtre
ou par mandat sur la poste adressé à M. G. Monval,
place de Vintimille, auquel les manuscrits,
tions,
demandes
et
communica-
réclamations devront être envoyés par
lettre affranchie.
•ïôo:
MOLIÈRE ET SA TROUPE
AU PALAIS-ROYAL.
LE SICILIEN
Ménage^ qui
a
eu
l'esprit
de ne pas être un ennemi de
Molière, de rechercher ses pièces dès
premier mot
dire le
fait aussi
le
par
la
sur le Sicilien une première
monologue
il
la
Ménage
remarque
:
Une
que
de
suite
ne manque que d'être accouplés
avertis, les lecteurs
fois
curieux ont poussé plus
loin et se sont aperçus qu'il en était à
dans toute
connu,
mandé
;
c'est
une
est
a
rime.
la
vers
nouveauté et d'en
postérité,
du rideau,
d'Hali, au lever
libres auxquels
vers
recueilli par
il
comédie. C'est
la
le
fait;
peu près de
n'en reste pas moins inexpliqué.
si le
mais
Sicilien n'aurait
la
On
pas d'abord été
s'est
première forme du
que Molière
à en faire disparaître la
de-
composé en
question donne tout de suite sa réponse
le vers eût été la
cas surtout
même
mais, pour être re-
Sicilien, c'est
:
Si
dans ce
se serait particulièrement appliqué
mesure
et le
rythme.
LH MOLIHRISTE
196
On
revenu
est
que Molière esquissait
h l'idée
en prose avant do
les
achever en vers,
que
et
ses pièces
première
sa
esquisse était déjà pleine d'hémistiches, d'inversions poéti-
ques, de vers rencontrés au courant de
quoi pas aussi de rimes?
D'ailleurs,
lien.
supposer que
les raisons
ne sent moins
précise,
libre, et
il
gence du
si
n'en trouve pas dans
quelque
avoir
Sicilien «erait resté
le
manquent,
commencer
à
présomptions, qui serait
si
On
faudrait
il
le laisser-aller
que
cette
semblable
si
le Sici-
pour
raison
à l'état d'ébauche, et
par
le laisser-aller
cadencée,
plume. Pour-
la
plus simple des
la
du
travail
mesure de
à
la
or, rien
;
phrase
la
coupe du vers
n'est pas possible de confondre avec la négli-
en
style ce qui
est le soin le plus
exact et le
plus précieux.
Faut-il croire, avec
nemis jurés de
meux axiome
«
Tout
la
les
rime,
curieux du paradoxe et les en-
que, démentant d'avance
de son Maître de Philosophie
le fa-
:
ce qui n'est point prose est vers, et tout ce
qui
n'est point vers est prose »
Molière aurait essayé un troisième genre de
espèce ambiguë qui, n'étant ni
cipât des
la
deux
prose ni
la
suppression de
la
consonnance
?
Mais ces
une
le vers, parti-
du vers par l'harmonie, de
:
style,
prose par
la
essais-là
ne se
tentent guères sans qu'on se fasse honneur de l'invention,
et
ne paraît pas que Molière
il
rains
de cette
que personne du caractère d'un
Il
est plus
averti ses
d'ailleurs,
homme
contempo-
plus éloigné
à système.
simple de croire que Molière, dont
naissait toute réglée par
n'a
ait
nouveauté, étant,
pas pris garde
une
la
pensée
oreille parfaitement musicale,
lui-même
à
ce qui nous occupe et
LE MOLIÈRISTE
a
qu'il
lui-même de
fait
197
rythmique
plrose
la
comme
,
M. Jourdain faisait de la prose, sans le vouloir.
Ce qu'il voulut dans le Sicilien, ce fut écrire une
jolie
pièce digne de tous les divertissements qu'elle couronnait
dans
Ballet des Muses.
le
La
donna son
pièce
culier, la
comme on
comédie galante,
disait
galante, c'est-à-dire la nouvelle prise dans les
Les
style.
deux ensemble donnèrent une comédie d'un genre
parti-
nouvelle
la
mœurs de
la
jeune et élégante société.
Le
ment
dont Marivaux devait
française,
charme de son
Du même
reux
ce caractère de galanterie essentielle-
Sicilien avait
théâtre
lui
à créer,
ton
Sicilien, le
métriques
composer
emprunta pas seulement
lui prit
il
même
la
la fable et
les
la
discret
musique mêlée
à
pensée d'un
fond que se ressouvenir
;
ait
coupes
pour
en
;
échappé à Beau-
imaginer, a-t-on
Beaumarchais peut
souvenu en croyant imaginer. Admettons que
lui
ce
ment, ce morceau
écrivains se
les
l'action,
entre les deux pièces est trop nettement
marchais, cela se peut néanmoins
pour
que
Barbier de Sévi lie.
La ressemblance
ait été
le
personnages du
— moins
du dialogue
accusée pour être fortuite. Qu'elle
n'est au
moins
car Beaumarchais^
— avec
le
faire
coup, Molière prêtait à deux de ses plus heu-
successeurs;
Marivaux, ne
un jour
théâtre.
fait
livre,
le Sicilien
rencontré par hasard, ce frag-
lu et relu
en cachette, où l'enfance des
presque toujours sa première éducation
littéraire, et qui reste le
modèle de leur œuvre future
vient naturel qu'on retrouve Bartholo
Figaro dans Hali,
dit,
s'être
le
dans
Don
;
il
de-
Pcdre,
comte Almaviva dans Adraste, Rosine
LE MOLIÈRISTE
198
dans Isidore,
et le petit acte original
dans les quatre actes
delà grande comédie.
Don
Pèdre
n'est pas
gentilhomme;
grondeur
comme
guette
il
mais
et
médecin
est
il
comme
amoureux
lui
;
rien n'y
furète
,
dépiste
Bartholo,
est
il
avare et
jaloux,
et
manque. Dehors ou dedans,
l'intrigue
et
en
l'éventé
maître, tout juste pour prouver que, contre la jeunesse et
l'amour,
exacte vigilance n'est que précaution inu-
la plus
tile.
« Hali, Turc, esclave d'Adraste, » dit la liste des acteurs
en
de
tête
la
comédie. N'en croyez rien. Hali n'est pas
Turc que Figaro
plus
résille et l'habit
per
n'est Espagnol.
Si Figaro porte la
de majo, c'est un déguisement pour trom-
censure. Si Hali porte le turban et
la
tale, c'est
la
veste à l'orien-
un habit de masque qui répond au
En
dies à costumes.
l'un et l'autre
réahté, Hali
et
du bal-
reste
goût invariable des Cours pour
let et caresse le
les
comé-
Figaro sont Français
:
Du
Lude, Chavigny, Saint-Faron et Montglas
Font l'amour sans soupirs, sans larmes, sans hélas
disait la
chanson
« sur les
procédé d'Adraste
ils
et celui
qui cajole et qui ose.
qu'étant gentilhommes
un
art.
ils
;
))
c'est
du Comte. Jeunes
ont tous deux l'amour de leur âge
mour
à
gens de Cour
Un
et
la
et
un peu
de
la
le
Cour,
de leur rang,
l'a-
point à remarquer, c'est
ne dédaignent point de toucher
Almaviva improvise des couplets, déchiffre cou-
ramment une romance tombée d'un balcon
ner
!
et
peut don-
leçon de chant à Rosine. Adraste, devançant Alma-
viva de tout
un
siècle, fait
de
la
miniature (est-ce bien de
I99
LE MOLIERISTE
la
miniature
?)
un peintre de
de
et remplace, auprès
jeune Grecque,
la
'-
portraits qui s'excuse.
Grecque, vous savez ce
qu'il faut lire. Isidore, l'esclave
grecque, est deux fois française, d'un seul mot, parisienne.
Hali,
comme
Figaro,
chambre à tout
(le petit à
à
Isidore
même
de
de tous
est
même
faire,
les métiers, valet
des couplets de circonstance
propos en deux langues que son virtuose chante
la
musique,
quelle
moins beau
pour n'être
d'à-propos
trop
est
ment avec
et, si
diseur, plus
pas de lui)
,
vous en doutez, écoutez seule-
compétence
sonne que Figaro qui
disserte sur le bécarre
il
diligent,
laisse
;
payant plus de sa per-
son maître
faire le jeu,
çà et là le conseil d'un habile et s'amuse à regarder
tie
de
donne
la
par-
mène.
plutôt qu'il ne la
Figaro, tout Figaro qu'il est, n'est que le cadet d'Hali;
ainsi
de Rosine à l'endroit d'Isidore. Les deux sœurs se
communs, ma-
ressemblent, mais les traits qui leur sont
ce que les fenêtres closes donnent
lice et finesse d'esprit,
d'impatience, ce que
du prisonnier,
la
la réflexion
sang-froid, ruse
dans
le droit
de
jeunesse, supériorité féminine, appartiennent plus francs
et plus
personnels à l'aînée.
Quand commence
le
pas le Barbier de Séville
Hah, qui
Pèdre
et
le
Sicilien
—
— on
peut suivre pas à
jour n'est pas encore venu;
le
devance, se tient devant
la
maison de
Don
organise sa musique.
Adraste vient à son tour.
il
donne de
liberté de dire, confiance
Il
est jeune,
aime, cela va sans dire. Ainsi tout
il
le
est
gentilhomme,
monde
est déjà à
son poste, Hali chantant ou faisant chanter, Adraste sous
le
balcon d'Isidore,
Don Pèdre
gardant sa porte, une épée
200
LE MOLIÈRISTE
SOUS
tholo^
en embuscade,
bras, et posté
le
comme
Bartholo n'était pas médecin ou
si
si
Basile ne lui
pour écarter doucement son homme,
conseillait pas,
Bar-
serait
la ca-
lomnie plus sûre que l'épéc.
Isidore n'est pas à sa fenêtre avec
Pèdre, moins complaisant que
une fenêtre sur
la
rue
:
le
don Pèdre
seulement,
comme
il
pour avoir toujours
sort,
il
manque
les
jamais de l'emmener avec
devenu amoureux
draste est
Sicilien),
menade,
emmenant
mais don
faut toujours
Don
qu'un jaloux se perde par ses précautions,
quand
;
Docteur, n'ouvre jamais
d'elle
yeux sur
lui.
Pèdre,
au passage;
sa prisonnière qui égaiera
ne
Isidore,
qu'A-
C'est ainsi
il
peu
sort (le
sa pro-
car elle lui dit tout ce qu'elle pense de sa jalou-
sie et tout ce
que Rosine
dira à Bartholo dans leurs
deux
scènes du second acte, avec cette différence qu'Isidore ne
se fâche pas^ n'ayant point de tort, et
que Rosine se fâche
parce qu'elle est prise en faute.
Don
Tandis que
moyens de
sa
femme, Adraste
d'elle. Il a
Pèdre, sans se décourager,, rêve aux
réduire l'esclave indocile qui ne veut pas être
dans
a trouvé celui de s'introduire auprès
la ville
Royal-Infant et qui ne
pour
la
mon,
un ami qui
lui
n'est pas le colonel
donne pas un
maison de don Pèdre, mais qui
billet
du
de logement
est le peintre
Da-
qui lui donne une lettre adressée à don Pèdre,
et
dans laquelle
il
le
présente
comme envoyé par lui pour ve-
nir faire le portrait de la belle Grecque.
Il
vient donc.
peinture,
Don
Ou comme
Pèdre devrait
jaloux,
faiseur de portraits et réclamer
Damon
ou comme amateur de
se défier de ce
Damon
gentilhomme
en personne; mais
garantit le talent de celui qui le remplace et sur-
201
LE MOLltRISTE
tout son désintéressement absolu. C'est
t-il,
qui s'offenserait
La grande
raison
on
si
lui parlait
un homme,
d'aucune récompense.
son
sans dot » produit déjà
«
écrit-
effet.
Adraste est accepté. Adraste se met à l'œuvre. La leçon de
chant du Barbier de Séville
scène du portrait dans
bien
ne
faite
Sicilien.
le
la
Situation piquante et
pour tourmenter un jaloux. Les deux amoureux
se quittent pas
prit;
qu'une variante de
n'est
pour ne pas
son modèle,
du regard. Le peintre
répond;
de galanterie où intervient par
don Pèdre
;
mais cette
amusement sans
résultat,
d'es-
un charmant duo
c'est
moment
la
basse brutale de
escrime d'esprit ne serait qu'un
jolie
don Pèdre
l'attention de
homme
gHsser sur le visage de
laisser l'ennui se
parle, elle
il
est
si
maître Hali ne venait occuper
et
ménager aux deux amants un
tête-à-tète.
comme
Hali n'a pas,
ni de fonctions
dans
la
Figaro chez
maison de
le
Docteur, d'habitudes
Don
Pèdre.
ne peut
Il
pas s'y présenter avec son cuir et son rasoir sous
texte
grand
du simple jour de barbe.
Don Pèdre
tandis qu'il consulte
comme
il
dit,
vengeance,
un
C'est
sur
un
soufflet q«''il a reçu et
Adraste
obtint
et
dont
il
d'Isidore qu'elle
le
fier,
et,
d'honneur,
fait
entreprendre ce qu'il jugera nécessaire pour
pré-
à jouer
affaire
en hidalgo sombre
jeu. Hali se déguise
le
veut
tirer
l'autorise
la
tirer
à
des
mains de son tyran.
En
d'autres termes, c'est
et qu'Isidore accepte
acceptera de
même
;
un enlèvement
avec l'excuse de
propose
Rosine
mais l'enlèvement de Rosine coûtera
peu d'invention à Beaumarchais,
enlevée du trousseau,
qu'il lui
la nécessité.
la jalousie
la
clef de
ouverte
et
la
jalousie
une
échelle
202
LE MOLIÈRISTE
appuyée au balcon. Dans
chez
lée qui se précipite
un
asile,
avec
c'est
Don
Adraste qui
la
Pèdre en
poursuit,
fureur d'un mari offensé.
la
tait
dans Adraste un
en
lui
un mari
réconcilier
un jaloux
et
et le tour est fait.
d' Adraste,
une femme voi-
Sous
Pèdre, qui redou-
à outrance,
voile qui
le
s'applique à
mains s'unis-
Don
cachait la
La
qui s'échappe.
c'est Isidore
main,
enchanté de trouver
sortent en bénissant
Ils
demandant
lui
l'épée à la
Leurs deux
deux époux.
les
Don
rival célibataire,
sent dans la sienne.
femme
le Sicilien, c'est
Pèdre,
prétendue
première,
s'enfuyant à son tour, laisse pour adieu au Sicilien l'amère
consolation avec laquelle Figaro achèvera un jour
faite
de son docteur
Quand
«
:
la
dé-
jeunesse et l'amour
la
sont d'accord pour tromper un vieillard, tout ce
qu'il fait
pour l'empêcher peut bien s'appeler à bon droit
:
La
Précaution inutile. »
Ressemblance d'action, ressemblance de genre,
tion directe entre les deux opéras-comiques
du
Séville et
Sicilien est
duite à l'insu
de Beaumarchais,
Après
la
secret
ému
entre
à fuir avec
un
?
ce
est possible,
Adraste
les privautés
plus
et
Don
le
me
qu'on
et la sortie
du
consentir
en
de
Pèdre, étrangement
qu' Adraste
;
souvent
le Sicilien,
s'est
permises,
c'est Isidore qi|i le
en jouant l'indifférence
gentilhomme
je
jusqu'au détail.
fidèle
qui vient
Isidore
silence embarrassant
et qui dissimule
vous
rencontre
scène du portrait dans
de toutes
se fait
cela
mais sa mémoire a été
faux peintre,
de
dans son imagination et trouvé
dans sa mémoire, cela se
;
du Barbier
bien établie. Qu'elle se soit pro-
répète. Qu'il ait cherché
ne pense
la filia-
:
«
paraît le plus civil
Qu'en
il
rompt
dites-
du monde
;
203
LE MOLIÈRISTE
demeurer d'accord que
et l'on doit
que chose en eux de
les
Français ont quel-
de galant que n'ont point
poli,
les autres nations. »
Dans
le
logement
ne veut pas
ou de
encore Rosine
le
un
se fait
pièces, fût-ce
;
et
parmi
on
cependant,
il
en
Il
sent l'autobiographie, et elle
indulgente.
La scène du
souvenirs de
les
-
ni
longtemps,
dire depuis
est
peu de
est
portrait,
y
dont l'étude
soit
Molière
enjouée,
avec
faite
l'a
ait
famiUère.
et
est badine,
de Mignard. C'est
l'atelier
autres
ses
peu où Molière
mis autant de son observation quotidienne
y
Conve
«
les plus accréditées,
d'un intérêt aussi attachant.
On
«
:
manque
ne
voit qu'il
doit le
son de
semble ne plus compter dans l'œu-
petit acte qui
vre de Molière
même
du
bien gai, ce jeune sol-
qu'il est
on
qui
Docteur résolu
également un silence,
d'une certaine éducation.
C'est trop insister,
sur
il
de
billet
entre Rosine
et le
même mouvement d'attaque
à travers son ivresse,
d'esprit, ni
cavalier,
qui le rompt,
Monsieur,
nez pourtant.
!
force,
scène du
la
de Lindor
livrer le billet
voix dégagé, avec
dat
du faux
et la sortie
à l'avoir de gré
et c'est
après
Barbier de Séville,
chez
là,
son
ami, qu'il a vu les détails, les essais, les tâtonnements de
la
pose, entendu l'inévitable
par
la
programme
coquetterie féminine, les
signifié
compliments
peintre, l'agaçante adulation des galants et
tie
brutale faite par les maris.
d'Isidore sur les
portrait,
on
En
écrivant
femmes qui veulent
dirait qu'il a
voulu
la
le
d'avance
obligés
contreparjoli
toutes avoir le
tirer raison
du
couplet
même
pour son ami
des ridicules avec lesquels celui-ci composait tous les jours.
Qui
sait
encore
si,
dans ce type uaique du portrait à
204
LE MOLIÈRISTE
mode,
la
ne
il
portraits de sa
Un
«
une
teint
petite
surtout
le
pas donné
s'est
femme
de
tout
bouche
visage
et
de parodier
le plaisir
lis
de roses, un nez bien
et
de grands yeux
pas
plus gros que
des
perfections
par
M"' Molière (dans
toutes
le rôle
qui s'écarte pour porter ailleurs,
l'air d'être l'exacte
plus piquante,
si le
la
?
car
il
délicat,
effet ce rôle
semble avoir été
terrible
compose
tout lui
dans une
le
la
malice eût été
fait
ne
Armande
lui a-t-il
pour
« esprit
elle.
pas été
Agrément
du plus
fin
et
«
tranquillité gracieuse et
»,
satirique
spirituelle
personnage d'Isidore tout
appartient. Lui
donner
le
lui va_,
en avait un autre. Jusqu'au
de
»,
rôle n'était
Sicilien,
ce qui
tout lui sied,
rendre. Outre ce premier droit qu'elle avait à
elle
dernier
conversation charmante, nonchalance de
nonchalance d'actions
parler,
le
l'une a bien
rôle d'Isidore eût été joué par
personne, cela va sans dire,
du plus
le
description de l'autre.
elle-même. Pourquoi en
distribué
liste
femmes
les
comme
n'y aurait guère lieu d'en douter, et
Il
et
de Dircé) reproduit
gravure d'Hillemacher, vous verrez, sauf
la
trait
de
par
;
poing, l'eussent-
le
d'un pied de large. » Comparez à cette petite
demandées
fait,
bien fendus
vifs
elles
portrait de
les
?
dans
le
que
le lui
réclamer,
la distribu-
deux pièces représentées à Saint-Germain en Laye
troupe du Palais-Royal, elle avait été assez mal par-
tion des
par
la
tagée.
M"' de
M"^ Du Parc
Brie avait joué Iris de la Pastorale comique,
avait joué Mélicerte,
Armande
n'avait encore
paru que dans un rôle accessoire, celui d'Eroxène
tour était venu d'en avoir plus
tout
fait,
nous venons de
le
important,
voir, et
;
son
celui-là était
nous nous trouvons
20 5
LE MOLIÈRISTE
encore devant
pas
la
même
question
:
Comment ne
l'eut-elle
?
Soigneux de ménager
ses autres
Parc cherchait des prétextes à
Molière
avait-il
pris
pour ne pas avoir
Ne
se
moment où M"' Du
l'air
donnait-il
administrative pour
de
Palais-Royal>
le
sacrifier
de prudence
cette raison
tromper lui-même sur un autre
genre de prudence, pour éviter de mettre sa
en lumière, pour
autant
l'écarter,
Germain qui devaient rapprocher
A
ces
commerce
la
femme
du séjour de Saint-
Cour
et les
pour Armande,
peut'ètre. Molière dans
Don
comédiens
?
deux motifs ajoutons-en un troisième.
d'Isidore était fait
trop
pourrait, de la
qu'il
scène, pendant ces onze semaines (i)
dans un dangereux
Armande,
les sacrifier à elle ?
pas aussi
se
quitter
de leur
parti
le
ombrageuse de
susceptibilité
la
comédiennes, surtout au
il
Pèdre,
Si
le
trop bien
était
Armande dans
rôle
fait
l'es-
clave grecque, ce n'était pas seulement de la ressemblance,
La septième scène du
c'était
de
d'être
une scène de comédie,
la
la réalité.
vie de Molière
;
c'était
la
porte
rieur, et la foule introduite à
Le
s'
ce
voilà,
du bonheur
!
Ces
Sicilien cessait
c'était la vie
elle-même
son foyer domestique.
malheureux ménage, à côté
illustres
et
ouverte sur son inté-
mal mariés,
qui,
s'
et
si
aimant
près
ou
admirant, n'ont rien pu se céder l'un à l'autre et n'ont
su que se faire souffrir. L'un, jaloux, soupçonneux, tyran^
nisé par sa faiblesse et tyran à
(i)
Onze semaines
et quatre jours.
son tour par passion
comme
206
LE MOLIÈRISTE
par défiance, l'autre
du soupçon,
coquette, plus fière
se plaisant à l'irriter
tiente de la tendresse qui lui fait
nant pas
la défiance, fût-ce
Tout y
est
quoi que l'on
;
de Molière
de Chapelle,
et
par représailles, impa-
une gêne
ait
escarmouche
«
dans
C'était
ainsi,
—
Il
conversation
scène d'ex-
la vérité est là, la
commence
est vrai.
on
est
deux époux^ calme
par cette piquante
puisque vous
donne
que ce puisse
me
cette
venu chanter sous nos
La musique en
pour vous que cela se
celui qui
la
:
Cette nuit encore,
fenêtres.
ne pardon-
et
cru voir dans le Misanlire
plications sans cesse renouvelée entre les
cette fois et définitive, qui
blessée
à la passion.
quoi que l'on soit tenté de
thrope,
encore,
faisait ?
le dites.
sérénade
était
— Je
admirable.
le
—
veux croire
— Vous savez qui
— Non pas mais, qui
— Obligée? — Sans
— Vous trouvez
était
?
;
être, je lui suis obligée.
doute, puisqu'il cherche à
me
divertir.
jamais
donc bon
vous aime? — Fort bon. Cela
qu'obligeant. — Et vous voulez du bien
tous ceux qui
net
prennent ce soin — Assurément. — C'est
n'est
qu'il
à
dire fort
?
ses pensées. »
Pour
«
finir
par
cette
Quelle obligation vous
vous ne me laissez
tiguez, comme on voit,
« si
tout
cela
conclusion plus nette encore
:
qui parle
:
ai-je ?.. » C'est Isidore
jouir d'aucune
liberté, et
d'une garde continuelle
ne part que d'un excès d'amour.
votre façon d'aimer, je vous prie de
me
—
?
me
fa-
— Mais
Si
c'est
haïr. »
Et nous cherchions pourquoi Molière n'a pas donné à
sa
femme
le rôle d'Isidore
;
la
véritable raison,
la voilà.
Les deux époux ne vivaient plus ensemble. Une sépara-
LE MOUERISTE
ou moins dissimulée
tion plus
207
les divisait
dans
même
la
rapprochait nécessairement
mais
maison. Le théâtre
les
Molière
occasions de ce rapprochement dou-
évitait les
loureux
les abrégeait
il
;
reléguée
Molière,
encore dans
y
Il
dans
l'arrière-plan
que
Mélicerte,
M*'*
l'était
le Sicilien.
avait
une situation plus connue qu'avouée
là
question,
pour
était
et c'est ainsi
Cour
nécessaire de l'éclairer devant la
était-il
autre
à
du moins,
;
secret
le
La Grange
celle-ci.
mais Molière
;
aurait
de rien avec
avec
lui,
elle.
Il
Il
ne
non.
dit
vivait par
et avec le public, sa famille véritable.
;
C'est une
?
le
Il
théâtre
faisait secret
dans cette
se soulageait
pleine expansion, et le Sicilien fut une de ses grandes confidences sur la scène.
Remarquons
toutefois, à l'honneur
colère.
Devant
de ce pauvre cœur
sa confidence est sans
tourmenté, que
cette famille
amertume
prend pour
qu'il
et sans
arbitre,
s'il
accuse quelqu'un, ce n'est pas Armande, c'est lui-même,
c'est la jalousie, leur
aussi bien qu'à elle.
le
monde.
Qjiels rôles
de jaloux. Sganarelle
se punir.
pu.
Il
Il
jaloux.
s'est-il
est
toujours donnés
son nom.
Il
:
«Oui,
se l'est
jaloux... jaloux
comme un
Sa délicatesse
diable.
?
;
des rôles
infligé
Il
pour
n'a pas
il
le dé-
comme un tigre,
Mon amour vous veut
s'off"ense
regard qu'on peut vous arracher
lui
toujours dit à tout
Et avec quel accent passionné
vous voulez,
toute à moi.
me
Il l'a
a cherché à se guérir par le ridicule.
est jaloux.
clare aujourd'hui
et, si
ennemi commun, son ennemi à
Il est
d'un
souris,
et tous les soins
d'un
qu'on
voit prendre, ne sont que pour fermer tout accès aux
208
LE MOLlèRISTE
cœur dont
galants, et m'assurer la possession d'un
me
puis souârir qu'on
Après cet admirable plaidoyer, sa cause
le public,
rend
elle
des débats par
de surprise
cri
? »
son voile
:
«
la
bouche de
ne
soit
sa propre
Don Pèdre
par
«
:
qui
lui
à la fin
quand au
partie,
Qu'est-ce que cela
Zaïde (ou M"^ Molière) répond en relevant
Ce que
monstre haï de tout
qui
condamne généreusement
se
jeté
ne
gagnée pour
est
pas pour lui-même. C'est
l'est
et qui
l'arrêt
veut dire
ne
je
vole la moindre chose. »
cela veut dire
de
ravi
monde,
le
lui
et
?
Qu'un
qu'il
jaloux est
un
n'y a personne
nuire, n'y eût-il point d'autre
intérêt, (i) »
«
N'y
eût-il
recueilli, et ce
point d'autre intérêt » vaut
ne sera pas
la seule fois
que Molière
de témoigner en faveur d'Armande contre
Ainsi se termine
mais à
la suite
de
le
la
Sicilien,
la
peine d'être
la
les
pièce bien entendu
fameuse entrée des Maures, où, parmi
nus
les
Grand
et
Maures à capot,
M"^ de
;
pièce venait le grand divertissement
final, la
et
s'efforcera
apparences.
la
le
Roi
et
les
Maures
Madame, M. Le
ValUère;, le marquis de Villeroy et
M°** de Rochefort, le marquis de Rassan et M""' de Brancas,
formaient l'éblouissante quadrille des Maures et des
Mauresques de
Pour
qualité.
rattacher
le
ballet
à
la
comédie,
Molière
mit
entre les deux une petite scène très curieuse et qui devait
faire
deux
fois fortune
pour une boutade à
(i)
la
:
de nos jours, parce qu'on
l'a
prise
façon d'Alceste, une pointe d'esprit
Cette restriction assez vague peut encore s'interpréter autrement.
LE MOLIÈRISTE
frondeur contre
209
magistrature du grand règne
la
ment, parce que tout
monde
le
Cour
à la
;
sur le
mo-
reconnaissait l'o-
du nouveau personnage introduit sur le théâtre
que lui-même, au milieu de l'amusement général, se
riginal
et
plaisait à être
La scène
reconnu.
du Sénateur
est celle
porter plainte sur le
fait
à qui
Don
Pèdre vient
de l'enlèvement d'Isidore et qui
refuse de l'entendre, tout occupé de la grande
mascarade
dont
il
dirige les répétitions. L'original
mascarade
était le président
du Sénateur
de Périgny, auteur du
à
la
ballet
des Amours déguisés, des devises du Carrousel,
des vers à
la louange des Reines
dans
les Plaisirs de
enchantée, ré-
l'Ile
cemment nommé précepteur du Dauphin
que
et
le
sérieux
de ses nouvelles fonctions n'avait pas empêché d'être
un
des organisateurs les plus actifs du 'Ballet des Muses
(i)
—
est
Il
alors
parmi
que
et
que
vrai
la
les
la
composition
exercices les plus
danse,
des ballets comptait
ingénieux de
l'esprit
avec tout ce qu'elle comprenait,
faisait
partie de l'éducation des princes.
C'est égal, quel
jeu
du Sénateur
que passer sur
la
amusement pour
affairé,
scène,
pas assez pour qu'on
toute la
Cour que ce
tout à sa mascarade qui ne fait
juste
ait le
assez
pour
être
temps de revenir sur
reconnu,
le
mou-
vement de gaîté et de juger si la plaisanterie n'a pas été
un peu vive. Je ne crois pas que ce fut Louis XIV qui
eût livré cette fois
(i)
M. de Périgny comme
il
avait livré.
Qjaoique monsieur de Périgny
Ait rendu du ballet la beauté sans seconde...
Dit Subligny dans sa
Muse Dauphine, 17
février 1666.
14
210
LE MOLIERISTE
dans
Fâcheux,
les
sûr qu'il fut
le
sante drôlerie.
«
Le
M. de Soyecourt
premier à
Il
avait
ri
à Molière; mais je suis
de l'audacieuse et divertis-
rire
qui n'eût pas été désarmé
;
19 de ce mois (du mois de février i6é6),
dit la GuT^ette^ eut
Muses avec
lesquelles
les
y
encore
le
:
«
Cour,
divertissement du 'Ballet des
nouveautés qu'on y avait ajoutées (le 14),
attirèrent
une foule extraordinaire. En rap-
prochant cette « foule extraordinaire
sénateur
la
?
»
Je veux que vous voyiez
de
la
cela.
phrase du
On
va
la
répéter (la Mascarade) pour ledivertissement du peuple »,
on
aurait lieu de penser
que
Ballet se donnait, grilles
le
ouvertes. »
Edouard THIERRY.
NÉCROLOGIE
Nous venons de perdre un précieux
collaborateur, dont
du Moliériste n'ont certainement pas oublié
signés du pseudonyme C. Delamp.
les lecteurs
articles,
Le Temps
a reçu la dépêche suivante de son correspon-
dant particulier d'Athènes
:
«
»
M.
Bilco,
membre de
Athènes, 17 septembre.
l'Ecole française, est
mort subitement à
Lamia, au cours d'un voyage archéologique, d'un accès de
nicieuse.
les
:
La nouvelle a
été
transmise à l'Ecole d'Athènes
collègues est parti aussitôt pour
service funèbre aura lieu
M, Joseph
Lamia
;
demain matin à
il
en a ramené
fièvre
:
le corps.
l'égUse métropoHtaine. »
Bilco n'avait pas vingt-quatre ans
!
La Rédaction.
per-
un de
ses
Un
CORRESPONDANCE
A M.
Henri de Lapommeraye, Président du Cercle de
dramatique
critique
Monsieur
Le
et
la
musicale.
et cher Collaborateur,
Moliériste a publié, selon votre désir, dans sa livrai-
son de septembre,
critique
du président du Cercle de
la lettre
au président du
Comité des
la
Inscriptions pari-
siennes.
N'ayant reçu
aucune communication
de
l'honorable
M. Henri Martin, je me vois forcé de vous répondre
moi-même, et moins brièvement que je l'eusse voulu.
Si le Moliériste,
en publiant
M. Nuitter, n'a pas
La Rounat au sujet de la
rateur
qu'il l'avait fait
vous pourrez
le
cité
vous en convaincre
et
et musicale,
à
la vraie
nous y arrêter
l'immeuble
spécialement
et
nom
de M. Ch. de
maison
le
:
de
faire
fois,
c'est
comme
vous voulez bien
le
Cercle de
la
critique
poser une plaque
commé-
maison mortuaire, nous n'avons pas
c'est
affaire
Comité des
institué
si
natale,
169 de son tome premier.
Quant au vœu, formulé par
morative sur
le
nouvelle
antérieurement, et par deux
vous reporter aux pages 109
dramatique
rapport de son collabo-
pour
ces
entre
le
propriétaire
de
Inscriptions parisiennes,
sortes
de travaux.
Le
212
LE MOLIERISTE
Cercle de
m'abuse.
la critique a, lui, d'autres attributions, si je
Aussi bien
n'a-t-il
une première
inspiré
pas
poser une plaque de marbre sur
avant d'avoir
en
disent^
a six ans,
il
maisœi des Cinges
la «
conforme à
qui, plus
est peut-être aussi plus près
Que
Que
y
il
fit
»,
enlever l'ancienne inscription de la rue
fait
du Pont-Neuf
heureusement
très
été
quand,
fois,
ne
effet, les
Jean Poquclin,
de
la tradition
populaire,
la vérité.
documents
?
père de Molière, habitait la rue
le
St-Honoré à l'époque de son mariage (162 1
).
Qu'il habitait encore la rue St-Honoix le jour où son
fils
Jean fut baptisé à S'-Eustache (15 janvier 1622).
Que
sa
femme, Marie Cressé, décéda rue Sl-Honoré
(1632). '
La rue S^-Honoré
longue,
est
elle
l'était
déjà à cette
époque.
Ce
n'est qu'à partir
que
précise,
et
habitant
« rue
Étuves.
»
S'-Honoré,
Mais^ en 1636,
ï6}},
logis
prcsumable,
sier
Il
est
de 1621
du Roi (163
«
mariage,
«
avait quatorze
toujours
ans.
conservé
au contraire, que
agrandi
»
comme
Son
le
père,
même
le petit tapis-
en devenant tapissier
1).
:
fùt-il établi
que Jean Poquelin habi-
maison des Ciîiges » dès l'époque de son premier
il
ne s'ensuivrait pas nécessairement que Molière
naquit chez son père, dans cette maison
sible
désigné
est
au coin de celle des Vieilles
avait-il
s'était
Je vais plus loin
tait la
Poquelin
Mohère
remarié dès
?
1636 que l'indication devient
de
père
le
;
serait-il
impos-
que, pour dix raisons, Marie Cressé soit allée faire
LE MOLIERISTE
ses
comme
couches chez sa mère, (i)
fréquemment aujourd'hui dans
Autant de points
M.
hésiter
de
21
le petit
il
3
arrive encore
commerce
parisien?
d'interrogation, qui auraient dû faire
Rounat
la
prendre
à
démenti formel à l'inscription de
l'initiative
d'un
rue de la Tonnellerie,
la
rédigée et placée en 1799 par des gens qui n'ont certai-
nement pas
ment
:
Cailhava, qui avait passionné-
tout ce qui touchait
recueilli
Lenoir,
au hasard
agi
archéologue distingué,
Molière
Alexandre
;
fondateur du Musée des
Monuments français enfin Delaporte, le fils du secrétaire
la Comédie qui, pendant un service de trente ans,
;
de
avait appris des anciens, de Lekain,
Bellecour,
etc., ce
son ami, de Préville, de
qu'une tradition ininterrompue avait
conservé de Molière.
Et
si
Lenoir
Cailhava,
(ce qu'il
eût fallu
et
Delaporte se sont trompés
commencer par démontrer rigoureu-
sement), ce fut de bien peu, à en croire BefFara, autre
chercheur,
plus
aux
recourut
Voici
22
l'extrait
avril
l'artillerie
ce
à
mêmes
sources
et
fouilla,
parce
sans
qu'il
perdre
monceaux de documents.
patience, des
le
que ses devanciers
précis
d'une
1828,- à
Amiens (2)
Grimarest
et
lettre
M. De
très
longue
la
Chapelle,
qu'il adressait,
commandant
:
Voltaire ont dit que Molière étoit né sous
les
pilliers des Halles. Il seroit bien singulier
que nos deux plus
grands poètes comiques fussent nés dans
endroit,
cet
(i)
Marie Asselin, femme de Louis de Cressé.
(2)
Archives de
la
Comédie
française.
l'un
d'un
,
214
"LE
tapissier, l'autre
tous
deux
MOLIÈRISTE
(Regnard), d'un marchand de salines épicier
qualifiés d'honorables
hommes dans beaucoup
ma
de l'état civil; mais j'ai démontré, dans
Molière
et
(i),
non sous
»
De
que
ses
père
et
que Molière n^y
et
son rue St-Honoré,
au
par un
^7
et
né.
Poquelin,
)8 dans une mai-
coin de celle des Vieilles-Étuves dont
bail que je
n'ai
pu
il
mais qui
trouver,
pu commencer quelques années avant 1636
avait
pas
est
découvertes tu' ont prouvé que J.
père de ÎMolière, demeur oit en 16^6,
était locataire
Dissertation sur
mère demeuroient rue St-Honoré
Halles
les pilliers des
tiouvelles
d^ actes
finir
et
après 16)8.
»
// paraît
qu'avant
ces
années
il
demeurait
même
rue St-
Hanoré, dans une maison portant aujourd'hui le n° 40,
A PEU près au milieu ENTRE LES RUES DES PILLIERS DE LA
TONNELLERIE ET DES PROUVAIRES. (2)
En présence de
reconnais
—
la
»
cette simple note, qui n'a pas
valeur d'un
—
document authentique,
mité des Inscriptions Parisiennes n'aurait pas,
je
le
le
Co-
je crois,
osé
affirmer que Molière est né au coin de la rue des Vieilles
Étuves (96 actuel de
la
rue St-Honoré);
il
aurait,
soirement, laissé subsister l'ancienne inscription de
du Pont-Neuf (38 de
crainte de greffer sur
la
même
provila
rue
rue St-Honoré), dans
la
une erreur probable une erreur plus
grande, dont nous ne disputerons
la paternité à
Georges
personne.
MON VAL.
Imprimée en janvier 1821.
faut remarquer que la rue des Prouvaires, beaucoup plus rapprochée de la rue de la Tonnellerie (aujourd'hui du Pont-Neuf) que de
(i)
(2)
la
Il
rue
]iers.
Sauvai, est
séparée
de cette
dernière
par
la
rue
Vauvil-
LE MOLIERISTE
21
5
MOLIÈRE ET COTIN
(Suite) (i)
Monsieur
Lorsque
j'ai
laborateur,
un
seul des
le
Directeur,
le
pris la liberté d'adresser à votre savant col-
bibliophile Jacob, la prière « de
sermons de Cotin qui
nous
citer
fasse allusion à Molière,
une seule plainte de Cotin contre Molière, un seul motif
bien authentique des colères de Molière contre Cotin,
je faisais
une réserve,
qu'on trouvât dans
pas le
texte sous
qu'il était possible
et reconnaissais
la Critique désintéressée
yeux)
les
»
(dont
je n'avais
quelques lignes hostiles à
«
Molière. »
Cette réserve, que «
dans sa réponse,
d'après votre
Rédaction
la
prudente
était
;
«
n'a
savant et très-exact collaborateur,
Thierry, un passage de
la Critique désintéressée fort
comédiens en général, mais qui ne
pour
les
lière
en particuHer. Toutefois cette citation
répond jusqu'à un certain point à
ne répond pas à
la
aussi fatigantes
dans un de ses sermons.
Voir ci-dessus,
p.
vise pas
même,
Mo-
si elle
troisième question,
que répétées
aux-
M. Paul Lacroix « Il est a
Cotin n'avait pas ménagé MoUère
a habitués
PRÉSUMER que l'abbé
(i)
ma
M. Ed.
blessant
première, laquelle était provoquée par
une de ces hypothèses
quelles nous
pas rappelée
vous avez pu reproduire,
:
»
157 et 179.
6
21
LE MOLIÈRISTE
Je dis que la citation tirée de la Critique désintéressa ne
répond que
«
question. Si
je
un
certain point
me montre
les
s'applique
La
troisième
que
satisfait, c'est
pas en particulier à
Précieuses et contre Ménage, et à qui
Vivat
ma
à
»
pas plus
en qui Cotin avait trouvé un auxiliaire contre
Molière,
et
ne
passage de Cotin ne
le
«
jusqu'à
!
Critique désintéressée est de
cette
avait
il
crié
:
»
entre
date,
1667
où
l'époque
termes sympathiques sur Molière
entre les Précieuses
:
Cotin
s'exprime en
l'époque où
et
il
de l'infamie des comédiens en général, quel motif
culier,
personnel, d'animosité
Cotin
contre
Molière
a
ce
c'est
?
puisqu'on veut voir dans
pu
exister de la part de
que nous
ridicule
le
parle
parti-
cherchons,
à Trissotin
infligé
une vengeance de Molière.
Non, Molière
n'est
quine vengeance;
le
nombre
temps qui ont attaqué
avoir jamais eu,
d'un acte de mes-
point coupable
les
comme
des polémistes du
est infini
comédiens en général^ sans
Cotin, une parole
pour Molière. Pourquoi donc Molière
Cotin plutôt que tout autre
?
Pourquoi donc
grand Comique une autre pensée que
les Trissotins
dans
la
bienveillante
celle
de
prêter
de l'un d'eux
?
—
Si
eût en eux des admirateurs ou
ne
lui
avaient
les
Va-
Molière a
copié Trissotin sur Cotin, Vadius sur Ménage,
pas parce qu'il voyait en eux des
au
tous
railler
personne de l'un d'eux, tous
dius dans la personne
tateurs qui
attaqué
aurait-il
ce
n'est
ennemis, mais quoiqu'il
tout
au moins des spec-
pas marchandé leur approba-
tion.
Ceci
dit,
je
n'en persiste pas moins à reprocher au
217
LE MOLIERISTE
bibliophile Jacob l'abus des hypothèses:
tenant,
ma
dégage de
sion qui se
me
nouveaux
efforts
Jacob
vous n'y réussirez pas
»
:
pour
que des ennemis^
cilier
ce que vous
m'expose peut-être à
je
« réconcilier
car
;
conclu-
c'est la
première lettre; en
avec
la
main-
fassiez
de
le bibliophile
on ne peut récon-
loin d'être l'ennemi de votre
et,
savant collaborateur, je déclare hautement que personne
n'apprécie plus que
mieux
naît
s'en
moi
les services
documents
tenu à des
est
ses utiles recherches et
rendus par
lui,
ne recon-
toutes les fois qu'il
à
certains,
des
incontestables et qu'il s'est gardé d'avancer ces
vérités
supposi-
pour personne, sa légitime
tions qui diminuent, sans profit
autorité.
UN PROVINCIAL.
Lire,
dans
le
Journal général
des 22, 29 juin et 6
l'Instruction publique
de
1882
juillet
(n°' 24, 25
et
26 de
la
44^ année)^ une étude historique et littéraire de notre colla-
borateur Ch,-L. Livet sur Molière
et
V Avare.
— Notre collaborateur Arsène Houssaye vient de grosnouveau volume
son
sir
curieux
roman
parisien^
:
Mademoiselle Rosa (i),
de trois fines études
d'Houdetot, M''^ de Lespinasse et
Ce
dernier
ouvrage
:
la
édité par la
(i)
I
morceau
Femme
et
n'est
qu'un
extrait
la fille de Molièrey si
Calman-Lévy,
très-
M™^
la Fille de Molière.
de son grand
luxueusement
maison Dentu.
vol. in-i8, chez
sur
prix
:
5 fr. $0.
LE PÈRE DE M^"
DU PARC
Notre collaborateur M. Ch. Brouchoud nous adresse,
de Lyon, une copie de
faite
par
Gorla,
Un
la
demande de
Jacomo de Gorla,
dénommée
le
père de
séjour en cette ville
faut rapprocher ce
document de
Brouchoud, dans ses Origines du
père de Marquise
Gros-René
qu'a écrit M.
ce
théâtre de
Lyon (2), sur
de Gorla, devenue M"^
son mariage avec René Berthelot,
Du
le
Parc par
dk Du Parc
et
aussi
:
€
» Estant
Du jeudi
20 décembre 16^ j.
comparu sieur Jacques de Gorla, opérateur, natif
de Ro^el (?) pays des Grisons, lequel a dict
habitant en ceste ville puis quelque temps
son habitation, entendant estre subiect
et
et
declairé qu'il est
désire
aux guet
et
y
continuer
garde , faire
fonctions et supporter les charges auxquelles les habitans de
ladite ville sont tenus;
(i)
Journal
officiel
les initiales.
(2)
P. 29.
de laquelle déclaration
il
a demandé
du 23 mai 1876. C'est un exemple du tort qu'on
les mots quand les documents n'en donnent
a de vouloir compléter
que
:
épisode inconnu de la vie de J. Racine (i).
H
les
Marquise de
la belle
à tort Marguerite dans l'article intitulé
219
LE MOLIÊRISTE
acte
au consulat
des
nommées
que
ledit
de vivre
ne;
se
et icelluy
supplié vouloir faire inscrire
de Gorla a faict
et
preste le serment entre leurs
mourir en la religion catholique
et
comporter en
tout ce qu'il
bon concitoyen
et
et
déclaration
tenu par
advertir
le
habiter suivant et
juillet
IS97
1617 pour
et re-
de sadite
ordonné quelle sera registrée au présent livre
de ladite ville de ceux
secrétaire
le
mains
consulat de
apprendra importer au service du Roy^ bien
et
livre
apostolique romey-
de ladite ville, ils luy ont octroyé l'acte requis
pos
au
des habitans de ladite ville. Lesdits sieurs après
au
désir de l'arrest
patentes de
et lettres
du
qui y viennent
conseil
du Roi du )
Sa Majesté du 19 novembre
servir et valoir audit de
Gorla en temps
et lieu ce
que de raison. »
Archives de la ville de Lyon,
fo
Registres des
Nommées, BB, 440,
64, v".
Le fragment
inexact qu'a
donné M. Benjamin Pifteau
dans ses Maîtresses de Molière (p. 85-86) ne pouvait nous
dispenser de publier in extenso ce document, certifié con-
forme à
l'original.
Paraîtront en octobre
A la librairie
collaborateur
A
M.
la
:
Maison mortuaire
M. Auguste Vitu
librairie
Leraerre, la
de Molière,
par notre
;
Laplace
L. Dumontier.
et
Sanchez, Molière auteur
et
coméditn, par
UNE RELIQUE DU CIMETIÈRE SAINT-JOSEPH
On sait
au
que Tancien cimetière de Saiiit-Eustache
commencement du XVII^
rue du
siècle, à
attenait,
l'hôtel
Bouloi. Pierre Seguier obtint de
la
Scguier,
fabrique de
église, dont il était le premier marguillier,
et de l'évêque
de Pans la translation de ce très ancien cimetière
dans
un terram à lui appartenant, au coin des rues Montmartre
I
et
du Temps-Perdu.
Cette translation eut lieu en 1630, et, dix
chancelier posa la pierre de fondation de
funéraire du nouveau cimetière.
le
ans après,
chapelle
la
Cette pierre vient d'être retrouvée dans les
fouilles
pratiquées pour la démolition du Marché Saint-Joseph.
On
y lit_ l'inscription suivante, au-dessous des armes de
Seguier, timbrées du mortier et soutenues des
masses de
chancelier de France :
ILLVSTRISSIMVS et ŒavissiMvs
DOMINVS DOM. PETRVS SEGVIER
FRANCIΠCANCELLARIVS FVNDAMENTIS
SACELLI
ISTIVS
PRIMA-
RIVM HVNC BENEDICTVM LAPIDEM INPOSVIT DIE XIIII
MENSIS IVLIJ. ANNI M. D. C. X L.
Nous espérons que, suivant la demande de M. Jules
Cousin, conservateur du Musée de la Ville, ce curieux
monument sera prochainement déposé à
Que n'a-t-on aussi bien retrouvé la
Jean-Baptiste Poquelin Molière,
metière 33 ans plus tard ?
l'hôtel Carnavalet.
pierre tombale de
ce même ci-
inhumé dans
LA RÉDACTION.
BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESaUE
—
Le Molière Hachette.
Le tome Vil de
des Grands écrivains vieat de paraître
M.
par
Amants
de Pourceaugnac et les
appendices
M.
la tapisserie
:
J. Guiffre}^,
édition.
Gomhaut
de
et
Macée
qui naguères a bien voulu donner la
primeur de cette note au Moliériste
mèdes du
l'
contient XAvare,
magnifiques, avec trois
Amours
des
il
:
Divertissement de Chambord,
; le livret
des inter-
imprimé à Blois en
1669, et une note sur les intermèdes des Agitants magnifiques.
Encore deux volumes,
Un
complet.
et
Théâtre
le
comprendra
10^
Lexique,
le
tance toute particulière, formé qu'il
est
et V Album
la direction
La
Biographie
compléteront cet admirable ouvrage, Tun des
de
la
collection
maison Hachette
parlait,
l'honneur
qui restera
et des érudits qui
Molière juge et partie.
cey
impor-
d'une
sous
de l'éminent philologue M. Ad. Régnier.
meilleurs
Molière sera
de
y auront
— Notre
de
la
collaboré.
collaborateur Sar-
dans l'un de ses derniers feuilletons au Temps,
de ces honnêtes amateurs, industriels, magistrats, professeurs, médecins, qui, sur le tard de leur retraite, s'avisent
subitement de
cas de
M.
armées,
etc.,
le
« faire
D""
du théâtre
.
Tel
est
qui vient de publier, sous ce
pensée, ses « poésies intimes »
gramme
»
précisément
le
Ad. Aulagnier, médecin principal des
titre
:
Fleurs de
dont, fidèles à notre pro-
qui est d'écarter tout ce qui
aô
se rapporte pas à
222
LE MOLIERISTE
notre Molière, nous n'aurions pas
à parler,
ce
si
petit
volume (i) ne contenait une Epigramme sur Mauvillain
ne se terminait par Molière juge
en vers, avec prologue
acte,
tiné à célébrer le
Molière
Nous ne raconterons
aucune tirade
;
et
comédie en un
partie,
à-propos des-
et apothéose,
254' anniversaire de
ne pas voir
et... à
et
naissance
la
de
feu de la rampe.
le
pas la pièce, nous n'en citerons
mais nous
la
signalons à nos lecteurs, pro-
mettant à ceux qui se seront procuré
le
volume quelques
heures de douce gaîté.
Voici r epigramme:
»
Le docteur Mauvillain dînant avec Molière,
»
Louis Quatorze entr« et dit malicieusement:
Que vous ordonne-t-il ? Voyons, soyez sincère,
Sire, certainement
Des remèdes sans fin ?
Mais, ne les prenant pas, je guéris sûrement.
»
—
»
»
— Le
de
mensuel La Croix a publié, dans
recueil
juillet,
;
un
article
très
hostile
à
Molière
>
sa livraison
:
Tartuffe,
signé: A. Charaux, professeur aux facultés catholiques de
Lille, faisant
Molière, paru
suite à
de côté
laissent
un
article
y
a quelques
les
documents
il
du
même
auteur, intitulé
mois. Ces morceaux, qui
irréfutables, et
ne s'appuient
au fond que sur des appréciations plus ou moins fantaisistes,
sembleront aux esprits sérieux
le
contre-pied de
l'histoire.
— La
Merlet
:
Hbrairie Hachette publie un
Etudes
littéraires
neille et de Molière,
sur
volume de M. Gustave
le théâtre
de
Racine, de
Cor-
dont nous parlerons prochainement.
DU MONCEAU.
(i)
In-i2 de
352
léans, 1882. Prix,
p.
3
Paris,
francs.
Ghio, Palais-Royal,
i
à 7, galerie d'Or-
BULLETIN THÉÂTRAL
—
Comédie française.
forcé
(MM.
Martel,
M.
Leloir; M"^ Fayolle)
mière
M"= Tholer)
Barré, etc.)
fois.
— Mercredi
(MM.
Tartuffe
Baillet,
Silvain,
—
Martel,
—
etc.)
Mariage forcé.
le
(MM. Coquelin
Lundi
(MM. Got,
la
première
Dimanche
sain, B. Barretta).
— Mardi
credi 13, le Misanthrope et
manche 17
Femmes
les
Odéon.
— Mardi
ou V^Amour
depuis 1864
musique
5
et
Médecin malgré
Mariage forcé.
et
— Mer— Di-
lui.
— Dimanche 24,
Delaunay, Coquelin, Truffier).
:
reprise
du
qui n'avait pas été ireprésenté
Marie Pinson).
et la danse,
les
Brohan, Jouas-
septembre, réouverture
peintre ^
4,
—
(MM. Got,
savantes
M""**
(MM. Amaury, CornagUa,
Malvau
J.
(MM.
savantes.
Lundi
12, le Mariage forcé.
le
et vendredi 22, le
;
—
27,
Richard,
Joliet,
cadet, Garraud, Jo-
Femmes
11, les
Coquelin cadet, Le Bargy, Leloir
M"^'
pre-
Davrigny, M""^ Lloyd, Martin, Bianca, Amel).
Fourberies de Scapin
Sicilien
la
Misanthrope, (M. De-
23, le Mariage forcé.
Barré,
Samedi 2 septembre,
liet,
le
Médecin malgré lui
et le
Mariage
Davrigny,
Reney joue pour
P.
Frémaux joue Lucinde pour
M'^^
le
Truffier,
Villain,
— Mardi 22,
fois Alcidas.
launay,
Samedi 19 août,
Joliet,
—
Bahier (début)
On
a
supprimé
jusqu'à cette amusante scène
;
la
du
sénateur, dans laquelle l'excellent Fréville eût désopilé la
salle,
du
à son ordinaire. Première représentation de V Ecran
roi
en un
ou
la Dernière fourberie de Scapin,
acte,
comédie-pastiche
en vers, de M. Ernest Boysse. (MM. Noël
1
.
224
LE MOLIÉRISTE
Martin
Chartier).
M""
Su-
dimanche
lo,
Achard, Boudier
Kéraval,
(rentrée),
zanne Pic et
— Mercredi
6
à
;
—
deuxième
à sixième représentation
Lundi
1
première soirée populaire à prix réduits
(MM.
Albert Lambert, Noël Martin, Rebel, Brémont, etc.
,
M""" Crosnier, Dyone,
J.
de ces deux pièces.
Malvau, Chartier).
Tartufe,
:
—
Mardi
12 et mercredi 13, septième et huitième du Sicilien
l'Ecran du
roi.
— Jeudi
douzième de VEcran du
—
Dimanche
duits
à
de
précédé du Dépit amoureux.
roi,
17, première matinée
Tartuffe.
:
neuvième du
et
14 a dimanche 17, neuvième à
populaire à prix ré-
— Lundi deuxième
— Mardi 19
18,
Sicilien.
à
quinzième de VEcran du
soirée populaire,
jeudi 21,
treizième
précédé du Dépit amoureux.
roi,
— Dimanche 24^ deuxième matinée populaire dixième
— Lundi 25, troisième
du
populaire
:
soirée
Sicilien.
temmes
A
savantes (rentrée de
l'étude
:
le
—
OpÈRA-CoMiauE.
MM.
:
les
et débuts.)
Médecin volant, V Etourdi, Sganarelle.
lundi II, lundi
de
Noël Martin
Lundi 4 septembre, vendredi 8,
populaire), Ï^Amour médecin,
18 (soirée
Poise et Ch. Monselet
—
Théâtre de Saint-Cloud.
Mercredi 23 août, au
bénéfice de l'orphelinat de Levallois-Perret, le Mariage forcé
et Tartuffe
çaise,
(MM.
Silvain et Joliet,
dans Tartuffe
bant, dans Cléante
;
;
M""
Dorine.
la
Comédie
fran-
et Orgon
M. Plan, élève de MauM. Matrat-Amel dans M"'' Pernelle,
;
comédien Hubert, comme on
rôle créé d'original par le
sait
de
Danglars, Elmire
;
Rosamond, Marianne
;
Boyer,
MONDORGE.
rmprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
—
Noël T&xier.
QUATRIÈME ANNÉE
NUMERO 44
NOVEMBRE 1882
LE
MOLIÉRISTE
%EVUE D^CENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E Campardon,
MM
:
Claretie, F. Coppée, V. Fourkel,
J. Guillemot,
HoussAYE, Paul Lacroix, H. de
Lapommeraye, Ch. Livet
A
J.
J.
LOISELEUR,
Ch
L.
Nuitter,
MOLAKD, Ch. MoNSELET
,
E.
NoEL '
'
Picot, L. de la Pijardière,
t. -P. Régnier, Ch. de
la Rounat, F. Sarcey
Dr H. ScHWEiTZER, Ed.
Thierry, E. Thoikan, a. v'itu, etc.
E.
PAR
Georges
M ON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10, GALERIE DU THEATRE FRANÇAIS, 10
1882
SOMMAIRE DU NUMÉRO XLIV
QUATRIÈME ANNÉE
—
Alceste et Montausier.— G.
SAINT-SIMON INÉDIT.
REGNIER. - L
MATHURIN
ET
MOLIÈRE
MOLIÈRE ET MADELEINE BEJART.
PAR Abraham Bosse. Avec deux
L'ASILE
—
Deux Portraits
fac-similé.
DU SONNET D'ORONTE.
MOLIÈRE ET COTIN.
-
Monval.
peints
- Alexis Martin.
— Ch. Marie.
Autre Réponse a un Provincial.
E. Marnicouche.
—
-
Du Monceau.
BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESQ]UE.
Mondorge.
—
BULLETIN THÉÂTRAL.
FRANCS PAR AN
LE PRIX d'abonnement EST DE 12
POUR TOUTE LA FRANCE
— ÉTRANGER,
1$ FRANCS.
UN NUMÉRO UN FRANC 50 CENT.
:
du Théâtre
G. Monval,
ou par mandat sur la poste adressé à M.
communicaVintimille, auquel les manuscrits,
On s^abonne
français,
2, place
tions,
Galerie
à la librairie Tresse, io,
de
demandes
lettre affranchie.
et
par
réclamations devront être envoyés
SAINT-SIMON INÉDIT
ALCESTE ET MONTAUSIER
Il
est
généralement admis que Charles de Sainte-Maure,
duc de Montausier (i),
c'est lui
La question
différents,
que
a été souvent agitée, et dans des sens très
en dernier
dans son Éfiigme
meraye
d'Alceste, et
était l'original
que Molière a voulu peindre dans son misanthrope.
lieu par feu
d'iÂlceste, ici
(Moliériste
du
i^''
M. Gérard du Boulan
même
mai 1879),
par
et
M. de Lapom-
par
M, Coquelin
aîné dans ses conférences à la salle des Capucines.
Taschereau, dans son Histoire de
Molière, cite
la vie
un passage de St-Simon qui
à éclairer quelque
Mais voici un
peu
le
point en
des ouvrages de
paraît de nature
litige.
manuscrits
extrait des
et
inédits
du
même
St-Simon, conservées aux archives des Affaires étrangères (2),
(i)
Né en
(2)
Série Ducs
1610, mort en 1690.
et
pairs de France
:
article
Montausier.
228
LE MOLIÉRISTE
qui est bien plus explicite et qui intéressera nos lecteurs à
plus d'un point de vue
En
Mgr
1688, (2)
(i)
Dauphin arrivant à
un Gouverneur.
luy fallut
de l'ordre
le
:
1661
dès
plus digne
et
Duc
avoit alors
choisy (4). //
et il
5VC. de
et
jS
ce
et
estoit
il
vray que
se
le
licencioit
et
(i) Il offre
duc
et la
le
faire mourir sous
de confience,
les
à
gens
beaucoup de gens,
(5) il se
estoit joué. Il lesceut
y
le
si
à
baston. Il arriva que fort
quelques ressemblances avec une note de St-Simon sur
livre
de M. Amédée Roux
XIV. Montausier
Durand, 1860), mais
(2)
il
le
duchesse de Montausier, qui forme, sans indication de source^
Ve appendice du
de Louis
que
assés souvent
s'emporta jusqu'à faire menacer Molière, quoy qu'alors
la mode, de
et
et
du Misantrope parut,
débita publiquement que c' estoit luy qui
le
à
faisoit craindre
tellement que dès que la comédie
et
estoient
pas moins
une grande justesse jointe au poids
toujours
donnoit. Cela
y
et
mœurs
ses
de sorties qui etnbar assoient d'autant plus
qu'elles avoient
qiiil
si
l' estoit
degré de faveur, de considération
contraignit beaucoup moins
des espèces
il
Pair à la fin de 166 j (3) fut
ans. Le choix ne pouvoit estre
naturel lenmit austères, son esprit ne
le
7 ans,
y repondit pleinement. Il fut seulement accusé
de trop de sévérité
parvenu à
l'aage de
Montausier fait chevalier
Lisez
:
1668,
le
il
^
sa vie
est
et
:
son temps,
Un
beaucoup plus précis
grand dauphin étant né
misanthrope à la cour
(i vol. in-S»,
le
Paris, Didier
et circonstancié.
i'='"
novembre 1661,
à
Fontainebleau.
(4)
En novembre.
En septembre
(5)
La première représentation
(3)
1668.
avait eu lieu le vendredi 4 juin 1666.
LE MOLIERISTE
peu de jours après
et corne
Mgr
cette pièce
et
pour
spectacle
passé à
s'estoit
fut représentée à St-Gcrmain, (i)
Dauphin començoit à suivre
le
M.
déplaisirs, nécessité fut à
médie
M.
cette occasion.
en
il
l'entendre bien.
et
sortit
estait le
ternit
si
charmé
il
elle
qu'il
Roy à
ces sortes
de
Vy
de Montausier
y arriva
voulut, puisqu'il
avançait plus
il
haut que
dit tout
cette co-
voir après ce qui
y
à grand honneur, quoyqu'il ne
voya chercher
M.
de
tost qu'il
et si
Ce
Molière.
ïMontausier
avaient couru dont
il s'estait
.
le
et
ce îMisatitrope
qu'il
et
meritast pas, ce qu'on
comique
en-
il
connoissoit
tremblé des
avait
la
estait,
fut rentré che^ luy
célèbre
Il
in-
la goustoit
plus honneste home qu'il eust veu de sa vie
en avoit dit sur luy,
estait
Plus
le
de Montausier de voir
toutte la cour
térieurement fort en colère, mais
voir
229
quel
qui
bruits
disculpé de touttes ses forces, rien ne
le
pouvait rasseurer. Enfin vaincu par plusieurs messages coup sur
coup,
que
il
M.
louer,
admirer sa
blance, l'envier
céder enfin
^
le vit
il
touttes fois, ne
à vouloir bien croire
oreilles et se défendait ; et la fin
faire ny que dire
courut à luy l'embrasser,
pièce, se défendre
fureur. Molière toujours plein
quand
5VC.
ce
qui
d'effroy
il
2 au 7 novembre 1668),
est ici
et
le
pas à en
estre flatté,
l'avait si fort
ne croyait pas
à
ses
de î\Contausier averti que son
se
mettre à table. L'esprit
i^r
décembre 1666 au 20
question ne fut que de cinq jours (du
Registre de
Lagrange, qui mentionne
George Dandin trois fois et une fois V Avare, ne parle pas
thrope.
mis en
fut qu'il ne sceut plus ny que
(i)Ily avait eu voyage à St-Gerraain du
1667; celui dont
le
modestement de sa ressem-
résister
souper estait servi convia Molière de
février
mourant de peur. Dès
alla sur parole, mais toujours
de Montausier
du Misan-
LE MOLIIÏRISTE
230
ny la débauche n' annoblissoient pas encor alors des professions
éloignées de les mettre
à la portée de tout
monde. Tellement que
le
ïKoliêre qui avoit soupe en débauche plus d'une fois en sa vie
avec de jeunes seigneurs (i), n'en
là avec cette
de la
mesme jeunesse
dignité, de
,
homme
combien moins avec un
de la place, de l'austérité de
l'aage,
Montausier. Aussy fut-il longtemps à
et ce
pas à m.anger hors de
estoit
le
comprendre
et
à
M.
de
l'oser,
fut une scène charmante pour ceux qui en furent tesmoins
qui devint la nouvelle du lendemain (2). V^. de Montausier
but à Molière
et
l'asseura de son amitié
pour toujours
et
luy tint
fidèlement parole. (3).
(i)
On
connaît, par les vers de Chapelle au marquis de Jonsac^
souper de neuf couverts à
chevalier « Qu'importe,
»
le
Croix de Lorraine, qui réunit Chapelle, le
la
comte de Lignon, La Porte,
le
Broussin, du Toc, des Barreaux, de
la
Mothe
(le
frère
l'abbé
du
de François Le
Vayer), enfin Molière,
que bien connoissez,
» Molière,
(2)
Ne
»
Et qui vous a
»
Messieurs
(3)
B
lui
bien farcez,
beuvoit assez
»
Les suivoit
et
»
Pour, vers
le soir, être
serait-ce pas là l'origine de
nuit, dans laquelle, avec
devenir
si
coquets et coquettes,
les
Roi lui-même
le
On
le
que
entendre
en goguettes.
fameuse légende de VEn
M. de Montausier
temps,
cas de
aurait fini par
?
cherchait à irriter
faisant
la
M. de Montausier
Molière
l'avait
Molière,
en
pour modèle
en
contre
pris
du Misanthrope. Mais il répondit touvouloir du mal à Molière, il jaut que l'original
» faisant la fameuse comédie
»
jours
»
soit bon,
»
qu'il n'a
:
]e n'ai
garde de
puisque la copie
» son misanthrope^
»
est si belle.
Le
seul reproche que
pas imité parfaitement son modèle
c'est
Montausier, citée par
un honnête homme.
M. Roux.)
;
faye à luijaire,
je voudrais bien être
»
(Anecdote sur
le
c'est
comme
duc de
LE MOLIERISTE
Quelle créance
ment erronée
faut-il
bien
»
accorder à cette note, passable-
sur plusieurs points de détail
M. de Montausier
tonner
aurait-il
M.
le
si
duc de Saint-Simon
M.
du Roy,
Ernest Boysse,
la
représentée avec
in-i8 qui, par
phique, se
le
«
bas-
?
comédie en un
vient de paraître chez Quantin, en
faire
grand peur que veut
Georges
V Ecran
?
eu pouvoir de
Molière, et Molière eut-il
le dire
231
MONVAL.
acte, en vers, de
succès à l'Odéon,
un charmant volume
choix du papier et l'exécution typogra-
recommande
à tous les bibliophiles.
'm^m^m'^^mm^m^m^^
MOLIÈRE ET MATHURIN RÉGNIER
C'est
un
presque
commun
lieu
de dire que Molière
aimait et pratiquait Régnier. Autant et plus que Boileau,
avec moins de réserve et de pruderie,
goûtait certainement
mâle
«
le
grand Comique
le
satirique aux
»
rudes
«
vers, »
De
l'immortel Molière immortel devancier,
auquel Musset voulait qu'on
il
gna
prenant cette
pas,
chapeau (i).
son
ôtcît
l'aimait, mais, à trois reprises,
seulement
son bien
fois
sur Macette, trois passages dont
des
Femmes (2)
et les
sœur aînée de
l'a
remarqué dans son beau
au
XVF
siècle,
M. Ch.
(i)
Epitre sur la Paresse.
(2)
Acte
livre
Lenient,
Acte
III
scène
m,
et acte iv
l'édit. citée.
Sans parler de
largement à
profit
et le
pour
commentaire de
les
la
la pièce,
scène v,
;
voy. la
passim.
(3).
»
Bien
comme
plus affirmatif de ceux
t.
t.
m,
de
la collection
p.
198 et note 2.
iv,
Satire VIII, sur
Fâcheux
XIII
sur la Satire en France
le
des Grands écrivains (Despois et Mesnard),
(3)
Tartuffe
Tartuffe,
scène v; voy. l'édition de Molière
II
la Satire
plaça l'un dans V Ecole
il
deux autres dans
plus, « Macette est la
un maître,
chez
d'emprunter au chef-d'œuvre de Régnier,
Non
ne dédai-
il
p.
469
et
l'Importun,
même
édition,
t,
dite
498 de
qu'il
mit
III, p. 8,
LE MOLIHRISTE
233
deux types, en ont
qui, en étudiant les
fait
ressortir la
ressemblance, (i)
Nous ne voulons
que
celui
le
à défaut d'autre mérite,
qui,
rallèle,
pas affaiblir en
prise surtout le
Moliériste, la
nous contentons de renvoyer aux
d'un rapprochement
reprenant ce pa-
n'aurait
nouveauté.
les
t>ien curieux,
Tout au moins ne
travail
le
de rapprochement est jusqu'à présent
française
a
(2)
bien plai-
trouvons-nous dans aucune des deux
le
grandes éditions de Molière où
:
fait
ce nous semble, n'a pas encore été signalé.
sant, et qui,
T.
théo-
un autre emprunt
signaler
par Molière à Régnier, emprunt
(i)
les
expressions de Macette. (2)
Nous venons seulement
sément
Nous
y verra comment, dans sa
détaillé. Il
presque
pas
textes le lecteur curieux
grande scène de séduction, Tartuffe emprunte
ries, les idées,
même
de critique et
le plus com.plet, celles
p. 147-153. Sainte-Beuve est du même avis; il dit expresPour moi, Macette est déjà Tartuffe. » (Tableau de la poésie,
au XVI^ siècle, édit. Troubat, 1876, t. i, p. 233.)
II,
a
la jeune fille qu'elle catéchise, dit M.
mot pour mot, dans la déclaration de
Nous croyons toutefois que M. Lenient
Le discours de Macette à
Lenient, se retrouve tout entier,
TartuflFe à Elmire. »
va trop loin
(P. 149}.
en disant
:
a.
La pauvrette qui
balbutie, va céder peut-être,
celle
d'Orgon dans
cipiter le
Tartuffe^ vient, par
dénouement. La scène
qu'à la prendre,
et,
mais non surpassée.
l'écoute s'étonne,
lorsque l'apparition de l'amant,
un coup de théâtre
était toute construite
malgré son génie,
il
l'a
;
hésite,
comme
subit,
pré-
Molière n'a eu
imitée, égalée,
si
l'on veut,
«
En revanche, M. Paul Mesnard (t. iv, p. 349 de son édition) refuse
Régnier
a Ce n'est assurément pas assez (les deux passages
trop à
cités
:
plus
Tartuffe. »
haut) pour
trouver
dans
Macette le
moindre germe de
L^ MOLIÈRISTE
234
MM. Aimé
de
Martin
lique. (2)
Nos
Louis Moland (i).
et
déclaration galante que
lecteurs
Thomas
Il
nous permettront, bien
chent par cœur ce merveilleux passage, de
ici
;
pour
l'intelligence de
qu'ils l'aient sous les
yeux
ce
de
la
qu'ils
qui va suivre,
sa-
transcrire
le
il
importe
:
Mademoiselle, ne plus, ne moins que
«
s'agit
Diafoirus récite à Angé-
la statue
de
Memnon, ren-
un son harmonieux, lors qu'elle venoist à estre éclairée des rayons
Tout de même me sens-je animé d'un doux transport à
du Soleil
l'apparition du Soleil de vos beautez. Et comme les Naturalistes remardoit
;
quent que
la
fleur
Astre du jour, aussi
nommée Héliotrope tourne sans cesse
mon cœur dores-en-avant tournera-t-il
vers
cet
toujours
vers les Astres resplandissans de vos yeux adorables, ainsi que vers son
Pôle unique. Souffrez donc, Mademoiselle, que j'appende aujourd'huy
à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur, qui ne respire et
n'am-
bitionne autre gloire, que d'estre toute sa vie, Mademoiselle,
vostre
très-humble, très-obeïssant, et tres-fidelle serviteur, et mary.
Aimé Martin
couplet,
avec
et
M. Louis Moland
fort
lointain
de Molière.
D'abord Aimé Martin
«
en note de ce
citent,
un passage qui n'a qu'un rapport
le texte
» (3)
:
L'abbé d'Aubignac, dans une dissertation contre Corneille, où l'on
retrouve
le
ton et
le style
de
emphatique de Balzac, débute
Dramatique au
Thomas
Diafoirus, c'est à dire la manière
ainsi
Corneille avoit
:
et
silence, mais, à l'exemple
condamné
de cette statue de
sa
Muse
Memnon
qui rendoit ses Oracles sitôt que le Soleil la touchoit de ses rayons,
(i)
Nous
il
a
laissons de côté, bien entendu, dans cette comparaison, l'é-
dition Eug. Despois et Paul Mesnard, qui n'est pas encore terminée.
{2)
Le Malade imaginaire, acte
(3)
Nous
11
citons d'après l'édition
viU, p. 177-
scène v.
in-12 de M. Alphonse Pauly,
t.
LK MOLIERISTE
235
grand Ministre.
repris SCS esprits et sa voix à l'éclat de l'or d'un
probable que Molière a voulu se
moquer de
» Il est
l'abbé d'Aubignac, célèbre
par son pédantisme autant que par ses querelles avec Corneille, Ménage,
Mlle de Scudéry, Richelet... (Voy, Dissertation sur l'Œdipe de Corneille,
in- 12, Paris, 1663.) (i)
Certes, la dissertation de d'Aubignac est fort médiocre.
C'est
un pauvre factum, pédant
plat
toutefois,
;
dans
mauvais,
le
et lourd,
injurieux et
l'abbé
montre
se
très
au-dessous de Thomas. Pour Balzac, Thabile artisan
de
écrivain considérable malgré
ses
phrases et de périodes,
comme on
pour
défauts,
qui
française
un bon professeur de rhétorique, on ne
fut,
ce qu'il vient faire
ici
l'a
trop
c'est
;
dit (2),
langue
la
voit pas
que
rabaisser
le
le
mettre en compagnie d'un d'Aubignac. Quant au passage
cité, est-il
non-seulement
que Molière
ait
voulu
le
«
probable
parodier
?
mais admissible
»,
Quel excès d'honneur
pour une phrase insignifiante d'un mince
blié dès sa naissance, c'est-à-dire
M. Louis Moland ne
de
quatre lignes
(i)
Œuvres
début de
de Molière,
VIII, p. 422.
;
et
de réponse à ses calomnies.
in-i2. (Bibliothèque de la
Comédie
de
les
les
em-
— Ce n'est pas précisément au
la
page 24. Voici
Troisième dissertation concernant
matique, en forme de remarques sur la
Œài'ç&
se contente
mais assez avant, à
la dissertation,
exact de cette plaquette
t.
Il
!
de choses dans
voit pas tant
d'Aubignac.
ou-
petit livre
depuis dix ans
tragédie de
^r
Paris, Dubreuil
le
Corneille
et
le titre
pocme dra-
Collet,
intitulée
1663,
française.)
t. I,
n La prose franp. 93
grammaire avec Vaugelas et sa rhétorique avec Balzac, s'émancipa tout d'un coup et devint la langue du
(2)
Sainte-Beuve, Causeries du hindi,
çaise,
parfait
qui avait
honnête
fait
sa classe de
homme avec
Pascal.
»
:
LE MOLIÈRISTE
236
Aimé Martin
pruntcr à
même
flexions, au
Pour nous,
mas. Ce passage
premier modèle de
le
liminéaire au
commentateurs de Molière ne
longtemps signalé. Dans son
Roy
grâce aux bienfaits royaux,
donc
parle
«
On
lit
le
ce
(c
pout ingratitude.
il
y
que
le Soleil levant la
miracle (Sire) avez vous
faict
en
voix et la parole.
de vos Palmes, et
moy
On
si
regardoit.
prend
la
suiect qui n'est
témérairement
animé que de vous,
et qui
bouche ouverte à vos louanges,
V. M.
si,
me
hardiesse de se mettre à
elle
ose vous offrir ce qui
par droict est desia vostre, puisque vous l'avez
et la
Il
Ce mesme
qui touché de l'Astre de
ne trouuera donc estrange
ma Muse
ressantant de cet honneur,
l'abri
»
vne statue qui rendoit vn son ar-
avoit
les fois
la
mais,
silence,
:
qu'en Etyopie
monieux, toutes
ay receu
le
que l'on eust tenu pour
maintenant
seroit
épitre
«
Régnier s'excuse de n'avoir long-
»,
temps témoigné son respect que par
reuerence,
tête
nous avouons nous étonner un
et
éditeurs et
les
en
est
il
Tho-
de
la tirade
à découvrir, car
est facile
l'aient pas depuis
sans ré-
lui,
dans un passage en prose de Régnier
des œuvres du poète,
peu que
les citer après
endroit de son commentaire, (i)
c'est
que nous voyons
de
et
faict
faisant des
un
cœur
naistre dans
aura éternellement le
voeus
et
des prières
continuelles à Dieu qu'il vous rende là-haut dans le ciel autant de biens
que vous en
faites
ça bas en terre.
Vostre très-humble
et très-obéissant et très-obligé suiet et serviteur.
REGNIER.
N'y
tre ce
a-t-il
(2)
pas une ressemblance qui saute aux yeux en-
langage très-sérieux, très-sincère, et ce compliment
(i)
Œuvres
(2)
Œuvres de Régnier,
de Molière, première édition,
t.
VII, p. 221.
édition Courbet, in-8, 1875, p. 4.
I
LE MOLIERISTE
Thomas où
de
épiques
prend des proportions vraiment
le ridicule
Des deux
?
me mouvement
même
côtés,
237
avec un très-simple
faire,
changement de construction (une
de cet innocent
simple particule
protocole
«
merveilleux couplet comique,
mê-
tour,
de Régnier,
jusqu'à la « salutation »
;
que Molière s'approprie, pour
liaison),
même
pensée,
la fleur
»
la
de
de son
finale
maîtresse de ce bou-
quet de niaiserie solennelle et maussade.
que Molière se
Est-ce à dire
qué de Régnier
ces
emphatiques
une
triste
la
de ridicule
servilité,
ples, sobres et dignes ?
un
par
en a choisi une pour
il
rappeler ainsi ses confrères au
et
l'homme des dédicaces sim-
respect d'eux-mêmes, lui,
liser
volontairement mo-
prodiguées au dix-septième siècle
émulation de
couvrir
soit
Faut-il croire qu'entre toutes les dédica-
?
Selon nous,
écrivain qu'il prisait
il
n'a voulu ni ridicu-
très haut, ni
contemporains une leçon de goût
donner
à ses
beaucoup sans doute
:
ne connaissaient pas Tépître de Régnier (ce sont choses
qu'on ne
Un
lit
guère),
jour qu'il
de cette
par suite, le
il
il
comique
le
l'aura lue avec
un
latent
sourire
mémoire, creuset magique qui gardait
sa
tout et transformait tout
Thomas,
;
n'eût pas porté.
trait
son Régnier,
feuilletait
lettre l'aura frappé
notée dans
et
et,
l'aura reprise,
;
puis,
pour
la
en écrivant
faire
rôle
le
sienne
de
désor-
et
mais inoubliable.
Quant à
la
gloire
du vieux Régnier, en quoi ce
vestissement pourrait-il
ses
éditeurs
MoUère,
il
et
la
commentateurs,
ne s'en
est
tra-
diminuer, puisque, entre tous
comme
trouvé aucun pour
le
L
aussi
ceux de
signaler
?
MOLIÈRE ET MADELEINE BÉJART
Deux portraits
La
peints par
Abraham Bosse
gracieuse hospitalité du Moliériste
aujourd'hui
à ses lecteurs
la
me
Il s'agit
de deux portraits peints à
célèbre graveur du
le
d'offrir
primeur d'une découverte
qui, je le crois, ne sera pas sans intérêt
Bosse,
permet
pour eux.
l'huile par
XVII"
siècle,
Abraham
l'élève
de
dans
le
Callot.
L'un
de
ces
portraits
représente
MoHère
rôle de Mascarille des Précieuses Ridicules
leine Béjart dans le rôle de
l'autre,
;
Madelon de
la
même
Madepièce.
Destinés évidemment à se faire pendant, ces portraits
sont peints sur deux minces plaques de marbre jaune
lonné de veines brunes
mètres en hauteur
Sur
le
et
leur dimension est de
;
de
1 5
20
sil-
centi-
centimètres en largeur.
fond un peu bizarre du marbre
les
figures se
détachent franchement, sans accessoires, sans terrain.
Les deux personnages sont représentés en pied, dans
le
costume certainement adopté en 1659,
mières représentations des Trécieuses
;
lors
des pre-
l'attitude, le geste
sont ceux qu'ils devaient avoir au début de la scène X,
ainsi
que
je le
démontrerai tout à l'heure.
Molière vu de
profil,
une main appuyée sur
le
pom-
LE MOLIERISTE
meau de
sa
longue épée, soulève de Tautre main son
chapeau rouge aux plumes
ble dire
ma
23
Une grande perruque poudrée mêle
d'un immense rabat
dessous bruns brodés d'or,
à
à-fait congruente
de rubans
!
Il
rouge,
avec des
h petite oie «
rouges,
quels canons
les
!
de haut,
;
et
tout-
quelle surabondance
souHers.
ceux-ci sont de « roussy
ou de maroquin
comment
corps
si
aux den-
l'habit est
les bas
y en a jusque sur
possible de dire
un demy-pied
!
;
ses flots
»
l'habit.
Quelles manchettes
gleterre
V audace de
»
visite.
telles
sem-
« effroyablement belles » et
« MesdameSy vous deue^ être surprises de
:
petit
du moins
sçay-je
que fêtais
Il
n'est pas
d'An-
de vache
bien quils avaient
bien en peine de
sçavoir
des talions si hauts et si dêlicas pouvaient porter le
du marquis,
ses
rubans,
ses
canons
et
sapoudre. (i)
Très curieux au point de vue du costume, ce portrait
me
semble moins intéressant au point de vue de
la
res-
semblance.
pour moi que l'auteur des
Il est certain
point /JC^^ devant
le peintre.
La physionomie ne
tradition prête
miné
le visage,
rappelle
à Molière
et
Ton
;
nullement
celle
que
la
l'absence de moustaches effé-
croit plutôt avoir
figure d'un jeune premier
tre
Précieuses n'a
quelconque que
sous
les
celle
yeux
de
la
l'illus-
penseur.
Au
dos de cette peinture, dans
(i) Récit
en pro^e
Barbin, mdclx.
et
en vers de
h
le
milieu du marbre, est
Farce des Trécievses
;
Paris,
Claude
240
LE MOLIÈRISTE
tracée sur
ment du
une seule
XVII'^ siècle,
ligne,
en caractères noirs évidem-
une inscription
ainsi
conçue
:
Jean Poquelin Rôle de Mascarilk. Bosse f.
Peinte avec
les
mêmes
couleurs
blanc légèrement bleuté pour
est
vue de
face,
choir, l'autre
une main sur
le
la
:
rouge pour
linge,
la
robe
et
Madeleine Béjart
hanche, tenant son mou-
main tendue en avant
et
grande ouverte,
—
LE MOLIHRISTH
geste qui semble
couplet
«
parfaitement
241
accompagner
le
fameux
:
zMais de grâce, Monsieur, ne soye^ pas insensible à
qui vous tend les bras
de vous embrasser.
il
ya
un quart d'heure
;
»
Une longue perruque ornée d'un
rouge
et
blanche et de l'autre d'un
tombe jusque
collerette
ce fauteuil
contente^ l'envie qu'il a
sur les épaules
nœud
plume
d'une
côté
de rubans re-
de Madelon;
d'une large
de dentelle d'autres rubans s'échappent
16
pour
LE MOLIÈRISTE
242
descendre jusqu'au bas de son corsage en pointe
est,
je l'ai
dit,
de Mascarille
et
agrémentée de broderies d'or
la
jupe blanche^
est
richement brodée aussi
visible sous
ici
MoUère
rappelant
qu'on donna
Au
dos de cette peinture
placée de
dent,
main
Li
la
Béjart.
le
l'idée
Pourtant
le
je
relève
une inscription toute
trouvée sur
j'ai
même
devait avoir quarante-un ans.
manière
conçue
le portrait
et tracée
par la
précé-
même
:
Bêjar (sic) 7^d/e de Madelon des Précieuses y Bosse f.
le
Je
que
elle est ainsi
;
bracelets.
bien jeune la comédienne qui, lors-
les Précieuses,
semblable à celle
ceux du cor-
rapproche davantage de
et se
;
robe,
semble moins lointaine que dans
que nous nous faisons de Madeleine
peintre a représenté
la
de grosses man-
au-dessous
;
deux poignets sont ornés de
La reSemblance
portrait de
robe
et d'argent
de
l'écartement
nœuds
ches bouffantes ornées de
sage, les
la
;
d'un ton rouge semblable à celui de l'habit
répète
en terminant,
ces detîx documents, dont
l'existence n'a point été constatée
jusqu'ici,
sont surtout
intéressants au point de vue des costumes, et c'est à ce
que
titre
j'ai
désiré les présenter aux Moliéristes.
Pour convaincre ceux de mes
signature, seraient tentés d'élever
ticité
un doute
de l'attribution de ces deux portraits
Bosse,
thèses,
il
me
serait facile
d'accumuler
ici
sur Tauthen-
à
Abraham
bien des hypo-
ou mieux, bien des preuves morales qui vien-
draient appuyer
(i)
lecteurs qui, malgré la
mon
dire, (i)
Le musée de Cluny possède une
peinture
d'Abraham Bosse.
LE MOLIERISTE
D'abord
le
caractère de l'œuvre, sa facture
che qui permet de reconnaître
tre
la
de plus,
;
la
le
un peu
graveur derrière
le
sè-
pein-
présence certaine de Bosse à Paris lors de
représentation des Précieuses, son goût pour les lettres,
la vie
me
de
plaisir qu'il
menait au dire de ses biographes,
semblent permettre de supposer
Molière et ses comédiens
ne
243
vit-il
les
deux
portraits
ny tant
dont
ils
constater
d'honnesteté,
ny
t>
que nous publions joignent-ils
peut-être à la curiosité qu'ils inspirent
mant de
pu fréquenter
comme d'Assoucy,
et peut-être,
jamais « ny tant de bonté,
tant de franchise que par my ces gens-là.
Aussi
qu'il a
une amitié
illustre
cet
attrait
char-
vouée à Molière
restent la seule trace.
Alexis
MARTIN.
et
DU SONNET D'ORONTE
L'ASILE
Dans
ticle
le n°
net où le
dans
Au
mot
«
cabinet
en vers de
lettre
Robi-
joue un tout autre rôle que
»
vers 376 du Misanthrope.
le
sujet de la véritable signification à
M. C. D.
Paris
41 du Moliériste, M' C. D. revient sur l'ar-
de M. Picot reproduisant une
cite
donner à ce mot,
un fragment de YEspitre aux
et s'élève contre
l'opinion
avons déjà combattue (voir
Le hasard de nos
de
M.
s'agit
t. II,
que nous
p.
270).
fixer le
de deux passages
sens de
des
tirés
«
:
comme moy,
Si quelqu'un,
est lourd, ignorant,
»
Il
«
Difficile^
leurs ouvrages n'estime,
mauvais
(Il est question des
il
poètes)
n'ayme point
la
rime,
hargneux, de leur vertu jaloux,
» Contraire en
jugement au
commun
bruit de tous
»
due
»
Les dames cependant se fondent en délices,
leur gloire
il
dérobe avec ses
;
artifices.
»
Lisant leurs beaux escrits et de jour et de nuict,
»
Les ont au
»
Que, portez à
»
Tant selon leurs discours leurs œuvres sont divines.
cabinet,
sous
le
l'église, ils
(Satire
11,
chevet du
lict
la
œu-
vres de Mathurin Régnier.
Premier passage
de
nous fournit aujourd'hui un
lectures
Il
Picot
le Moliériste^
nouvel argument pour aider à bien
boutade d'Alceste.
beuriêres
;
valent des matines,
»
éd. Jouaust, 1876, pp. 14 et I5)-
LE MOLIÈRISTE
Il
n'y a pas d'équivoque possible
meuble destiné
le petit
précieux ou supposés
gnier poursuit ainsi
«
Quel
>
Quand
plaisir
:
245
ici le
cabinet est bien
recevoir les objets
à
et
:
penses-tu que dans l'âme
je
sente
l'un de ceste trouppe en audace insolente
»
Vient à Vanves à pied pour grimper au coupeau
»
Du
»
»
Que
Que
»
Et se bouchant
»
Tourne
Parnasse françois
Tous
Molière
de son eau,
et boire
froidement receu on l'escoute à grand peine,
la
Muse en groignant luy
les
l'oreille
au
yeux à gauche
» Et, pour fruit
>
defîend sa fontaine,
récit
et les
de ses vers,
lit
de travers,
de sa peine, au grand vent dispersée,
ses papiers servir
à
connaissait trop
la chaise percée ? >
bien son
Mathurin Régnier
pour n'avoir pas eu ce dernier vers dans
du sonnet d'Oronte,
à propos
«
Franchement,
M. Picot et avec
deM''C. D. et du
l'analogie
papiers
Mais plus loin (page i6), Ré-
tels.
il
est
lui
il
la
pensée quand,
a fait dire à Alceste
bon à mettre au
:
cabinet. »
tous ceux qui ne sont pas de l'avis
nôtre
(i),
voudront bien constater
de sens des vers mis ci-dessus en
admettre avec nous que Molière a exprimé
que Régnier, mais en termes plus
la
parallèle,
même
et
idée
choisis.
Ch. marie.
(i)
Voir
médiaire
le Molière- Hachette,
du 2$ décembre 1881.
t.
V,
p.
467, au i«r renvoi,
et
V Inter-
MOLIÈRE ET COTIN
AUTRE RÉPONSE A UN PROVINCIAL. (l)
Vous demandez de nouveau. Monsieur, pourquoi Moière aurait attaqué
Cotin plutôt que tout autre, dans
personnage deTrissotin. Je ne reviendrai^ dans cette
ni sur les
et
Sermons du grotesque abbé que
—
pour cause
ils
ia Critique désintéressée. Je
Dictiojinaire
tire
me
Mignot, attaqué dans
pas lus,
—
ni sur
bornerai à rappeler, avec
de Larousse, que Cotin, offusqué par
de Boileau, composée en
traiteur
je n'ai
imprimés
n'ont jamais été
1665,
la
le
la 3" sa-
fournit au pâtissier-
même
pièce,
un
libelle
vers dont celui-ci enveloppa les biscuits qu'il vendait.
libelle, intitulé
le
lettre,
en
Ce
Despréavx, ov la Satyre des Satyres (2), est
devenu, sans doute par suite de son
mode
bizarre de distribu-
tion,
d'une insigne rareté. Mais
il
dans
les Variétés bibliographiques
d'Edouard Tricotel (pages
363 à 373).
(i)
Sa lecture vous convaincra facilement que
Voir ci-dessus,
(2) Petit
de Pallas
a été reproduit en 1863
p. 157,
179
et
215.
in-8 de 12 p., 1666, dédié au ducide Saint-Aignan, « favory
»,
que Molière venait de peindre, disait-on, dans l'Oronte
du Misanthrope, attribué à l'abbé Cotin par
la Satyre, éd.
de 1717,
la
note 2 du Discours sur
tome IV. Amsterdam, Mortier.
G. M.
LE MOLIÉRISTE
Cotin eut
même
en
s'en
maladresse d'insulter grossièrement Molière
la
temps que son ami Boileau. Le poète comique
vengea plus tard dans
tes raison
247
de
Les
le faire.
les
Femmes
risées
savantes et eut cer-
du parterre
n'étaient-elles
pas un châtiment bien mérité et dû en toute justice à des
vers tels que ceux-ci
?
J'ay veu de mauvais vers sans blâmer
J'ay leu
le
^
Poëte,
ceux de Molière et ne l'ay point
sifflé,
(vers 19).
Et
j'espargne la Serre avec son style enflé.
Mais
Luy
le
cadet Boisleau
me
pousse (i) à la satyre.
qu^on ne voit jamais dans
le
sacré vallon.
Se place en conquérant au sommet du Parnasse
Il descend de la Nile, et, la foudre
à
la
main,
Tonne sur Charpentier, tonne sur Chapelain
Puis, donnant à
ses
Que
tient
;
(2)
vers une digne matière,
ses
Comme un de
:
Héros
il
encense Molière.
(vers 38).
s'il
ne
me
pas pour un original,
Je n'ay pas
comme luy
Je n^ay pas
comme
Pillé dans
les
copié
luy,
Juvénal
;
pour faire une
satyre,
auteurs ce que j'avois à dire.
(i)
Var. Me
(2)
Voilà Rasius et Baldus
force à la Satyre,
destie... », dira bientôt
!
« Je vois
Molière au
«
votre chagrin et que, par
troisième gredin ».
mo-
G. M.
24B
MOLIÉRISTE
Lli
Sçachant l'art de
place?'
chaque chose
C7t
son lieu,
Je ne puis d'un farceur me taire un demy-dieu
;
(vers 44).
Despréaux {i), sans argent,
crotté
jusqu'à P échine,
S'en va chercher son pain de cuisine en cuisine.
Son Tur lupin (2)
On
promet tous deux (3) quand on fait chère
les
Ainsi
l'assiste,
entière.
auE l'on promet (4) et Tartuffe et Molière.
(vers 114).
•
•••••••••••••
Nostre
homme
,A
compte n'est pas
ce
•
infatué de sa façon d^ écrire,
si
près de se dédire
:
S'offense qui voudra, rien ne peut Vallarmer,
Il n'a
que
ce
moyen de
se
faire estimer.
Les plus noires vapeurs de sa mélancolie
Sont au moins à
ses
yeux une
illustre folie ;
A
SES VERS
Il
RÈGNE SUR Parnasse, et Molière l'a dit
EMPRUNTEZ LA BeJAR APPLAUDIT
;
!
(vers 216).
Molière
Cotin qui
est
le
donc
nommé
cinq fois dans les invectives de
poursuit de son animosité, sans motifs per-
sonnels et uniquement parce qu'il était l'ami
Qu'on s'étonne
après cela, ajoute
usé de représailles
(i)
(2)
(3)
(4)
M.
de Boileau.
Tricotel,
qu'il
!
Var. Le Censeur sans argent.
Var. Là Frantaupin l'assiste.
Var. On les donne à Paris.
Var. Comme on donne à la Cour.
G. M.
ait
LE MOLIÈRISTE
249
Je complète cette lettre par deux remarques:
1°
La
incomplète-
diatribe de Cotin a été reproduite
ment, sous
le titre
de Discours sur
page 226 du Recueil des Contes du
Satyres de 'Boileau,
et
les
Satyres de 'B*****, à la
sieur de la Fontaine,
les
A
autres pièces curieuses, (la sphère).
Amsterdam, chez Jean Verhoeven, ié68. Je trouve dans
ce rare petit volume la variante suivante pour le premier
des passages relevés ci-dessus
J'ay veu de
J'ay leu
méchans
patiamment
:
blâmer
vers, sans
les écrits
de
J'ay entendu Molière, et ne l'ay pas
2° C'est à tort
Poëte
ont supposé
et celles qui la suivent,
;
sifflé.
que Taschereau, Tricotel
Dictionnaire de Larousse
Turlupin
le
Rifflé,
que
que
j'ai
et l'auteur
du
l'épithète
de
remplacées plus
haut par des points, s'appliquaient à Molière. Cette hypothèse est démentie par Cotin
114. Ed. Fournier a
et
lise
de Molière (Paris,
fait
lui-même dans
voir,
dans
les
les vers
113
notes de sa Va-
Dentu, 1868, page 55), que
le
Tur-
lupin de Boileau était son propre frère, Pierre, qui prit le
surnom de Puymorin (i)
d'Intendant et de
des
menus
plaisirs
en cette qualité
la
dépense
faite
et eut
jusqu'en 1682 la charge
Contrôleur général de l'argenterie et
du Roi
(v. le
Dictionnaire de Jal.)
pour
le
Bourgeois gentilhomme à
Ami
de Molière,
et bientôt
enfant sur les fonts avec la
fille
de
Chambord,
conservé aux Archives nationales et que l'on peut
(i)
Ces
qu'il enregistra et signa le curieux état
lire
in-
son compère, ayant tenu son dernier
de Mignard. (i^ octobre 1672).
G. M.
250
LE MOLIKRISTE
extenso à
la fin
de l'excellente édition classique
comédie-ballet donnée
tout
de cette
récemment par M. Louis
Moland.
Je termine en faisant remarquer que
les
Variétés biblio-
graphiques de Tricotel n'ont été tirées qu'à 250 exemplaires et ne se
trouvent plus facilement.
Il
serait d'ailleurs
plus agréable aux Moliéristes de pouvoir joindre
en pla-
quette la Satyre des satyres à leurs collections d^écrits relatifs
à l'auteur des
Femmes
savantes.
notre bien aimé doyen exaucera ce
prochainement
le libelle
Nous espérons que
vœu
de Cotin dans
la
en réimprimant
Nouvelle
tion moliéresque.
E.
Cahors, 7 octobre 1882.
MARNICOUCHE.
collec-
BIBLIOGRAPHIE
— Notre collaborateur M.
L'Avare.
Ch.-L. Livet vient
Dupont, dont nous
d'ajouter au Tartuffe de la collection P.
avons
parlé,
un ^Avare conforme
à
originale^
l'édition
avec des notes historiques et grammaticales, suivies d'un
« lexique de la langue de l'Avare (i) ». Soit dit
sant,
nous n'aimons pas beaucoup ce dernier
en pasqui
titre,
Molière avait une langue spé-
pourrait faire croire que
pour chacune de ses pièces. La notice préliminaire de
ciale
M. Livet
avait déjà paru dans le Journal général de
truction publique
:
c'est l'histoire
de
la
F Ins-
pièce et des sources
auxquelles Molière a puisé.
Le
texte,
revu sur l'édition princeps de 1669, est aug-
menté des variantes de
1681^
1734, qui portent
16S2,
principalement sur les jeux de scène.
Les notes générales imprimées à
tendent,
comme
commentaires,
fort à la
on
mode
se rend
celles
du
et ofirent
suite
la
de
Tartuffe^ 1 élargir le
au lecteur ces
«
la
pièce
champ
des
leçons de choses »
depuis quelque temps. Après les avoir lues,
mieux compte de Tépoque
et
du milieu où
passe la pièce, des préjugés, des conventions,
se
des usages
que l'on peut y noter, des rapprochements littéraires
auxquels elle donne lieu. Nous en louerons l'exactitude,
(i)
I
vol. in-i8 de
278
p. Paris, P.
Dupont, i883, prix
:
i
tr.
5o
LE MOLIERISTE
252
à l'exception de l'attribution à Dancourt de la comédie
du
Flatteur, qui appartient à J.-B. Rousseau.
Enfin,
le
lexique
sans faire double emploi
qui,
représente une
l'excellent livre de Gènin,
somme
avec
consi-
fournit aux
dérable de travail et de patientes recherches,
élèves une série chronologique de citations bien précieuses
pour l'étude des progrès de
la
langue au
XVIP
siècle.
En recommandant ce nouveau volume, nous annonplaisir, comme devant paraître dans la même
collection et aux mêmes conditions, le Misanthrope et les
çons avec
Femmes
Savantes.
— Nous
Houssaye
a
avons
que
dit
pubUé, à
notre
nouveau roman
de son
suite
la
Arsène
collaborateur
:
Mademoiselle Rosa, trois études intitulées les Grandes Amoureuses,
Les quinze pages qui terminent
paru dans V Artiste sous ce
— La
librairie P.
titre
:
le
Ollendorf vient
remarquable étude de M. Coquelin ?ânè
C'est l'article de
lière.
très
augmenté,
la
volume avaient déjà
VOiseau bleu de Molière,
de publier
:
la
très
V Arnolphe de Mo-
Revue des deux Mondes revu et
tel qu'il a été lu
par l'auteur à
des
la salle
Capucines (i).
A
bientôt,
pour compléter
la
trilogie,
l'étude
sur Tar-
dont l'éminent comédien va bientôt représenter
tuffe,
le
rôle principal dans sa grande tournée d'Autriche et Russie.
DU MONCEAU.
(i)
I
petit vol. in-i6
de 98 pages. Papier vergé de Hollande
Quinze exemplaires sur chine
:
5 fr.
:
2
fr.
BULLETIN THÉÂTRAL
—
Dimanche 24 septembre, les
Comédie Française.
Femmes Savantes (M. Coquelin aîné devait jouer Vadius;
cadet, Trissotin. Ce dernier ayant fait, dans
matinée, une chute de cheval, M. Coquelin aîné a joué
Trissotin, M. Truffier, Vadius. Les autres rôles par
MM. Delaunay, Richard, Silvain, Leloir, Tronchet ;
j^mes Madeleine Brohan, Jouassain, Barretta, Bianca et
Fayolle).
Dimanche 20 octobre, i'^ matinée, donnée
le
au bénéfice de l'association des artistes dramatiques
Dépit Amoureux (MM. Joliet, Baillet, P. Reney, de Féraudy ; M"" Bianca et Frémaux).
M. Coquelin
la
—
:
—
Dimanche
15 octobre, matinée populaire,
le Malade Imaginaire.
populaire
Mardi 17 à Lundi 23, le Dépit Amoureux.
Odéon.
et
lundi
16,
soirée
MM.
—
Dimanche 8 octobre,
Poise et Ch. Monselet.
OpÉRA-CoMiauE.
médecin, de
—
:
V^Amour
—
M. le docteur A.
Théâtres de Vienne (Autriche)..
Friedmann nous adresse, de Wien^ un intéressant article,
trop long pour être inséré en son entier, dont nous
extrayons les passages suivants
:
La
saison théâtrale a été heureusement inaugurée à
Vienne. Jeudi 5 octobre, on a donné V Avare au Carltheater,
«
réservée d'ordinaire aux productions d'Offenbach, de
et au genre de vos Variétés. Un jeune artiste,
M. Alois Wohlmûth, qui, après avoir longtemps vécu
en Amérique, a débuté à la « Burg », a très-dignement
rempli le rôle principal. C'est un acteur qui pense, qui
salle
Lecocq,
médite ses rôles et s'identifie avec son personnage; on
surtout applaudi après la grande scène du 4^ acte.
l'a
LE MOLlèRISTE
2 54
Samedi 7 octobre, on a donné Tartuffe au Burg-Theater.
Le mérite d'avoir donné cette représentation au public
difficile de la « Burg » revient tout entier à M. Adolf Wilbrandt, le nouvel intendant-directeur de la première
scène de Vienne. Ce poète éminent, dont les drames
Arria et Messaline, Néron, Gracchus ont été applaudis chez
nous, a donné là une nouvelle preuve de son grand talent d'administrateur.
La traduction nouvelle est de
M. Hermann de Lohner. C'est la troisième adaptation allemande du Tartuffe. Représenté trois fois sans succès en
1788, on l'a repris et joué deux fois en 1818, à la
« Burg », sous la direction de Deinhardstein.
Voici
quelques
extraits
Vienne qui ont parlé de
La
la
'Nouvelle Presse libre
des
principaux journaux de
du 7 octobre
soirée
qui,
:
comme
vous savez, suit
cours des événements
avec un intérêt tout particulier le
« Le succès a été complet.
en France, écrit
Chaque mot a porté. L'intérêt, l'hilarité sont allés croissant pendant les trois premiers actes. On a joué tout
d'une haleine. Molière sans entr'actes, c'est la mode de
Paris. Levinsky et Baûmeister ont merveilleusement joué
Tartuffe et Orgon. M"^ Hartmann, très fine dans Elmire,
eût été plus applaudie encore dans Dorine, rôle que
]^me Mitterwurzer a dit d'une manière trop savante
et
pointue. La tentative a été couronnée d'un plein succès,
et voilà Tartuffe acquis au répertoire. »
littéraires
La
:
de voir V Imposteur s'ajouter à
au Malade Imaginaire, approuve aussi la suppression des entr'actes ; la pièce se déroule ainsi avec plus
de vitesse et d'unité.
Presse, qui se réjouit
V Avare
et
La Weiner AUgemeine Zeitung, qui a aussi voué un culte
à la littérature française dans son feuilleton quotidien, ne
s'occupe que de l'interprétation.
La Morgenpost ne croit pas que Tartuffe sera longtemps
des nôtres. Elle n'y voit point de perte, mais plutôt un
avantage. Les personnages de MoUère ne sont, d'après
elle, que crayonnés
il
n'en a donné que les contours.
:
LE MOLIERISTE
255
ne montrant les passions et les défauts de l'humanité que
dans leur expression élémentaire ; aussi a-t-il perdu la
pointe de sa verve satirique avec l'organisme plus compliqué de la vie moderne, et n'a plus de place sur notre
théâtre.
La
a le droit
un
intérêt
Comédie
Française^ la maison de Molière,
devoir de donner ses œuvres, et dans
purement archéologique de résurrection litté-
seule
comme
le
raire.
La
Vorstadtzeitung pense, au contraire, que, sous la direc-
tion de
M. Wilbrandt,
le
Burgtheater travaille à sa renais-
sance, par l'amour désintéressé du vrai et du beau. Elle
admire l'ingénieuse et naturelle simplicité par laquelle ce
grand Français, mort
il
y
a
deux
siècles, sait
encore émou-
voir les cœurs blasés d'aujourd'hui.
La
accorde à M. Lev^^insky la dévode Tartuffe, et félicite M™^
Mitterwûrzer d'avoir réalisé dans Dorine Tidéal de
Ste-Beuve, qui a cru voir en elle le symbole de la robuste
Muse de PoqueHn.
Deutsche Zeitung
non
la sensualité
V Extrablatt
croit devoir
tion mais
MoHère (Mulier)
Le
Tagblatt dit
hasarder
que
la
Il
dit
que
la
!
première a été un peu froide.
un long
majestueuse
Enfin, le Fremdenhlatt consacre
tuffe.
calembour que
ce
ne « taceat in ecclesiâ »
grande
et
Tarperruque de
article à
Louis XIV a plané sur la soirée du 7 octobre. Comédiens
et comédiennes semblaient descendus des toiles d'Hyacinthe
Rigaud. L'impression a été profonde et sérieuse ; le
comique simple de l'impérissable et indestructible comédien psychologue a enlevé le public d'assaut.
(( Molière, dit-il,
a attaqué le plus redoutable guêpier en
écrivant son Tartuffe. Les bas-bleus, les misanthropes, les
parvenus, les cocus, qu'il avait copiés jusqu'alors, n'avaient
fait que divertir la masse de spectateurs ; car ici la pointe
du fouet ne
cinglait
que des minorités, aux dépens des-
quelles, d'après l'éternelle loi de nature, la majorité avait
permission de rire. Mais le Tartuffe répandit le trouble et
l'effroi dans cette majorité même; toute la société régnante
LE MOLIÈRISTE
256
moins directement atteinte. Tartuffe,
l'église ou du grand monde
c'était
donc aussi un peu l'Etat, la Cour, la Noblesse. Qui ne
mentait pas dans ce royaume rayonnant du mensonge?
Chacun croyait le mensonge d'autrui, afin qu'autrui crût
le sien. Canevas en vérité digne de l'Aristophane de la
sentit
plus ou
c'était le
bigot de
se
;
Perruque, et surtout d'un satirique de premier ordre,
joyeux du combat. Molière osa donc donner ce chevaleresque coup d'épée dans le guêpier. Il en sortit, bourdonnant, piquant, en fureur, des guêpes noires, des guêpes de
pourpre, des guêpes d'or et de soie, et toutes se ruèrent
sur l'audacieux perturbateur. Les guêpes noires furent les
plus enragées, parce qu'elles se sentirent mortellement
piquées, et elles entraînèrent toute la ruche contre l'agresseur. Mais le 12 mai 1664 fut le plus beau jour de
la vie de Molière; tous les rossignols de la gloire chantèrent ses louanges du haut des vieux arbres du parc de
Versailles ; ce soir-là, Molière fut le roi du monde. »
Et M.
D' Friedmann termine sur cette citation du
qui prouve que Vienne compte aussi ses
enthousiastes de Molière, et que M. Coquelin jouera
Gros-René, Mascarille, Pancrace, Sganarelle et Tartuffe
devant un public sympathique, initié aux beautés du Maître
par une critique sérieuse et éclairée.
le
FremdenbJait,
— Mercredi 25 octobre,
salle
Chaîne (rue d'Allemagne),
collaborateur de Lapommeraye devait faire une
conférence sur Molière^ au bénéfice de l'Orphelinat du
19'' arrondissement. Empêché par une indisposition, il a été
remplacé par M. le pasteur Dide, qui a improvisé un
éloquant éloge de celui « qui a porté si haut la dignité
notre
cueillies,
a dit
A
Tappui de ses paroles, chaleureusement acde la Comédie Française,
avec talent la première scène du Misanthrope.
de l'Art
».
M.
Caristie Martel,
MONDORGE.
Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
—
Noël Texier.
QUATRIÈME ANNÉE
DÉCEMBRE 1882
NUMÉRO 45
LE
MOLIÉRISTE
%EVUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
MM
:
Campardon, J. Claretie, F. Coppée, V. Fournel, J. Guillemot,
A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
J.
L01SELEUR
Ch.
L.
,
Nuitter
,
MoLAND
E.
Ch.
,
Picot
,
L.
Monselet,
de la
E.
Noël,
Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,
Dr H. ScHWEiTZER, Ed. Thierry, E. Thoinan, a. Vitu, etc.
PAR
Georges
MON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMEDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10,
GALERIE DU THEATRE FRANÇAIS, 10
1882
SOMMAIRE DU NUMÉRO XLV
QUATRIÈME ANNÉE
\/\A/\/\A/
—
LE CHASSEUR DES FACHEUX.
Aug.
LE PROCHAIN BANQUET-MOLIÈRE.
MOLIÈRE ET COTIN. — Un Provincial.
Vitu.
LA FARCE DES QUIOLARDS. — Eug. Noël.
UNE ERREUR A PROPOS DE MOLIÈRE. —
BIBLIOGRAPHIE.
— A.
BULLETIN THÉÂTRAL.
de Montaiglon
et
'
Blondet.
Du Monceau.
— Mondorge.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
français,
2, place
tions,
:
— ÉTRANGER,
UN FRANC
I3 FRANCS.
50 CENT.
à la librairie Tresse, io, Galerie
de Vintimille, auquel
demandes
lettre affranchie.
et
les
du Théâtre
M. G. Monval,
manuscrits, communica-
ou par mandat sur la poste adressé
à
réclamations devront être envoyés par
LE CHASSEUR DES FACHEUX
Marie-Renée de Longueil,
Boulenc de
Crevecœur,
de René
fille
marquis de Maisons, ministre
d'Etat,,
épousé,
avait
de Longueil
de Madeleine
et
le
24
23,
ou
25 février 1656^ Charles-Maximilien- Antoine de Bellefourière,
marquis de Soyecourt (on prononçait Saucourt), ma-
réchal de camp, chevalier des ordres du Roi, grand-maître
de
la
garde-robe du Roi, puis grand veneur de France.
Le marquis de Soyecourt
lière,
au moins par
la
romanesque qui obscurcit
Il
est sûr,
l'épître
appartient à l'histoire de
la vie
puisque MoHère
dédicatoire
que Sa Majesté
lui
de notre grand Comique.
le
elle-mesme,
la
et qui a esté
tel est le
un
bonté de
lui
trouvé par tout
ce
ou de
ses
ca-
ouvrir
le
plus
nouveau carac-
de Dorante. Le chasseur qui assomme
du, récit de sas exploits
cynégétique,
Fâcheux au Roi,
l'ordre « d'y adjouster
beau morceau de Touvrage »; et que
tère est celui
lui-même dans
raconte
de sa comédie des
donna
ractère de fascheux dont elle eut
les idées
Mo-
légende, c'est-à-dire par l'invention
les
gens
déconvenues en jargon
caractère indiqué par le Roi. Voilà la
26o
LE MOLIÉRISTE
contes en
n'a pas
simple. Elle
vérité toute
l'on a voulu
l'air, et
que
ses courtisans à la risée publique
))
que M. de Molière,
»
scène est
»
lui
dit
et voici
sujet,
première représentation de cette comédie qui se
M. Fouquet,
»
Soyecourt
»
encore copié.
»
Molière l'introduit sous
»
et apprise par les
»
heures, et
»
la
le
C'en
»
fut
assez
chez
fit
montrant M. de
lui
la figure
pas
où
Cette scène,
dit.
la
d'un chasseur, fut
faite
comédiens en moins de vingt-quatre
Roi eut
le plaisir
de
voir en sa place, à
la
représentation suivante de cette pièce. »
Tout sonne faux dans
gage du Roi, tutoyant
bouffonne
la
Molière en
Voilà un grand original que tu n'as
«
:
dit à
de
sortir
»
Roi
la
Roi lui-même qui
fut le
comment. Au
»
le
de
livré l'un
Le fascheux chasseur
Menagiana, introduit sur
le
M. de Soyecourt. Ce
donna ce
Roi eût
le
«
:
amateurs des
aux>
suffi
la
cette anecdote
comédien
le
:
et signalant à sa
personne d^un de ses grands
hauteur l'un de
l'autre.
Vaux
le
verve
sont à
officiers
Ce que nous en pouvons con-
trôler tout d'abord est d'ailleurs inexact.
jouée à
l'action et le lan-
La
mercredi 17 août i66r,
la
pièce avait
été,
seconde repré-
sentation ne fut donnée à Fontainebleau que le jeudi 25,
jour de la Saint-Louis, c'est-à-dire à huit jours et
non pas
à vingt-quatre heures de la première (i).
Qu'était-ce
donc que M. de Soyecourt
de Tallemant des Réaux
nous apprennent que
le
et les lettres
de
Les
historiettes
M™^ de Sévigné
marquis de Soyecourt, après avoir
été l'un des seigneurs les plus
[i) Registre
de
?
La Grange, page
36.
amoureux
et les plus
aimés
26 1
LE MOLIÈRISTE
de
le
la
cour de France^ passait, en sa maturité, pour l'iiomme
rapport entre un
ty'pe
à
du monde. Mais quel
plus spirituel et le plus distrait
homme
galant, spirituel et distrait, et le
MoHère
même
?
On
n'a pas assez
remarqué que Grimarest
n'admet pas l'anecdote
informé que M. Ménage de
scène fut
Molière
faite.
versification; car
n'}^
M. de MoHère
manière dont
a
aucune part
plaisir à la voir représenter,
Ce pauvre Grimarest
fois qu'il
la
n'est
que pour
personne, que
s'excusa
j'ai
des rai-
ont tâché de
et
(i)
Roi
le
en
prit
fit
vraiment pas chanceux; pour
la vérité,
Où
n'avez-vous pas lu que
charge de grand-veneur
tout.
France pour
-Cette
(i)
le
les
poète
était
charge qu'en 1670,
Vit de
M.
du
récit
de
le reje-
Voilà qui expliquerait
en
efiet l'ancien
le reste.
grand-veneur de
anecdotiers de 1694; mais
des fêtes
est
M. de Soyecourt rem?
Mais l'explication ne vaut pas mieux que
M. de Soyecourt
pour
le
lieu
ne
il
il
colorer par une inexactitude de
plissait la
plus.
plus
la
beaucoup de
y>
réclame en faveur de
le
un
dicta toute entière dans
Menagiana; mais, suivant leur méthode, au
ter, ils
la
il
chasse,
quelque chose de suspect dans
flairé
belle
cette
trouve plus que sourde oreille. Les modernes ont,
vrai,
lui-
mieux
dit-il,
l'ayant versifiée,
scène de ses Fâcheux,
une pauvre
« J'ai été^
ne connaissant point
sons de ne pas
jardin, et
:
la
De sorte qu'une
nommer, la lui
d'y travailler.
belle
XIV
du Fâcheux chasseur indiqué, dit-on, par Louis
il
ne
l'était
pas
de Vaux, n'ayant été pourvu de
neuf ans après
de Molière, 170Î,,
m-8,
p.
la
48 à jO.
première re-
202
LE MOLIÈRISTE
présentation des Fâcheux. C'est de quoi
fabricateur de
le
l'aventure ne s'est pas avisé (i).
Hiltons-nous d'ajouter que
ne remonte pas
cour pour
se trouve ni
dans
la
i*""
édition
1693, un vol. in-12), ni dans
la
in-12),
si
où l'abbé Faydit,
noyé
recueillis par
du Menagiana
la 3^, c'est-à-dire
l'indigeste auteur
Bouteville, sous
1694, 2 vol.
de
amis Galland, de Launay,
Mondin, Pinsson,
Baudelot,
un
(Paris,
Jéléma-
la
souvenirs authentiques de Ménage,
les
ses
peu digne de
(Amsterdam, 1693, un
des éditions amplifiées (Paris^
i''=
comanie, a
la 2^
seulement dans
vol. in-12). Elle apparaît
dans
rôle
et la
L'anecdote sur M. de Soyecourt
sa naturelle majesté. (2)
ne
monde
savait trop le
XIV un
jouer à Louis
faire
de ce canard
la responsabilité
Ménage, qui
à
fatras qu'il
Boivin,
Châtelain,
Valois,
Dubos
de Bautru et du prince de Guéménée, car
il
et
noms
couvre en vain des
porte à chaque
ligne la signature de son insipide auteur.
y a plus
Il
:
marquée de
l'étoile *,
:
On
y trouve en
Nuits,
parler
fait
effet,
Ménage,
à
des Mille
première
la
pas question de
Soyecourt
(i)
:
Mais, cher collaborateur,
devint
n'est-il
N'oublions pas que Louis
XIV
il
de
n'y
Ce
silence est
pas permis de penser que,
grand-veneur qu'en
grand chasseur devant l'Eternel dès 1661
(2)
Or
du chasseur ni de M. de
l'épisode
pas un mot, pas une allusion.
M. de Soyecourt ne
une
et
personne,
représentation des Fâcheux à la fête de Vaux.
est
page 38,
qui est la signature de Galland, une
dans laquelle l'ingénieux conteur
note
la
du Menagiana original prouve
la lecture
la fausseté de l'anecdote
1670,
il
si
pouvait être
?
avait alors vingt-deux ans.
G.
M
LE MOUÉKISTE
décisif.
Qu'on ne trouvât
Menagiana,
il
263
rien sur les Fâcheux dans le vrai
n'y aurait eu nulle conséquence à tirer d'une
absence de souvenir ou d'un
que Ménage parle de
la fête
manque de mémoire. Mais
de Vaux, du prologue de Pel-
lisson et de la pièce de Molière, et
ment
l'incident le plus
représentation, c'est, à
qu'il
remarquable qui
mes yeux,
la
omette précisé-
se rattachât à cette
preuve
plus
la
dente que l'anecdote est de pure invention. Ainsi
lui-même
sort de son
tombeau pour
réfuter les
évi-
Ménage
commérages
de l'abbé Faydit (i).
Auguste VITU.
LE BANQUET-MOLIÈRE
Notre troisième banquet annuel aura
lieu
le
lundi
15
janvier 1883, au Palais-Royal.
Nos collaborateurs, nos abonnés, nos
hommes de lettres et artistes, sont
amis,
faire
La
parvenir leurs adhésions avant
le
lecteurs,
nos
priés de
nous
31 décembre.
cotisation est fixée à dix francs.
G.
(i)
M. de Soyecourt mourut
à Paris le 12 juillet 1679.
d'abord aux Grands-Augustins, puis transporte dans
chapelle de Tilleloy, en Picardie.
le
M.
inhumé
chœur de la
Il fut
MOLIÈRE ET COTIN
A
Monsieur B. Marnicouche.
Monsieur,
Je m'empresse de vous remercier de Tappui que vous
voulez bien
me
donner dans mes protestations contre
bus des hypothèses que
le bibliophile
Le
je
l'a-
reproche à notre cher doyen
Jacob.
Bibliophile ayant dit
:
« Il est à
présumer que l'abbé
Cotin n'avait pas ménagé Molière dans un des sermons
qui attiraient en
foule la société précieuse et
gens de courï), nous
seul des
Vous
lui
avons demandé
sermons de Cotin qui
faites très-justement
remarquer que
J'avais
notre
:
des
de nous citer un
Molière. »
fasse allusion à
Cotin n'ont jamais été imprimés
teur n'en parlait
«
l'élite
les
sermons de
cher
collabora-
donc que par hypothèse.
demandé
aussi
qu'on
me
fît
attaque bien authentique de Cotin,
connaître une seule
non contre
les
comé-
diens en général, mais contre Molière personnellement.
Vous me
citez la satire
intitulée
:
Despréaux ou la Satyre
(i)Voir ci-dessus, p. 113, 157, 179, 215
et 246.
265
LE MOLIÉRISTE
et attribuée à l'abbé Cotin,
imprimée en 1666,
des satyres,
qui contient douze pages de vers médiocres contre
préaux,
Molière.
—
Tricotel
je
;
Puymorin,
son frère Boileau
contre
J'avais
lu
cette
connaissais le
satire
dans
les
cité
de
passage
Molière et aussi les commentaires
sur le
Descontre
et
Variétés
de
la Valise de
^pas
ridicule
de
satire
:
tout cela ne m'avait pas touché.
me
vous
Si
prouvez
Cotin est fondée
vez
si,
;
ne
la
l'attribution
trouve, ni dans Tabbé d'Olivet,
Moréri, citée parmi les ouvrages de Cotin),
provoqué
Mais
il
la
monde, heureux
suis bien
la
meil-
d'être renseigné et d'avoir
découverte d'une vérité.
Pour moi,
je le nie, et
vous donnerai
les
motifs de
ma
dénégation. D'abord,
à Molière, dans le passage cité par le
Ensuite, la satire en question
Despréaux
;
elle
m'en
pour avancer,
précisément à l'époque ou Cotin
satire parut
l'auteur de
soit
pourrais
je
en attendant vos preuves. Mais,
et
ni dans
appartient à l'accusateur de justifier l'accusation.
cette satire.
Molière
je
rendrai de
les
Prouvez moi donc d'abord que Cotin
nir là
à
dans quelque catalogue contempo-
forcé de rendre les armes, et je
leure grâce du
la
à la suite de la Ménagerie vous trou-
la Satire des satires
rain (on
que
un
frère
je
la
criait vivat
Moliériste, p.
n'attaque
attaque
te-
!
158.
pas seulement
de Despréaux,
un Turlupin, qui
Jouant de son nez
Chez
Il
le sot
n'est pas
campagnard gagne de bons
disnez.
du tout prouvé que Cotin, ami de
Gilles
266
LE MOLIÉRISTH
ennemi de Boileau Puymorin,
Boileau, fût
désigné
Enfin,
ici.
comment
Cotin, qui,
à la
raître la Ménagerie, dirigée contre
à Despréauxj
comme on
« sans raison »
De
de
tout cela
la satire
du
le fait
je
même
Ménage,
dans
précisément Ménage
conclus que Cotin
la
date, fait pa-
reprocherait-il
satire,
d'attaquer
?
n'est point
qui lui a été attribuée, longtemps,
après sa mort, et
certaine
qui est
celui
je persiste
contraire^
à soutenir,
— que Cotin
—-
l'auteur
je
crois,
jusqu'à preuve
n'avait pas provoqué,
par des attaques directes, les coups de Molière
;
je
vous
remercie, Monsieur, de m'avoir fourni cette occasion de
maintenir
5
mon
affirmation.
novembre 1882
UN PROVINCIAL.
LA FARCE DES QUIOLARDS
ET LE BOURGEOIS GENTILHOMME
La Farce
appeler de
des Quiolards, voilà
la
littérature locale, locale
pour Rouen, mais pour
tier
certainement ce qu'on peut
non pas seulement
le quartier Saint- Vivien et le
quar-
Saint-Nicaise, où plus qu'en tout autre quartier de la
ville^ s'était
c'est-à-dire
conservé, au
le
XVIP
siècle, le
langage purin,
vieux français agrémenté de
la
prononcia-
tion traînante et chantante particulière au pays
de Cor-
neille.
La Farce
tait
qu'un
tient à
M.
des Quiolards est
très petit
nombre
une comédie dont
notre Bibliothèque Leber, mais que
Jules Adeline ont eu la
l'accompagnant de
il
n'exis-
d'exemplaires, dont un appar-
M. Auge
et
bonne idée de réimprimer,, en
dix johes eaux-fortes
et
d'une intro-
duction très intéressante. Les eaux- fortes et l'introduction sont, bien
entendu, de M. Jules Adeline. Rarement
bibliophiles ont fait
pour leurs réimpressions un plus heu-
reux choix. La Farce des Quiolards a son importance dans
notre histoire
littéraire,
et c'est,
de plus, une œuvre fort
amusante. Nous allons essayer de mettre en évidence ces
deux points.
La rédaction de
cette
comédie,
telle
qu'elle fut impri-
LE MOLIÉRISTK
268
mée à
l^ouen,
Jean Oursel l'ainé, rue Ecuyêre, vis-à-vis
che^^
la rue du Petit-Puits, à l'enseigne de
deuxième moitié du
la
M.
J.
Adeline de
imprimerie du Levant
l'
y
remonte certainement pas plus haut que
avec permission^ ne
XVIP
façon
la
siècle, et c'est
ce qu'établit
plus incontestable; mais
la
le
scénario de la Farce doit remonter à une époque beaucoup
plus reculée.
Cette farce,
lin,
''et
de
ses
comme
du Vilain Mire, dont Molière
lui,
comme
tant d'autres,
celles
de Tate-
Femme Muette, jouée à Montpellier par Rabelais
compagnons de l'Ecole de médecine, comme celle
la
comme
dans sa jeunesse
a fait
il
son Médecin malgré
avait tiré, d'un autre scé-
nario fort en vogue, sa petite pièce du Médecin volant; les
mêmes
données,
bout de
la
temps,
les
les
France à
mêmes
l'autre, et,
retrouvaient d'un
selon les lieux, selon les
troupes comiques ambulantes
interprétaient chacune
lecte local.
Le
à
lire).
Le plan
on n'en
donnait lieu à mille
les
dia-
écrivait rien (les
en ce temps-là, savaient
seul de la pièce, en ses princi-
pales scellés, devait être respecté
laissé à la fantaisie des
ou locales
chacune en son
sa façon,
plus -souvent,
écrire eût été inutile, les acteurs,
rarement
se
sujets
artistes.
saillies,
;
mais
le
dialogue était
Cette liberté du dialogue
à mille jeux de scène inat-
tendus. Chaque pièce donc se jouait avec des variantes infinies,
grande
qui faisaient
souvent
le
principal attrait et la plus
joie des spectateurs.
La nïème
pièce n'était pas
chose. Quelqu'un, à Rouen,
gina d'écrire et
telle- qu'elle
fut
même
il
ainsi
toujours
la
même
y a deux cents ans, s'ima-
d'imprimer
la
Farce des .Qtiiolards
jouée alors probablement sur
quelque
26^
LE MOLIÉRISTE
du quartier Saint-Vivien, dan^
théâtre
tants de ce quartier ; mais la
jour se retrouver dans la
d'un autre temps,
même
la
pièce pourrait quelque
langue d'une autre province et
n'avait pas été
s'il
langue des habi-
si
rare alors qu'on
prît le souci de rédiger ces sortes de farces. Ecrire coûtait,
si
le vélin
cher! n'avait pas qui voulait
le scribe
indispensable
;
à sa disposition^
ni,
absorbaient
église. et tribunaujc les
tous.
Quoi
en
qu'il
lement rédigée,
soit, la
elle fut
Farce des Quiolards ne fut pas seu-
imprimée,
devenus d'une extrême rareté
que nous l'avons
ainsi
c'est d'après cet
son édition
Rien
dit,
à
exemplaires en sont
et les
en existe un cependant,
il
;
bibliothèque Leber,
la
M. Adeline
exemplaire que
et
vient de faire
illustrée.
n'est plus curieux, pîus intéressant
que tout ce quj
rappelle ce vieil art dramatique, ce vieil art gaulois de la
Farce,
si
cher à nos ancêtres.
Les Rouennais âgés, dont
souvenir peut remonter
le
jusqu'au Théâtre-des-Qimtre-Colonms, se rappellent parfaite-
ment que son
très illustre directeur Gringalet,
parade toujours réjouissante,
gramme du
spectacle, qui
une analyse de
tait la
la
pièce nouvelle
formule d'usage
;
de
:
le
Vous
même, en
Vous
la
le
pro-
plus souvent, en
alle-^ voir...
tête
primée, l'ancien éditeur nous analyse
lards
au pubhc
détaillait
consistait,
après une
de
la
C'é-
pièce im-
Farce des Quio-
:
allei voir
Nicodème Laquiole
et
quels veulent paraître d'une condition
de savetier, où
ils
viennent d'hériter.
une Cattelotte, sa femme,
les-
mille fois plus relevée que celle
ont pris naissance, à cause de
cettt;
et
un ^5,
qu'ils
LE MOLIERISTE
270
Vous y
verrez aussi ufi fripier, qui leur
personnes de qualité pour
De
Le
plus,
vous y verrez,
etc.
ne leur vend pas seulement de beaux habits,
fripier
leur apprend à les bien porter, leur
il
contenance,
les
que savetier
et
appelle
M.
donne des leçons de
et M""* de
La Quiole,
savetière finissent par
més véritablement en gens de
d'être citée
se croire
qualité.
bien
si
transfor-
La scène mérite
:
MONSIEUR JUIF
Madame, pendant que vous
allez
(le fripier).
vous habiller,
je
gens de qualité à monsieur votre époux
l'exercice des
de
les dépouilles
présente
les revêtir
;
vais faire
il
faire
est nécessaire
qu'il le sache.
CATTELOTTE.
Ecoute bien monsieur
Juif,
Nicodème.
MONSIEUR JUIF (parlant à Laquiole).
Monsieur,
faites
quatre pas à droite, autour de la table, et
gauche à votre rencontre, pour vous apprendre
un honnête homme, ou qui que ce
LA
Monsieur, de tout
bien
la
Marchez à moi
soit.
j'irai
à
manière de saluer
ainsi.
Q.UIOLE.
mon cœur;
je
vote valet.
suis
Vo
porté vou
?
MONSIEUR
Monsieur,
Monsieur,
il
JUIF.
faut quitter ce langage grossier. Dites,
je suis ravi
de votre rencontre
;
Mais toutefois, vous apprendrez assez bien à parler pat
des savants
;
c'est assez
que d'en savoir
s'il
comment vous
la
vous
plaît
:
portez-vous ?
fréquentation
faire les gestes,
LA QUIOLE.
Monsieur, monsieur,
me
vaie.
je
ne veux pâler à personne
;
chest asset que
no
27
LE MOLIERISTE
MONSIEUR
Apprenons donc
C'est bien dit.
JUIF.
le
tour de votre table et venez à
gauche,
et
de votre main droite
le bras
la tête vers
dehors
et
la
moi
jetez tantôt
côté de
madame
leçon à
la
marchez,
je
vous
prie, à la
:
n'avez pas votre éventail
?
Puisqu'ainsi
gauche de monsieur votre époux
votre servante après, avec son habit de
fille
suivante. Mais quoi
réflexion se place tout naturellement
furètent,
a
en quête des sources probables
et
ont oublié
:
ils
celle-ci, faute d'avoir
n'eussent pas
manqué
ici.
Les com-
connu
la
d'une
le
ses
comédies,
Farce des Quio-
leçon
donnée à
maître de danse n'est-elle pas née
réminiscence de
Quiole par
effet,
le
flairent,
d'établir qu'il lui dût l'idée
première du Bourgeois gentilhomme. La
M. Jourdain par
et
vous
improbables où
pu puiser quelques-unes des scènes de
lards
!
?
mentateurs de Molière, qui toujours cherchent,
il
un
gauche, ramenez-la devant. Tournez vos pieds en
Quoi, madame, vous voilà déjà dans vos habillements
Une
chapeau
un
vous appuyez gravement sur votre canne....
Vient ensuite
est,
le
puis, retournant
votre perruque derrière le dos, tantôt de l'autre,
peu
des gens
les perfections extérieures
de qualité. Achevez
sous
I
la
leçon
donnée à M. de
La
vraisemblable, en
fripier Juif? N'est-il pas
que durant ses deux séjours à Rouen, Molière
vit
représenter la farce en question sur quelqu'un de nos petits
théâtres locaux
;
on
sait qu'il
ne négligeait rien de ce
qui touchait à son art et que partout
s'instruire et à puiser
Est-il nécessaire
pour
il
savait trouver à
ses propres pièces.
de rappeler
comment
finit la farce ?
Les
cent et un écus hérités de la tante ne tardent pas à dispa-
^^ MOLIÈRISTE
2^2
raître, et
La Quiole reprend en chantant
« sa
pauvre cha-
vate. »
Tout me
Couler
En
n'héritage
comme
j'ai
vu
beurre fondu,
bien moins de temps que j'en pâle.
Je n'ai
pu qu'un vieux paillasson,
Pour me coucher tou de
Anchite qu'un viau qui
Il
mon
Ion,
s'étale.
commentateurs des
n'est pas jusqu'aux
fables de
La
subitement
Fontaine qui, dans ce savetier, devenu riche
et
d'origine à
subitement ruiné, ne puissent trouver un point
d'âge en
suivant
et du Financier. En
la fable
du Savetier
travers notre
âge jusqu'à nos jours l'esprit gaulois à
un dernier
pas
pourquoi même ne verrait-on
rature,
de
la
litté-
reflet
écus, dans
Quiole, avec son héritage de cent et un
la très
joUe chanson de Béranger
:
je suis héritier.
Grâce à Dieu,
Le métier
De
Me
rentier
plait et
Travailler serait
m'enchante
J'ai
cinquante écus,
J'ai
cinquante écus,
J'ai
cinquante écus
De
Mes amis,
rente.
la terre est
J'ai
Vivre en
J'ai
à moi,
de quoi
roi,
me tente
me sont dévolus,
Si l'éclat
Les honneurs
;
un abus.
;
cinquante écus, etc.
LE MOLIÊRISTE
273
mes amours,
Des atours
Parez-vous, Lise,
Que
La
toujours
richesse invente;
Le clinquant ne vous convient
J'ai
N'est-ce pas là
Eh
bien
!
plus,
cinquante écus, etc.
un ressouvenir du pauvre
savetier ?
non, cette histoire du savetier enrichi, trans-
formé par Molière en marchand de drap tranchant
grand seigneur, apprenant
sant faire
siècle
Mamamouchi,
en
purement
siècle,
l'ont
livresque,
les
manières
belles
pour ceux
cette histoire,
reprise,
comme
Montaigne,
la
Quiole, de
tous les enrichis, de tous les
gestes
nous re-
M. Jourdain
parvenus qui
», suivant la vieille expression
une
c'est
imitation de la vie réelle qui, perpétuellement;,
donne ce spectacle de
qui, de
pas une imitation
n'est
dirait
du
et se lais-
«
et
de
des
font
Dans
normande.
tous les cas, c'est une très bonne idée que d'avoir remis
au jour, en
l'illustrant
line, la vieille
de rire les
comme
vient de le faire
Farce rouennaise qui,
si
souvent,
M.
J.
Ade-
fit s'esclaffer
Rouennais du temps de Corneille;
qui,
sans
doute, égaya Corneille lui-même, et dont, après tout,
n'est pas possible
mière pour
le
de dire qu'elle ne fut pas un
futur auteur
trait
il
de lu-
du Bourgeois Gentilhomme.
Eugène NOËL.
18
UNE ERREUR A PROPOS DE MOLIÈRE
M.
Sarcey,
dans
Femme
la
affirmé
à diverses
qui
reprises,
tue
ses propres idées sur l'éducation
qui
erronées,
tions
à
de
réfuter. M'attaquer,
la
des
Molière.
moi inconnu,
femmes. Ces
MM.
A.
asser-
sont
une
de
les
J'entreprends
à
ont
vote,
bouche de Chxysale,
peu à peu,
s'accréditent
gloire
la
Dumas,
M. A.
femme gui
la
et
que Molière exprimait^ par
atteinte
et
Dumas
et
Sarcey qui ont étudié Molière à fond, et dont l'opinion
fait autorité,
c'est
une grande audace,
assurément.
Mais,
mon
insuf-
certain d'avoir raison, je n'hésite pas, malgré
fisance
comme
Voici
la
écrivain.
la postérité a ratifié les idées
des
femmes
encore à
l'épais
de
?
La
le
Est-ce que
sur
l'éducation
bon sens de Chrysale, qui veut que leur
thèse
venu à
serait-on bien
sous
MoHère
«
:
que nous en sommes aujourd'hui
Est-ce
?
capacité se hausse à distinguer
pourpoint
M. Sarcey
dernière critique de
un haut-de-chausses d'un
nous agace^
et
dire que, grâce à l'autorité
couvert duquel
elle se présentait, elle a
contribué
à perpétuer chez nous des préjugés fâcheux sur
des femmes.
même
du nom
peut-être
le
rôle
»
Ainsi, selon
M.
Sarcey^
si
beaucoup de gens croient
LE MOLIÉRISTE
que
femme
la
mêmes
mêmes
n'a pas les
que, par conséquent,
et
études que
l'homme
aptitudes que
ne doit pas s'adonner aux
elle
faute
la
lui,
275
en grande partie à
est
Molière.
Voici
M. A. Dumas
de
la critique
pour Molière, mais Chrysale a
dément que son
mieux
esprit a
ne borne plus son étude à
de ses enfants^ à
que de
à faire
déci-
hausser
se
mœurs
pot
le
l'esprit
dont son
raison bien simple qu'elle perdait
la
ménage qui ne
sa jeunesse à attendre le
ne pouvait ni surveiller
moyen
elle
son ménage, à avoir
faire aller
comment va
savoir
mari a besoin, par
prit
suis désolé
femme trouve
la
former aux bonnes
l'œil sur ses gens^ à
pas le
:
un pourpoint d'avec un haut-de-chausses;
à connaître
qu'elle
tort
« J'en
:
venait pas,
et
gens qu'elle n'avait
les
bonnes mœurs
d'avoir, ni former aux
l'es-
des enfants qu'aucun mari ne songeait à lui donner. »
M. A. Dumas,
nombre de femmes n'ont pas trouvé de maris, c'est
Voilà qui est fort spirituel. Ainsi, selon
si
parce
qu'elles
Molière. Les
marier en
sciences
Eh
?
s'
avaient
femmes
élevées
selon
adonnant aux
arts,
à
la
littérature
un
homme
produit, doivent
de juste-milieu
donc
être
;
fait
ses
à
beau-frère
etc.
aux
et
faux.
idées,
d'Orgon
Or, Philaminte
et
;
dans
le
Mo-
lorsqu'il
exprimées par des person-
nages d'un tempérament moyen. Dans Tartuffe,
le
de
idées
les
Je le souhaite sans l'espérer.
bien, ces critiques portent tout à
lière est
les
été
trouveront-elles plus facilement à se
c'est
par
Misanthrope, par Philintc,
Chrysale étant deux extrêmes,
idées de Molière sur l'éducation des
femmes ne
pas plus être celles de l'un que celles de l'autre.
les
peuvent
276
LE MOLléRISTE
Elles sont exprimées par
l'amant d'Henriette.
les
....
De
dit
un personnage modéré,
je
ne
femme
ait des clartés de tout,
veux point
lui
la
passion choquante
se rendre savante afin d'être savante.
Telles sont les idées de Molière.
de Chrysale,
qui
femmes
comme
conséquent, est proposée
fille
S'il avait
les idées
exaltées
au besoin
sement aux exagérations de
sa
On
sœur.
au-dessus de
par
elle a l'esprit alerte,
et riposte
charmant de femme, ce type, qui a
est fort
et qui,
modèle. Or, cette jeune
n'a pas simplement du bon sens^
elle est fort spirituelle
l'auteur,
eu
n'aurait pas créé cette aimable Henriette,
il
contraste avec ces
fait
par^
:
femmes docteurs ne sont point de mon goût.
Je consens qu'une
Mais
Il
celui
le
les
très malicieuvoit, ce type
préférences de
que préconise Chry-
sale.
L'erreur de
MM.
Sarcey
Dumas m'étonne
A.
et
au
plus haut degré.
Comment deux
de
l'art
écrivains qui possèdent à fond les règles
dramatique, qui savent, par
conséquent,
que
le
caractère de Chrysale est voulu par la plus élémentaire de
ces règles, par la règle
des contrastes
n'ont-ils pas conclu que,
la contre-partie
blâme
même
blâme
les
comment,
dis-je,
de
la
femme, Molière
exagérations de Chrysale parcela
et ridiculise celles
Je consens qu'une
;
exagérations du mari étant
des exagérations
et ridicuHse
qu'il
les
femme
Oui, Molière veut bien
ait
de Philaminte
?
des clartés de tout.
qu'une
femme
s'instruise,
à
LE MOLIERISTE
que ces
;ondition toutefois
:heront pas
Il
le
me
femme de
la
qu'il dit
Qu'une femme en
Mais^ à quoi bon
[Chrysale
"éussi
;
de tout
clartés
»
n'empê-
bien tenir son ménage.
de démontrer que Chrysale lui-même
serait facile
pense pas ce
«
277
?
ne sont pas
J'ai
quand
sait
il
prétend
toujours assez, etc.
voulu prouver que
celles
de Molière
;
les
je crois
idées de
y avoir
cela suffit.
BLONDET.
Cet
\ois,
article
répond en partie à
M"''
Marie Châteaumi-
qui a publié une étude sur V Education des feînmes au
XVII^
siècle et
itléraire
du
5
^"®
de Scudery, dans la Revue politique
août dernier.
G. M.
et
BIBLIOGRAPHIE
Lz Bibliographie Moliéresque^ n° ^j6,
turques
traductions
trois
ancien
ambassadeur en
France
2oé-8, a indiqué
p.
Ahmed Véfyk
par
du Mariage
:
Médecin malgré lui et de George Dandin,
curieuse notice que
née dans
la
M.
Barbier de
5
novembre 1882,
Asie-Mineure^
parlant des
il
du
forcé,
réimprimé
et
Meynard en
avait
la
don-
Revue critique (XV, 1874, p. 73.)
Le docteur G. Daremberg, dans un
Débats du
Efendi,
article
:
Une
complète ces premières
distractions
continue ainsi
intitulé
:
«
que
Et puis
le
il
des
d'eaux en
indications.
En
y peut trouver,
touriste
le soir
du Journal
ville
pourra
aller
au théâ-
« tre, fondé par le Bienfaiteur de la ville de Brousse, S. Ex.
((
Ahmed
« Il
Véfik Pacha, qui parle
le
français
à merveille.
a traduit en turc toutes les pièces de Molière et les
« fait représenter sur le théâtre
de Brousse.
Même
quand on
amusant de voir M. Jour-
«
n'entend pas
«
dain au milieu de vrais Ottomans, ou d'entendre débi-
« ter le
le
turc,
il
est
sonnet d'Oronte dans
la
langue du Coran. »
Ainsi tout Molière est traduit en turc. Mais, d'après
Barbier de Meynard, le traducteur l'arrange à
serait bien curieux d'avoir la traduction
au moins de ces imitations
voir en France
un
;
elle
la
Il
de quelques-unes
ne manquerait pas
vrai succès de curiosité.
Anatole de
M.
turque.
MONTAIGLON.
d'a-
LE MOUERISTE
279
La maison mortuaire de Molière
d'imprimer
puis
si
le
donc en parler plus
Au premier
seur du livre
on
478 pages
est
un peu
petit texte
Ion, Ed. Fournier, Soulié et Jal
surpris de la gros-
compact sur
Les 400 autres
appendice non mentionné sur
de Richelieu^
Non,
?
la seule
B. Fil-
dit Beffara,
est
le titre
trom-
ne répondant qu'aux 78 pre-
peur ou plutôt incomplet,
mières pages.
l'édi-
tôt.
abord^
:
de-
Nous ne pouvions
4 novembre.
le
maison mortuaire, après ce qu'en ont
la rue
Achevé
longtemps attendu, n'a été mis en vente par
Lemerre que
teur
—
(i).
i" octobre dernier, ce beau volume,
représentent
couverture
la
curieux
le
Y Histoire de
:
maison par maison, depuis Louis XIII
jusqu'à nos jours, résultat de patientes recherches qui ont
permis à M. Auguste Vitu de multiplier
détruire le
moindre doute dans
Cet appendice contient
tête
de
la
aux moliéristes
:
preuves
la
très
les
Comédie
et
de
lecteur.
de dix notices qui
Nous publions en
présente livraison celle qui concerne
Nous
n° 85 occupée par les Soyecourt.
Vitu sur
du
l'esprit
d'ailleurs plus
Thistoire de Molière.
se rattachent à
les
la
maison
signalerons encore
ingénieuses observations de
française (n°* 2 à 6)
;
le
M.
surinten-
dant général des bâtiments du Roi, M. de Ratabon (maison
n° 10)
Paume
posée
;
les Dionis^
dont l'un
des Mestayers (n° 32)
la fausse
fut
;
la
propriétaire
du Jeu-dc-
maison Hulot où
plaque de i844(n° 34);
le
reste
musicien dan-
seur Louis de Mollier et les peintres Corneille (n° 36);
(i)
In-8 imprimé par Unsinger, avec plans
res à 25 fr.; 15 sur
Japon
:
50
fr.
et dessins,
soo exemplai-
280
LE MOLlèRISTE
Marsy, sculpteurs du Roi, voisins de Molière
les frères
(n"
38); M. de Montmort (n" 48);
Mignard
cault (n° 21); P.
de Feuquières (n"' 23
M. Gaboury
S.
Molière n° 37)
M. Vitu
;
et sa
23 bis)
et
ce
La
garde-meubles de
(n° 39)
;
la fontaine
à
page 174, cette note manuscrite
la
petit plan
du
fief
Popin
:
de rouge indique l'emplacement
partie entourée
exact de la maison dont Baudelet, tailleur de la Reine,
« était propriétaire
« rut le
«
Fou-
conseiller
Pierre et Jeanne Levé (n° 104), etc., etc.
cite,
d'Edouard Fournier sur un
tt
les
;
Donneau de Vizé
et
le
Catherine, comtesse
fille
depuis
février
17
ans,
quand Molière y mou-
Cette
maison, dédoublée en
1 5
1673.
1705, est aujourd'hui remplacée par celles qui portent
« les n°* 38 et 40, et qui font face à la rue Villedot. »
Cette
qui n'est pas datée, remonte à près de dix
note,,
années. C'est en mai
1873 qu'Ed. Fournier
la
pour notre directeur G. Monval, qui organisait
foyer de
Ventadour,
la salle
le
il
la
taire
en
y a dix
Que
fait
ans,
Ed. Fournier, qu'une erreur de
titres
lui.
il
que
juste
se convertissait
La démarche élémen-
un immeuble
:
laissé,
a repris le travail là
il
l'a
prendre
de dire que^
où son
conduit à bien, et son
restera certainement attaché à
n'esi
42,
de propriété. La mort est venue
M. Vitu
prédécesseur l'avait
nom
n"*
lui restait-il à faire ?
de recherches sur
connaissance des
trop tôt pour
une série de
main d'Ed. Fournier^ dont
métrage avait conduit d'abord au
au n° 40.
au
que possède aujourd'hui M. Vitu.
le petit carnet
Donc,
annotés de
alors,
musée-Molière du Jubilé
bi-centenaire, et qui exposa sous vitrine toute
livres spéciaux
rédigea
si
la
découverte.
M. Vitu
est
Mais
l'Améric
.
LE MOLIERISTE
Vespuce de
en a été
la vraie
251
maison mortuaire, M. Ed. Fournier
Christophe Colomb.
le
En fermant
ce livre
ne pouvons nous
si
consciencieux et
d'un index alphabétique,
l'absence
nous
exacte
si
défendre de formuler un regret sur
guide
indispensable
dans un pareil arsenal de documents bourrés de dates et
Que
de noms.
de richesses pour ainsi dire perdues, faute
d'un inventaire,
même sommaire
!
Espérons que l'ém-inent érudit tiendra compte de notre
légitime désir dans les ouvrages qu'il
de
paume
les et
des Mestayers,
Jeu
le
maison des Pilhers des Hal-
la
MoHère,
théâtres de
les
prépare sur
qui doivent compléter
et
son intéressant musée d'archéologie moliéresque.
— Brindeau. — M. G. d'Heylli vient de pubHer,
brairie Tresse,
une notice biographique sur
sociétaire, retiré depuis
Edouard
Comédie
début,
1854
Brindeau
française,
et
il
le 9
avait
cependant
le
saluer
de Valère {Tartuffe
:
nous pouvons
d'un dernier adieu, grâce aux rôles
ici
et
la
Femmes savantes
Tacteur de Musset
fut surtout
à
son deuxième
effectué
21 mai 1842, dans Clitandre des
le
Brindeau
mars dernier.
douze ans
appartenu
avait
où
décédé
à la H-
ancien
cet
VAvare), de Don Carlos (Don Juan),
enfin d'Alceste (4 juillet 1852), qu'il rejoua à sa représentation de retraite (26 février 1859).
La notice de M. d'HeyUi
est
précédée d'un beau portrait
à l'eau-forte gravé par Lalauze.
— Le
2^
Molière-Mol A.ND.
édition des
paraître.
Œuvres
— Les
tomes FV
complètes de Molière
et
V
de
la
viennent de
Les deux suivants ne tarderont pas à être
rais
en
LE MOLIÊRISTE
282
vente
;
il
semble que
de vitesse
le
frères Garnier veuillent
les
Leur tome IV comprend
comme
de Venise, 1661,
;
le
:
texte italien des Gelosie
Rodrigo de Cicognini, d'après l'édition
fortiinalc del principe
Navarre
gagner
Molière-Hachette.
appendice
Don Garde
de
de
V Ecole des Fem-
VEcole des Maris, les Fâcheux,
mes suivie des Stances de Boileau et d'un extrait des Noudes pensions
Liste
velles nouvelles ; la
somme
1000
de
Le tome
pour
V
de
Remerciement au Roi et la
et surtout ce
Femmes du
obtenu jusqu'ici
—
Querelle de l'Ecole
la «
du Peintre
de l'Ecole des
je
»
ne
ment accompagné de
Y Impromptu de
la
Amours
Zélinde,
rarissime Tanégyrique
pourquoi
sais
ses
l'hôtel de
:
gazetier Robinet, qui n'avait pas
—
honneurs
les
d'une réimpression. L'Impromptu de Versailles
les
est
égale-
compléments indispensables
Coudé
^
la
de Calotin, la Lettre sur
lide,
l'Ile
ballet et
comme
au miUeu des
Marquis,
du
théâtre et
les affaires
comédie. Enfin
Festes de
enchantée, est suivie
:
Vengeance des
Guerre Comique. Le Mariage forcé y figure deux
comme
la
s'ouvre par trois documents du plus haut in-
l'histoire
le Portrait
le
« le
pour
figure
»,
Femmes.
Critique de VEcole des
térêt
—
livres;
pour 1663, où
comique
sieur Molière, excellent poète
Versailles
la
et
fois,
Princesse d'E-
des Plaisirs de
de l'intéressante relation attribuée
à Marigny.
Chaque pièce
est
accompagnée d'une gravure de ce
pauvre Staal, qui vient de mourir un peu oublié.
— Les
comédiens italiens a la cour de France sous
Charles IX, Henry
III,
Henry IV et Louis
XIII.
— Ce
LE MOLIÈRISTE
que M. Armand Baschet vient
très intéressant ouvrage,
de publier chez Pion
documents
que parce
» tirés
« d'après les lettres royales et autres
des archives d'Italie, ne nous appartient
prologue d'une Histoire
qu'il est le
précieux
les
Comédiens
des
Molière qui utilisera, en les
italiens contemporains de
plétant,
283
com-
documents déjà publiés par notre
Campardon.
collaborateur E.
Nous attendons impatiemment
permettra
de
travaux de
M. Armand
parler
— Paris sous
cette
qui nous
suite_,
développement des
quelque
avec
Baschet.
Louis XIV.
— Nous
ne pouvons passer
sous silence ce beau volume in-4' publié par l'éditeur Laplace avec
un goût
et
une conscience au-dessus de tout
éloge, et dont le texte est de
Paris sous Louis
XIV,
c'est
plupart
la
à quelque
C'est Saint-Eustache, d'où
jean-Baptiste
;
c'est la
de Clermont, où
;
c'est la
de
le Paris
Mo-
est
de
épisode
sorti
avec
le
plus loin,
et,
;
Louvre
puis le
Ici,
une
toujours
fait
;
le Palais
petite erreur
dit-il
Royal
de M. Maquet,
à la page 85 ».
Or
:
après
le
de
collège
Téil
et l'Hôtel
et la salle
«
vie.
nom
le
Nesle, au pied de laquelle
Bourbon, ce dernier bientôt démoli pour
Petit-Bourbon,
sa
a épelé la langue de Plaute et de
il
Tour de
à la colonnade (i)
(i)
il
Sorbonne
fondé son Illustre Théâtre
Petit
pour nous
avec ses plans, ses vues, ses monuments, qui se rat-
lière^
tachent pour
rence
M. Auguste Maquet.
a
du
faire place
de Mirame
mauvais
succès
du
lesTrécieuses et ïeCocu avaient
de brillantes chambrées quand Molière fut subitement
chassé de son théâtre par les démolisseurs au service de
M. de Ratabon.
LH MOLlèRISTE
284
OÙ Louis
XIV
établit définitivement la
qui va bientôt devenir
rois,
illustrera
sienne;
la
du mariage
l'église
;
le
troupe de Monsieur
Saint-Germain-l'Auxer-
Val-de-Grâce, dont Molière
dôme dans son beau poëme
le
Saint-Paul, où
il
à
Mignard
;
enterrera Madeleine Béjart, qui le pré-
cède d'un an dans
tombe. J'en passe,
la
et le
Pont-Neuf
où, tout enfant, Molière a flâné devant quelque parade
tabarinique et bouquiné par tous les temps, et
où
le
le
Châtelet
jeune directeur fut enfermé pour une dette de
sa
troupe.
Feuilletons
donc ce beau volume où tout nous parle de son
temps, jusqu'aux frontispices, attributs, culs de lampe, chiffres et lettres
ornées d'après Sébastien Leclerc, Lepautre,,
monneau, Audran.
C'est
un
très agréable
parcourt encore utilement après
de Paris à travers
chapitre détaché.
âges^
les
A la
fois
Si-
panorama qu'on
magnifique publication
la
dont ce
comme un
est
livre
document sérieux
et fort
beau
volume d'étrennes.
— Nous signalons aux
lumes
in-8°,
Louis Perrin,
imprimé par
et publié
un texte étabH par
par
M.
latine à la Faculté des
critique
moliéristes bibliophiles, c'est-à-dire
un magnifique
à tous nos lecteurs,
le
E. Benoist,
lettres
en deux vo-
maître-imprimeur de Lyon,
la librairie
et explicatif, rédigé
Hachette.
de Paris,
par
le
Il
contient
professeur de poésie
un commentaire
même
savant, et
une
M. Eugène Rostand.
traduction en vers de
L'Académie
Catulle,
française décernait l'an dernier à ce double
travail le prix Jules
Janin.
Nous n'avons pas à faire l'éM. Benoist est, à cette
loge du texte et du commentaire
:
LE MOLIÉRISTE
285
heure, de tous nos éditeurs de textes latins, celui dont l'Eu-
rope
plus de cas; son Virgile est
fait le
élevé à la gloire
tand çst à
vie avec
du grand
la fois
poète.,
une œuvre
effort
trop
visible
parfois aux dépens
et
de l'élégance.
caractère,
romain, égale
beaux types de
un
L'exécution matérielle
vrai bijou
la
typographique;
bandeaux,
d'imprimerie
culs-de-lampe,
de Louis Perrin, unissent à
un
plus originale
Molière aimait
crèce, ses
vif
sentiment de l'antiquité.
et
lisait
deux poètes
nous signalons
Catulle,
comme Horace
latins favoris. C'est à ce
l'édition de
MM.
lecteurs connaissent la scène
si
moderne
fantaisie
la
Rostand
curieux passage de Lucrèce
est
que
Nos
textuellement traduit,
du De Naturâ rerum,
à jamais regrettable, et anéantie par le feu.
gratiis
eram
tibi
L'ode char-
(2),
imitée de
nos jours par Alfred de Musset, se trouve déjà dans
Amants magnifiques
(3). Catulle est aussi représenté
(i)
Acte
(2)
Livre
(3)
Troisième intermède,
II,
la
Lu-
et
titre
et Benoist.
le
du ^Misanthrope, (i) où un
seul reste d'une traduction complète
mante d'Horace, Donec
;
lettres
ornées, etc., dessinés exprès pour cette publication par
fils
le
perfection des plus
lyonnaise
célèbre école
la
fleurons,
vignettes,
fidèle et ori-
on ne peut guère y reprendre
une exactitude poursuivie
;
fait
les
de conscience, sui-
d'art et
des deux volumes en
italique et
monument
vrai
amour pendant de longues années,
ginale, patiente et inspirée
qu'un
un
La traduction de M. Ros-
les
dans
scène IV.
III,
ode IX.
Dépit amoureux. C'est le
germe des char-
mantes scènes du Dépit amoureux (dont Molière reprend, comme on 1^
voit, le titre pour son imitation), d
Tartuffe et du 'Bourgeois gentilhomme
286
LE MOLIÉRISTE
l'œuvre du grand Comique, sinon par des traductions spé-
du moins par d'incontestables
ciales,
verront avec plaisir
liéristes
beau
le
imitations. Les
mo-
travail qui rajeunit, avec
tant de science et de goût, l'œuvre complète de l'amant de
Lesbie.
— Nous extrayons du Livre du lo novembre dernier
cette
étoiinante annonce, dont nous laissons la responsabilité à
Tauteur de
Collet
«
Sous
avait
l'article
un
quelques affiches de théâtre,
M. Ch.
et qui,
Restauration, en
la
1824,
Saint-Omer,
à
il
y
directeur, pufôste assurément des plus distingués
pour l'époque, aurait pu servir de modèle à tous
ses confrères.
avoir
De
:
:
les
fait
Un
soir,
s'avança vers
la
rampe
saluts réglementaires,
trois
improvisa d'une voix
Messieurs,
il
émue
mesdames
et
la
petite
notre
et,
après
homme
allocution suivante
:
mesdemoiselles,
Des engagements d'honneur m'obligent à porter, dans quelques
jours, sur d'autres rivages, ma troupe et mes pas. Mais, avant de partir, j'aurai l'honneur d'offrir à la belle ville de Saint-Omer une représentation extraordinaire composée de
:
LES ILLUSIONS DE
ou Le Serpent réchauffé dans
comédie en
5
actes, et
MADAME PERNELLE
le
sein d'une honnête famille,
en fort beaux vers de feu Poquelin Molière.
Et Tartuffe fut joué quelques jours après
!
— Au
moment de mettre sous presse, nous recevons
prospectus d'une édition monumentale ^,des Œuvres de
Molière, avec illustrations de Jacques Léman et notices
par A. de Montaiglon, entreprise par l'éditeur J. Lemonnier, 53 bis, Quai des Grands-Augustins, et dont nous
parlerons dans notre prochaine livraison.
le
DU MONCEAU.
1,
BULLETIN THÉÂTRAL
— Samedi
Comédie Française.
mercredi
et
dimanche
8,
1
dimanche 26 novembre:
Truffier,
28 octobre, vendredi
2 (matinée), mercredi
le
Mariage
Martel, Leloir, Davrigny,
forcée
1 5
,
3,
mardi 2
(MM.
JoHet,
Paul Reney, Villain,
MasquiUier,M"''Fayolle). — Jeudi
TartuffeÇM. Dupont).
— Mardi 28, Misanthrope (M. Delaunay, M"^ Tholer).
Odéon. — Dimanche 29 octobre, matinée populaire,
— Lundi
Dépit amoureux
23,
le
le
Sicilien: \q soir, le Sicilien.
(MM,
30, \q
Amaur}'^ Kéraval, Peutat, P. Achard, M"-' Real
M. Pinson).
— Du lundi
20, soirée populaire
l'Avare et le Médecin
:
médecin, de
MM.
—
le
—
-Dieudonné-Favart
plet.
Samedi 4 novembre,
— Vendredi
les
:
Salle
la
17 novembre,
troupe française Coque-
Précieuses Ridicules (Coquelin,
comble. Colonie française au com-
L'Archiduc Guillaume. Couronnes de
lauriers^
couleurs françaises et autrichiennes, offertes par
nenthal
et
M"^
les
(M. Coquelin aîné).
I" soirée des représentations de
M"^ Alice Lody).
10 novembre, V Amour
F. Poise et Charles Monselet.
Carl-Theater de Vienne.
lin
lui.
Dépit anwureux.
Vendredi
Théâtre de Bordeaux.
Précieuses ridicules
10, et
— Lundi
—
malgré
19, le Dépit amoureux.
Mardi 21 au dimanche 26,
OpÉRA-coMiauE.
novembre au vendredi
6
du mardi 14 au dimanche
et
Janish,
du
Burgtheater.
—
aux
M. Son-
Dimanche
288
LE MOLIÈRISTE
le
19,
•
(M.
Tartuffe
Coquelin joue
M""' Favart, Elmire; Barrai,
;
Lambert, Géante; M"® Lody, Marianne)
(M. Coquelin, Pancrace).
forcé
Ridicules.
M. Coquelin
principal;
rôle
le
Orgon; Dieudonné, Valère A.
— Lundi
Lody sont
et M"'^
et
Mariage
le
20, les Précieuses
l'objet
d'une vé-
ritable ovation.
Kotre correspondant viennois, M.
mann, nous
adresse une
dans laquelle
il
de
la
le D''
lettre pleine
Alfred Pried-
de détails curieux_,
résume l'opinion des principaux organes
sur l'interprétation du personnage de
presse locale
Tartuffe, qui venait précisément d'être joué à la
par Levinsky,
faite
;
n'a pas
fait
mieux.
Tartuffe,
riage forcé
:
«
fait
En résumé, Coquelin
«
Le
Wiener Abendpost,
diable
on
reconnaît trop vite.
peu aimable, on ne séduit pas.
avoue que
et
l'artiste «
bonhomme
de
la
clut
y>
le
»
Tartufïe de
»
par ces mots caractéristiques
!
»
— Le
M. Coquelin,
que l'exécution plastique
—
:
dit la
est sur
;
et la
quand
Tagblatt
comique
— V Extrablatt troiwQ
conception du comédien.
son Molière
et sincère
a réussi à fondre l'élément
l'élémentsérieuxdurôle.
post déclare
On
« trop
Morgen-
n'est pas à la hauteur
M. Friedmann conTout Vienne relit
«
»
Imprimerie de Pons
Ma-
on ne prend pas ce
roulement d'yeux pour un regard ouvert
est si
pas eu,
n'a
s'annonce trop rudement,
le
ses gardes devant de pareilles dents;
on
n'est
de son mieux, mais qu'il
succès complet des Précieuses et du
le
»
d'être
on a trouvé que «Levinsky joue autrement, mais
pas battu », et que Coquelin «
dans
Burg
((
La comparaison ne pouvait manquer
MONDORGE.
(Charente-Inférieure). — Noël Texier.
QUATRIÈME ANNÉE
NUMÉRO 46
JANVIER 1883
LE
MOLIÉRISTE
%EVUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
Campardon,
MM
Claretie, F. Coppée, V. Fournel,
J.
:
J.
Guillemot,
A. Houssaye, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
J.
L01SELEUR
L.
,
Nuitter
Moland
Ch. Monselet, E.
,
Noël,
Picot
L.
de la Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,
Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu, etc.
Ch.
,
E.
,
par
Georges
M ON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMEDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10, GALERIE
DU THEATRE FRANÇAIS, lO
1883
SOMMAIRE DU NUMERO XLVl
QUATRIÈME ANNÉE
-
RÉPONSE AUX Q.UESTIONS D'UN PROVINCIAL.
Bibliophile
Jacob.
BANaUET-MOLIÈRE.
TROIS PIÈCES INÉDITES CONCERNANT LA FAMILLE DE
MOLIÈRE. —G.Depping.
CURIOSITÉS LITTÉRAIRES.
Molière inconnu. - A. Buisson.
BIBLIOGRAPHIE. — Du Monceau.
BULLETIN THÉÂTRAL. — Mondorge.
—
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
français,
2, place
tions,
:
— ÉTRANGER,
I
J
FRANCS.
UN FRANC 50 CENT.
à la librairie Tresse, io, Galerie
du Théâtre
ou par mandat sur la poste adressé à M. G. Monval,
de Vintimille, auquel
demandes
lettre affranchie.
et
les
manuscrits,
communica-
réclamations devront être envoyés par
RÉPONSE
AUX QUESTIONS
D'UN PROVINCIAL.
C'est sous ce titre que Bayle a rassemblé dans
(%ptîerdam,
^nier
Leers,
1704,
diverses lettres qu'il avait écrites
5
un
livre
vol. in-12), V Abrégé de
en réponse aux critiques
qui lui furent adressées au sujet de son grand Dictionnaire
historique et critique. Je
donnerai ce
même
ponse, très abrégée et très sommaire,
plus
ou moins hypothétiques qui m'ont
d'érudition, au sujet de
téraire de l'abbé
Je réponds à
Un
tes
» et
par un
d'histoire
la querelle
et
lit-
et Molière.
lui-même
:
qui m'est resté absolument inconnu
;
l'aise
forces, contre
thèses repM'i
opinion sur
Cotin avec Boileau
donc bien à
mes
mon
un anonyme, qui
Provincial
je suis
aux observations
été faites,
ennemi de l'hypothèse en matière
terrible
«
titre à cette ré-
s'est intitulé
pour protester d'abord, de tou-
une habitude, un
parti pris
d'hypo-
et/a%^«to, qu'on prétend avoir découvertes
dans tout ce que
j'ai
écrit relativement à Molière.
Onmeper-
LE MOLIERISTE
292
me
mettra de
d'une accusation aussi mal fondée:
Justifier
témoi-
l'hypothèse, de la part d'un ignorant, n'est qu'un
gnage plus
homme
affirmatif de
son ignorance
de
;
qui a bien étudié son sujet et qui
d'un
part
la
possède à fond,
le
l'hypothèse est toujours un pas en avant dans la théorie de
la probabilité.
même
à
Une hypothèse
à priori est sans valeur, lors
fortiori s'appuie sur
des
faits
acquis. J'ai
donc pu
« Il est a
présumer que Cotin
lière
;
une hypothèse
et ressort
de documents
qu'elle n'est pas fausse et ridicule
dire avec toute apparence de raison
la
même
assurance, en
sur
ductions,
les
me
mêmes
n'ont jamais été imprimés
crit
dans
rait
en
les bibliothèques
faire
encore, avec
dirais
le
fondant sur
il
mêmes
les
n'en existe pas de
pubHques
le
;
in-
sermons
Ces
raisonnements.
;
la société
manus-
hasard seul pour-
découvrir quelques citations dans un ouvrage
nous savons combien
contemporain, mais
rancunier, vindicatif, irascible
quand un satyrique
rie
ménagé Mo-
n'avait pas
dans un des sermons qui attiraient en foule
précieuse et les gens de cour. » Je
:
s'en prenait à
Boileau ayant osé dire, dans sa
était
n'entendait pas raille-
il
;
Cotin
un prédicateur,
satyre IV,
que
et
Raison
la
ressemble à un pédant
Qui toujours nous gourmande,
Souvent,
comme
et loin
dé nous toucher,
temps
à prêcher,
Joly, perd son
Cotin s'écrie avec indignation dans
des Satyres
«
Ne
la Critique désintéressée
du temps:
diroit
on pas
parle de l'orateur
qu'il parle
chrétien
de Jodelet
(Joly)
;
il
?
parle
Cependant
il
du curé de
Saint-Nicolas jadis, et maintenant évêque d'Agen
!
»
Co-
LE MOLIERISTE
tin n'était
pas et ne iut pas évêque, mais
du Roi, lorsque
un
le
Satyrique osait
Qu'aux sermons de Cassagne
ment
et
qu'il
dans
fallait,
la
du ressenti-
colère,
haine de Cotin contre Boileau.
la
que Cotin, une
N'est-il pas probable
engagé dans
fois
une querelle implacable avec Boileau
par
ses amis,
et
conséquent avec Molière, dès l'année 1666, se
de l'usage
aumônier
était
il
de l'abbé Cotin.
et
misérable origine de
la
de
dire
au large
festin, être assis plus
Telle fut
293
soit autorisé
des prédicateurs qui conservaient en
chaire
toute leur personnalité, pour mettre ses auditeurs au cou-
rant de
guerre
sa furieuse
contre
le
Satyrique
Ce
?
fut
vers cette époque qu'il quitta la prédication pour se re-
mettre à rimer; car, ditRichelet (dans ses Particularités de
la vie des auteurs français),
sis
Il
au large à ses sermons
«
il
vit
qu'on
revint cependant, et plus d'une fois, à
dans diâérentes paroisses de Paris,
leurs, qu'il
ne
« J'ay
et le
et
extrêmement son
fallait
chaire,
sans doute
il
la
comme
à son
(dans
Perrault
mais
je
sermon
puis vous
;
c'estoit
rue Sainte-Avoye, où
auditoire. »
il
farceur impie Molière.
des modernes),
aux nouvelles cathoUques de
remonta en
Vipereaux,
l'abbé Cotin, raconte
des anciens
asseurer que j'ay esté fort pressé
tisfit
lieu
procédés batail-
et ses
le sieur des
Des Préaux,
oûy prescher
son Parallèle
donc tout
pas ignorer à ses auditeurs sa lutte
laissa
contre deux mécréants,
appelait Boileau
prédications
ses
et l'on a
de croire, connaissant son caractère
il
étoit toujours as-
et qu'il se fatiguoit inutilement. »
La dernière
était vieux, peut-être
fois
il
sa-
qu'il
âgé de 72 ans
un motif bien impérieux pour
;
lui faire
L^ MOLIÉRISTE
294
oublier son grand âge, la faiblesse de sa voix et
noncement
prêcha encore au mois de mars 1672
de cette année-là,
pour
à
la
mon
première
Femmes
les
(i), et
le
soin de tirer
de
il
12 mars
le
savantes avaient
jouées
été
au théâtre du Palais-Royal. Je
fois
Provincial
cher
son re-
depuis plusieurs années;
à la prédication
laisse
une
là
très
bonne hypothèse.
Je vais à présent essayer de démontrer
du MoUériste
cial
ce
et,
Le
me
que moi aux hypothèses
est aussi porté
demandé de
Provincial m'a
lui
rappeler les
lui signaler
allusion
ait fait
Femmes
la
n'ai
1672,
dispute de
savantes.
Provincial m'a prié de iui citer une seule plainte de
Cotin contre Molière? M.
pondu pour moi
très
ges de la Satyre
nommé
de
la
E.
de MoUère
Marnicouche a déjà ré-
gracieusement, en citant cinq passa-
des
manière
Satyres,
la
dans lesquels Molière
plus insultante
pas arrêté sur l'injure faite à la
;
femme ou
mais
il
ne
est
s'est
à la belle-sœur
:
A
il
seul des
? je
sermons prêches en mars
Trissotin et de Vadius, dans les
et
un
à Jvlolière
pendant qu'on représentait au Palais-Royal
Le
Provin-
le
semble^ moins excusable.
sermons de Cotin qui
pu que
que
ses vers
a négligé
empruntez
d'extraire
la
Béjard applaudit,
deux vers qui taxent MoUère
d'impiété, en accusant Boileau d'être complice de l'auteur
du
Festin de Pierre
(i)
Voy.
le
:
pvemiQr Alerciire galant, publié par de Vizé.
LE MOLIÈRISTE
O
295
docteur sans pareil ô protecteur des lois!
Et sans qui la vertu se verroit aux abois.
Il faut, comme à l'unique en piété sur terre,
Inviter votre Muse au grand Festin de Pierre.
aussi
fais
Je
!
une réserve pour
le
fameux passage dans
lequel Boileau remplace Colletet sans argent, crotté jusqu'à
l'échiné,
qui
S'en va chercher son pain de cuisine en cuisine
Son Turlupin
Est-ce Molière
:
l'assiste...
comme
?
supposé Taschereau.
l'a
ce Boileau-Puymorin, le contrôleur des finances
Edouard Fournier a voulu
encore accoucher
Turlupin,
ici
changé
nous
de
la
comme
?
n'osons pas
nom
le
en Frantaupin
que
Puymorin
la
Nous y
n'est
nombre des convives du
par Chapelle au
de
dans
offre matière à réfléchir.
reviendrons. Disons seulement
nommé
Nous
d'une hypothèse, mais
que Cotin a
Critique désintéressée,
prouver.
le
Est-
pas
cabaret
Croix de Fer, où trônait MoUère.
Le Provincial nous apprend que
prouvé que Cotin,
Boileau-Puymorin.
était brouillé
»
ami
de
On
sait
«
n'est pas
il
du tout
Gilles Boileau, fût ennemi
avec Gilles Boileau, se rapprocha de
qu'ils restèrent
de
que Boileau Despréaux, qui
depuis réconciliés.
Il
lui,
n'en fut pas de
et
même
de Boileau-Puymorin, qui, en se brouillant avec son frère
Despréaux, devint un des séides de Cotin
dit
Richelet dans sa notice,
rart,
Le
Chapelain, Boileau
Provincial insiste
bien authentique des
le
furent
Ses
amis,
d'Ablancourt,
Con-
:
«
contrôleur. »
pour qu'on
colères
lui
indique un
de Mohère
contre
motif
Cotin
?
LE MOLIÊRISTE
296
Molière
constamment
était et fut
comme un
regarder cette inviolable amitié
pour dire à Cotin son
lière avait trop
fait
de goût
et
digner du succès qu'on
tin.
pourquoi,
Voilà
moqué
meilleur ami de Boi-
le
une hypothèse bien aventurée que de
leau. Est-ce faire
en plein théâtre
sa fièvre, et
dans
aux
les
du madrigal sur un
pris l'un et l'autre
dans
En
Mo-
outre,
de jugement pour ne pas s'in-
faisait
Poésies galantes
Femmes
plaisamment du Sonnet à
si
motif suffisant
?
savantes,
de
Co-
il
s'est
la princesse Uranie sur
carrosse de couleur amarante,
les Poésies galantes.
Ce
fut le
coup
de grâce. Cotin ne s'en releva pas.
Le Provincial
fait
plus qu'une hypothèse, c'est-à-dire
étrange confusion, en disant que
Molière un auxiliaire contre
nage
»
Il
.
une
Cotin avait trouvé en
((
contre
les Précieuses^ et
ne se souvient pas que Cotin
Médes
était le favori
grandes, des véritables Précieuses, et qu'il n'avait rien à
De
là
une
interprétation tout à fait erronée de ce passage de la
Mé-
voir dans les Précieuses ridicules de
nagerie,
Molière.
de Cotin (La Haye, Pierre du
in-i2, page 30)
achevée.
On
:
«
Bois,
le
m'a averty qu'après
les Trétieuses,
pédant coquet. Vivat
!
que tout Paris doit y
et petits,
estre, parce
mariez
le
on doit
faux sçavant
Les comédiens ont mis dans leur
affiche qu'il fiiudra retenir des loges
grands
pet.
Je pensois que toute la Ménagerie fût
jouer, au Petit-Bourbon, Ménage hypercritique,
et
1666^
et
de
bonne heure
et
que toute sorte de gens,
non mariez, sont
intéressez au
Ménage. Voilà une vraye pointe de gens de théâtre »
Où diantre le Provincial a-t-il vu que cette plaisanterie an!
nonçât une sorte d'entente entre Cotin
bon
aussi
de remarquer, en passant, que
et
la
Molière
? Il
est
Ménagerie a été
LE MOLIÉRISTE
composée en 1660, puisque
encore dans
la salle
de quitter vers
le
la
297
troupe de Molière jouait
pour prendre possession de
même
année,
en
loin l'hypothèse,
n'est point l'auteur de la Satyre
que Cotin
«
cette
du Palais-Royal.
la salle
Le Provincial pousse un peu bien
concluant
fut obligée
du Petit-Bourbon, qu'elle
mois de septembre de
qui lui a été attribuée. »
En
effet,
il
n'a pas trouvé cette
Satyre citée dans l'Histoire de l'Académie française, continuée
par l'abbé d'Olivet, ni dans Moréri, édition
1759, où l'abbé Goujet ne
Cotin, que
la Critique
parmi
cite,
les
:
me
vous
« Si
à Cotin est fondée
trouvez
C'est
reil à
ici
je suis
que
;
si,
à
suite de
la
bataille,
les
il
Satyre
la
Ménagerie^ vous
la
dans quelque catalogue con-
voudrais avoir à remplir un volume pa-
n'est plus possible
mon
puisque
Le ProM. Marnicou-
bien forcé de rendre les armes. »
l'un de ceux de la Réponse
vincial, car
rendre
je
de
prouvez que l'attribution de
la Satyre des Satyres
temporain,
de
désintéressée sur les Satyres.
vincial triomphe et s'écrie, en s'adressant à
che
définitive
ouvrages
aux
questions
d'un pro-
de mettre en ligne de
cher Provincial doit
être forcé
de
armes, dix, vingt, trente citations dont quelques-
unes sont fort longues.
courtes, qui sont
même, dans
la
Je
me
dernière édition de ses
revue en partie ÇParis, Esprit
Billiot,
une note marginale à ces deux vers
Et que sert à Cotin
la
donc aux plus
bornerai
les meilleures. Boileau,
Boileau lui-mê-
Œuvres
qu'il
171 3, in- 12),
ait
a mis
:
raison qui lui crie
:
N'écris plus, guéris-toi d'une vaine furie.
Voici
la
note
:
« Il avoit écrit
contre
moi
et contre
Mo^
LE MOLIÉRISTE
298
Hère
:
donna occasion
ce qui
seurs d'hypothèses
tendre que
la
û(
la critique
sa Critique désintéressée^ tout
teur; mais le
de
priori tenteront peut-être
Fem-
les
»
Les
fai-
faire
en-
que Cotin
Satyre des Satyres n'est pas celle
composée, puisqu'il
avait
à Molière de faire
d'y tourner Cotin en ridicule.
ines savantes et
assez habilement dans
en y glissant des corrections d'au-
commentaire de Brossette, rédigé sous
l'ins-
piration de Boileau, caractérise et désigne bien la i'a/^re des
Satyres,
en disant que ce
Boursault qui
fut
une copie manuscrite que
sur
comme
Ecoutons Brossette,
(L
Fier et présomptueux
souffrir
Pour
s'en venger,
il
fit
chaire
la
Cotin ne
libelle
en prose,
les
satyres
du temps, dans lequel
intitulé
:
de
faire entrer
s'avisa encore,
MoUère dans
M. Despréaux.
par de nouvelles
Satyres suivantes
railleries,
;
la
il
il
:
publia
lui
imputoit des crimes
malheureusement pour
Celui-ci ne
comme on
la
le
Boileau, dans sa Satyre IX,
dans
les
ruiner
de
la risée
savantes,
suite
vengea que
verra
le
lui,
ne l'épargna
s'en
mais MoHère acheva de
comédie des Femmes
la
chargeoit notre auteur
cette dispute, et
de Tricotin, qu'il changea dans
sotin. »
(Voyez
désintéressée sur
réputation, en l'immolant, sur le théâtre, à
que, dans
comme un
Juvénal.
Critique
la
des injures les plus grossières et
pas plus que
et
s'en tint pas là
un
Il
fût contesté.
lui
reprochoit
lui
il
grand crime d'avoir imité Horace
imaginaires.
ne put
Cotin
étoit,
:
une mauvaise satyre contre M.
dans laquelle
Satyre des Satyres).
il
courir.
fait
Boileau lui-même
c'était
comme
que son talent pour
Despréaux,
l'auteur avait
si
imprimer
la fit
sous
le
pubU-
nom
en celui de Tris-
prit
la
peine de se
LE MOLIÉRISTE
défendre contre
les
299
odieuses imputations de la Satyre des
Satyres et de la Critique désintéressée
'
Qui méprise Cotin n'estime point son Roi
Et
et
selon Cotin, ni Dieu, ni
n'a,
!
ajoute cette petite note, dans la dernière édition
il
Œuvres (17 13)
ses
foi, ni loi
:
«
de
Cotin, dans un de ses écrits, m'ac-
cusoit d'être criminel de lèze-majesté divine et humaine. »
Nous regrettons de suspendre ici nos citations.
Le Provincial constate enfin que la Satyre des
d'une rareté insigne, puisqu'on ne
est
dans aucun catalogue, quoique
la
pâtissier
le
trouve
Mignot en
répandu quantité d'exemplaires, avec lesquels
pait ses biscuits.
Nous ne pensons
pas que
Satyres
décrite
il
ait
envelop-
Bibliothèque
la
Nationale possède un exemplaire de cette édition princeps
et
subreptice
imprimée
nom
à Paris, sans
sans indication de lieu et sans date.
On
à notre grande Bibliothèque, sous le
numéro
manuscrit du temps,
autres pièces contre
pentier
et
le
conserve, sous
:
Y, 5093, un
contre
Despréaux
et
niesme par Saint Pavin, Ouinault, Char-
de Briancourt.
le
trouve cependant
in- 12, qui contient la Satyre de Cotin
Despréaux ; épigramine pour Cotin
contre
d'imprimeur,
Mais
la
Bibliothèque
de l'Arsenal
n° 6916, B. L., Despréaux ou la Satyre
des satyres, et la Critique désintéressée sur
les
satyres
du temps,
éditions originales, l'une de 12 pages et l'autre de 63 pa-
ges
in- 8,
réunies dans
une main du
cueil
:
XVIP
la
même
siècle
couverture de parchemin;
a écrit sur la garde de ce
Critique des ouvrages de
M.
re-
Boileau Despréaux, par
le
sieur Cotin.
Enfin,
on ne
saurait
mieux
finir
que par une hypo-
LE MOLIÈRISTE
300
thèse
:
l'exemplaire de la Satyre des Satyres présente encore
la trace salie
d'une pliure^ qui semble annoncer que
a servi d'enveloppe aux biscuits
lifié
du
pâtissier
la feuille
Mignot, qua-
d'empoisonneur dans les Satyres de Boileau.
P.-L.
JACOB,
bibliophile.
BANQUET-MOLIÈRE
Nous rappelons
à nos collaborateurs, à nos abonnés et
à nos lecteurs, que le 3^ Banquet des Moliéristes aura lieu
Dimanche 14 Janvier 1883, à sept heures et demie
précise, chez Douix (café Corazza), galerie Montpensier,
le
au Palais-Royal, sous
Nous
prions les
la
présidence de
retardataires
leurs adhésions avant le 8 janvier.
La
M. Paul
de nous
cotisation est iixée à dix frams.
faire
Lacroix.
parvenir
TROIS PIÈCES INÉDITES
CONCERNANT LA FAMILLE DE MOLIÈRE
Les
trois pièces
qu'on va
famille de notre grand
lire,
pièces qui concernent la
Comique, sont tirées des papiers du
Châtelet, conservés aux Archives nationales.
Le
principal magistrat
Paris, qui, à l'époque
à-dire
sous
le
du Châtelet, après
dont
il
dans ces pièces, c'est-
—
le
magistrat principal du
Châtelet, ainsi que nous l'avons déjà
moire
lu
tiques
prévôt de
règne de Louis XIII, n'avait plus qu'une
purement nominale,
autorité
s'agit
le
montré dans un mé-
devant l'Académie des sciences morales
(i),
Lieutenant
« était le
civil,
dont
et poli-
les fonctions
répondaient assez exactement à celles de préfet de police
de Paris. Jusqu'en 1667, c'est-à-dire jusqu'au
Louis
XrV
établit
moment où
un Lieutenant-général de poHce,
cette
partie de l'administration de la capitale resta dans les attri-
butions
du Lieutenant
seulement chargé de
(i)
civil.
Mais cet
la sécurité
Quelques pièces inédites concernant
langes, par Guill.
Depping.
—
officier n'était
des habitants;
madame
il
de Sèvigné
pas
avait en-
et
les
Cou-
Paris, Alph. Picard, 1882, 32 pag. in-8.
LE MOLlèRISTE
302
sont plus spécialement au-
corc d'autres attributions qui
jourd'hui
du domaine de
magistrature ordinaire, du
la
même
ou
ressort des juges de paix,
tout simplement de
que
celui des officiers de l'état-civil, tels
exemple. Ainsi,
Lieutenant
le
civil
par
les notaires,
avait à régler ce qui
concernait les tutelles, les curatelles, les émancipations,
les interdictions, etc., et,
rents,
— pouvant
en cette qualité,
qu'on appelait alors
conseils de famille,
se faire
De
du Châtelet.
1637
à
il
était assisté,
»
qui nous occupe, le Lieutenant
le
l'homme de sang,
civil
le
las
core
il
le servir
promu
à
la
Vicomte
a
Pré-
et
surnommé
de remplir des fonclui
sa mémoire reste endemandé comme une grâce au Roi de
surnom de cruauté dont
Louis XIII, sur
période
métier de justicier qui
avait valu le
pouvoir
la
la
bourreau du cardinal de Richelieu.
tions criminelles et d'exercer le
avait
de
fameux Laffemas, qu'on
obtenu ce poste quand,
flétrie,
pa-
un des con-
1643, par conséquent pendant
vôté de Paris fut
« Il avait
présidait les
remplacer dans cette présidence
par un des conseillers dont
seillers
il
assemblées de
:
dans un emploi moins compromettant.
les conseils
de Richelieu,
dignité de Lieutenant civil,
Laffemas, en mars 1641, eut,
comme on
et,
le
l'avait
»
donc
comme
tel,
verra plus loin,
le
contrat de vente d'une maison, ou plu-
tôt d'une part de
maison, appartenant aux enfants mineurs
à
homologuer
de Jean Poquelin
Jean Poquelin
et
était
de défunte Marie Cressé, sa femme.
leur tuteur naturel;
qui réclamait cette homologation.
d'ajouter
que Jean Poquelin
Quant aux deux
autres
aussi était-ce lui
Nous n'avons pas
est le père
affaires,
besoin
de Molière.
Laffemas n'y
figure
LE MOLIERISTE
point
:
dans l'un
303
un des
et l'autre cas, c'est
Chàteletqui préside
et qui décide, ici sur
du
conseillers
une requête pré-
sentée par Robert Pocquelin, marchand à Paris,
là
sur
autre requête adressée par Louis Cressé, également
une
mar-
chand à Paris, et beau-frère du père de Molière.
Guillaume DEPPING.
I.
Archives
pièce,
dossier
nationales,
Y
—
3907.
Aux
Archives,
cette
du 17 janvier 1639, a été rangée à tort dans
du mois de septembre de cette même année.
le
Décision du Châtelet sur une requête présentée par Robert Pocquemarchand à Paris, créancier d'Etienne Poise (ou Poisé), également
lin,
marchand
à Paris,
mais tombé en
ayant pris
faillite, et
bert Poquelin demandait qu'il fût, selon l'habitude,
teur à l'absence, curateur contre lequel
pût diriger
il
la fuite.
nommé un
Ro-
cura-
et intenter ses
actions.
Ce Robert Pocquelin, évidemment de
pas mentionné dans
e^
le livre
5Mr s«/<3m///g (Paris, Hachette, i863,
forme ou sous une autre, presque tous
Du Lundy
Veu
17''
Janv""
la
d'Eud. Soulié
famille de Molière, n'est
Recherches sur Molière
où figurent, sous une
membres de la famille.
:
in-8),
les
1639,
linformation de banqueroutte,
Estienne Poise, marchant,
faite
cher^ le Dim'^'^ 19^ Dec. dern'',
PocqueUn, marchand... de
La requeste
à
fallit
et
absance de
par le commiss'^ Le
à
la
Va-
requeste de Robert
Paris, créancier dud. Poise,
nous présentée par
led.
Pocquelin, ten-
pante a ce quil nous pleult créer ung curateur pour labsence
LE MOLIERISTE
304
dud. Poise, contre lequel
puisse diriger et intenter ses
il
actions,
Après que Chevallier Borsier, dem' rue des
parr^ St-Nicolas-des-Champs, sest présenté
Gravilliers,
pour curateur
à labsence dud. Poise,
Ouy
du Roy,
sur ce le Procureur
et
de son consente-
ment.
Avons
led. Chevallier receu
et
recevons curateur, en
labsence dud. Poise,
Contre lequel poura
intenter
led.
touttes actions
Pocquelin
et autres, diriger et
pouroit avoir contre
quil
led.
Poise,
Lequel Chevallier, a voUontairement
charge, promis faire son debvoir en
ment,
faict et
constitué son
pris et accepté lad.
et faict le ser-
icelle,
proc'' à leffect
de lad. cura-
M" Nicolas de La Place, proc"" aud. Chastelet, en la
maison duquel, size Rue Tysserandrye, il a esleu et eslit
tion,
son dom"" y revocquable
(sic)
pour y
estre faict tous ex-
ploictz et aultres actes concernans lad. curation, lesquelz
entend vallider,
personne,
M''
et
comme
vray
Daniel Ameline,
Faict et
ordonné
(Signé)
:
silz
estoient faictz à
dom"% dont avons donné
proc""
sa
il
propre
Lettres
à
dud. Pocquehn.
les jours,
mois
et
an que dessus.
ChevaUier, Chauvelin.
n.
Archiv. nat.,Y. 3908.
— Le 16 janvier
1640.
Convocation du Conseil de famille d'Agnès Asselin,
tille
émancipée
LE MOLIERISTE
d'^e, sous l'autorité de
305
son curateur aux causes
(ij,
Guillaume
Cressé.
La grand'mère de Molière
Marie Cressé.
une Marie Asselin,
était
et sa
mère une
Agnès Asselin avait
été remboursée sur la succession Cressé d'une
de i25o livres, dont son tuteur, Louis Cressé, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demandait à être déchargé, afin de n'avoir
plus à en payer l'intérêt.
Ce Louis Cressé était le beau-frère du père de Molière, Jean Poquelin, qui avait épousé une Cressé (Marie Cressé); Jean Poquelin
assistait à ce conseil de famille; il y exprime, comme on verra, son
opinion, contraire à celle de Louis Cressé.
Agnès Asselin fut plus tard religieuse Bénédictine à Montargis.
(Ed. Soulié, Recherches, pag. 53 (2), igS.
somme
L^an mil
Veu
six cens quarante, le seiziesme Janvier,
par nous,
M^
Guilloys,
conseiller
du Roy en son
Chastellet de Paris, la requeste présentée par Louis Cressé,
marchand
tapissier^
bourgeois de Paris,
Expositifz qu'aiant rendu
Marthe Cressé
et
compte à Guillaume Cressé,
Jean Pocquelin, de l'exécution testamen-
de defFunct Louis Cressé, leur père, par devant
taire
commissaire Gaigny,
et
_,
le xxii
décembre mil
six
le
cens
trente neuf,
(i) Curateur aux causes, celui qui était nommé à l'effet d'assister le
mineur dans tous les actes de procédure pouvant concerner ses intérêts. Les actes de procédure émanant du mineur devaient être signifiés à la requête de ce dernier, procédant a sous l'autorisation de son
curateur aux causes, s Guyot, Répertoire de jurisprudence, V^ Cu-
rateur.
(2)
vante
Eudore Soulié
:
«
A
(pag. 53-54) a exprimé,
ses derniers
comme
on
sait, l'idée
sui-
moments, qui sait si Molière ne fut pas asde sa famille ou par des dames quêteuses ap-
sisté par une religieuse
partenant à l'un des couvents de Montargis, où s'étaient retirées ses
parentes? Deux sœurs religieuses l'assistèrent, de celles qui viennent
uêter pendant
le
carême à
Paris.
»
20.
3o6
LE MOLIÉRISTE
Et par icelluy,
auroient chargé
ils
icelluy
suppliant de
payer en lacquict de lad. succession à Agnès Asselin,
fille
émancipée d'aage^ soubz lauthoritté de Guillaume Cressé,
son curateur aux causes,
quante huict
la
somme
de douze cens cin-
dont
livres, dix sept sols, dix deniers,
icelle
succession estoit debittrice envers icelle Asselin, a la closture du
compte de
tuition, qui luy a esté
rendu
laume Cressé, son curateur aux causes
commissaire Gaigny,
Et daultant que
huict
livres,
lequel
vingt deux
somme
lad.
de douze cens cinquante
somme, ou de
la
sur
led. suppliant,
descharger par
est prest et offre
led.
Décembre 1639,
court a intherests
etc.,
désireroit sen faire
il
paiement quil
celle
le
et à Guil-
par
(?)...
moien du
le
présentement de
moitié mettre entre
les
faire d'i-
mains dun
notable bourgeois qui s'en chargera, ou de la consigner
au greffe.
C'est
pourquoy
parens et amis de
il
a faict appeller par devant nous, les
lad. Asselin,
pour donner leur advis sur
contenu cy dessus, lesquels sont comparus, scavoir
le
Led. Louis Cressé, tuteur
;
Guillaume Cressé, marchant
tapissier,
paternel, et curateur aux causes de lad.
Claude
ris,
Bastelart,
oncle maternel
:
cousin germain |
émancipée;
marchant boucher, bourgeois de Pa;
Jean Pocquelin, marchant tapissier à Paris,
chambre ordinaire du Roy, cousin germain
cause de deffuncte Marie Cressé, sa
femme
et vallet
paternel,
de
à
;
PhiUppes Lescacheux, marchant teincturier, bourgeois
de Paris, cousin paternel
;
LE MOLIERTSTE
307
Denis Turin [ou Surin], marchant
cause de
tapissier, à
Geneviefve Le Flamant, sa femme;
Charles Guichart, marchand apothicaire, bourgeois de
cousin maternel, à cause d'Elizabeth Bastelard (i),
Paris,
sa
femme;
Ausquels avons
led.
serment, ont
faict
elict,
faire
serment...; lesquelz,
scavoir
après
:
Lesd. Guillaume Cressé et Claude Bastelart, quils sont
que
d'advis
lesd, deniers
demeurent encore
mains dud, Louis Cressé qui en paiera
adviseront
trois
lintherest,
mois
es
pendant
dune personne solvable
lesquelz
ses parties
pour
prendre, ou de pourvoir par mariage l'émanci-
les
pée, ayant deub led. Louis Cressé en donner advis plus
ne
tost quil
faict à présent,
Jean Pocquelin, Philippes Lescacheux
Lesd.
Thurin,
et
Denis
dadvis que lesd. deniers demeurent
quils sont
entre les mains dud. Louis Cressé, jusques a ce que leman-
cipée soit pourveue par mariage, en paiant lintherest au
denier courrant,
Et led. Charles Guichard, quil est de pareil advis, at-
tendu quilna pas adverty
Par
led.
Louis Cressé,
son procureur,
à
les
et a faulte d'en estre par
chargé,
greffe,
ny en
paier
lesd.
aucun
de présentement paier
parens ont deub convenir,
eux convenu, de
attendu
faict.
de M* Laurent Regnauld,
est dit quil est prest
personne solvable, dont
dans huy au
parens plus tost quil na
assisté
quil
le
consigner
nen veut plus
estre
intherest.
Et par lesd. parens susnommez, à lexception de Guil-
fi)
Il
y a
écrit
:
Ba/telard.
LE MOLliRISTE
308
laume Cressè
advis des
et
Jean Pocquelin, a esté ditqviils oont eu
offres
dud. Cressé que depuis deux ou trois
que
jours, et
lesd. deniers
du pete dud. Cressé pour
ont esté cy devant mis es mains
garder jusques alamajoritté
les
de lad. émancipée, ainsy quil
du 12
juillet
est porté par advis
1631, et qvils ne peuvent sy promptement
ny trouver personne pour prendre
adviser,
de parens
lesd. deniers à
rente, nestant pas raisonnable de permettre cesser led. in-
attendu
terest,
•
le
peu de biens qu'a
lad.
émancipée.
Sur quoy, nous avons ausd. partyes donné lecture de
dires
leurs
fait
et
remonstrances, et ordonné qu'il en seroit
rapport au Conseil.
Il est dit,
par délibération du Conseil, que, dans quin-
zaine, les parens de lad.
mineure seront tenus convenir
entre eux d'ung bourgeois solvable es mains duquel lad.
somme
de douze cens cinquante huict
livres, dix sept sols,
dix deniers sera mise, pour luy en faire proffict, a raison
de l'ordonnance, jusques a ce quelle ayt atteinct laage de
majorité,
ou quelle
soit
occasion vallable pour
pourveue en mariage, ou trouver
faire
Temploy de
lad.
somme,
si-
non
elle
soit
tenu d'aucun intherest, et sera led. Cressé remboursé
de ses
es
mains dud. Louis Cressé, sans quil
frais.
Signé
R
demeurera
:
R. Guillois.
(?) le
—
Du
Jour.
— De Montrouge.
Jeudyxix Janvier 1640.
in.
Archives Nat.y Y. 3909.
Jean Poquelin, (père de Molière), tapissier et valet de chambre or.
du Roi, tuteur des enfants mineurs de défunte Marie Cressé,
dinaire
3O9
LE MOLIÈRISTE
femme, demande au Châtelet l'homologation d 'un contrat de vente
d'une maison ou plutôt d'une part de maison sise à St-Ouen, appartenant auxdits mineurs, comme héritiers des défunts Louis Cressé
et Marie Asselin.
Cette pièce a été signalée par Eud. Soulié, Recherches sur Molière^
page 142 (en note), mais l'auteur ne l'a pas reproduite, comme tant
sa
d'autres qu'il a publiées intégralement.
L'an mil
six
Le Samedy
conseiller
tenant
cens quarante-ung.
Mars par devant nous, Isaac de Lafiemas,
9^
du Roy...
privée maistre des requestes...,
lieu-
civil...,
Est comparu
M^
Charles
Fremyn, procureur de Jean
Pocquelin, tapissier et vallet de chambre ordinaire du Roy,
enfans mineurs
père et tuteur des
de defiuncte Marie
Cressé,
Qui nous
a dit
héritiers de defFuncts
ayeul
et ayeulle, le
village
dans
Louis Cressé et Marie Asselin, leur
quart d'une maison et héritages seize au
de Sainct-Ouyn,
lad.
comme
que ausd. mineurs appartenoit
et
quelques meubles qui sont
maison, laquelle estoit du tout
neurs pour ne leur rapporter aucun
mi-
inutille ausd.
proffict,
au contraire
une grande despence,
C'est pourquoy, pour le bien et utiUité desd.
il
auroit
vendu
icelle,
ensemble
lesd. héritages et
suivant l'advis des parans desd. mineurs aux
prix, clauses et conditions qu'ont faict leurs
à
M=
mesme
le
la
somme de six
comme
pot de vin,
par devant Moufle et
du présent mois
et an,
(sic)
co-héritiers,
Laurent Regnault, procureur au Chastelet
moyennant
pour
mineurs,
meubles,
de Paris,
mil livres et quatre cens
appert par contractz
Le Vasseur,
nottaires, les
5*
liv.
passez
et 6=
LE MOLlèRISTE
310
Auquel contract du
6*
dud. mois,
en requiert (ou
il
requéroit) l'homologation.
A
cet effect, auroit
parans
les
M' Jean Richer
le
convoquer
faict
mineurs,
desd.
qui
par-devant nous,
seroient
aussy oncle paternel
;
cheux, cousin maternel
Auquel Richer...
pour
lesd.
mois
Guillaume Pocque-
femme; Louis Cressé
Guillaume Cressé, oncles maternels
dit
dud.
Marie Gamart, oncle paternel,
à cause de feue Marie Pocquelin, sa
et
6'
:
Nicolas Pocquelin, oncle paternel;
lin,
fondé
procureur au Chastelet,
jeune,
de leur pouvoir, signé de leur main, dud.
et an, assçavoir
comparus par
;
Phelippes Lesca-
;
après...
serment par luy
faict....
constituans qu'ils sont d'advis de
a
Ihomo-
logation dud. contract du 6^ jour de ce mois et
payement
y mentionné pour
l'effect et
jouir par
led.
Regnault de
contenu aud. contract.
(Suit la délibération conforme du conseil).
Signé
Un
escu.
:
DE LAFFEMAS.
(La mention du prix de
de Lafïemas).
l'acte est
de
l'écriture
CURIOSITÉS LITTÉRAIRES
MOLIÈRE INCONNU
Le morceau qui
mais
il
est
fait l'objet
de
article n'est
presque complètement ignoré.
teurs de Molière ne
intérêt
de cet
le
publié;
l'a
siècle
que de nos jours, un poète ne
culièrement de théâtre,
les
travaux de
S'il
fugitives,
toujours,
sont
dont
la valeur,
travail est fort délicat.
trop
soin ce que
coup
et se
Il
fallacieuses
le
Elle
les
souvent,
L'éditeur
incontestables.
consciencieux a donc pour devoir de
!
Sa
répand en madrigaux, en sonnets, en
épigrammes, en pièces
hélas
erre au-delà.
de s'exercer.
verve poétique trouve mille occasions
l'intérêt,
s'occupe parti-
scène n'absorbent
la
Son génie
pas complètement son esprit.
dont
des édi-
d'en rechercher l'authenticité.
se confine dans une étroite spéciaHté.
s'éparpille, elle se
Aucun
n'est peut-être pas sans
et
reproduire
Pas plus au grand
il
pas inédit,
Son
recueillir.
faut qu'il se défie des séductions,
de
l'inédit,
qu'il
examine avec
hasard met devant ses yeux, qu'il
lise
beau-
montre quelque peu sceptique. Mais lorsqu'une
pièce a résisté à ce rigoureux contrôle, et qu'il est claire-
ment
établi qu'elle est authentique,
l'honneur de figurer à
la suite
et
lui
refuser
de l'œuvre du maître
Les savants éditeurs de Corneille
Marty-Lavaux
pourquoi
et
de Racine,
}
MM.
Paul Mesnard, se sont toujours inspirés
312
LE MOLIÉRISTE
de cette méthode.
ont offert dans leurs belles éditions
Ils
l'hospitalité la plus large à ces pièces
dans
les lettres et
ne s'en
est
dans
les recueils
plaint nullement.
du temps. Le lecteur
Quelques-unes sont char-
mantes, pleines de délicatesse
si
et
Corneille ont tant produit
de grâce. Or,
en
dehors
Molière
théâtre, à plus forte raison
a-t-il
quatre vents de Paris les fleurs de sa
Tous
les
morceaux
conservés sans doute.
main,
légères disséminées
muse
et
Racine,
si
côté du
à
dû semer aux
primesautière.
fugitifs qu'il produisit
ainsi furent
coururent d'abord de main en
Ils
s'égarèrent dans les gazettes et se perdirent dans
les recueils.
Or
jusqu'à présent les dévots de
se sont pas assez appliqués à les rassembler.
MoHère ne
Les éditions
de notre poète ne contiennent pas ou contiennent peu de
ces pièces détachées.
En dehors
bres, le Remerciement
au Roy
c'est à
peine
si les
des deux morceaux célè-
du Val de Grâce,
et la Gloire
plus complètes pubHent le Sonnet à Le
Vayer et les Bouts rimé:^ commandés sur
le
Bel-Air.
*
* *
Les vers qui nous occupent se trouvent pour
mière
fois
imprimés dans un volume devenu
la
pre-
très rare
au-
jourd'hui, mais assez répandu à la fin du dix-septième siècle.
Paru chez Jean Ribou,
il
a
pour
Poésie Galante des plus célèbres
lume
se divise
tispice gravé.
nom
de
titre
:
Les Délices de
Aulheurs de
ce
Temps.
la
Le vo-
en deux tomes, ornés, chacun, d'un fron-
Les stances sont signées en toutes
MOLIERE.
Les voici
:
lettres
du
(i)
(i) M. Paul Lacroix les a signalées sous le n" 2i5 de sa Bibliographie moliéresque, 2° édition, p. 55, comme imprimées à la page 201
de la if« partie des Délices, édition de 1666, in-12.
LE MOLIÈRISTE
313
STANCES GALANTES
qu'Amour
Souffrez
cette nuit
vous
réveille
Par mes soupirs, laissez-vous enflâmer
Vous dormez
Car,
Ne
c'est
trop, adorable merveille,
dormir que de ne point aimer.
craignez rien
Le mal
;
:
dans l'amoureux Empire,
:
n'est pas
grand que l'on
si
Et lorsqu'on aime
que
et
Son propre mal souvent
le
cœur
le fait
;
soupire
le satisfait.
Le mal d'aimer c'est de le vouloir taire ;
Pour l'éviter, parlez en ma faveur,
Amour
le
veut, n'en faites pas mystère,
Mais vous tremblez,
Peut-on
souffrir
et ce
Dieu vous
peur.
fait
une plus douce peine
?
Peut-on subir une plus douce Loy ?
Qu'estant des cœurs l'unique souveraine,
Dessus
le vostre,
Amour
agisse en
Roy
?
Rendez-vous donc, ô divine Amaranthe,
Soumettez-vous aux volontés d'Amour,
Aimez, pendant que vous
êtes
Car
point de retour.
le
temps passe
et n'a
charmante.
MOLIERE.
Nous croyons que
strophes sont rigoureusement
ces
authentiques. Et cette certitude s'imposera, croyons-nous,
à l'esprit de nos lecteurs,
s'ils
veulent bien
nous suivre
dans cet examen.
* *
Et tout d'abord, on admettra sans doute que
Galantes ne sont
sont écrites
dans
nullement
le
goût
indignes de
du temps^
les
les Stances
Molière.
Elles
rimes en sont
LE MOLIÉRISTE
314
riches. Elles sont jolies; elles ont de la grâce. Si elles
ne
sont point exemptes de quelque fadeur, c'est un reproche
qui s'adresse au ton et à l'esprit du siècle bien plutôt qu'à
lui-même. C'est un défaut dont Racine
l'auteur
ne se défendent
neille
dans
les
pas
semblent issus de
preuves. Mais
Le volume,
il
en
composés dans
même
la
considérations, nous
un
le
même
style
ne constituent pas des
est d'autres qui sont décisives.
que nous l'avons
ainsi
imprimé
est
dit,
ordinaire de Mohère^
Claude Barbin celui de Racine. Désirant publier
recueil de poésies galantes,
Ribou
Cor-
veine poétique. Toutes ces
savons,
le
chez Jean Ribou. C'était l'éditeur
comme
et
Molière lui-même
intermèdes de ses pièces et dans Mélicerle a intro-
duit bien des vers qui sont
et
toujours;
ait
demandé
à
inconnu, désireux de
est tout naturel
il
MoUère quelques
fortifier
vers.
un volume contre
rence du public, aurait pu se livrer au
pour Jean Ribou, une
telle
hypothèse
que Jean
Un
libraire
l'indiffé-
subterfuge;
mais
est inadmissible.
Pourquoi recourir à l'apocryphe lorsqu'on peut avoir
réel
Ribou
sidu;
il
entretenait avec
MoHère
n'avait qu'à lui exprimer
immédiatement exaucé. Ces
braire
et
poète
signature de
rait
le
?
le
son
commerce
désir,
qu'il fût
relations incessantes entre
bas de ces stances.
pas le poids et l'autorité que quelques
le lui
pour
li-
expliquent justement la présence de la
MoUère au
donnent à un
le plus as
livre. Il
demanda
le sien à
Ribou n'igno-
noms
illustres
MoUère, qui ne
refusa pas.
Boileau, de son côté, était en rapports suivis avec Jean
Ribou,
comme
avec MoUère. Lui, aussi,
il
voulut bien
LE MOLlèRISTE
3
15
contribuer à enrichir ce recueil. L'ouvrage contient deux
morceaux de
Rapprochement
lui.
ceaux ont, tous deux,
satire
connue,
de
Molière. L'un
trait à
est la
Boileau
le féliciter
l'auteur
à
de son succès et
célèbre
également
esprit...; l'autre est l'ode
par
adressée
Femmes, pour
traits
fameux
'Bjire et
:
mor-
ces
singulier,
de VEcole des
venger des
le
l'envie.
Brossette va nous dire à quelle époque cette ode fut
posée
com-
M. de Molière sur Y Ecole des Femmes,
gens frondoient. M. Despréaux lui envoya
Stances à
«
:
que plusieurs
ces vers le premier jour de l'année 1663 ».
Or
la
première édition des Délices porte justement cette
du 25 septembre.
date de 1663. L'achevé d'imprimer est
On
peut présumer que Molière, sur
bou,
lui
donna
début de
la
—
Si
cueil.
fameux
les vers
même
la prière
de Boileau
septième
la
;
elle est la
dre du temps.
Elle fut faite
en 1664.
la
trouvons dans
la
:
Rare
et
L'on voit que
était
les
quatrième dans
l'or-
»
seconde édition des Dé-
dont l'achevé d'imprimer porte
Le morceau
la satire
Cette satyre n'a été com-
«
:
posée qu'après
1664.
le re-
Brossette va nous donner encore les éléments
d'un rapprochement instructif
lices,
au
avait reçus
année, et qui enrichirent ainsi
nous passons maintenant à
esprit,
Or, nous
qu'il
de Jean Ri-
la
date du
12
juillet
dates concordent parfaitement.
donc dans toute
la fleur
de sa nouveauté,
lorsque Jean Ribou Tengloba dans son recueil.
Ce
livre
des Délices devait
être
une pubHcation
connue. Plusieurs impressions en furent
ainsi dire
coup sur coup, en 1663, 66
se tenait,
ainsi,
au courant, à
l'affût
faites,
et 67.
et,
Le
très
pour
recueil
des nouveautés de
3l6
LE MOLlèKISTE
l'année, fine se colportait pas sousletnanteau.
en règle,
privilège
En supposant
bonne
foi
se vendait librement.
il
que, pour la première de ces éditions, la
de Boileau eût été surprise,
U
réimpression
tient aussi
au grand jour
et
Lutrin, ni l'auteur
Or,
la
en aurait au-
qu'il
seconde édition
donc bien évident que
est
il
:
?
qu'on y eût im-
et
primé ses vers contre son gré, croit-on
torisé
Muni d'un
de son aveu, et que
du Tartufe n'a
les
con-
cela se passait
ni
du
l'auteur
été trompé.
*
Les stances sont de Molière. Nous n'en pouvons douter.
Quand
furent-elles
composées
?
quelle
occasion
les
fit
naître ? à qui s'adressaient-elles ? Voilà qui est plus déli-
Sur ce
cat à déterminer.
terrain,
les
inductions sont très
hasardeuses, et ne peuvent aboutir,
elles
si
aboutissent,
qu'à des probabilités.
L'édition de 1663 ne contient pas les
l'édition
première
la
de 1666
est
seconde
même
valle
Stances galantes;
L'achevé d'imprimer de
les publie.
la
du 25 septembre 1663 ;r achevé d''imprimer de
est
du 25 août 1665.
probable que
donc vraisemblable,
Il est
les vers furent
composés dans
l'inter-
de ces deux dates.
époque de
Molière venait à cette
grande faute
Béjart.
Il
de sa vie
venait
lutte contre ses
de
:
donner
ennemis
contracter
son mariage
l'Ecole
avec
des
triomphant. Le Roi avait mis
le
en
comble à
la
poète, en lui allouant une pension de mille
crut, dit Grimarest,
Femmes;
Il
avait été vive.
que son bonheur
plus
la
Armande
était
sa
sorti
fortune du
livres
:
«
Il
seroit plus sensible.
LE MOLIERISTE
s'il
le partageoit
laquelle
une
avec une femme. » Cette femme, vers
inclination fort vive
redoutable l'en séparait
Aussi
mariage
le
et fort assidue
la
jeune
du poète
Il
et
elle
lui
attente.
un obstacle
le portait,
présçnce de la mère.
précédé d'une cour fort longue
ne cessa que par
asile
le
coup de
chez
des galanteries
harmonie avec
véritable-
pendant cette longue
sentiment des Stances sont en par-
la disposition d'esprit
du poète à ce
n'est pas seulement Molière, n'est-ce pas sur-
tout Molière amoureux qui est l'auteur de ces vers
Au
reste,
du morceau. Au lecteur de juger
avons réussi. Aucun
vers n'est à dédaigner,
de sa plume. M. Paul Mesnard achève en ce
édition définitive
si
détail n'est indifférent, dès qu'il
cerne Molière; aucun
du grand Comique.
Stances galantes méritent d
lui
?
peu importe. Nous voulions surtout démon-
trer l'authenticité
Molière
de
tête
lui.
que Molière, qui l'aimait
sujet et le
moment. Ce
la
qui vint un beau jour se jeter entre les bras
chercher
adressa
Le
:
fut-il
est vraisemblable
ment^
faite
fille
;
317
y trouver
S'il
s'il
nous
con-
est sorti
moment une
croit
que
les
place, les dévots de
en sauront gré.
Adolphe BRISSON.
'
BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESaUE
Le premier
livre dédié a Molière.
—
L'excellent
dont l'éloge n'est
plus à faire, signale, dans sa livraison du 25 novembre
dernier, un exemplaire petit in- 12 des Ecosscuses (veuve
Oudot, Troyes, 1739), avec titre et deux frontispices imprimés en vert, qui porte, à la page 155, le paragraphe suivant:
Pour moi, je ne sçai pas pourquoi on ne s'est pas encore avisé de songer à dédier des ouvrages à Monsieur h
grand Molière
Il me semble que, depuis qu'il est mort,
il est bien un assez grand seigneur pour cela. Je voudrois
donc qu'en considération de son mérite d'autrefois, les
auteurs d'aujourd'hui lui fissent la dédicace de leurs pièIntermédiaire des chercheurs
et
des curieux,
(i
ces... », etc., etc.
Et
le D""
marque
ce vœu
date ? »
By
ajoute
:
«
Dans un
livre facétieux, cette re-
ne le sont peut-être pas. Trouve-t-on
ou mentionné quelque part avant cette
et ce désir
réalisé
—
M. Guillaume Guizot, professeur au Collège de France,
qui consacre si heureusement une partie de sa vie au culte
de Shakspeare, est aussi un moliériste fervent. Il veut
bien nous signaler, comme conservé à la bibliothèque de
Bagnols sur Cèze (Gard), un manuscrit de musique, « recueilli par Philidor l'aîné, ordinaire de la musique du Roi
et garde de sa bibliothèque de musique, l'an 1708, » contenant
L'ouverture de George Dandin (1668);
de la Grotte
(i6é8);
du Ballet des !Kuses (1666);
de Tourso:
—
—
niac {sic) (1669);
de V Impatiente
letdes/(?MX Pithiens (1669).
—
—
(1661); —
et
du hz\-
LE MOLIERISTE
— L'Artiste a publié,
une
de
tête
de sa livraison d'octobre,
eau-forte de Gabriel Boutet
belle
article
en
319
M. Aug.
Baluffe, intitulé
:
le
accompagnant un
Portrait de Molière
Bourdon. Pourquoi ce tableau, dès longtemps
porté au catalogue du Musée de Montpellier comme Portrait d'un jeune Espagiwl, vient-il grossir la liste, déjà formidable, des images où l'on a cru reconnaître Molière ?
Sur quelles conjectures s'appuie-t-on pour hasarder cette
attribution tardive ? D'abord sur la présence simultanée de
Molière et de Bourdon à Montpellier. M. Baluffe parle de
« huit ou neuf années pendant lesquelles Molière aurait séjourné au moins une fois l'an dans cette ville ». Il y a là
exagération de la moitié. Puis, sur ce que « la même idée
est venue à plusieurs personnes à la fois. // avait l'air
par
Sébastieîi
MoHère,
d'être
dit
M.
Baluffe,
nous l'avons
pris
pour
Cela n'est pas sérieux. On en viendra bientôt à
Molière au bas de tous les portraits du temps à
écrire
longs cheveux et à fines moustaches. Tous peuvent répondre en quelque point au signalement, très vague et
trop cité^ donné vers le milieu du XVIII^ siècle par M"^
Poisson, qui avait sept ans à la mort de Molière !
Pour nous, les portraits de Mignard resteront la source
authentique. Le Sganarelle de Simonin et l'Arnolphe du
Tableau des farceurs s'en rapprochent assez pour nous paraître acceptables. Le buste de Houdon,, transfiguration
idéale, est désormais populaire. Tout le reste fait nombre,
mais ne compte pas (i).
tel.
»
:
—
L'abondance des matières nous force à remettre au
prochain numéro la suite de la bibliographie, le Boursault
de Laplace, le Molière de Jouaust, et les Amours de Gombaut
et Macée, de MM. J.-J. Guiffrey, superbe livre qui vient de
paraître chez Charavay.
Du MONCEAU.
le portrait. Quant aux erreurs de détail, nous deM. Baluffe où il a trouvé que Molière « avait nombre
de rôles espagnols dans son répertoire » et qu' « il rapporta à Paris
(i)
Voilà pour
manderons
à
une centaine de mille francs
y»?
Tout
cela est bien légèrement avancé.
BULLETIN THÉÂTRAL
—
Comédie-Française.
Dimanche 26 novembre^ le Mariage FORcè (MM. Martel, Joliet, Villain, Truffier, Davrigny, P. Reney, Leloir; M"" FayoUe) et 199" représentation du Monde où l'on s'ennuie.
Mardi 28, Che^ l'avocat,
le Misanthrope (MM. Delaunày, Prud'hon, Boucher, JoBaillet,
liet,
P. Reney, Tronchet; M"'" E. Broisat,
Dimanche 3
Amel, Tholer) et V Eté de la Saint-Martin.
décembre, le Mariage forcé (dito) et le Marquis de VilDimanche 24, matinée L'Avare (MM. Thiron,
lemer.
Boucher, Martel, JoUet, Villain, Truffier, Le Bargy, Leloir, Tronchet ; M"" Reichembers, Barretta, P. Graiiger)
•
—
—
—
:
et le Testament de
Odéon.
César Girodot.
—
Lundi 4 décembre, soirée populaire à prix
V Avare (MM. Clerh, Amaury, Rebel, Kéraval,
Fréville; M'"* Raucourt^ etc.) et le Médecin malgré lui
(MM. Porel, Clerh, P. Achard, Kéraval, Boudier, FréVendredi 8 et saville; M"""^^ Chéron et Chartier).
Lundi 11, YEcole des Mamedi 9, le Dépit Amoureux.
ris (MM. Noël Martin, Amaury, Kéraval ;
M"" Hadaréduit
:
—
mard, Chéron
et
—
Nancy-Martel.)
—
Lundi 25 décembre, matinée
Opéra-Comiciue.
médecin, de MM. Poise et Ch. Monselet.
:
VA-
mour
Salle des Capucines.
Dumas
lière
:
— Conférences
sur les prédécesseurs et
les
Samedi 25 novembre, Cyrano
de M"'= Marie
successeurs de
'Bergerac.
Mo-
— Samedi
23 décembre, Scarron, son Roman comique, son Théâtre.
MONDORGE.
Imprimerie de Pons.
— Noël Texier.
aUATRIÈME ANNÉE
NUMERO 47
FÉVRIER 1883
LE
MOLIÉRISTE
%EFUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
Campardon,
J.
MM
Claretie, F. Coppée, V. Fournel,
:
J.
Guillemot,
A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
Moland
Ch. Monselet, E. Noël,
L.
de la Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,
Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu, etc.
J.
Loiseleur
Ch.
L.
,
Nuitter
,
E.
,
Picot
,
PAR
Georges
MON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMEDIE FRANÇAISE
PARIS
LIBRAIRIE TRESSE
10, GALERIE
DU THÉÂTRE FRANÇAIS, 10
1883
SOMMAIRE DU NUMÉRO XLVII
QUATRIÈME ANNÉE
VNArt/W
LA GLOIRE DU VAL DE GRACE. — Ed. Thierry.
MOLIÈRE ET LE MASQUE DE FER. — J. Loiseleur.
BANaUET-MOLIÈRE. — Toast de M. Paul Lacroix.
QUESTION DE CABINET. — Dr C.. II Mathanasius.
BIBLIOGRAPHIE. — Du Monceau.
ERRATUM IMPORTANT. — Ad. Brisson.
ÉPHÉMÉRIDES MOLIÉRESQUES. — G. M.
BULLETIN THÉÂTRAL. — Mondorcre.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
— ÉTRANGER,
UN NUMÉRO UN FRANC
:
On s'abonne
I 3
FRANCS.
50 CENT.
à la librairie Tresse, io, Galerie
Français, ou par mandat sur la poste adressé à
du Théâtre
M. G. Monval,
communica-
79, boulevard de Clichy, auquel les manuscrits,
tions,
demandes
lettre affranchie.
et
réclamations devront être envoyés par
LA GLOIRE DU VAL DE GRACE,
TARTUFFE ET LA PAIX DE
Au commencement
L'ÉGLISE.
de l'année 1669, Molière avait der-
rière lui l'Avare, succès épuisé, devant lui^ espoir renais-
de représenter Tartuffe, avec
sant, l'autorisation
sans remède à jouer entre les deux;
Vizé ne comptait pas
;
la
grande
levée définitive de l'interdit.
mais
la
les
Maux
De
pièce de
affaire était Tartuffe et la
Tout concourait
à cet heu-
reux dénoûment. Le temps en avait amené Theure.
lière n'eût-il rien
changé à sa comédie,
entre le
Mo-
Tartuffe
essayé aux Fêtes de Versailles et celui qui s'apprêtait à reparaître,
•
il
y
avait quatre ans de distance, autant
différence; la pièce, qui en était à naître le 12
était
maintenant une pièce ancienne.
craindre
veauté.
le
Lu, ou joué acte par
Tartuffe était presque aussi
L'apaisement
tout.
La
Il
scandale, qui est surtout
s'était fait
n'y avait plus à en
un
eff"et
acte, couplet
connu que
autour de
dire de
mai 1664,
de
Il
nou-
par couplet,
l'Ecole des
lui.
la
Femmes.
se faisait par-
vivacité des dicussions s'éteignait jusque dans les
hautes régions de
la
Evêques dissidents
Théologie. La soumission des quatre
réjouissait l'Eglise.
Sans rapprocher au-
LE MOLIERISTE
'
324
treraent des situations et des personnes
mot de soumission
—
quement au schisme
Molière
et
— on peut toujours
que,
dix-septième
le
mises en regard, sans prononcer du
siècle n'aurait jamais
côté de Molière ce
que
dire
qui s'appliquait uni-
n'était pas schismati-
qu'un témoignage public de
ses sentiments religieux ne pouvant manquer d'être bien-
venu dans
Molière cherchait sans doute
la circonstance,
l'occasion de la donner; l'occasion s'offrit d'elle-même,
il
dut la prendre d'autant plus volontiers qu'en
il
le faisant,
mêlait à un acte de respect pour les choses saintes
un
acte
de sincère amitié.
Cet acte d'amitié
de
la Gloire
et de piété à la fois, c'était le
du Val de Grâce, pour lequel
mis d'imprimer
passant, que le
le 5
il
poëme
obtint le per-
décembre 1668. Et remarquons, en
Roi signa
même
le
jour le privilège des
Plaideurs et celui de la Gloire du Val de Grâce.
On
sait
Mignard
de quelle vive
se
et durable
prirent l'un pour
affection Molière
l'autre
et
dès leur première
rencontre.
C'était à
Avignon. Rappelé en France après vingt-deux
ans de séjour en
bien
le
l'ordre
Italie,
Mignard
mot?)
à l'invitation
du Roi,
avait quitté
le
Romain,
docile (est-ce
de M. de Lionne, ou plutôt à
Rome
le
10 octobre 1657.
On
voyageait lentement alors, surtout quand on n'était pas
désireux d'arriver. C'était
apparemment
le cas
de Mignard^
qui obéissait sans enthousiasme.
Il
mit huit jours pour venir de
mois pour
las à
aller
Avignon, en
Marseille.
Rome
à Marseille,
un
de Marseille embrasser son frère Nicos' arrêtant
D'Avignon,
il
à Aix, après s'être arrêté à
poussa une pointe sur Vaucluse,
LE MOLltRISTE
325
revint se reposer auprès de son frère, eut l'esprit d'y
ber malade et de s'y oublier, ou convalescent, ou
tom-
même
entièrement remis, pendant un an, dit-on, mais un peu
moins,
je
suppose.
La troupe de Molière
tournées au fond de la'province romaine
Papes réunit un jour
Alpes
et le brillant
une de
ses
l'antique ville des
peintre célèbre des deux côtés des
le
comédien de campagne qui
Lyon un
de donner à
;
faisait
théâtre
rival
se vantait
de l'hôtel de Bour-
gogne.
Aussi bien ce comédien de campagne, parisien venu de
perdu Paris de vue.
Paris, n'avait-il jamais
Tandis que Mignard
s'attardait
de son mieux pour ne
pas arriver à Fontainebleau^ MoHère^
ne pas rentrer plus
plaignait de
y remonter par
les détours.
des plus douloureux
de
fut loin
D'Assoucy, qui en partagea
;
de talent, une
cuisine
une belle personne,
femme
frères avaient de
La
était
le pain,
bonne chez
compagnie à l'avenant. Madelaine ne
contentait pas d'être
ni le théâtre
Toutefois, son exil n'était pas
trouver amer.
le
les Béjart, et la
impatient, se
exilé
vite à Paris, et s'essayait à
de tète
et
c'était
une femme
Thonnête homme. Tout
nomade
ni la province.
l'élégance et le plaisir dans
Ses
d'esprit.
cela ne sentait
C'était Paris, c'était
une société charmante. De
cette société, Molière, qui s'y trouvait bien, s'était fait
Mohère y introduisit Mignard,
famille.
se
une femme
et les voilà liés
une
pour
la vie.
Lorsque Molière
arriva
pas
joindre.
partir
avec
Lyon
le
fit
sa rentrée à
comédien,
les réunit
il
Lyon,
si
le
peintre n'y
ne tarda pas à
l'y
re-
de nouveau, l'un déjà prêt à re-
pour ne plus retourner sur ses pas,
l'autre
toujours
LE MOLIÉRISTE
32é
prêt à s'arrêter et s'arrêtant
si
bien de portrait en portrait,
qu'une nouvelle dépêche de M. de Lionne vint
dre.
Il
fiillut
se séparer.
Les deux amis durent
rendez-vous à Paris. Pour Molière,
date,
que Mignard
n'est pas bien certain
semondonner
beaucoup ha-
c'était
moins de ne pas prendre
sarder, à
le
se
cependant
et
il
devança de beau-
l'y
coup. Mignard d'ailleurs fut tout de suite conduit à Fontainebleau,
et
Molière
deux ans
depuis
était
au
établi
Petit-Bourbon, lorsque Mignard vint demeurer, auprès de
Scarron
de Ninon de Lenclos, dans
et
rue des Tour-
la
nelles.
Leur fortune
rent presque du
Tous deux avancè-
s'éleva parallèlement.
même
pas, le
veur du Roi, Mignard
Reine-mère. Quand
le
du
fils
tapissier
Romain dans
la
dans
la fa-
faveur de
la
la raison d'État, inspirant deux grands
ministres, tourna tout d'un
de Louis de Haro vers
le
coup
vues de Mazarin
les
mariage de Louis
XIV
et
avec l'In-
d'Espagne, ce fut à Mignard qu'Anne d'Autriche
fante
demanda
le
portrait
passer les Pyrénées
devant ce portrait,
lippe
IV
de son
comme
fait
en
le
fils,
le
portrait qui
Roi en personne,
trois heures^
que
être la fiancée d'un prince
père
et le
et ce fut
la fille
apprit à se sentir heureuse d'avoir
pour
devait
de Phi-
été choisie
armé jusque-là contre son
gage d'une heureuse paix entre deux grands
royaumes.
Par une naturelle reconnaissance, dès que
fut entrée
dans sa nouvelle patrie,
portrait de
une
telle
la
magie
même main
les traits
elle
la
jeune Reine
voulut avoir son
qui lui avait présenté
avec
de son auguste époux: Mignard
LE MOLIERISTE
en
était
327
au portrait de Marie-Thérèse lorsque Molière en
était à l'Ecole des
Maris.
Plus tard, Molière en était au lendemain de VEcole
Femmes
Don Juan
et à la veille de
vant d'acquitter
le
vœu
Anne
:
XIV
qui avait donné Louis
France, choisit Mignard pour peindre
la
des
d'Autriche, ache
coupole de
la
à la
cha-
du Val de Grâce.
pelle
Là-dessus, déchaînement des rivalités jalouses.
commencé
par dénier tout mérite à cet absent,
si
On avait
mal
venu, dont on ne voulait plus dans son pays; on avait
cependant par reconnaître
en
le
cepta
défiant de
la
s'élever à
refini
valeur de ses portraits, mais
un autre genre; Mignard ac-
le défi.
Romain de surnom, pour prouver qu'il
tenta Pœuvre romaine, et entreprit
l'était
fait, il
aussi de
premier de
le
naturaliser la Fresque en France.
La coupe du Val de Grâce, la coupole, disons-nous aujourd'hui, fut le vaste champ de cette fresque. Il y représenta la Trinité divine glorifiée dans la splendeur des Cieux
par les chœurs des Anges, les Saints des deux Testaments,
les
Martyrs, les Pères de l'Église et toutes
ordres religieux
—
travail
;
sept cents figures,
gigantesque
!
— on
et ce travail,
les
légions des
les a
comptées,
Mignard l'exécuta en
mois, avec l'aide de Dufresnoy, son ami, son com-
six
mensal, romain au
même
titre
que
lui,
peintre et poète
la-
tin.
Cette fresque
avait reconquis
d'où
ris
il
ramena
l'attendait
immense menée
son droit de
sa jeune
cité;
à
il
bonne
partit
femme devenue mère
une pénible surprise:
il
fin,
Mignard
pour Avignon,
;
mais à Pa-
y trouva Colbert
LE MOLIÈRISTE
328
chargé de
la
nommé
surintendance des bâtiments, et Lebrun
premier peintre du Roi, par Tinfluence de Colbert, avec
une direction générale sur tous
les arts
du
dessin.
n'accepta pas d'être en tutelle sous Lebrun
cer à ce- que
nous appelons
les
c'était
;
commandes
Je ne parle, bien entendu, de Mignard
tient
un
de
me
orgueil qui ne
la fierté d'Alceste
renon-
officielles.
que par rapport
à Molière. Je n'ai pas à décider entre lui et
juger
Mignard
Lebrun, ni à
déplaît pas, je l'avoue, qt qui
me
ce qui
:
toucherait davan-
tage, ce serait de pouvoir m'expliquer les quatre ans qui
la
coupole
la Gloire
du Val
séparent l'achèvement de
pour
le
poëme de
Si la célèbre
coupole
comment ne
née,
fut
fit-elle
devait faire plus tard
?
et le privilège
obtenu
de Grâce.
découverte aussitôt que termi-
pas tout de suite le bruit qu'elle
Si elle
ans après avoir été achevée
:
ne
fut
découverte que quatre
pour quelle raison, ou sous
quel prétexte?
Après avoir accordé, en 1662, à son couvent de prédilection le privilège d'être presque sépulture royale et
cœur des souverains,
de
garder en dépôt
le
serait-elle sentie
moins pressée de poursuivre son œuvre,
par
l'effet
pas aussi
consommée en 1666,
Pour un motif ou pour un
enlevé que vers la
duisit
fin
du Val de Grâce
entre
autres
n'ar-
des travaux dont Colbert était bien
plus Hbre d'ajourner la dépense
pelle
Reine-mère se
de quelque crainte superstitieuse naturelle aux
longues maladies, et sa mort,
rêta-t-elle
la
de 1668. C'est alors que
fut ouverte
les
Molière n'attendit pas
?
autre, l'échafaudage ne fut
aux curieux.
la
cha-
On y
con-
ambassadeurs moscovites,
sans
doute que
le
mais
pubHc y
fût
LE MOLIERISTE
329
admis pour publier ou du moins pour
poème.
tion de publier son
devancer l'opinion pour
principes de
Il
diriger, initier les esprits
la
sévère, avertir les
l'art
solliciter l'autorisa-
voulait prévenir les cabales,
aux
yeux d'une nouveauté
qui risquait de les surprendre, imposer l'admiration de la
fresque et de « ses brusques fiertés ^
rer enfin le ministre d'aller
éminent
artiste,
comme
dit,
il
conju-
généreusement au-devant d'un
mauvais courtisan,
si l'artiste,
négligeait
de gratter à sa porte.
Voilà
le
poëme. Molière
était
préparé à
l'écrire. Il avait
eu un maître, son maître préféré, Lucrèce,
et
un modèle
du peintre,
plus voisin, l'Epitre
de Dufresnoy sur
dont
confidence, et c'est aussi l'honneur
avait reçu
il
la
l'art
de Mignard que ses entretiens avec ses deux amis soient
devenus deux poèmes didactiques.
Dans
la
Gloire
Molière
écrit. Il
cédé de
la
peint
même. Mignard
l'a
conquis au pro-
Tempera, à ses hardiesses sans complaisance, à
son improvisation
non
du Val-de-Grâce^ Mignard enseigne,
sans retouche. Molière ne craint
plus de brusquer le
comme un agrément
mouvement,
inférieur
—
ni d'éviter le
Molière
fait
pas
charme,
aussi
sa
fresque.
En même temps,
Saintes Filles.
foi
le
dessine à son tour son groupe des
peint avec une délicatesse respectueuse
un hommage rendu à
qui est
de
Il
il
cathoHque sous sa forme
la religion,
la
une profession
plus digne, étant la plus
indirecte, la plus touchante et la plus poétique
O
noble tendresse [la tendresse de
[la Reine -mère)
briller pour vous cette auguste princesse,
vous, dignes objets de
Qu'a
fait
:
la
LE MOLIÈRISTE
330
Dont au grand Dieu naissant, au véritable Dieu,
Le zèle iiiaf^nifiquc a consacré ce lieu,
Purs esprits où du ciel sont les grâces infuses,
13caux temples des vertus, adorables récluses,
Qui, dans voire retraite, asec tant de ferveur,
Mêlez parfaitement la retraite du cœur.
par un choix pieux hors du monde placées,
Ne détachez de lui nulle de vos pensées.
Qu'il vous est cher d'avoir sans cesse devant vous
Ce tableau de l'objet de vos vœux les plus doux,
D"y nourrir par vos yeux les précieuses flammes
Dont si fidèlement brûlent vos belles âmes.
D'y sentir redoubler l'ardeur de vos désirs,
D'y donner à toute heure un encens de soupirs
Et d'embrasser du cœur une image si belle
Des célestes beautés de sa gloire éternelle,
Beautés qui dans leurs fers tiennent vos libertés.
Et vous tofit mépriser toutes autres beautés...
Et,
Après ce gage donné à l'orthodoxie, tombait
objection
qui s'élevât encore contre
Tartuffe, C'était
pour
l'
la
seule
la
représentation de
auteur-comédien sa signature du
formulaire; personne ne pouvant plus suspecter ses intentions,
Molière entrait personnellement dans cette
»
de l'Eglise
Paix
«
comme
que Louis quatorze regardait
son
N'ayant plus à sévir contre d'austères
glorieux ouvrage.
et intraitables vertus, le
Roi
avait
moins de scrupule à pro-
téger une comédie qui leur aurait fourni en d'autres temps
d'amers sujets de plainte. Lui-même avait trop hautement
signalé son
zèle religieux
moment que
l'hypocrisie.
pour n'être pas plus
Il
interdit qui désolait Molière.
Grange
posteur
les
écrivit sur
ou
trois
cle, ni
Tartuffe.
perles
son
livre
la date ;du
5
février,
en grandes majuscules
il
2 août
allumées.
:
La
L'Im-
dessina de nouveau
1667. Point de cer-
mi-parti noir et bleu, ni unicolore, cette
cidément ces
en ce
leva tout d'un coup le long
A
Et, au-dessus,
radiées du
fort
trois perles radiées figuraient les
fois.
Dé-
chandelles
LE MOLIÉRISTE
331
L'autorisation de jouer fut accordée à
de
veille
l'
improviste.
La
représentation, Robinet ignorait encore qu'elle
la
dût avoir lieu
le
lendemain.
Il
ne
le sut
que
le
jour
même,
par les affiches.
Si l'on doute de Tinfluence
— disons
tinée de Tartuffe la fin
religieux et le
que purent avoir sur
poëme de
la Gloire
la
trêve
dans
la
De
5
même
démêlés
le
rapprochement du
février avec les nouvelles suivantes,
semaine par
des-
du Fal-de-Grâce, on n'en
trouvera peut-être pas moins curieux
spectacle du
— des
la
la Ga:(eîte
données
:
Le premier du courant, sur le soir,
un courrier de Rome que le Nonce du Pape y avait envoyé
extraordinairement, lequel en apporta deux brefs, Pun aux cvJques
«
arriva
Paris, le q février 1669.
ici
d'Alet, de Pamiers, d'Angers et de Beauvais, et l'autre à l'archevêque
de Sens et aux évêques de Chàlons et de Laon, qui avaient négocie,
avec ledit Nonce, ce qui concernait l'affaire des quatre évêques.
» Le 3, ledit Nonce eut, le matin, audience du Roi, en laquelle il
présenta ces deux brefs à Sa Majesté, l'assurant que Sa Samteté, ayant
été entièrement éclaircie de la conduite de ces quatre évêques, elle était
demeurée pleinement satisfaite de leur soumission et de leur obéissance.
Ensuite, il lui demanda la protection royale pour empêcher par son
autorité que la paix tût désormais troublée, ce qu'elle lui promit
avec un zèle digne du fils aîné de l'Eglise, l'ayant aussitôt déclaré aux
prélats qui étaient présents à cette audience en assez bon nombre, et
qui le remercièrent d'avoir procuré un si grand bien à l'Eglise.
» Le 6, Leurs Majestés, avec lesquelles était Monsieur, allèrent entendre la messe au Val-de-Gràce, dont elles admirèrent l'architecture,
et les peintures qui embellissent cet auguste monument de la piété de
la Reine-Mère, la Reine y ayant traité les religieuses avec une magni-
ficence singulière. »
Nonce du Pape
Ainsi, le
tait
le
lundi;
le
donc pas
jour où
le
MM.
mardi, Tartujje parut sur
même
de l'Eglise
LL.
eut audience le
3 février.
un dimanche. La troupe du Palais-Royal ne
l'intervalle
l'affiche. Il
où
il
n'y eut
d'une représentation entre
Roi promit solennellement de
et celui
C'é-
jouait pas
le
veiller sur la paix
leva l'interdit qui arrêtait la pièce.
n'assistèrent pas
au spectacle du Palais-Royal,
LE MOLIÈRISTE
332
ce qui est tout simple
:
qu'aux pièces à ma-
elles n'allaient
chines, les machines ne pouvant pas être déplacées
le
lendemain,
admirer l'architecture
allaient
elles
N'est-il pas vraisemblable, à la rigueur,
que Louis qua-
dessein après avoir bien voulu per-
le
fait
mettre à Molière de
En
mais,
et les
du Val-de-Grâce.
belles peintures
torze en avait
;
son poème
lui lire
?
1664, l'arrivée en France du légat que l'on attendait
à Fontainebleau ne fut pas
terminèrent
la
du Tartuffe
tation
moindre des motifs qui dé-
le
donnée au Nonce.
suivit l'audience
N'oublions pas,
médie devant
le
défense de Tartuffe; qw 1669, la représen-
d'ailleurs,
Nonce,
et
que Molière
que
le
Nonce
avait lu
l'avait
sa
co-
approuvée.
Edouard THIERRY.
— M.
le
D'W. Mangold nous
écrit qu'il vient
de décou-
aux Archives royales de Berlin, quelques dates pré-
vrir,
cieuses pour l'histoire du Théâtre Français, dont une par-
déjà imprimée depuis trois ans, et qui se trouvent
tie est
dans
le
geois,
journal manuscrit d'un gentilhomme brandebour-
envoyé à
la
cour de Louis
XIV
en 1663, 1664
i6éé. La plus importante de ces découvertes est
de
la
et
la date
première représentation du Portrait du Peintre^ qui
eu lieu non pas avant
la
MM.
Despois (IH, 420)
mais
après,
lui-même.
comme l'a
première de V Impromptu
et
dit
Fournel
M.
(I,
Bazin,
^
comme
241) l'ont prétendu,
et,
avant tous, Molière
MOLIÈRE ET LE MASQUE DE FER
Le
Bibliothécaire de la ville d'Orléans à M. Georges Afonval,
Archiviste de la Comédie-Française.
Cher Monsieur,
t
vient de paraître à Bordeaux une brochure qui ne peut manquer
d'attirer votre attention. EUea pour titre Le Secret dit masque defer,
Etude sur les dernières années de J.-B. Poquelin de Molière {1664ijo3). L'auteur, qui se déguise sous le pseudonyme d'Ubalde, est
un écrivain connu par une étude intéressante sur Clotilde de Surville
et par de savants travaux sur l'harmonie et les théories musicales.
Pour lui, toutes les explications qu'on a données du mystère de
l'homme au masque de ter sont fausses et non avenues. Il me fait
rhonneur d'emprunter, en les approuvant, les principales démonstrations que j'ai données de cette vérité dans un livre récemment publié
chez Pion, sous ce titre Trois énigmes historiques.
Il
:
:
Mais il ne conclut pas, avec moi, qu'il y a une légende au fond de
cette ténébreuse histoire, que le mystérieux prisonnier n'était qu'un
détenu vulgaire sur la tète duquel l'imagination populaire, cette féconde et inconsciente créatrice, a concentré des faits propres à divers
Pour lui, le captif n'est autre que Molière.
Molière n'est point mort le 17 février 1673 après la quatrième représentation du Malade Imaginaire. Il fut seulement ce jour-là pris
d'une syncope: les Tartuffes, ne pouvant le tuer, obtinrent du roi la
permission de le faire disparaître. Voilà pourquoi, bien que censé
mort le 17, il ne fut inhumé que le 21, pourquoi l'mhumation se ht
la nuit, pourquoi l'acte de décès ne fut signé d'aucun témoin, pourquoi enfin toute la correspondance et les papiers de l'auteur de Hon
Juan disparurent pour jamais, accaparés et détruits par les Jésuites.
Après avoir supprim-i l'écrivain, on supprimasses écrits.
captifs.
dit l'auteur, M. Paul Lacroix et M. Jules Loiseleur,
« Chose bizarre
qui se sont occupés avec passion et on ne peut plus sérieusement de
Molière, ont aussi chacun écrit un livre sur l'homme au masque de
fer: et rien, absolument rien, ne les a mis sur la piste que nous venons de suivre; rien ne leur a crié: Mais c'est lui, c'est lui »
I
B
ri
»
»
!
Je l'avoue à ma honte, et mon illustre ami M. Paul Lacroix ne se
refusera point sans doute, pour ce qui le concerne, à faire un semblable aveu : nous n'avons pas vu cela rien ne nous a crié c'est lui
Nous sommes deux aveugles. Confessons notre infirmité et reconnaissons que Molière est mort à la Bastille en i7ol->, après avoir, pendant
trente ans, porté le masque sous lequel les Jésuites avaient caché ses
:
abhorrés.
Agréez, cher Monsieur,
:
traits
,
mes meilleurs compliments.
Jules
LOISELEUR.
!
.
LE BANQUET-MOLIÈRE
Le dîner du 14 janvier 188^ a réuni le même nombre
de convives que le déjeuner du 15 janvier 1882 vingt-six,
dont voici les noms
:
:
MM. Edouard Thierry, F. Coppée, Carie de Rash, Jules
Guillemot, O. Uzanne, Ad. Brisson, Jouaust, Lalauze,
Larroumet;, Thoinan, Garraud^ Silvain, Monval, Ed. Pasteur, Méliot, de Marthold, Th. Cart, Varat, Georges Herbert, Grosselin, Dubois de l'Etang, D'' Couturier, Ch, Marie, Harrison, Jeanvrin et Lévy.
A
huit heures précises,
on
avait «
mis sur table
))
MM.
Halanzier, président de l'Association des artistes
dramatiques, et Lhéritier, membre du Cçmité^, s'étaient
excusés au dernier moment, ainsi que
cher, A. de Montaiglon et Léman.
MM.
artistes^
M. Paul Lacroix,
le
F, Hillema-
Martel, Saint-Germain, Truffier, Talien et d'autres
qui jouaient à l'heure même de la réunion, ont
exprimé leurs regrets de n'y pouvoir
sider
MM.
banquet;
M, Monval
a
indisposé, a
mais
donné
il
avait
assister.
dû renoncer à venir préenvoyé son toast, dont
lecture au dessert
:
Messieurs,
réunis, dans la même pensée, avec les mêmes
nous voulons que Molière
intentions, en formant les mêmes vœux
soit, pour la France, ce que Dante est pour l'Italie, Shakespeare pour
Nous nous sommes
:
TAngleterre, Cervantes pour TEspagne nous voulons que cet homme
un sage moraliste, un excellent écrivain, un
auteur dramatique de Tordre lé plus élevé, devienne, pour notre
nous
chère France, le plus illustre représentant du génie français
voulons que chacun puisse dire, comme disait La Fontaine « Molière,
;
célèbre, qui esta la fois
;
:
c'est
mon homme
!
»
LE MOLIERISTE
335
La France n'a pas toujours été juste pour ses plus dignes enfants.
XVIII« siècle, iVloIiù-re n'était pas ce qu'il est aujourd'hui on ne
l'admirait qu'avec certaines restrictions; on critiquait les dénoûiuents
de ses plus belles pièces on lui reprochait de^ négligences de style;
on l'accusait d'avoir fait tomber la Comédie dans la Farce, et les co.médiens français avaient de la peine à maintenir ses chefs-d'œuvre
au répertoire, en face de l'indifférence du public.
Quant à _^son histoire particulière, on ne s'en occupait guère ; on
ignorait même la date exacte de sa naissance; on ne cherchait pas à
connaître, à découvrir les détails de sa vie au théâtre, à la cour, dans
la société polie et lettrée. On se contentait de l'ouvrage, si insuffisant,
si fautif, de Grimarest, au sujet duquel Boileau écrivait, dans une
« Ce n'est pas un ouvrage qui mérite qu'on en
lettre à Brossette
» parle. Il est fait par un horhme qui ne savait rien de la vie de
Au
:
;
:
»
»
Molière, et
que tout le
se
il
trompe dans
monde
tout, ne sachant pas
même
les
faits
sait.»
Notre tâche, la tâche des vrais admirateurs de Molière, a donc été de
combattre, de détruire tous les préjugés, toutes les erreurs, toutes les
injustices qui existaient à l'égard de sa personne et de ses ouvrages.
Nous y sommes parvenus, avec le concours dévoué de la ComédieFrançaise, qui a remis en honneur l'admirable théâtre de son fondateur et qui lui a rendu, grâce à des talents d'interprétation incomparables, les applaudissements de la foule empressée et enthousiaste ;
Molière, le grand Molière est désormais jugé, apprécié, admiré, comme
ses œuvres immortelles sont considérées comme la plus
il doit l'être
haute expression de notre littérature nationale. Ce n'est pas tout la
critique savante a levé presque tous les voiles qui couvraient la vie de
:
:
l'homme, du poète, du comédien
:
tout
le
monde
ici
a
nommé
Befïa-
ra, Taschereau, Eudore Soulié, Jal, Ed. Fournier, Ed. Thierry,
Fournel, Moland, Campardon, Loiseleur, Claretie, Livet, Vitu et beaucoup d'autres dont les travaux intelligents et consciencieux nous ont
restitué, en quelque sorte, le véritable Molière.
Molière a déjà ses journaux, non-seulement notre cher MoUéristeen
France, mais encore une ou deux revues allemandes; Molière a ses
peintres, ses dessinateurs et ses graveurs, qui multiplient sans cesse
sa noble image Molière a ses éditeurs et ses libraires, qui ne se lassent pas de réimprimer ses œuvres dans tous les formats et souvent
avec un luxe que les amateurs réclament et encouragent; Molière a
ses traducteurs et ses commentateurs dans toutes les langues de l'Europe; Molière, enfin, en ce moment même où nous célébrons en famille le 261» anniversaire de sa naissance, est applaudi peut-être
dans vingt, dans cent théâtres, où l'on représente quelques-uns de
ses chefs-d'œuvre, en mémoire de ce glorieux anniversaire. Molière
n'aura donc jamais assez d'éditions de ses œuvres, jamais assez de représentations de ses comédies, jamais assez de portraits et de statues.
C'est pourquoi je vous demande, Messieurs, ae porter un toast à la
création prochaine d'un Musée Molière, d'une Bibliothèque molié;
resque.
Après
ce
petit
M. Carie de Rash
discours,
a
donné
chaleureusement
applaudi,
lecture d'une lettre qu'il ve-
nait de recevoir de M. Louis Ulbach et que nous publierons dans notre prochaine livraison.
M. Georges Herbert a dit ensuite une pièce de vers
:
LE MOLIÈRISTE
336
V Enterrement de Molière^ que nous regrettons de ne pounon plus qu'une lettre du
D"" Purgon, lue par M. C. de Rash.
Mais on trouvera, en tête de cette livraison, le remarquable morceau dont M. Ed. Thierry a donné la primeur
aux convives du banquet Molière, et qui complète si heureusement la série de ses études sur Tartuffe.
Après le café, M. Silvain a dit avec talent la Tête, de
Leconte deLisle, et la grande tirade de Don Louis; M. Monval a lu V Hommage à Molière qui termine les Papillotes, de
MM. Valadc etTruffier. Puis tous deux ont joué la première
scène du Misanthrope. M. Thierry a fait une très curieuse
communication de deux passages ignorés ou très oubliés
du Sorberiana, et MM. C, de Rash et G. Herbert ont prolongé la soirée jusqu'à minuit par la lecture ou la récitation de leurs poésies inédites.
M. Saint-Germain, l'éminent comédien du Gymnase,
nous avait envoyé ce couplet inédit des Dieux^ de Gusvoir reproduire, faute d'espace,
tave
Nadaud
:
Ecoutez
la
voix du génie
Qui
vient du lointain horizon
Sa parole est une harmonie,
Sa pensée est" une leçon.
Pour
Pour
mort
lui la
:
tresse le lierre,
ans sont ralentis
Et nous fêtons encor Molière
Tous les Dieux ne sont pas partis
P. -S.
—
lui les
L'avant-veille,
mensuel des Parisiens
;
dans
la
!
même
salle,
pour cette
des vers de
de Paris s'était,
le
dîner
fois, in-
Dîner de Molière. On y a lu
MM. L.
et J. Christophe, que le défaut de place nous
empêche de publier aujourd'hui.
titulé
:
Duvauchel
QUESTION DE CABINET
Ne
mes chers
craignez rien, ô moliéristes,
touché de près ou de loin à
n'ai jamais
confrères, je
la politique; je
ne
commencerai pas aujourd'hui.
La question que
je
veux
n'en est pas moins
traiter ici
grave, au contraire. Elle s'est imposée aux meilleurs es-
deux mondes depuis deux
prits des
été partagés
:
siècles, et les avis
ont
qui a raison? qui a tort? c'est ce que je
me
non pas compendieusement^ mais
propose d'examiner,
avec
tous
les
développements qu'exige un
qui a
sujet
déjà préoccupé plusieurs de nos collabprateurs (Voir le
Moliériste,
t.
H,
p. 246, 270, et IV,
Alceste, parlant à
a
155, 244)
Oronte de son sonnet,
Franchemeni,
Les commentateurs
il
est
bon
se sont
à
:
lui dit
mettre au cabinet,
:
»
emparés de ce dernier mot;
des ruisseaux d'encre ont coulé, les volumes se sont entas-
volumes pour prouver
sés sur les
importants
1°
2°
3°
Que
Que
Que
l'un de ces trois points
:
le cabinet était
un meuble
le cabinet était
un
retrait
;
;
le cabinet était l'un et l'autre, et
que Molière
a
cherché une équivoque.
Nous n'admettons que
repoussons
les
la
deux autres,
première interprétation
et voici
nos raisons
:
;
nous
LE MOLIÈRISTE
338
Consultons d'abord
les dictionnaires antérieurs à la date
du Misanthrope.
Le
Dictionnaire français-latin d'Henri Estienne, en 1549,
traduit cabinet par cistula, conclave, pinacotheca;
%py, par cimeliarchium
les
cabinet
du
d'une femme, toutes
; « le cabinet
sortes d'ornemens, ioyaulx et affiquets qu'elle ha
pour
s'accoustrer et attifer, miindiis ; cabinet en iardin, nubila-
rium
vel
En
suffugium imbris
1573,
et solis.
»
le Dictionnaire français-latin
de Nicot reproduit
exactement Henri Estienne.
En
binet
1602,
que
le
Nomcnclator octilinguis n'emploie
pour traduire
le
mot
le
mot ca-
grec-latin gynceceum,
la
stanza délie done...
En
16 14,
langues,
le
Tesoro
de las très lenguas, thresor des trois
tmàuk cabinet ^ar
camerino, studiollo (sic) en italien;
retrete,
recamara, escatula, arquilla, guarda-joyas, reposteria,
alcoba,
en espagnol. Dans ces traductions,
retrete,
à cause
de son sens actuel, pourrait laisser des doutes; en faisant
une
on
contre-épreuve,
voit
retrete
traduit par cabinet,
garderobe, ou, en italien, studiollo, armariollo,
En
16 18,
le
Dictionnaire françois-flamen traduit cabinet
par lieu secret, een
(.abinet
du Roy,
salvaroba.
secreet, een heymelilcke plaetse,
cabinet
et ajoute
:
d'une femme, cabinet en jardin, avec
des traductions conformes à celles d'Henri Estienne et de
Nicot. Contre-épreuve: ^wae/, privé, retrait, basse
bre, latrine;
—
le
mot
cabinet
ne paraît pas parmi
chamles sy-
nonymes.
En
latine
1620, Y Abrégé du Tarallèle des Langues française
du R. P. Monet traduit
conclavium
interius;
puis
cabinet par
viennent
:
et
conclave secretius,
cabinet, réservoir
du
LE MOLIERISTE
meuble
et
En
meuble
624,
1
le
Thésaurus vocum omnium.
par scrigno,
cistula
1637,
augmenté par
des femmes, cas-
donne.
le Parallèle...
développer,
le
,
cabinet.
ripostio di scritture; le cabinet
En 1636,
En
etc.
..
Dictionnaire français-italien traduit cabinet
le
setta, cassettino délie
sans
cabinet de jardin.
par pannier, cabinet, et latrina,
mais non
forica, par retrait,
1634,
femme;
d'appareil de
A. Aubert, traduit
En
femme, ioyaulx
plus riche et exquis; cabinet de
le
autre
339
etc.,
l'article
du P. Monet reproduit,
de l'Abrégé de 1620.
Trésor des trois langues de
Is
Hierosme Victor
reproduit l'édition de 161 8.
En
1643,
le Dictionnaire françois-flamen
copie
l'édition
de iéi8.
En
1644,
le Thrésor des trois langues
répète les éditions
de 1614 et de 1637.
Même
date, le Dictionnaire français-italien répète
aussi
celui de 1634.
En
1650,
Cotgrave de cette date
le
binet ar casket far jewells, etc., also
•wardrobe... etc.. Cabinet
Si le
mot
claset paraissait
correspondantes
cabinet,
;
a
dit
ca par
En
1663,
le
retrait,
Cabinet, a
closet, little
peu
ca-
chamber, ar
d'Allemagne, cabinet du Roy...
—
voici les traductions
clair,
verducade
;
closet,
wall, with a hanging bottome, en français
En
;
:
built oui
of a
trompe.
Calepin de cette date traduit latrina ttfari-
mais non par
cabinet.
1671, le Dictionnaire françois-italien de Nath.
traduit cabinet par cabinetto, studiolo-,
Contre-épreuve
:
cessa
est traduit
cabinet
Duez
d'Allemagne.
par privé, aisément, la
LE MOLIERISTE
340
non
garde-robe, mais
cabinet; laterina par latrinCj privé, mais
non cabinet.
En 1673, Blondcl,
publie une nouvelle édition
chitecture,
de Savot, qui avait paru pour
française
1624,
directeur de l'Académie royale d'ar-
^^ ^^
complète en y ajoutant des notes
pièces en appendice
chambres
de V Architecture
première
la
le
:
garde-robes; »
le
XV=
chapitre
traite
«
des
chambres, garde-robes
et anti-cabinets,
XVI
chapitre
fois
anti-
et arrière
consacré aux
est
en
quelques
et
cabi-
«
nets et arrière-cabinets. »
A
du chap. XV,
la fin
p.
on Ht
97^
robe n'est nécessaire que pour y
cée, de sorte
que
sa capacité sera assez
ne sera que de quatre pieds,
où
ces,
il
faut
qu'il
aux princes qu'au vulgum
pas,
n'ai-je
même
en deux catégories
Le
chapitre
Nous
de
«
une plus grande place
pecns,
bibliothèque,
:
livre
les
pauvres^ remèdes
XVP
n'a pas
un mot qui
rappelle les « aise-
»
voici en 1676.
l'architecture,
la
Ouvrons
le traité «
sculpture, de
la
des Principes
peinture, avec
Dictionnaire des termes propres à chacun de ces
que publié en 1673, peut
le texte
arts,
un
»
cité,
de Savot, bien
laisser des doutes,
parce que, sur
point qui nous occupe^
ment
un
temps qui divise tous ses remèdes
remèdes pour
:
»
pour semblables usages
ma
par Félibien. L'ouvrage que nous avons
le
elle
riches?
les
ments.
grande quand
ce n'est en celle des Prin-
si
quelque part dans
de médecine du
pour
garde-
une chaise per-
besoin de plus grande place. »
évident
est
Il
est
« l'arrière
:
retirer
il
reproduit peut-être simple-
des éditions de 1624 ou de
1632; mais
le
LE MOLIÈRISTE
de Félibien
livre
incontestablement postérieur
est
Nous y
ans au Misanthrope.
gruants à
du
Molière
car
verra,
dit pas, si
pu donner au vers de
vécu
nous semble
il
qu'il aurait protesté
:
Cabinet. Le mot de cabinet a plusieurs significations,
il
prend quelquefois pour une armoire h
se
papiers
une
fie
on
cabinet ;
sens qu'on essaya de lui donner à partir de
le
avait
«
mot
par ce qu'il ne
[\Cisanlhrope ont
1685, et contre lequel
s'il
le
comme
par ce que dit Félibien
les spectateurs
de dix
relèverons tous les mots con-
matière, y compris
la
34I
ou d'autres
serrer des
sortes de hardes; d'autres fois
petite pièce d'un
il
signi-
appartement, qui peut servir à plu-
sieurs usages.
que l'on orne de
l'on appelle cabinets les lieux
» Ainsij
tableaux^ et que Vitruve,
liv.
VI, chap.
5,
appelle Tina-
cothecœ.
» Cabinet
de conversation. C'est ce que Vitruve appelle
exedra.
ou
» Cabinet,
lieu retiré
dans un jardin.
» Cabinet d'estude.
où
» Cabinet,
»
l'on serre des papiers.
commodité propre
garde-robe le lieu
B
une
Garde-robe. C'est
chambre, ou cabinet de
petite
à serrer des meubles;
où
on
nomme
aussi
est la chaise percée.
Latrine, retrait, privé, forica, latrina. Vitruve.
ou aisance. Latrina.
» Privé,
Jamais,
on
nonyme de
le voit, le
privé,
de
nyme,
à
comme
dit Félibien,
l'usage
des
mot
retrait
cabinet n'est pris
ou d'aisément;
délicats,
que
»
comme
le seul
est 'garde-robe.
se plaçait
ce
meuble
C'est
qui,
sy-
synolà,
pour
LE MOLIÈRISTE
342
les particuliers, s'appelait « chaise percée^ » et
»
chaise d'aâfaires (i) »:
fondre avec
la « chaise
meuble
de commodité
dont
articulé à l'usage des malades, et
nait à volonté
le
Roi,
dossier s'incli-
A
Ver-
munies des usten-
indispensables, mais pas pour tout le
siles
le
de siège
», sorte
de crémaillères.
l'aide
avait plusieurs garde-robes,
y
sailles, il
en arrière à
pour
ne faut pas con-
qu'il
monde
;
car
un
des massifs du jardin, entouré d'une grille, porte encore
le
nom
de carré .des demoiselles d'honneur.
Enfin, pour revenir au cabinet, qu'on se rappelle l'amu-
sante
épigramme de La Monnoie;
« saint
Pacôme en son
cabinet,
»
il
ne nous montre pas
mais
Saint Pacôme'sur un privé.
Nous nous sommes
déjà avancé bien au-delà de la date
à laquelle nous aurions pu nous arrêter. Revenons sur nos
pas, et
cherchons
si,
dans une époque antérieure, quelque
poète n'a pas eu à rendre la
comment
nit
il
même
s'en est tiré. Voici
idée que
Molière, et
Maynard, qui nous four-
deux exemples tellement caractéristiques, que nous
nonçons
à
excellents
de
lière
en chercher d'autres,
et
même
à reproduire les
commentaires de M. Paul Mesnard dans
la collection
re-
des Grands Ecrivains, et de
le
Mo-
M. Ludo-
vic Lalanne dans la Correspondance littéraire (1859).
Chambre
[du Roy ] deux porte-chaises d'affaide gages payés sur les Menus, » c'està-dire sur la caisse des oMenus plaisirs ; on comprend pourquoi. Chacune de ces deux charges, en 178g, se vendait i5,ooo liv. en cas de
y a encore à
servans six mois
la
(i) a II
res,
transmission.
;
600
liv.
LE MOLIERISTE
Dans
343
premier, Maynard parle de ses poésies
le
:
Les vers que mon esprit sublime
dextrement lime et relime,
Ont je ne sçay quoy de si net
Qu'ils sont tout l'attente du Louvre,
Et la Reyne veut qu'on leur ouvre
La porte de son cabinet.
Si
(Manifeste).
Maynard
Reine,
si
du jugement favorable de
serait-il aussi fier
elle avait fait
la
ouvrir à ses vers la porte de son
« privé » ?
Dans
le
vais poète
second exemple, Maynard s'adresse
à
un mau-
:
Rimeur à l'esprit de travers,
Et qui n'a rien qui ne desplaise....
... L'ouvrage le plus net
Qui se lime en ton cabinet,
N'est que pour la chaise percée.
{Epigr. pour un mauvais poète).
La
d'où
distinction est claire
;
et la différence entre le lieu
partent les vers et le lieu
bien- établie
:
au
cabinet,
où
ils
vont se perdre
est
selon Maynard, sont destinés les
vers de Maynard, à la chaise percée les vers de ses enne-
mis.
Au temps
de Molière,
la
confusion n'était pas
plus
permise.
Trois dictionnaires
importants,
avec grand
préparés
soin, ont été publiés après les ouvrages de Savot, revu par
Blondel, et de Félibien; ce sont ceux de Richelet (1680),
de Furetière (1685)
Richelet copie
mots
à
et
de l'Académie (1694).
peu près Félibien; de
garde-robe, latrines, lieux,
ne donne pour synonyme
plus,
ou privé (ahest
cabinet.
ni
aux
aisément),
il
LE MOLIERISTE
344
donne au mot
Furetière, le premier, et seul,
cabinet le
sens de privé, que nous n'avons jamais trouvé ni avant
ni après
jusqu'en
lui,
1719;
et
encore
penser qu'il a voulu faire une espièglerie en citant, à
pui de son interprétation,
en a
fait
une
jour où,
le
donne pour exemple
hommes.
des
»
:
«
le
vers de
Mais peut-on croire que
l'Académie, qui admet
effet,
latrines et privé,
robe,
d'eux par cabinet y
et
comme
les
épier,
il
il
les plus éclairez
mot
le
Non
l'ap-
comme
traduisant éclairer par
ce sens, était de la langue usuelle?
En
Molière,
Les Princes sont
lui,
permis de
est-il
cabinet,
en
certainement.
mots
aisément, garde-
ne traduit aucun
Richelet,
ne donne à ce dernier mot que
les
diverses significations données par Félibien et Richelet.
Cependant, en 17 19,
Richelet qui
chancetés
Abé.
de
l'autel
Il
y
surtout
dans
un
a
cette
nouvelle édition du
recueil alphabétique de
on n'a pas voulu
(i),
(i) «
vit
est
être
en
reste
mé-
de maUce sur
des gens qui assurent que l'abé est un homme qui
approche point ».... On dit un vertueux, un
et n'en
saint abé. Ces dernières qualités sont assez rares
:
;
mais
celles-ci sont,
par malheur, plus ordinaires: abé fénéant, mou, ignorant, délicat,
voluptueux, galant, éveillé, gaillard, amoureux, etc.»
» Abondance. Vin où il y a beaucoup d'eau. Tant qu'on boit de l'abondance, on ne se brûle pas le foie, et charitablement on doit croire
que c'est dans cette vue que M. Gratien et autres gens qui tiennent
pension font boire de l'abondance à leurs pensionnaires grands et
petits.
»
Absurde.
net est
si
Il
signifie sot, ridicule, impertinent...
fier et si
Le
S^
abé
Maume-
vain qu'il est absurde.
» Académiste... Chaque académiste, lorsqu'il est un peu habile, a tôt
ou tard 5 ou 6,000 livres de rente, tandis que le pauvre Amelot de La
Houssaye ne gagne que des poux à faire traduction sur traduction.
» Actionner. Ternie de Palais. François Hérard, de Vitry, est un co
LE MOLIERISTE
345
Fureticre, et l'on a reproduit son explication
du vers du
Misanthrope, explication qui se retrouve ensuite dans Trévoux.,
mais dont nous n'avons à nous occuper que pour
constater sa première
apparition dix-neuf ans, et son ad-
mission définitive plus de cinquante ans après
la
date
du
Misanthrope.
Je ne sais,
trouverez
tre
«
mes
ô moliéristes,
louable
chers confrères,
matière dont
» la
je
pour
satisfaire
vous
m'occupe. Mais no-
chère Revue vous offre bien d'autres régals
la variété
si
;
il
faut de
des goûts différents; les savants en
us,
qui préfèrent des sujets plus graves,
les
excellents articles qui précèdent
s'appuieront sur
ou suivent
celui-ci;
peut-être cependant quelque tète à l'envers, en retrouvant
ici
un parfum de cabinet
pas,
ne nous blâmera-t-elle
(sîudiolo),
en ce temps de carnaval, de nous être rappelé
fameuse maxime de Pierre Leroux:
« à
chacun selon
la
ses
besoins! »
D' Chrysostome
Président-fondateur
et
n MATHANASIUS,
membre unique de
la Société
des 'bibliophiles de Saint-Mathurin.
quin que
amis.
» Bâti,
l'avarice oblige
mal
Etc., etc.
bâti...
tous les jours d'actionner ses meilleurs
Varillas est très
mal
bâti... »
»
BIBLIOGRAPHIE
Les amours de Gombaut et de Macée.
l'Histoire de la
choisi cette phrase de Y Avare
:
— L'auteur de
M.
Jules Guiffrey, a
« plus, une tenture de ta-
Tapisserie française,
des Amours de Gombaut et de Macée... » comme
épigraphe de sa très complète étude sur une tapisserie
française du musée de St-Lô, fort beau volume imprimé
par Motteroz et illustré de 5 héUogravures hors texte et de
pisserie
9 fac-similé d'estampes anciennes (i).
Une
«
Amours
de
phrase de Molière, dit l'Avertissement y a valu aux
Gombaut
et
de
Macée une véritable
célébrité... Il
n'en a pas fallu davantage pour attirer l'attention sur l'histoire de ce roman champêtre et mettre en honneur une
tapisserie oubliée depuis bien longtemps et bien intéressante cependant comme monument de la langue et des
mœurs de notre pays. »
M.
expoGuiffrey a divisé son travail en trois parties
prouvant la grande popularité du
:
sition et étude des faits
pendant deux siècles au moins ; description des huit
tableaux et reproduction des strophes inscrites sur chacun,
avec les variantes ; examen des questions relatives à l'origine et à la date de cette poésie populaire.
sujet
Cette étude, du
même
plus haut intérêt pour les moliéristes,
temps un
livre de bibliophile. L'exécution
beauté du papier,
matérielle est à la hauteur de l'ouvrage
choix des caractères, soins donnés au tirage, perfection des
est
en
:
fac-similé, tout est irréprochable, jusqu'aux têtes de pages
(i)
1882.
In-40 de 60 pages. Paris,
Cli ara vay frères, 4,
ruede Furstenberg
LE MOLIERISTE
et
347
aux culs-de-lampes, spécialement exécutés d'après des
tapisseries
du
Total
bon
:
XVIP siècle.
et
beau
livre.
— Encore une
Œuvres complètes de Molière.
édition
de luxe
Sept volumes chez L. Hébert, libraire, rue Perronnet, n° 7. Texte scrupuleusement revu et coUationné
sur les originaux avec les variantes de 1682. Vie de Molière,
par Voltaire. Annotations de Bret, Auger, Aimé Martin,
etc. Portrait de Molière, d'après Chenavard, et 18 gravures
sur Chine d'après H. Vernet, Desenne, A. Johannot et
Hersent.
!
RoTROu ET BouRSAULT.
—
La
Ubrairie Laplace vient
nouveaux volumes à son intéressante collection théâtrale in-i8, qui rend à bon marché de si réels
services aux lettrés et aux curieux.
d'ajouter deux
Le premier est un Théâtre choisi de Rotrou, avec une introduction par M. Félix Hémon
Rotrou et son œuvre, ouvrage couronné par l'Académie française. Il comprend les
Sosies, Laure persécutée, la Sœur, St Genest, Don Bernard de
Cabrer e, Venceslas et Cosroès.
:
:
Le second est un Théâtre choisi de Boursault, précédé
d'une très substantielle notice biographique
Edme Boursault, sa vie et son œuvre dramatique, par notre collaborateur
Victor Fournel.
:
On y
trouve réunis: Esope à la
cure galant, Thaéton, les
le
Mots à
Esope à la cour, le Mermode, la Satire des Satires,
ville,
la
Jaloux prisonnier.
L'absence du Médecin volant et du Portrait dupeintre s'explique par la réimpression qui en a été donnée par M.
Fournellui-même dans ses Contemporains de Molière.
Nous
signalerons tout particulièrement à nos lecteurs
du rôle que joua Boursault dans la fameuse
l'explication
querelle de l'Ecole des femmes (p. xviii et suiv.).
Le Secret du MAsauE de
Fer. Etude sur
années de J.-B. Poqudin de Molière
les
dernières
(1664-1703), par Ubal-
LE MOLIÉRISTE
348
de (i), auteur de
et
la Profession de foi
d'Ubalde (Positivisme
Idéalisme).
C'est « avec la plus vive émotion » qu'Ubalde vient
apprendre à tous le nom véritable, si longtemps et si
vainement cherché de l'homme au masque de fer. » Ce
nom, comment Ubalde l'a-t-il trouvé ? Grâce à la méthode
a posteriori « cette clef de voûte des connaissances humaines. » Comme Pythagore, il a pu s'écrier avec transport:
Eurêka !
«
Les historiens du Masque de Fer, Carra, Paul Lacroix,
Marins Topin, Loiseleur, n'ont, paraît-il, vu goutte à la
question l'inconnu masqué de velours noir ne fut ni un frère
de Louis XIV, ni le comte de Vermandois, ni le duc de
Monmouth, ni Fouquet, ni Avedick, ni M. de Beaufort,
:
fils de Cromv^ell, ni Marchialy, ni Mattioli.
au masque de fer, c'est MoUère!
ni le
L'homme
Ainsi donc Molière ne serait pas mort le 17 février
1673, mais le 19 novembre 1703, octogénaire; il n'aurait
pas été inhumé au cimetière de Saint-Joseph, mais à celui
de Saint-Paul ; sa fausse veuve aurait été bigame et ce pauvre Guérin fils, enfant adultérin Que de révélations d'un
sans parler des chefs-d'œuvre à jamais perdus
seul coup
que dut ruminer Poquelin-Masque de fer pendant ces
trente années de captivité, à Pignerol, au fort d'Exilés,
aux îles Sainte-Marguerite, à la Bastille
!
!
!
Il
est regrettable
que l'auteur anonyme (un
officier
en
ne daigne pas nous dire comment on
supprima Molière, et comment il put passer pour mort
pendant les quatre jours qui séparèrent la ^^ représentation du Malade imaginaire des obsèques ?
retraite, croit-on),
Folie ou mystification?
Dans
les
deux
cas, triste, triste
!
DU MONCEAU.
(i)
Brochure
i883. Prix: 1
gr. in-8
fr.
de 32
p.
Bordeaux, Férct; Orléans, Herluison,
ERRATUM IMPORTANT
Les Stances peu connues
Amaranthe,
» publiées par
dernière livraison ont été
imprimées en 1845 dans l'édition d'Aimé Martin. Elles
ont figuré depuis dans les éditions Taschereau, Philarète
« à
M. Adolphe Brisson dans notre
Chasles, Moland, Hillemacher et Lemerre.
Voici, d'ailleurs, la lettre que nous adresse notre colla-
borateur
:
Mou
cher confrère,
Ainsi que je l'ai dit au début de mon article, les Stances galantes
ne sont nullement inédites. Je tiens à ajouter que quelques éditeurs,
entre autres MM. Hillemacher et Moland, les avaient déjà recueillies.
Mais on a présenté le morceau comme apocryphe. J'ai simplement cherson authenticité m'a semblé
ché à montrer qu'il ne l'était pas
ressortir d'un ensemble de faits, de coïncidences, de circonstances que
tel était l'objet de l'article auquel vous
je me suis efforcé de grouper
avez bien voulu offrir l'hospitalité.
;
:
Agréez,
etc.
A.
BRISSON.
18 janvier 1883.
M. Bous d'Anty, dans une petite note insérée au Figaro du
P. S.
22 janvier, conteste énergiquement l'authenticité des « Stances galantes. » Ses arguments, pour être savants , en sont-ils beaucoup plus
—
plausibles ?
Comment admettre avec lui que Jean Ribou, éditeur habituel de
Molière, eût osé dans son recueil publier des vers apocryphes signés en
toutes lettres de ce nom, quand il lui était si aisé d'en obtenir d'authenmais de
tiques ? D'un autre libraire la licence pourrait se comprendre
son éditeur ordinaire, le poète l'aurait sans doute fort mal accueillie.
Quant au caractère et au ton des « Stances », mon Dieu! Molière,
comme Racine était de son temps, et il a laissé couler de sa plume
maintes strophes qu'il eût agréablement raillées dans la bouche de
Trissotin. Je prends au hasard, dans un intermède du Sicilien :
Si du triste récit de mon inquiétude,
Je trouble le repos de votre solitude,
Rochers, ne soyez point fâchés.
Quand vous saurez l'excès de ma peine secrète,
Tout rochers que vous êtes,
Vous en serez touchés.
Franchement, l'occasion serait belle de railler, avec Alceste, « ce style
figuré dont on fait vanité. » Ces vers, cependant, sont bien authentiques ;
en sont-ils moins précieux? Ils sortent « du bon caractère et de la vérité, »
au moins autant que ces pauvres Stances galantes, impitoyablement
foudroyées par M. d'Anty.
A. B.
;
ÉPHÉMÉRIDES MOLIÉRESQUES
JANVIER
ifiS'.^
La Comédie-Française, officiellement fondée depuis plus de deux
la jonction des Troupes, occupait alors la salle de Gue.icgaud
(ancien jeu de paume de La Bouteille), rue Mazarine.
ans par
— Tartuffe. Recette
— Misantrope et Médecin malgré luy
Jeudi 14. — Ecole des Femmes
— Téléphonie et Cocm ?Wi7^/«<2/re
Vendredi
Samedi 16. — Amphitrion
Dimanche 17. — Téléphonte et Cocu imaginaire
Lundi 18. — Fascheux et George Dandin
Mercredi 20. — L'Estourdy
Jeudi 21. — L'Avare
Samedi 2 — PoMrceaug-nac et Crispin médecin
Mardi 26. — Plaideurs et Médecin malgré luy.
Mardi
Jeudi
5351. i5s.
5.
'/•
1
.
5.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.
.
.
.
760
3
563
10
954
627
10
5'
»
799
648
3i8
10
534
700
i5
5iii
»
»
»
JANVIER 1783.
La Comédie occupait alors, depuis neuf mois, la nouvelle salle du
faubourg Saint-Germain, élevée par Peyre et de Wailly sur les jardins
de l'ancien hôtel de Condé (aujourd'hui VOdéon).
—
Mercredi ^«^
Amans généreux et Po«rce^M^H<3C
jeudi 2.
Gouvernante et Alédecin malgré lui
Jeudi 9.
Femmes savantes et Vacances
—
—
Vendredi
10.
.
—Festin de Pierre
{i^'^
.
.
25gi
.
.
.
1.
3s.
621
i5
799
14
looG
4
début d'Armand
Verteuil dans S^anarelle).
Jeudi ïG.
Femmes savantes et Xwocat PatQlin
—
.
,
.
.
.
G. M.
-j-j-j
8
BULLETIN THÉÂTRAL
Comédie Française.
~ Dimanche
24 décembre 1882,
(MM.
Thiron^ Boucher, Martel, JoUet,
M'^"
Truffier, Le Bargy, Lenoir, Tronchet, Masquillier
Reichemberg, Barretta, P. Granger. M. Villain joue pour
Dimanche 31, matila première fois le commissaire).
née les Femmes savantes (MM. Delaunay_, Barré^ CoqueHn cadet, Joliet, Villain, Silvain, Tronchet, Masquillier ;
M"" Madel. Brohan, Jouassain, Barretta, Samary, Fayolle).
le
Dimanche 7 janvier, matinée et dimanche 14
Mariage forcé (MM. Martel, Johet, Villain, Truffier, Davrigny, Masquillier ; M''" Fayolle. M. Le Bargy joue pour
la i""^ fois Alcidas).
Lundi 15, 261^ anniversaire de la
naissance de Molière
le Misanthrope (MM. Delaunay,
Prud'hon, Boucher, Truffier, Joliet, Baillet, Tronchet,
le Malade
Masquillier; M"'"' Broisat, Tholer et Amel)
imaginaire (MM. Got, Thiron, Barré, Coquelin cadet,
Prud'hon, Martel, Tronchet, Masquillier ; M""'^ Jouassain,
Barretta^
Samary, la petite Aumont) et la Cérémottie (le
Samedi 27, les Précieuses Ridicules
prœses, M. Got).
(pour la rentrée de M. CoqueUn).
matinée
:
L'Avare
;
—
:
—
:
;
—
:
;
—
—
Lundi 15 janvier, pour l'anniversaire de
Odéon.
Molière Tartufe et le Malade imaginaire avec la Cérémottie. Entre les deux pièces, Tà-propos traditionnel
les Papillotes, petite comédie à trois personnages de MM. Léon
Valade et Jules Truffier. Le vieux comédien-poète Hauteroche, qui a probablement oubUé les railleries de Vlmpromptu de Versailles, a composé un Compliment à Molière:
son petit fils Hubert et sa nièce Madeleine
deux amoureux
en ont fait des papillotes; il s'agit de le remplacer:
heureusement le jeune Hubert est poète aussi ; il impro:
:
—
—
Ul MOLlèniSTE
352
vise
son compliment, qui
morceau des
est
certainement
le
meilleur
que nous regrettons de ne pouvoir citer, faute d'espace. Nous ne ferons qu'un reproche
à ces stances,, c'est que chaque strophe commence et finit
par un vers masculin. Il faut croire que cette licence n'est
pas contraire aux lois de la versification, puisque MM.
Valade et Truffier Font adoptée, mais l'oreille n'en est pas
moins quelque peu choquée.
Cet aimable badinage, lestement enlevé par MM. Noël
Martin, Amaury et M'^'' Real, a été redonné le lundi 22,
en soirée populaire, et le dimanche 28, en matinée, entre
^Papillotes, et
Tartuffe et le Malade, suivi de la Cérémonie.
Opéra-Comique.
Gaité.
les
— Sur
artistes
la
— Lundi
22 janvier, VAmour médecin.
proposition de leur camarade Talien,
la Gaîté ont voulu, eux aussi,
du théâtre de
fêter Molière le 15 janvier.
Belle Gahrielle, après le tableau
Dans un
de
la
entr'acte
de
la
prison, les Directeurs,
musiciens et la figuration se sont réunis
autour d'un buste de MoHère, que
M. Dumaine (Pontis) a couronné, après avoir dit une
remarquable pièce de vers de circonstance de M. Charles
Raymond Tartuffe triomphant, publiée par la Revue critique.
Une tombola improvisée, dans laquelle M. Clément
Just (Henri IV) a gagné le buste de Molière, a produit
une somme de 200 francs qui a été versée dans la caisse
de l'Association des Artistes dramatiques.
On ne pouvait mieux terminer que par une bonne action cette petite fête intime en l'honneur de celui qui fut
les interprètes, les
au foyer des
artistes,
:
la bienfaisance
même.
MONDORGE.
Imprimerie de Pons (Charent».Inférieare).
— Noël Texier.
aUATRIÈME ANNÉE
MARS 1883
NUMÉRO 48
LE
MOLIÉRISTE
%EVUE MENSUELLE
PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE
E.
Campardon,
J.
MM
Claretie, F. Coppée, V. Fournel,
:
J.
Guillemot
A. Houssaye, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,
J.
L01SELEUR,
Nuitter
L.
MoLAND, Ch. Monselet,
E.
Noël,
Picot
L.
de la Pijardière,
F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,
Ch.
,
E.
,
Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry,
E.
Thoinan, A. Vrru, etc.
PAR
Georges
M ON VAL
ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
PARIS
10,
LIBRAIRIE TRESSE
GALERIE DU THÉÂTRE FRANÇAIS,
1883
10
SOMMAIRE DU NUMÉRO XLVII
QUATRIÈME ANNÉE
V\A^rt/V»
TARTUFFE TRIOMPHANT,
— Ch. Raymond.
— G. Monval.
Poésie.
UN NOUVEAU MYSTIFICATEUR.
MOLIÈRE A MONTARGIS. — Th. Cart.
CORRESPONDANCE. — C. Port, F. Hillemacher,
DIX SUJETS TIRÉS DE MOLIÈRE. — V. Lardet.
— Du Monceau.
ÉPHÉMÉRIDES MOLIÉRESQUES Février
BULLETIN THÉÂTRAL. — Mondorge.
INDEX ALPHABÉTIQUE.
TABLE DES MATIÈRES.
A. Loquin.
BIBLIOGRAPHIE.
:
1683-1783.
—
G. M.
LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN
POUR TOUTE LA FRANCE
UN NUMÉRO
On s'abonne
:
— ÉTRANGER,
I 3
FRANCS.
UN FRANC 50 CENT.
du Théâtre
Français, ou par mandat sur la poste adressé à M. G. Monval,
79, boulevard de Clichy, auquel les manuscrits, communications,
à la librairie Tresse, io, Galerie
demandes
lettre affranchie.
et
réclamations devront être envoyés par
TARTUFFE TRIOMPHANT
A-PROPOS DIT LE l5 JANVIER l883, AU THEATRE DE LA GAÎTÉ,
PAR
M. DUMAINE.
O Molière, permets qu'un poète inconnu
Rappelle un de tes vers dont il s'^est souvenu ;
D^ autres plus dignement ont célébré ta gloire^
Mais aucun plus que moi ne chérit ta mémoire;
Nul n'a mieux pénétré les secrets de ton cœur
:
Vu ta chair saigner sous ton rire moqueur^
Tai souffert avec toi, bouffon, quand, ta grimace
D'un pleur encor brûlant dissimulant la trace,
J'ai
Tu
jouais ton
martyre
!
Oh ! comme il a germé
Le grain de la douleur dans ton âme semé !
Mais c'est là ta grandeur si ton mâle génie
:
N'avait pas épuisé la souffrance infinie.
Si r amour, secouant ton cœur comme un grelot.
N'avait mis dans chacun de tes vers un sanglot,
Tu n'' aurais pas connu la flamme surhumaine
Qui fait vibrer en toi V amant de Célimène;
Ton cœur n'eût pas laissé tes beaux vers pour témoins.
Et, fadmirant autant, nous t'en aimerions moins !
.
LE MOLIÉRISTE
356
—
Si la hideuse Envie
Ami, repose en paix.
Bavant sur tes écrits empoisonna ta vie ;
Si Tartuffe ose encor Jlétrir en toi l'acteur.
Nul n'écoute, aujourd'hui, ce louche détracteur
Qu'importe que le vent décharné des tempêtes,
Et, jaloux du soleil qui brille sur nos têtes,
Pousse des tourbillons de sable jusqu'au ciel ?
Le
vent retombe, et, seul, le soleil éternel
Continue à verser
la sereine lumière.
—
Ainsi fait ton génie, ô sublime Molière
Oh
! s'il
est
parmi nous un poète
!
irrité,
Qm'zV parle, car le Peuple a soif de vérité,
Nous
l'attendons
!
que sa voix
Il faut
retentisse,
Qu'il mette dans son vers l'éclair de la justice,
Qu'il soit notre Molière, et que ce fer lutteur
et V Imposteur !
Ecrase sans pitié V Infâme
Tartuffe est triomphant ; partout il règne en maître
Il n'est pas seulement dans la robe du prêtre.
Il s'est fait plus
Sur
moderne
:
:
orateur charlatan,
publique il vend l'orviétan.
Cachant ses appétits sous sa maigreur d'' apôtre.
Il se hisse au pouvoir sur Pépaule d^un autre ;
la place
démasque alors, et, devenu très gras.
Etale un abdomen qu^on ne soupçonnait pas.
Puis, quand le peuple vient redemander sa place,
Le Tartuffe à Vengrais Vappelle « Populace ! »
Et, le bâton levé, lui dit pour V avertir :
a La maison m'appartient ; c^est à vous d''en sortir
Il se
Charles
RAYMOND.
! »
UN NOUVEAU MYSTIFICATEUR
Notre vénéré doyen, M. Paul Lacroix, reçut,
an, deux lettres datées de
neur de nous
Bordeaux
communiquer
qu'il
aussitôt,
nous
il
fit
y
un
a
l'hon-
et qu'aussitôt
nous
fûmes disposés à suspecter publiquement, trouvant leurs
promesses trop belles
et
nous souvenant de
la fausse
cor-
respondance de Seine-Port, des faux manuscrits de Vrain
Lucas,
et d'autres mystifications célèbres.
Mais, en pareille matière,
il
est
b^n de
n'agir qu'avec la
plus extrême circonspection; nous nous étions donc imposé le délai d'un
deux
vie,
lettres
an, qui vient d'expirer.
Le
signataire des
de janvier 1882 n'ayant pas donné signe de
nous nous croyons en
droit d'imprimer sa prose
son nom, sans doute emprunté,
soit
pour mettre nos
et
lec-
teurs en garde contre les tentatives d'un mauvais plaisant,
soit
pour arriver à
la
découverte d'un trésor,
si
trésor
il
y
avait.
Voici
la
première
lettre
reçue par
le bibliophile
Jacob
:
LE MOLIÉRISTE
358
«
Monsieur P. Lacroix,
bibl.
de V Arsenal^ à Paris.
20 janvier 1882.
Monsieur,
J'ai
che^ M^'" Alvarès de Léon,
acheté, Pété dernier,
bouquiniste, un gros volume relié en parchemin avec
mu~
sique d'église notée en rouge et en noir, et contenant plusieurs manuscrits
grand format d'une ancienne écriture
:
L'Imposteur, comédie en trois actes.
Panulphe, comédie en cinq actes.
Le Festin de
y
comédie en cinq actes (en prose.
Pierre,
a un premier acte en vers, sur papier bleu
et
dhm
Il
plus
petit format, ajouté à la fin).
L'Amour
docteur, en un acte.
L'Homme
à bonnes fortunes, en cinq actes.
manquent
L'Atrabilaire, en 5 actes (les trois derniers
sont remplacés
par des feuilles de papier
Les comédies malheureusement s'arrêtent
du volume contient un long
et
là, et le reste
ennuyeux ouvrage sur
Nature, en prose et en vers mêlés
[i],
et
blanc).
la
copié avec beaucoup
de soin sur un côté, sans aucune rature. Les comédies, au
contraire, sont écrites des
deux
côtés, avec
des ratures
nombreuses. Le Festin de Pierre présente notamment des
pages entières barrées,
les comédies étaient de
et d'autres attachées
ensemble. Si
main de Molière! Je n'ose l'espérer ; je dois vous avouer même que le dernier ouvrage me
parait bien être de la
(i)
«
Vous
êtes
l'innocent
lu
d,
même
un méchant
comme
que Molière
la
écriture.
diable,
monsieur Rochefort, qui
disent les bonnes gens.
Vous
a traduit, précisément en prose et vers, de
De Rerum Naturâ de
faites
n'êtes pas sans avoir
nombreux
Lucrèce vous êtes fort au courant
des transformations du Tartuffe, et vous savez que le Misanthrope
est inscrit quelque part sous le titre de l'Atrabilaire amoureux.
passages du
;
LE MOLIERISTE
359
Pensant vous intéresser, je vous fais part de
vaille, et
vous prie d^agréer. Monsieur, toutes mes
Claude
ma
trou-
civilités.
ROCHEFORT,
Poste restante, grand bureau, à Bordeaux.
P. S.
— Toubliais
de vous dire que la première page
contient ces mauvais vers
«
»
»
»
»
•ù
y>
»
*
:
Ce livre est à moy
Comme Paris est au Roy.
En cas de perdition,
Charles Drouyn est mon nom.
Si tenté du démon
Tu dérobes ce livre,
Apprends que tout fripon
Est indigne de vivre. >
Sainct-Sulpice d'I^on
(i),
ce 7 febvrier
Réponse immédiate, comme bien pensent nos
iy3i.
lecteurs,
de l'excellent bibliophile Jacob, qui reçoit, par retour du
courrier, la lettre suivante
:
Ce 23 janvier 1882.
Monsieur,
On
vient de
me remettre
votre obligeante lettre. J'ai au
commencement du mois prochain un voyage à faire dans le
département du Nord. Je m'' arrêterai quelques jours à Paris, et f aurai l'honneur de venir vous communiquer moi-
même
le
volume manuscrit en question.
Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur, avec mes vif^
remerciements, toutes mes civilités.
Claude
{i)
la
Saint-Sulpice d'Izon
Gironde,) à k)
kil.
et
ROCHEFORT.
Cameyrac, (aujourd'hui département de
de Bordeaux.
LE MOLIÈRISTE
360
Six mois
s' étant
écoulés sans que
entendu parler du voyageur
une dernière
écrit, le
28
diquée
et cette lettre
;
réclamée,
juillet,
nous a
29 septembre
le
M. Paul Lacroix
ait
de sa trouvaille, nous avons
et
lettre à la seule adresse in-
comme non
été retournée,
suivant, par
le
bureau des
rebuts.
Qu'y
de vrai dans
a-t-il
connue de
la
place de l'Hôtel de
dame ne
cette
de M.
les allégations
Le nom de M"" Alvarès de Léon,
fort?
la
ville, à
se souvient d'avoir
Roche-
librairie
bien
Bordeaux. Mais
vendu aucun manuscrit
répondant au signalement indiqué.
Quant au Charles Drouyn, de Saint-Sulpice d^Izon, qui
aurait possédé ce livre
stater
que ce
nom fut
en 173
1,
nous nous bornerons à con-
celui d'une famille
de comédiens, dont
quelques membres ont appartenu au Théâtre-Français (i).
Georges
MONVAL.
(i) Drouin (Jean-Jacques-François), né à Paris, le i" octobre 1716,
débuta en 1744, après avoir couru la province et appartenu à l'Opéra-
Comique.
Mme Drouin,
Enfin, la
sœur
et
sa
femme,
jouait les rôles de suivantes et les caractères.
femme du fameux
Préville était
belle-sœur des précédents.
une demoiselle Drouin,
MOLIÈRE A MONTARGIS.
En feuilletant, il y a quelque temps, à la bibliothèque de Montargis, un ouvrage manuscrit, composé par
Boivin et
tome n,
intitulé
sur
un
:
Notices sur Montargis,
feuillet intercalé
j'ai
trouvé,
page 708,
à la
la
au
note
suivante. Malgré la singularité de sa rédaction, je puis garantir l'exactitude de la copie qui en a été prise
«
Dans
le
» atnhulants,
:
courant de l'hiver 16 J 2, une troupe d'acteurs
au nombre de ij à 16, vinrent donner quelques
» représentations ; cette troupe était sous la direction de Molière,
» et
parmi
» Béjard,
ses
acteurs
on
distinguait
Lagrange, T)uparc, Af""
» reçur) (i)
un d'eux
reçut
même
des
les
T)ucroisy,
sieurs
Béjard,
Duparc.
pommes à
la figure,
(ils
ce
» qui est la preuve de sa bonté.
» (^Molière composait alors
»
M*
de ikT'^ de Montpensier.) »
Cette note n'a été écrite qu'au
tre siècle.
La
collection Boivin
P Etourdi.
commencement de no-
n'a d'ailleurs
été
formée
qu'en 1840 sur des documents authentiques (?) épars dans
[i)
Ces deux mots sont
biffés
dans
l'original.
--^
362
les
greniers de
la
la
On
mairie.
pièces dont s'est servi
crétaire de
MOLIÈRISTE
n'a
aucune des
retrouvé
M. Boivin. Monsieur Mouflet,
mairie de
se-
Montargis, à l'amabilité duquel
nous devons ces derniers renseignements,
a
bien voulu
aussi parcourir les archives de l'époque.
Il
cune mention de Molière. Monsieur E.
Camus, receveur
n'a trouvé au-
de l'hospice de Montargis, a vainement cherché, dans ses
trace de représentations théâtrales en
registres,
1652
à
Montargis.
comme
D'autre part, cette note ne se trouve pas,
l'au-
teur semble l'indiquer, dans les Mémoires de Mademoiselle,
ni dans
que
j'ai
aucun des nombreux autres mémoires de l'époque
consultés. Enfin,
grave, soit au
et c'est là ce
commencement de
revenait de Poitiers
(si,
ce dont je doute,
à la fin de l'année, quand,
il
y a de plus
quand MoUère
qu'il
1652,
se rendait à
y est allé), soit
Lyon, la troupe
il
ne comptait point encore parmi ses membres
Du
Croisy
et
les
sieurs
Lagrange.
Cette pièce m'a paru cependant, malgré son invraisemblance, assez curieuse pour être publiée dans le Moliériste.
Un
autre chercheur sera peut-être
et saura
en
tirer
plus heureux
un renseignement exact sur
les
que moi
pérégri-
nations de Molière.
Th.
CART.
CORRESPONDANCE
I.
Cher Monsieur Monval,
Je viens de
lire l'assaut
vois pas qu'il ait tout à
nouveau du «Provincial.» Je ne
fait tort, si la
forme. Les
extraits
que vous
des Satyres,
lancée
en 1666,
nom
de Trissotin
le
rôle et le
t-on
que Molière
donner
la
ait
et Boileau, fait-il
du
Moliériste.
Femmes Savantes
qu'il
provoque
et harcelle
et
Il
y
a
mieux à
en
tirer,
Molière
?
M.
Livet,
126, avait cité de
pour
très-singulier,
certaines
?
lui-
direct d'au-
Ménage
Précieuses, p.
deux passages reproduits par
petit Uvre, très-curieux,
très-spirituel,
suffisance
années de réflexion pour
Boileau et à Molière contre
Ménagerie
Satyre
mais comment explique-
un appel, voire un emprunt
dans son livre Précieux
la
pris six
;
la
plus étrange encore — comment Cotin
même, en même temps
torité, à
de
justifient certes à
réplique au libelle dans ses
Et-ce qui est
question se trans-
lui fournissez,
la
polémique
la cause,
de ce
en certaines pages
autres odieux et
méprisable,
au demeurant très rare, sans heu ni date, de 92 pages,
fait
de pièces et de morceaux, un seul et
le
pire daté de
1660, l'œuvre entière, croit-on, publiée en 1666. L'auteur
y prend à partie
et vise
d'une épigramme chaque ridicule
364
de
MOLIl'-RlSTE
l.H
son ennemi. C'est
sonnet de
le
la
page 59
que
je
vous veux signaler:
Galantiser en sotane et calote,
le fardeau des ans,
Pédant rival des jeunes courtisans,
Des visions est bien la plus falote !
Le dos courbé sous
L'abbé Cotin s'en moque à haute voix,
Boileau sous cappe, et le gaillard Molière
Promet de vous une farce aux bourgeois.
Sans autre souci de ce que cette citation vous pourra
dire,
je
crois qu'elle
encore dans
mérite d'être recueillie, n'étant pas
la circulation.
Groyez-moi, cher Monsieur, votre bien dévoué,
CÉLESTIN
PORT.
n.
A
Monsieur
Directeur du Moliériste.
le
Monsieur,
Permettez-moi d'ajouter quelques mots à tout ce qui
s'est dit à
Franchement,
si
controversé du Misanthrope
bon
à
a disserté à perte de vue
;
«
On
propos du vers
gnes à
l'effet
votre
dernier
—
Il
est
mettre au cabinet.
on
numéro
passe
en rechercher
me
du mot
en revue tous
le
»
monta-
a entassé des
d'interpréter la signification
lexiques pour
présent.
il
sens
cabinet ;
anciens
les
précis dans
semble qu'avant de s'acharner
:
le
cas
ainsi sur
LE MOLIÉRISTE
365
*
un mot,
faut s'attacher h la contexturé grammaticale
il
phrase où
la
vous
il
figure.
Examinons donc en peu de mots,
si
voulez bien, quelle est l'intention que l'auteur a
le
prêtée au personnage,
ment
de
nous conduira naturelle-
cela
et
à déterminer la portée de l'expression
dont
il
s'est
servi.
Alceste, ce philosophe qui dit à tout le
et qui
comprendre
fait
son style
est détestable,
monde son
un poète (gens
à
le
lui
fait,
que
irritabile)
marque par une boutade
qui témoigne crûment de sa mauvaise humeur.
Remarquez
mot
le
franchement
qu'on dé-
c'est ainsi
:
bute lorsqu'on va s'exprimer, à propos de quelqu'un ou
de quelque chose, d'une manière excessive
On
dira
franchement, cet
:
on
avoue^-k
;
chement,
il
homme
est
un
et défavorable.
c'est-à-dire,
sot,
ne dira guère, dans le sens habituel
a beaucoup d'esprit; ce mot, qui est
de
même
de ce qui suit
c'est-à-dire,
singulier que,
parmi
le
:
est
sonnet est bon à mettre
au
bon qu'à cela.
n'est
franchement,
les objets
Nous
il
il
fût
bon à
Il
paraîtrait
Il
serrer avec soin
auxquels on attache du prix.
arrivons tout droit au cabinet, et je ne vois pas de
conséquence plus
directe.
face en protestant contre
et qui^ disent-ils,
quons que dans
les
— Les pudibonds
la
connue, puisque
:
certains
les
choque,
les diction-
passent sous silence. Or, remar-
ouvrages de ce genre (les bibliographes
le savent) la précision n'était
loin de là
se voilent la
une acception qui
n'était pas
naires contemporains
et
fran-
en
caution oratoire, ne viendrait pas sur les lèvres.
cabîiïet,
:
une pré-
les dictionnaires
pas absolue dans les détails,
mômes
mots vulgaires y
étaient des à-peu-près,
étaient négligés.
D'ailleurs
LE MOLIÈRISTE
366
Furetière cite le cabinet sous l'acception en question, et
cela
peu de temps après
mort de l'auteur
la
croire qu'elle ne sortait pas toute
;
et
est à
il
armée de son cerveau
et qu'elle était usuelle.
Au
près,
il
doit pas
s'étonner de rencontrer
façon de parler dans Molière
cette
n'est
on ne
surplus,
l'a
il
que
n'est pas à
Le
des
mœurs
de
confortable, ce luxe
à
la société,
Tépoque où
des temps modernes, et
par suite, la ^rmWfe dans-certaines énonciations,
m' exprimer
ainsi, n'existaient
seraient ébouriffés
nages
qualifiés,
vêtus d'or
et
de
soie,
— On
en usaient au
n'est pas plus difficile
Si
je
rencontre quelques personnes qui voient
je
m'en applaudirai
abandonnerai volontiers
a
on
murs.
moi,
le
puis
pas encore, et nos puristes
convenable, ou du moins
aujourd'hui/ on est plus
l'affiche sur les
je
si
du sans-façon avec lequel des persçn-
Louvre ou au Palais-Cardinal.
comme
cela
prouvé dans plus d'une rencontre. Ce langage
le reflet
écrivait.
il
;
misanthrope
Franchement,
il
;
dans
mon
comme
le cas contraire,
petit
factum,
et
je
je leur
dirai,
:
est
bon
à mettre
au cabinet!
»
Agréez mes compliments empressés.
Frédéric
8 février i883.
HILLEMACHER.
LE MOLIÉRISTE
367
m.
Bordeaux,
Monsieur
Dans
M.
le
février de
votre excellente revue,
termes
en
Loiseleur m'attribue,
Jules
février 1883.
Directeur du Moliériste,
numéro de
le
5
courtois
et
bienveillants, mais clairs et ne présentant rien d'ambigu,
la paternité
de
brochure intitulée
la
le
du Masque de
Secret
Fer, par Ubalde, publiée le mois dernier à Bordeaux par
la
maison Féret
et
fils.
J'avoue parfaitement que
et qui ai
la
déposé chez
recherche de
merci, jamais
c'est
les libraires ladite
en
paternité,
la
imprimer
ai fait
Comme
brochure.
littérature,
n'a,
permise l'attribution en question, de quelque façon
mative qu'elle
soit d'ailleurs présentée. Je
l'auteur de cette brochure
;
côté à désigner cet auteur,
champ des
Dieu
ne puis trouver que très
interdite, je
été
moi qui
affir-
ne m'avoue pas
mais, n'ayant pas d'un autre
ne puis que
je
conjectures. Après tout, les
laisser fibre le
pseudonymes ont
toujours été employés dans les lettres, soit pour une raison,
soit
pour une autre,
même
contient
nasius,
que
et
n'allons
je
un
soupçonne
pas
tomber
nous reprochons, non
Puisque
je suis
l' assentimeyit
votre dernier
!
très fort d'être...
me
à
cette
que
chez autrui.
peu près, dans votre
esti-
permettre de vous envoyer,
,
les
ob-
:
L'estimable bibfiothécaire de
et
lui-
Matha-
le travers
complet de l'auteur de la brochure
servations suivantes
flair
II
Mais, halte-là!
dans
que nous signalons,
nommé, ou
numéro
d'un docteur
à notre tour
mable revue, voulez-vous
avec
et
spirituel article
ma
ville
natale, avec ce
habitude qui n'appartiennent qu'aux vrais
368
LE MOLIÊRISTE
travailleurs,
résume
heureusement, en quelques lignes,
fort
les principales raisons (je n'ose dire les principales
prcuves)>
au nombre de quatre, présentées par M. Ubalde à l'appui
de son hypothèse, très hardie sans doute, mais pas plus
absurde
et
même
foule d'autres
beaucoup plus vraisemblable qu'une
:
MoUère, mort
1°
le
17,
ne
fut
inhumé que
le
21
au
soir;
2°
L'inhumation se
fit
de présenter son corps à
religieuse
à nuit close, et on évita surtout
l'église et
de
faire
une cérémonie
;
3° L'acte de décès
ne
fut signé
d'aucun témoin, con-
trairement aux intérêts de mademoiselle Molière^ expressé-
ment
4<*
spécifiés et
expUqués par M. Loiseleur
De
la
toute
correspondance de
;
Molière,
aucune
pièce n'a jamais pu être retrouvée.
Voici quatre
évidents, dont
faits
les
causes n'ont pas, que nous sachions,
encore été sérieusement recherchées.
rait-il
Ne
vous semble-
pas grandement temps qu'ils fussent enfin élucidés,
avec tout
le
soin désirable, par les dévots à Molière, au
nombre desquels
mission de
me
je
vous demande, en terminant,
compter
que
vous voudrez bien
faire
l'honneur d'insérer cette réponse à
dans
votre prochaine livraison, et je
me
per-
la
?
J'ose espérer, Monsieur,
bien
parfaitement
parfaitement certains,
M.
J.
me
Loiseleur
vous prie de vouloir
croire votre respectueux serviteur,
Anatole LOQJJIN,
'De l'Académie des Sciences, Belles
de Bordeaux.
lettres et
Arts
DIX SUJETS TIRÉS DE MOLIÈRE
POUR PAPIERS DE TENTURES.
Un
collectionneur a recueilli, quoique dans un grand
de délabrement, dix sujets tirés des pièces de Molière
et exécutés en forme de médaillons. Ces sujets sont la reproduction de dessins originaux de quelque artiste décorateur de l'époque du premier Empire ou de la Restauraration. J'ignore s'il en existe une suite plus nombreuse, et
voici la désignation de ceux que j'ai sous les yeux:
état
1°
...
Le
TDépit
a C'est
2°
amoureux;
une fausseté digne de ce supplice.
» (Il
déchire
la lettre).
Le Mariage forcé ;
« Ah! nous parlions de vous et nous en disions tout le bien qu'on
en peut dire. «
3° Don Juan;
V S'il vous a vue la première, il m'a vue la seconde. »
4° Le MisantJjrope ;
( Pourquoi désavouer un billet de ma main ? »
5° Z^ Tartuffe;
« Tout doux! vous suivez trop votre amoureuse envie. »
6° L'Avare;
» Montre-moi tes mains. »
7° Monsieur de Pourceaugnac;
«
Me
guérir
?..
»
8° Les Fourberies de Scapin;
i
Scapin,
il
faut te rendre à cela. »
Les Femmes savantes ;
€ Sonnet à la princesse Uranie. »
10° Le Malade imaginaire;
t Ah
insolente! il faut que je t'assomme.
<)°
!
Ces
»
en couleurs, dont l'exécution est très
composition n'est pas sans quelque mérite, paraissent avoir été retirés d'un vieux paravent, à en
juger par quelques lambeaux de toile adliérant encore au
papier. Le Scapin surtout m'a paru magnifique de dédain,
devant Léandre à genoux.
Chaque médaillon a 55 c. de diamètre; la hauteur
moyenne des personnages est de 30 c. au i" plan.
sujets, tirés
soignée et dont
la
Victorien
LARDET.
BIBLIOGRAPHIE
— La
Le Molière-Moland.
promesses
maison Garnier
tient ses
se hâte de compléter
son édition des Chefsd'œuvre de la littérature française. Les tomes VI et Vil
viennent de paraître. C'est d'ahordTartufe, avec la préface,
etles placets; la Lettre sur l'Imposteur et la Critique du TarPuis Don fuan, suivi de la polémique relative au
tuffe.
et
« Festin dePierre^ » les Observations,
la. Lettre sur les ObserRéponse; enfin les Fragments de Molière, par
Champmeslé, qui remirent au théâtre la scène de Char-
vations,
la
et celle de M. Dimanche, à une époDon Juan de MoHère n'était plus au répertoire.
Le tome VII donne le texte espagnol d'El burlador de
lotte et
de Pierrot,
que où
le
Tirso de Molina, le Fils criminel, de De VilCmvitato di pietra, scénario de Dominique, et le
Festin de Pierre, en vers, deThomasCorneille.il comprend
en outre l'Amour médecin et le Misanthrope suivi de la lettre
de De Vizé.
Nous avons lu avec le plus vif intérêt les notices et les
notes de notre collaborateur M. Louis Moland.
Sevilla, par
liers,
le
Œuvres complètes de Molière.
bon marché,
— Encore une nou-
soigneusement imprimée, sur papier teinté, en caractères elzéviriens. 4 vol.
in-i2. A la librairie Bloud et Barrai, 4, rue de Madame.
Prix, franco-poste : 8 francs.
velle édition à
Les Papillotes.
de M. Léon Valade
Tresse (i).
très jolie,
— La brochure
[et J.
du charmant à-propos
Truffier] a paru chez l'éditeur
On se souvient peut-être que, dans notre précédente livraison, nous avions reproché aux auteurs d'avoir commencé
et fini
(1) I vol.
chaque strophe de leur compliment à Molière
in-i8 br. Prix
:
i
fr.
50.
.
LE MOLIÉRISTE
37 1
par une rime masculine. Tous deux en appellent à Boileau lui-même, auteur des Stances si connues :
En
vain mille jaloux esprits
dont chaque strophe commence et finit aussi par un vers
rnascuhn. C'est « à dessein » que les deux auteurs àes Papillotes ont « fait choix d'un moule classique, afin de ne
» pas tomber dans un rythme trop moderne. »
A la
—
bonne heure
mais j'en crois encore plus mon oreille que
Boileau lui-même, et je reste toujours pour ce que j'en ai dit.
!
Les premières de Molière.
— Sous
ce titre alléchant,
M. Alphonse Leveaux vient de pubHer, à Compiègne (i),
un simple tableau chronologique des pièces de MoHère,
agrémenté
d'extraits des Anecdotes dramatiques,
de Clément
et Delaporte.
—
Deutschlands Urteil uber Molière.
Cq Jugement de
r Allemagne sur Molière, par M. le D''C. Humbert, deBielefeld, vient de paraître à Oppeln, chez Georg Mask, en
un volume in-8 de 206 pages. C'est le pendant du Jugement de l'Angleterre sur Molière (Gulker, 1878) et le complément de Molière, Shakspeare et la critique allemande
le i"(ié70(Teubner, 1869). Il se divise en deux livres
1770), où nous trouvons Schlegel et Lessing; le 2* (17701808), comprenant Klopstock, Herder, Schiller, Engel,
Wieland, Arndt et Becker.
:
C'est là
un
très curieux ouvrage, qui mériterait d'être
traduit dans la -langue de Molière, de jour en jour plus fa-
milière aux Allemands tandis que la leur.
.
—
Qui l'eût cru ? Le journal « Ix
Molière a Manitoba.
» du 8 janvier dernier, annonçait que le cercle
Provencher ou club dramatique de Saint-Boniface se préparait à jouer du Molière.
Le Manitoba est l'organe de la population catholique,
Manitoba,
française et métisse des bords de la
(i) Irap.
H. Lefebvre, 1882, in-8 de 29
Winnipeg.
pp., papier de Hollande.
le molieriste
372
Molière lisant son Misanthrope a l'auberge du MouLe charmant tableau de J.-B. Trayer
(1867) qui porte ce titre et appartient au musée de La Rochelle, n'était guère connu jusqu'ici que par la photographie, exposée au Jubilé de 1873, et par un très médiocre
bois du petit illustré la Famille. M. E. Pirodon, l'habile
ton-Blanc.
—
depuis 25 ans, a popularisé tant d'œuvres de
donc de remplir le vœu de nombre d'amateurs en publiant une très remarquable lithographie de
cette scène célèbre. Je sais plus d'un moHériste qui voudra
décorer sa salle à manger de ce gai tableau d'intérieur, où
l'on voit attablés Molière, Corneille, La Fontaine, Boileau, Racine et Chapelle.
On trouve la lithographie de M. Pirodon chez M. Bulla,
éditeur d'estampes, 14, rue Chaptal. Chaque épreuve,
soigneusement tirée sur chine par l'imprimerie Lemercier,
est du prix de 10 francs.
artiste
qui,
maîtres, vient
—
Sous ce titre, M.
Molière auteur et comédien.
Léon Dumoustier vient de publier, chez MM. Laplace et
Sanchez, une étude sans prétention sur la vie et les œuvres
du Maître. Nous n'aurions qu'à louer ce petit livre, ré-
sumé
facile de travaux sérieux, s'il ne renfermait, à côté de
nombreuses fautes typographiques, des conjectures passablement hasardées de la part d'un auteur qui a pour but
de mettre son sujet à la portée des gens au monde. Ce
public est sans défense, n'étant pas enclin à contrôler les
renseignements qu'on lui donne. Nous devons être d'autant
plus sévères, et déclarer que ce livre aura besoin d'être
revu et corrigé pour mériter de prendre place dans une bi-
bliothèque moliéresque.
—
J.
Le premier fascicule de l'édition monumentale dont M.
Lemonnyer a eu l'heureuse pensée de confier l'exécution
MM. Léman
A. de Montaiglon pour
Hérissey pour la typographie,
vient de paraître. C'est VEtourdi, superbe volume gr. in4, du prix de 20 francs. Nous le décrirons comme il le
mérite dans notre prochaine livraison.
à
le texte
et les
pour
l'illustration,
notes,
et
DU MONCEAU.
—
ÉPHÉMÉRIDES MOLIÉRESaUES
FÉVRIER l683
Lundi
— Fascheux, Médecin malgré luy ....
II. — Bourgeois Gentilhomme
18. — A Versailles Despit amoureux (MM. de La-
^87
I»'.
Jeudi
Jeudi
Grange, Rosimont, Guérin, Dauvilliers, du Croisy,
M"es Guérin, de Brie, Guyot, de
Brécourt, Verneuil
La Grange)
!.
los.
488
lo
(à la
Cour)
:
;
—
—
—
—
—
Virginie, Escarbagnas
Samedi 20.
Virginie, Escarbagnas
Lundi 22.
Mercredi 24.
Virginie, Mariage forcé
Misanirope et Fascheux
Jeudi 23.
Vendredi 26.
Yngims, Mariage forcé
Wirginie, George Dand in
Dimanche 28.
746
822
i33i
11
94
1208
r338
5
b
5
i5
i5
io
FÉVRIER 1783
—
—
—
trion
Mardi 25. — A Versailles Tartuffe et les Aveux difficiles
Jeudi 27. — Ecole des Maris et le Roy de Cocagne (la
Mardi 4.
Ecole des femmes et Médecin malgré luy.
(Dugazon joue le Notaire, Enrique et Sganarelle)
Mardi II.
Cvisp'm médec'xn et Médecin malgré luy.
Mardi 18.
A Versailles: Ecole des Maris et Amphi.
.
.
:
de Vermilly a joué
début)
délie
pour son
le rôle d'Isabelle
462
447
10
10
(à la
(à la
Cour)
Cour)
6^
2675
»
G. M.
BULLETIN THÉÂTRAL
—
Samedi 27 janvier les PréCoquelin, Barré, Coquelin cadet,
Boucher, Roger, Villain, Davrigny, M""" Samary, Bianca,
Dimanche 28, matinée le Misanthrope (MM.
Martin).
Delaunav, Prud'hon, Boucher, Johet, Villain, Truffier^
Baillet ; M""'^ Broisat, Tholer, Amel) et le Malade itnagiCoMÈmE-FRANÇÀiSE.
cieuses ridicules
—
:
(MM.
:
MOLIÈRISTE
'^E
374
(MM.
Thiron, Barré,
Coquelin cadet,
Prud'hon,
Samary,
Le soir Tartuffe (MM. Boucher, Marpetite Aizmont).
tel, Joliet, Dupont-Vernon, Villain, Baillet, Leloir; M"*"
Reichemberg, Samary, Lloyd, Amel).
Mardi 30 et
jeudi I" février les Précieuses ridicules (M"^ Kalb joue pour
la première fois Cathos).
Dimanche 4 février, matinée:
VEtourdi (MM. Coquelin, Coquelin cadet, Garraud, Boucher, Martel, Joliet, Baillet, Davrigny: M""' Martin, FayoUe);
le soir, les Précieuses Ridicules.
Mardi gras 6, l'Etourdi
et le Malade imaginaire avec la Cérémonie (M. Got joue
Purgon et le Prœses).
Samedi 10, les Précieuses ridicules.
Dimanche 11, matinée les Fourberies de Scapin (MM. Coquelin^ Garraud, Joliet, Roger, Truffier, Baillet, Davrigny ;
M"'" J. Samary, Thénard, Frémaux).
Dimanche 18,
matinée les Précieuses ridicules (M. Garraud joue pour la
Gorgibus).
Mardi 20, Amphitryon (M"^ Amel,
i""^ fois
joue pour la i""* fois Cléanthis), et les Fourberies de Scapin.
Dimanche 25, matiJeudi 22, le Dépit amoureux.
née, le Mariage forcé.
naire
Martel, Joliet, Roger;
Jouassain, Barretta,
M'"'^^
—
:
—
:
—
—
—
—
:
—
:
—
—
—
Odèon.
Papillotes,
— Dimanche 28
le
janvier,,
Malade imaginaire
29, soirée populaire
:
Tartuffe,
:
lade imaginaire Qi la Cérémonie.
le
Malade
17,
le
et
la
—
les
—
—
'
Papillotes,
— Dimanche
11,
le
Ma-
Tartuffe,
—
M""
les
Lundi
Lundi 5
Du mardi 13 au samedi
(MM. Amaury, Kéraval, Peutat;
Cérémonie.
Dépit amoureux
Tartuffe^
:
Fourberies de Scapin.
les
février, soirée populaire
matinée
et la Cérémonie.
Dimanches 18 et 25, matinées
Real et Pinson).
Tartufe, le Malade imaginaire et la Cérémonie, spectacle
qui réalise les plus fortes recettes possibles avec le tarif
réduit des représentations populaires.
OpÉRA-CoMiauE.
r Amour
tnédecin,
de
:
— Lundi gras
MM.
5 et dimanche 25 février,
Poise et Ch. Monselet.
—
Samedi 27 janvier, conférence
Salle des Capucines.
de M"^ Marie Dumas Montfleury et son théâtre.
:
MONDORGE.
,
5^:
INDEX ALPHABÉTIQUE
Bayle 291.
Beaumarchais 197.
Alexandre 99.
(père et
Beauvais 79.
Beffara 21 3.
Béjart (Armande) 28, 71 7^1
I 5i, 208, 3x6.
Béjart Madeleine) 3o, 238,
325, 36i.
Béjart (Geneviève) 22.
Béranger 82, 272.
Blondet 277.
Boileau Despréaux 1 1
i58.
246,265,291, 3 14, 363, 371:
Boileau iPuymorin) 265, 295.
Boileau (Gilles) 238.
Bosse (Abrahami 238.
(P)
Bossuet 40.
Allouard (Henri) 176.
Amour docteur [V] 358.
Amour médecin (V) 95, 224,
287, 3i4, 352, 370. 374.
Amours de Gombaud
Macée (les) 3o, 346.
Amphitryon
et
de
26, 3i, 69, 35o,
373.
Arnolphe de Molière (V) 3o, 62.
Asselin (Marie) 3o5.
Atrabilaire amoureux (Pi 358.
Aubignac (Fabbé d') 234.
Aubry
Avare
fils) 22.
26, 3o, 3i, 63, 87,
160, 175, 25i, 253,
119,
287, 314, 35o, 35i, 369.
Avignon 324.
5
Boucher i33.
Boulan (Gérard
Bourdon
du) 28, 228.
(Sébastien) 319.
Bourgeois gentilhomme
B
27, 175, 249, 267, 373
Boursault 10, 347.
Ballet des Muses (le) 209.
Baluffe (A.) 28, 319.
Balzac 234.
Banquet-Molière 263, 3oOj
334.
Barbier de Maynard 29, 278.
Brossette 298, 3i5,
Barbier de Séville
Brouchoud
(le)
Baschet (A.) 283.
Baudelet (René) 1 16.
197.
Boyer
(l'abbé)
106.
Boysse (Ernest) 23o.
Boyvin (Fabbé 4
Brissart i3i.
Brisson lAd.) 317, 349.
(G.)
74, 218.
(le)
LE MOLIÈRISTE
376
Deschanel
Cailhava
3, 21 3.
Campardon
(E.) 78.
Cart (Th.) 60, 362.
Cercle de la critique
2T
177,
I.
Chabrol de Volvic
Dujon
6.
Cimetière
St-Joseph
160, 218.
Claretie (Jules)
175.
(le)
3,
i53,
26, 61,
Comtesse d'Escarbagnas
Continuateurs de Loret
274.
(L.)
,
372.
Du
Du
Parc 218, 36i.
Parc (M°"«) 101,208, 218,
36t.
Dupont- Vernon 186.
(la)
27, 373.
Ecole des Femmes
(les)
10.
Coquelin aîné 3o, 32, 62, gS,
288.
Corneille (Pierre) 5, 47, 108,
167, 234, 3ri.
Corneille (Thomas) 167, 370.
Cotin (Pabbé) ii3, 157, 179,
2i5, 246, 264, 291, 363.
Courtois (L.) 28.
Coypel 190.
Cressé (Marie) 212, 3o2.
Cressé (Louis) 3o3,
Critique désintéressée (la) 1 79,
2i5, 292.
{!')
26, 3o,
62, 192, 3i6, 35o, 373.
Ecole des Maris [V] 26, 3i,
i83, 314, 373.
Ecran du Roi
[V]
224.
Elomire hypocondre 92, 145.
Enigme
d'Alceste (1') 28.
Estienne (Henri) 338.
Estreicher (Ch.) i5o.
Etourdi
Fâcheux
(P)
146, 35o, 372.
(les)
210, 260, 35o.
Farce des Quiolards (la) 267.
Fauconneau - Dufresne (Dr)
159.
D
Daremberg (D'
(A.)
Dumoustier
Châteauroux iSq.
Chorier (Nicolas) 73.
gS.
(E.) 62,
Dumas
Chapelle 295.
(E.) 32, 64,
Desenne i35.
Don Garde de Navarre 29.
Don Juan 32, 336, 35o, 369.
Drouyn, 359, 36o.
Dufresnoy 327.
Félibien 340.
Femmes savantes
G.) 278.
Depioî 92.
Dépit amoureux 29, 3r, 94,
(les) 27, 87^
94, ii3, irg, 128, 157, 160,
186, 192, 223, 247, 253,
293, 35o, 35i, 369.
Fénélon 36.
Festin de Pierre, 358.
128, 175, 224, 253,
314, 369, 373, 374.
Depping (G.) 3o3.
Fontenay-le-Comte 72.
Foulquier 137.
Fouquier (Achille) 93.
Dassoucy 325.
De Brie
Delamp
(M«"«) 3o, 208.
(C.) i52, 210.
287,
vh
LE MOLIÈRISTE
Fourberies de Scapin
(les) 26,
27, 3i, 175, 223, 36g, 374.
Fournel (Victor! 122, 347.
Jalousie de Barbouillé
Johannot ^Tony) i36.
Fournier(Edouard) 249, 280.
Friedmann
(la)
27.
(D^ A.) 253, 288.
Furetière 344, 366.
La Borde (de) 4.
La Bruyère 47.
Lacour (Louis) 27, 92.
Gaucher (M.) 88.
George Dandin 192,278,350.
Gloire du Val de Grâce (la)
Lacroix (Paul) 4, 10,26,28,71,
ii5, 124, i5i, 157,
264, 3oo, 334, 357.
Laffemas 3o2.
La Fontaine 3, 272.
La Grange io3, 126,
33o, 36i.
Lalauze 137.
323.
Grimarest i5i, 261,
3 16.
Guérin d'Estriché 75.
Guérin tils 124.
Guéroult (G.) 120.
Guichard 24.
Guiffrey
Guillaume
Guizot
Lapommeraye(H.
3o, 346.
iEug."! 176.
(J.-J,i 6,
Laprade
Lardet
H
335.
I
Homme
d'I
à bonnes fortunes
I
j
I
(P)
Houdon
(P)
!
99.
319.
Houssaye
(A.)
Humbert
(G.),
217.
371.
358.
de Versailles
Legrelle 62.
Leloir (L.) i38.
(Jacques) 286, 372.
Lenient (Gh.) 232.
Lenoir (A.) 4, 21 3.
Leveaux (A.) 371.
Leys iL.) 87.
Littré 123.
Livet (Ch.)
(1'),
Impromptu
145, i5i.
Lebrun 328.
Legouvé iE.i 181.
Limoges 159.
I
Imposteur
Le Boulanger de Ghalussay
Léman
358.
Hôtel de Bourgogne
(V.)
La Rounat
I
142, 281.
Hillemacher (F.) i36, 366.
Holberg 62.
Heylli (G.
de) 28, 177.
(V. de) 93.
369.
tCh. de) 178, 211.
Laverdant (G. D.) i23.
i
j
(G.)
179,
I
(G.) 3 18.
Herbert
2i5,
(1')
10, 332.
Inscriptions parisiennes Comité des) 116, 177,210.
Intermédiaire des chercheurs
et des curieux (P) 3 18.
10, 21, 145, 217,
25 ij 363.
Loiseleur (J.) 333, 367.
Loquin (A.) 368.
Loret 10.
Lucrèce, 358.
Lully 25.
Lyon
72, 325.
.
LE MOLIERISTE
378
M
Moland
88, 2^4, 281,
(L.) 29,
370.
Mahrenholtz iD') 29.
Maison mortuaire de Molière
(lai
Malade imaginaire [le] 27,63,
94, 334, 253, 333. 351,369.
Mangold (D' W.) 332.
Maquet (A.^ 283.
Marcou (F.) 87.
Mareuse 7.
Mariage forcé {le)
.
11 3.
(G.) 93.
(P.)
233, 3ii.
Mesnil (R. du) 79.
Meudon
de) 228.
(G.) 9,
27,
09,
214,231,280, 336,
26, 3i, 63,
175, 223, 278, 287,
3 14, 35i, 369, 373.
Marie (Ch.l 70, 245.
Marivaux 197.
Marnicouche (E.) 25o.
Martin (Aimé) 234.
Martin (Alexis) 243.
Marty-Lavaux 3i i.
Masque de fer (le) 347, 367.
Mathon 81.
Maynard 340.
Médecin malgré lui (le) 63,
94, 99, 175, 223, 268, 278,
287, 314, 35o, 373.
Médecin volant (le) 27, 268.
Ménage 195, 216, 261, 265,
296, 363.
(le)
Montausier (duc
Monval
160,
Mercure galant
278, 286, 372.
Montargis, 36 r.
Montfleury, 374.
Montpellier, 72.
Manitoba, 371
Mesnard
3i, 175, 192, 35o, 369.
(A. de) 6, 148,
Montaiglon
279.
Merlet
Monet (le père) 338.
Monsieur de Pourceaugnac
75.
Myrtil
et
Mélicerte 28,
Narbonne
72.
Nicot 338.
Noël (Eug.) 273.
Nuitter (Gh.) 118, 178, 211.
O
Olivet (l'abbé d')
3.
Panulphe, 358.
Papillon de la Ferté 22.
Papillotes
(les)
35
1,
370,
Parfaict (les frères) 100.
Pellisson (M.) 1 19.
Person (E.) 87.
Person (L.) 28, 193,
244j 287, 314, 336, 337,
35o, 35i,358, 364, 369.
24.
Nantes 72.
Perrault 293.
26, 28, :-,
35, 44, 56, 63,68,87, 128,
i55, 175, 182, 223, 228,
i
N
Millin 4.
(le)
189,
36o.
Moreau (Em.) 55.
Moreau le jeune i33.
Moulin (H.) 14.
Mignard 3o3, 3i9, 323.
Misanthrope
3 5o,
Philidor l'aîné 3 18.
Picot (E.) 61, i55, 244.
Pijardière (de la). V, Lacour.
Pirodon, 372.
LE MOLIÈRISTE
379
Poise 95.
Schweitzer
Poquelin père 212, 3o2.
Poquelin (Robert) 3o3.
Port(C.) 364.
Portrait du peintre (lé) 332.
Scribe 12.
Seine-Port, 357.
Sganarelle ou
le
Cocu imagi-
naire 29, 35o.
Shakspeare 5.
Pougin (A.) 93, 121.
Précieuses ridicules (les) 29,
3i, 63, 128, jSj, 160, 216,
238, 287, 296, 35i, 373.
Précieux et précieuses, 363.
Psyché
29, 92.
(D"")
(le) 93, 95, 121, igS,
223, 287.
Soulié (Eudore) 3o3.
Soyecourt (M'^ de) 259.
Sicilien
T
27, 192.
R
Rash (C. de) 335.
Talbot, comédien 32, 64.
Talbot, professeur 32.
Tartuffe 11, i5, 26, 3i, 36,
G3, 87, 95, 99, 119, 128,
160, l63, 188, 223, 232,
254, 286, 287, 323, 35o,
35i, 358, 369, 373, 374.
Taschereau 157, 228.
Raymond
Teplov
Rachel 142.
Racine (Jean)
37,42, 47,
5,
67. 99j 167, 3_ii.
Ragueneau (Marie) 3o.
Raincy (le) 99.
Rambouillet (M'^^ de) 112.
(Ch.) 356.
Regnard 214.
Régnier (Mathurin) 232, 244.
179, 210, 2i5, 332.
Thoinan (E.) 25.
Titon du Tillet 4,
Toulouse 72.
Richelet 293, 341.
Robinet 102, 33 1.
Rochebilière (vente) 91.
Rochefort (Claude) 359.
Rostand (E.) 284.
Rothschild
(A.)
(J.-B.) 372.
r,
370.
I
U
247.
Rousseau
Roux
Trayer
Tricotel 246.
Truffier(J.) 35
(B»'» J. de) 10.
Rotrou 28, 123, 347.
Rouen
(Wasili) 26, 61, i53.
Thierry (Ed.) 28, 112, 124,
Ubalde, 348, 367.
(J.-J.)
44, 68.
228.
S
V
!
1
!
Saint-Laurent (Vincens) i63.
Saint-Simon (duc de) 228.
Sainte-Beuve 39, 42.
Sarcey (F.) 274.
Satyre des Satyres (la) 11,
265, 294, 363.
Sauzay (E.) 93, 95, 121.
Scherer (E.) 32, 35, 43, 56,
67, 121,
j
j
Valade(L.) 35 1, 370.
Vernet (Horace) i35
Vesselovski 154.
Vienne 72.
Villemain 12.
Vitu (A.) 178, 279.
Vizé (Donneau de) 11
Vrain-Lucas, 357.
Z
I
1
Zorilla 93.
3.
TABLE DES MATIERES
N°
G.
XXXVII.
— Avril
—
Mon VAL.
Pages.
Les tombeaux, de
Fontaine, rapport au Comité
parisiennes
Bibliophile Jacob.
1882.
VvColière et
des
de
La
inscriptions
3
— Correspondance
—
—
E. Thoinan. — Papillon
Fer
Molière (Recherches)
Claretie. — Petit Questionnaire
10
Molière et l'édit de Nantes. MM.
Scribe et Villemain à l'Académie
Ch. L. LivET.
Une question de droit à propos du
H. Moulin.
Tartuffe
de
la
28
:
15
parent
té
J.
de
22
:
Demande
Wasili Teploff
26
Du Monceau. -—
Bibliographie
Molière à
la
librairie des bibliophiles ; Gérard du 'Boulan ; Rotrou ;
l'Artiste ; Traductions en croate et en turc ; Molière s Leben und Werke ; Le Molière-Moland, etc'.
çaise
;
:
— Bulletin théâtral
Mondorge.
.
Comédie
:
Odéon
Capucines
;
Collège de France ; Salle
;
Association philotechnique
N°
Sainte-Beuve.
—
xxxviii.
— Mai
des
31
Scherer
35
40
-
Molière
— A Georges& Monval, poésie
— Un réformateur
E. Picot. — Petit Questionnaire Réponse 28
Wasili
Du Monceau. — Bibliographie
poëme-
La
Moreau.
Th. Cart.
L....
Versification
de
le style
E.
littéraire
étude de
Molière
;
Mondorge.
61
Molière,
M. Dujon ; Molière et Holberg ; Epitre à
VArnolphe de Molière, par M. Coquehn.
— Bulletin théâtral
43
53
56
:
:
Teploff
:
27
fran-
1882.
— U Hérésie de M.
— Aimer Molière
La Rédaction.
12
:
Comédie
fran-
62
L£ MCH.IÉRISTE
çaise
Odéon
;
de France
;
jSl
Théâtre Royal du Parc
Capucines
;
;
Collège
Salle des
N"
—
— Juin
XXXIX.
63
1882.
Ch. Marie.
Autre réponse à M. Scherer
Bibliophile Jacob.
Le procès de Molière et d'un médecin
C. Brouchoud.
E. Campardon.
Meudon
Mathon.
—
71
— Molière à Vienne
— Documents
72
inédits
— LEcusson
:
La maison de
75
des Toquelin de Beauvais
...
Armoiries exécutées en chromolithographie ^
d'après un ancien vitrail
E. A....
Une lettre inédite de déranger
Du Monceau.
Bibliographie ; Editions classiques ; Vente Rochebilière ; Ix Moliére-Museum ;
Epitre à Molière ; Le Don Juan Lenorio de Zorilla ;
Etudes de M. G. Merlet ; Molière et l' Opéra-Comique
—
67
—
— Bulletin théâtral
79
80
82
87
Comédie franOpéra-CoThéâtre Rossini
çaise ;
Odéon
Soirée chez M™'
mique Collège de France
la comtesse de Beaumont; Mairie du XI* arron-
M0NDORGE.
:
;
;
;
;
94
dissement
XL. —
N<'
Juillet
1882.
—
Molière et sa troupe au Talais-Royal :
Ed. Thierry.
r Alexandre de Racine
Cotin et Trissotin
Bibliophile Jacob.
Ch. Nuitter.
La V^aison mortuaire
Du Monceau. Bibliographie Editions classiques;
Molière librettiste : Myrtil et Mélicerte
—
—
;
—
;
;
XLi.
Icono-molierophile.
— Août
— Les
A.
119
— Rachcl
de Montaiglon. —
128
1882.
Illustrateurs de
Mo131
lière
La Rédaction.
116
:
N°
Un
99
113
:
Bulletin théâtral Comédie franThéâtre Rossini.
Gaiety théâtre Odéon
Mondorge.
çaise
—
interprète de Molière
^^Sur
....
deux vers de VElomire
142
LE MOLIÈRISTE
382
hypocondre
— Molière
Ch. Estreicher.
•
en Pologne
— Sur
Molière
d'un méA. Vesselovski. — Petit Questionnaire
Réponse
28
Wasili
— Le
C.
du Misanthrope
Un Provincial. — Correspondance {Cotin
G. Mon VAL. — Molière à Châteauroux
Mondorge. — Bulletin théâtral Comédie
C.
Del AMP.
procès de
le
145
149
et
decin
ICI
:
Teploff
:
D....
cabinet
et
tin
,
Trisso-
.
;
Lycée Louis Le Grand
160
— Septembre 1882
Vincens Saint-Laurent. — Un nouveau dénouement
du
Mondorge. — Bulletin théâtral Comédie
Athènes Smyrne
H. Allouard, — Les
moments
Molière
hors
H. DE Lapommeraye. — Deux
La Rédaction. — Réponse à un
(MoLegouvé
Dupont-Vernon. — Aux
Du Monceau. — Iconographie moliéresque
N"
XLii.
Tartuffe
;
;
derniers
Statue, figure
163
fran-
:
çaise
157
159
fran-
:
çaise
153
155
de
175
;
texte
lettres
176
177
Provincial,
lière et
Cotinj
E.
et
de Molière
:
190
N°
XLin.
— Octobre
— Molière sa
yal
La Rédaction. — Nécrologie
Ed. Thierry.
le
181
le
Molière-Coypel
:
179
interprêtes
troupe
et
1882.
au Palais-Ro-
Sicilien
—
195
C. Delamp
:
210
G. Monval.
Réponse à M. de Lapommeraye
Un Provincial.
Molière et Cotin (suite)
C. Brouchoud.
Le Père de iW"^ du Parc
La Rédaction.
Une relique du cimetière St-foseph
Du Monceau,
Bibliographie le Molière-Hachette;
—
—
—
—
La Croix
juge
Mondorge. — Bulletin théâtral
.
211
215
218
220
:
Molière
et
partie
221
;
:
Comédie
fran-
LE MOLIÊRISTE
çaise
383
Odéon; Opéra-Comique; Théâtre de
;
St-
Cloud
N"
— Saint-Simon
G. MoNVAL.
223
— Novembre
XLrv.
inédit
1882.
Alceste et
:
Mon-
tausier
— Molière
Martin. —
L....
A.
.227
et
Mathurin Régnier
Molière
portraits attribués à
et
232
Madeleine Béjart,
deux
Abraham Bosse
238
Fac-similé des deux portraits, dans le texte.
240-41
Ch. Marie.
L'Asile du sonnet d'Oronte
244
E. Marnicouche.
Molière et Cotin, autre réponse
à un Provincial
246
Du Monceau.
Bibliographie
Avare, annoté
par M. Livet; P^rnolphe de Molière
251
Mondorge.
Bulletin théâtral Comédie fran.
—
—
—
V
:
—
çaise
:
Odéon
;
Vienne
;
Salle
N°
;
Opéra comique
;
Théâtres
de
Chaîne
XLV.
—
—
—
— Décembre
253
1882.
A. ViTU.
Le chasseur des Fâcheux
Molière et Cotin (suite)
Un Provincial.
La Farce des Quiolards et le Bourgeois
E. Noël.
gentilhomme
—
Blondet.
Une erreur à propos de Molière
A. De Montaiglon.
Molière traduit en turc.
Du Monceau. Bibliographie la Maison mortuaire
de Molière, par M. A. Vitu
Brindeau, par G.
—
—
.
.
.
259
264
267
276
277
:
;
Molière-Moland ; les Comédiens italiens,
Baschet ; Taris sous Louis XIV, de M. MaCatulle, traduit en vers ; Affiche de théâtre.
d'Heylli
de M.
quet ;
;
le
— Bulletin théâtral Comédie*
Odéon Opéra comique Bordeaux Vienne.
— Janvier 1883.
N° XL
Bibliophile Jacob. — Réponses aux
d'un
Provincial
G. Depping. — Trois
concernant
fade Molière
A. Brisson. — Curiosités littéraires Molière
Mondorge.
çaise
;
;
278
fran-
:
;
;
287
VI.
questions
pièces
mille
291
la
inédites
•
:
in~
301
LE MOLIÈRISTE
384
connu (Stances Galantes)
Bibliographie
le premier livre
dédié à Molière ; Un portrait dit de Molière ....
—
Du Monceau.
—
MoNDORGE.
Bulletin théâtral ; Comédie française ;Odéon Opéra comique Salle des Capucines.
;
;
N°XLVii.
— Février
et
la
—
et
de Macée, par
tion de Molière
Masque
320
—
—
—
Du Monceau. — Bibliographie
baut
318
1883.
La Gloire du Val de Grâce, Tartuffe
Paix de V Eglise
Molière et le Masque de Fer
J. L01SELEUR.
P. Lacroix.
Toast du Banquet-Molière
D' C. II Mathanasius.
Question de Cabinet
...
Ed. Thierry.
311
:
;
M.
Rotrou
,
et
:
'Boursault
Le
;
du
secret
parUbalde
Erratum important
Ephémérides moliéresques
—
—
— Bulletin théâtral
Mondorge.
çaise
Opéra comique
;
N*
;
xLViii.
Odéon
;
— Mars
346
349
Janvier
:
•
Comédie
:
.
.
350
fran-
Gaîté
351
1883.
—
Ch. Raymond.
Tartuffe triomphant
G. Monval.
Un nouveau mystificateur
Th. Cart.
Molière à Montargis
C. Port, F. Hillemacher^ A. Loquin.
pondance
V. Lardet.
Dix sujets tirés de Molière
—
—
334
337
Les Amours de GomGuiffrey ; Nouvelle édi-
de Fer,
A. Brisson.
G. Monval.
1683-178)
323
333
355
357
—
—
Du Monceau. — Bibliographie
G. Monval. — Ephémérides MOLiÉREsauES
1683-1783
Mondorge. — Bulletin théâtral
361
Corres-
363
369
370
:
février
Index alhabétique
373
373
375
Table des matières
380
Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).
—
Noël Texier.
-.:;/,
;,
d
Universily of Toronto
Library
DO NOT
REMOVE
THE
GARD
FROM
THIS
0)
ca
*?^
POCKET
M)
•H
HO
Acme
Library Gard Pocket
Under Pat. "Rd. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU
Jn^.
\>