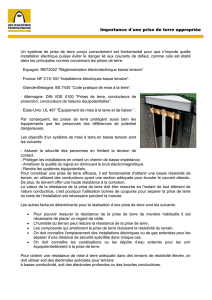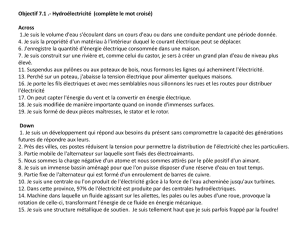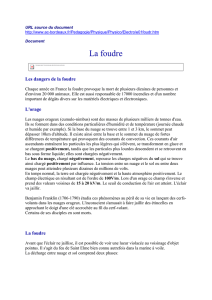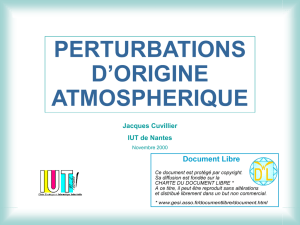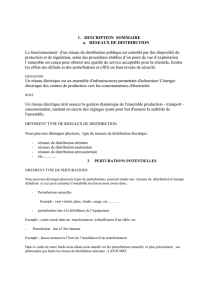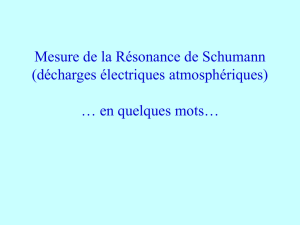Télécharger l`ouvrage - Lambert

L a m b e r t - L u c a s
L I M O G E S
Houda Ounis
COUP DE FOUDRE
Etude linguistique
d’une métaphore
Préface de Michel Arrivé
Couv Ounis 13/11/07 12:10 Page 1 (2,1)

L’analyse de centaines d’occurrences prises en discours de l’expre s s i o n
coup de foudre et des termes qui la composent montre qu’elle possède
trois acceptions:
«frappe d’un feu céleste»,
«amour subit et violent»,
«désir irrésistible de posséder quelque chose»,
autour d’un signifié générique:
« événement ponctuel et brutal provoquant une ru p t u re dans l’ord re
attendu des choses».
L’ a p p roche sémantico-syntaxique montre les limites de la notion de
m é t a p h o re te lle que la conçoivent les cognitivistes (cf. Lakoff et Johnson
1985) pour qui la métaphore est une construction mentale basée sur l’ex-
périence concrète et universelle des choses: l’expression coup de foudre
serait dérivée du foudroiement météorologique. Mais le caractère dérivé
de l’expression ne permet pas de comprendre ses occurrences en discours.
Et puis nulle autre langue que le français ne présente en de tels termes le
fait de tomber subitement amoureux. C’est que chaque langue nature l l e
est un système autonome indépendant du monde et de la pensée ; ses
signes prennent leur identité dans les relations paradigmatiques et syn-
tagmatiques qu’ils entretiennent en discours. Il n’y a pas lieu d’établir de
h i é r a rch ie entre les sens ni de distinguer entre sens source et sens figuré.
Finalement, c’est la notion même de métaphore qui est ici remise en
cause.
Houda Ounis est docteur en Sciences du langage de Paris X - Nanterre,
rattachée à l’UMR 7114 - MoDyCo (Modèles, Dynamiques, Corpus). Elle
a publié en collaboration avec Danielle Leeman «Coup de foudre: méta-
phore ou signifié dans la langue?» dans Chercher les passages avec
Daniel Delas (2003), « Le nom amour:grammaticalisation et métapho-
re» dans Revue de sémantique et pragmatique n° 15/16 (2004), « Donner
un sens à des formes verbales a priori capricieuses: l’exemple de l’impé-
ratif» dans De la langue au texte: Le verbe dans tous ses états (2) (2005).
140 pages
19 euros
ISBN 978-2-915806-45-8
Couv Ounis 13/11/07 12:10 Page 1 (1,1)

Houda Ounis
COUP DE FOUDRE
Etude linguistique
d’une métaphore
Préface de Michel Arrivé
Ouvrage publié avec le concours
de l’Université Paris X - Nanterre

PRÉFACE
À première vue, le sujet de ce livre est modeste : une expression
de la langue française, coup de foudre. Une « petite » expres-
sion : « un groupe nominal comportant un groupe préposition-
nel introduit par de » (page 82). Et pas si fréquente que ça : il a
fallu faire appel non seulement à Frantext, mais à l’inépuisable
Google pour en trouver commodément un grand nombre d’oc-
currences. Cette petite expression, certes, est examinée dans
tous ses états. C’est par exemple « le coup de foudre qui, dans
la nuit du 15 au 16 octobre 2005, abattit dans la Forêt des Bau-
ges le Chêne aux Loups Malades, plusieurs fois centenaire ».
Mais c’est aussi « le coup de foudre qui, la nuit suivante – il n’y
avait plus d’orage – frappa simultanément Jean-Baptiste et Do-
rothée : ils se marièrent quinze jours plus tard ». Et c’est encore
le même « coup de foudre qui, le lendemain de leur mariage,
poussa irrépressiblement Dorothée et Jean-Baptiste à acquérir,
peut-être imprudemment, un gros 4 x 4 coréen ».
De quoi faire une thèse. Une bonne petite thèse bien tran-
quille ? C’est peut-être ce que s’est dit Houda Ounis au moment
où elle a déposé son sujet. Elle a commencé à constituer paisi-
blement son corpus. Et elle a pu rester dans une tranquillité
euphorique une bonne semaine. Un peu plus ? Ça m’étonnerait.
Je gagerais plutôt que ce fut un peu moins. Ensuite, et jusqu’à la
fin, ce fut l’angoisse…
Car d’emblée elle a vu que se creusait une distance tout de
même considérable entre les signifiés – oui, je vais parler saus-
surien : on verra bientôt pourquoi – de cet unique signifiant
coup de foudre. Pour le Chêne aux Loups Malades, le coup qui

8 COUP DE FOUDRE
l’a soudainement frappé a été dévastateur : il a fallu bien vite
tronçonner les restes calcinés des vieilles branches et du véné-
rable tronc. Il n’est finalement resté du grand vieil arbre que
quelques stères de bois de chauffage. Rien de comparable pour
Jean-Baptiste et Dorothée : pour eux, rien de dévastateur. Oui,
j’entends des rires sardoniques : je leur demande de s’inter-
rompre, ils ne sont nullement justifiés par le sens de l’expres-
sion. Et je reprends, sereinement : pour eux, rien de dévastateur
dans le coup de foudre. Bien au contraire : la naissance, brutale,
il est vrai, d’un amour durable (quinze jours, c’est déjà de la
durée, n’est-ce pas ? Et ça a sans doute continué après le ma-
riage…). Quant à l’achat, sur un coup de foudre, du gros 4 x 4
coréen, il a été aussi soudain que les deux autres coups de fou-
dre. Mais il n’est menaçant qu’à terme, et seulement pour le
budget du jeune couple.
Le premier problème est double : il consiste à repérer à la
fois la distance qui sépare les trois signifiés et ce qu’ils ont en
commun. L’auteure s’acquitte de cette tâche avec le plus grand
sérieux, en commençant par étudier séparément les éléments
constitutifs de l’expression : le coup, la foudre et, bien sûr, le
de. L’analyse formelle est fort bien menée, et pleinement
convaincante. C’est tout au plus si, page 61, je suis tenté de
contester la description diachronique qui est faite de coup. Non,
coup n’est pas un exemple du « procédé de dérivation régres-
sive » qui forme un « déverbal » en privant un verbe de ses
marques morphologiques. C’est l’inverse qui s’est produit :
coup représente en français le latin col(a)phus – comme il est
d’ailleurs explicitement dit page 40 –, et c’est le verbe couper
qui a été formé sur le nom coup. Oui. Mais je devine ce que
Houna Oudis va me répondre, et, de son point de vue, elle aura
raison. Du strict point de vue synchronique, la différence entre
les deux analyses s’annule. Ce qui est pertinent, c’est que
« coup est morphologiquement apparenté au verbe couper ».
C’est seulement la chronologie – coup est, très largement, anté-
rieur à couper – qui permet de retenir l’hypothèse de la forma-
tion du verbe sur le nom plutôt que l’inverse.
Après l’analyse de la distance et des traits communs, reste
un second problème, encore plus difficile. C’est celui qui est à
la fois décrit et résolu par le vieux nom de métaphore. Car, on
s’en souvient, la métaphore, étymologiquement, ce n’est rien
d’autre que le « transport » – l’auteure parle, page 120, de
« transposition » – du « sens » d’une unité linguistique. Trans-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
1
/
131
100%