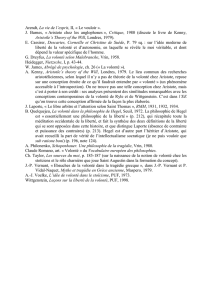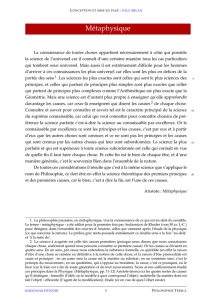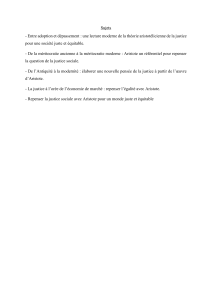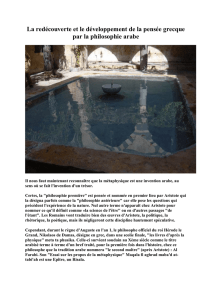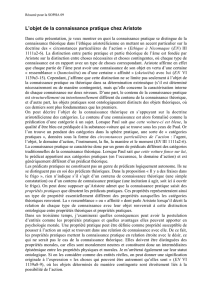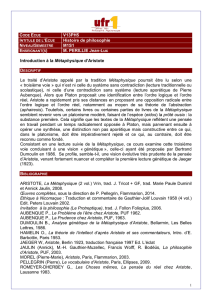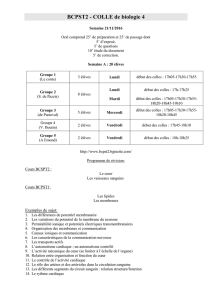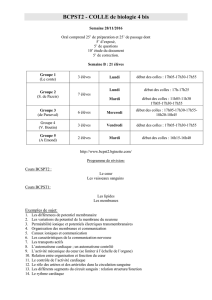Cette fin, c`est de « transformer ce monde » écrit Hegel. Lorsque l

Pigeard de Gurbert
Colles
1
Première Supérieure
Gay-Lussac
Cours commun / Oral
2012-2013
LA MATIERE
1) Sartre, L’être et le néant, IV partie : le visqueux
2) Aristote : matière et forme
Commençons par analyser la cause matérielle. Elle répond à la question : en quoi la chose est-elle
faite ? Par exemple, cette statue est d’airain, ce lit est en bois (Phys., 190a). Pour faire comprendre ce
qu’il entend par «matière», Aristote recourt systématiquement à des exemples empruntés à l’art.
Outre la statuaire, il sollicite divers domaines de la fabrication humaine : la coupe d’argent, le
gouvernail en bois, la maison en briques (194ab). Et les exemples qui semblent relever de la nature
— la semence de la plante (190b), les os, les nerfs et la chair de l’animal (Méta., 1035a) — ne sont
compréhensibles qu’au regard de ces exemples artificialistes. La supériorité numérique de ce type
d’exemples indique que la cause matérielle ressortit originairement à la sphère de l’agir humain. La
matière est conçue, dans son essence, comme matériau. Elle désigne ce sur quoi un pouvoir-faire a
prise, ce qui se prête à la transformation sous l’effet d’un agent. Au livre de la Métaphysique,
Aristote définit précisément la matière comme ce qui a la puissance d’être telle chose déterminée, et
établit de fait un parallèle entre l’art et la nature : «tous les êtres qui sont engendrés, soit par la
nature, soit par l’art, ont une matière, car chacun d’eux est capable à la fois d’être et de ne pas être
(to dunaton einai kai mê einai), et cette possibilité, c’est la matière qui est en lui» (1032a). Ce
parallélisme cache en vérité le primat du pouvoir-faire humain sur la puissance naturelle. La notion
de puissance naturelle de la matière dérive de la puissance artificielle des matériaux, qui n’a elle-
même de sens qu’en référence à la puissance d’un agent humain. Cette définition de la matière par la
puissance d’être ou de ne pas être se trouve aussi dans De la génération et de la corruption : «au sens de
cause matérielle, la cause des êtres générables est ce qui peut à la fois être et ne pas être (to dunaton
einai kai mê einai, 335a)». Cette puissance d’être et de ne pas être constitue «la marque essentiel du
générable et du corruptible, car tantôt il est, et tantôt il n’est pas. Il en résulte nécessairement qu’il y
a génération et corruption pour ce qui peut à la fois être et ne pas être. Et c’est pourquoi, au sens de
cause matérielle, telle est la cause des choses générables» (335b). L’être de la matière consiste tout
entier dans sa puissance d’être. La matière se définit par ce que l’on peut en faire : du bois on peut
faire un lit, du marbre une statue.

Pigeard de Gurbert
Colles
2
La matière est le fonds dunamique de la chose : non pas son être mais sa puissance d’être.
Elle est l’hésitation devenue propriété ontologique. Les changements se font entre contraires, et
la matière est la puissance d’être ces contraires. «Chez tous les êtres, en effet, qui sont dits
pouvoir, le même être est puissance des contraires» (Méta., 1051a). La matière est ce réceptacle
dunamique des contraires : «nécessairement, donc, la matière qui change doit être en puissance
les deux contraires à la fois. Et puisque l’Etre a un double sens, tout changement s’effectue de
l’Etre en puissance à l’Etre en acte, par exemple du blanc en puissance au blanc en acte. De
même encore pour l’accroissement et le décroissement. Par conséquent, on peut dire, non
seulement que tout ce qui devient procède par accident du Non-Etre, mais aussi bien que tout
procède de l’Etre, à la condition de l’entendre de l’Etre en puissance et non de l’Etre en acte»
(1069b). C’est bien la notion d’être en puissance qui permet de biaiser avec l’ultimatum
parménidien.
Plus précisément, la matière se définit par sa puissance de pâtir : «le gras, par exemple, est
combustible, et le malléable-de-telle-façon, compressible» (1046a). Si la forme pure est
impassible, la forme engagée dans la matière est passible (De gén., 324b) : «en effet, il est de la
nature de la matière de pâtir et d’être mue, tandis que mouvoir et agir est le fait d’une autre
puissance. Cela est évident, tant pour les choses qui procèdent de l’art que pour celles qui
procèdent de la nature» (335b). La puissance passive inhérente à la matière est conçue d’après le
schème productif de la fabrication humaine : tel bloc de marbre a la puissance de recevoir telle
forme sous l’action du sculpteur. La cause matérielle représente la chose à l’état de pure
puissance. A ce titre, la matière est la condition nécessaire mais non suffisante des choses en
tant que déterminées. «Il n’est pas suffisant, en effet, écrit Aristote dans les Parties des animaux,
de dire de quoi tout cela est fait [...] ; si nous avions en effet à parler d’un lit ou d’un objet de ce
genre, nous chercherions à déterminer sa forme plutôt que sa matière, airain ou bois [...] Car un
lit, c’est telle chose dans telle matière, telle chose caractérisée de telle façon. Il faut donc parler
de sa configuration. C’est-à-dire ce qu’est sa forme» (640b).
L’analyse de la cause matérielle appelle donc celle de la cause formelle, qui la prolonge et la
complète. «J’appelle matière, écrit Aristote au livre de la Métaphysique, ce qui, n’étant pas un être
déterminé en acte, est, en puissance seulement, un être déterminé» (1042a). Si la matière loge du
côté de la puissance, la forme, elle, est acte. Aristote le dit dans le De Anima : «la matière est
puissance, la forme entéléchie» (412a). De même, on peut lire dans la Métaphysique qu’il y a «deux
sens de l’Etre, l’Etre qui est en entéléchie et l’Etre qui est en tant que matière» (1077a). La cause
formelle répond à la question : à quoi la chose ressemble-t-elle ? Comme la détermination constitue
le critère ontologique des choses, la cause formelle, en informant la matière, répond à la question :
qu’est-ce que c’est ? Si la matière constitue le fond d’indétermination des choses, la forme est
dépositaire du «ce que c’est» de la chose : un lit, un gouvernail, une statue d’Hermès. Matière et

Pigeard de Gurbert
Colles
3
forme sont des concepts importés du domaine du faire humain. C’est d’abord pour l’artiste ou
l’artisan que ces concepts se distinguent et prennent sens. L’architecte dispose de matériaux qu’il
assemble pour former une maison. La simple observation de la nature ne nous dit rien de tel.
Regarder la nature, c’est d’abord étudier les productions humaines. La distinction de la matière et de
la forme qui provient des produits humains est ensuite naturalisée. C’est bien dans cet ordre
qu’Aristote présente les choses : «De même, en effet, qu’on appelle art dans les choses ce qu’elles
ont de conforme à l’art et de technique, de même on appelle nature ce qu’elles ont de conforme à la
nature et de naturel» (Phys., 193ab). Chaque chose est un composé de matière et de forme : «par
matière, j’entends par exemple l’airain, par forme, la configuration qu’elle revêt, et par le composé
des deux, la statue, le tout concret» (Méta., 1029a). Et la forme n’est pas séparable de la matière, si ce
n’est dans l’abstrait (193b). Il y a une primauté ontologique de la forme sur la matière dans la
mesure où, pour Aristote, être, c’est être déterminé : «la forme est antérieure à la matière, et [...] elle
a plus de réalité qu’elle» (Méta., 1029a). Il dit encore dans les Parties des animaux, que «la nature
formelle a plus d’importance que la nature matérielle» (640b). Cette hiérarchie ontologique se décide
selon la distinction puissance-acte à laquelle correspond la distinction matière-forme : «chaque
chose est dite être ce qu’elle est plutôt quand elle est en acte que quand elle est en puissance (Phys.,
193b)». La forme confère à la chose sa différence spécifique, c’est-à-dire sa pleine réalité. Elle
assigne à la multiplicité des choses un statut ontologique que Parménide lui refusait. Pour Aristote,
l’être parménidien a la même indétermination que la matière. Partant, il représente non pas l’être au
sens plein, mais le plus bas degré sur l’échelle des êtres, l’être qui n’est qu’en puissance. C’est un
véritable renversement de l’ontologie parménidienne : l’être en son fait impotent fait ici figure de
simple puissance d’être à laquelle il manque la détermination par la forme, c’est-à-dire l’actualisation
des déterminations enveloppées dans l’être. L’être du Poème est un être avorté, quelque chose
d’inachevé. Son fait impotent prend le sens de pure puissance. L’introduction de la cause formelle
comme principe de détermination sert à définir négativement le fait d’être comme in-déterminé.
L’être vrai est désormais le «ceci» (Méta., 1028a), c’est-à-dire l’être qui a actualisé telle puissance
particulière qu’il portait en lui. L’être ne connaît que deux modes : l’être en puissance et l’être en
acte. Encore faut-il préciser que le passage à l’acte de telle puissance déterminée n’épuise pas la
puissance propre de la matière. Sous l’actualisation de telle forme, la puissance d’être autre de la
matière perdure. Il y a ainsi un fonds de possibles qui ne laisse pas de travailler la chose par-delà
telle ou telle actualisation. En effet, «tout ce qui est possible peut ne pas s’actualiser. Donc, ce qui a
puissance d’être peut aussi bien être et ne pas être. La même chose est donc puissance et d’être et
de n’être pas» (Méta., 1050b). Ce fonds dunamique de la matière garantit la vie même de choses, leur
être-en-mouvement. Si l’actualisation d’une forme déterminée épuisait la puissance de la matière, la
nature se figerait bientôt.

Pigeard de Gurbert
Colles
4
3) Epicure, Lucrèce : les atomes
3) Hegel, Introduction à l’esthétique, chap 2 :

Pigeard de Gurbert
Colles
5
Quelle est donc cette fin que visent l’art et la technique et qui constitue
l’essence même du concept de culture ? Cette fin, c’est de « transformer ce
monde » écrit Hegel. Lorsque l’artisan transforme un arbre en planches, tout
comme lorsque l’artiste transforme un bloc de marbre en statue, ils font l’un
et l’autre d’une chose naturelle une création de l’esprit humain. Il n’y a donc
pas lieu d’opposer produit technique et œuvre d’art. Tout au plus peut-on les
distinguer par les moyens respectifs qui sont les leurs. L’art et la technique
sont des activités par lesquelles l’homme transforme les choses naturelles en
objets culturels à travers lesquels, comme dit Hegel, « il retrouve comme un
reflet de lui-même » (chap. 2). L’homme transforme ainsi la matière selon les
idées qu’il a dans l’esprit. La culture est en ce sens une matérialisation de
l’esprit qui est en même temps une spiritualisation de la matière. En effet,
l’homme s’approprie la matière en lui inoculant la forme de son esprit. A la
différence de la matière brute, une œuvre d’art comme un objet technique ne
pas donnés mais produits. L’esprit imprime à la matière « son cachet
personnel » comme le dit encore Hegel.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%