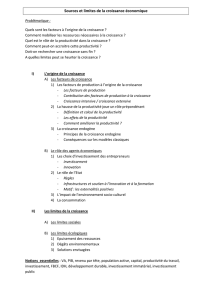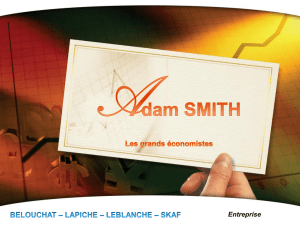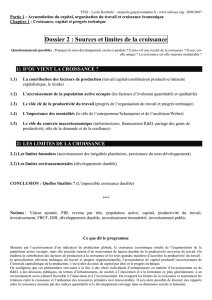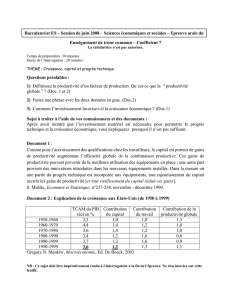Régis BOULAT - Gestion et Finances Publiques

Régis BOULAT
Docteur en histoire
Chargé de recherches à l’université Pierre-Mendès-France (Grenoble II)
et chargé de cours à l’université de Franche-Comté.
Sa thèse, Jean Fourastié, la productivité et la modernisation de la France
(années trente - années cinquante) a été couronnée en 2007 par le Prix Fourastié-Nodal
Egalement membre de l’Association française des historiens économistes (AFHE)
Jean Fourastié, la productivité et la modernisation de la France
dans les années 1950
Au cours des années 1950, la France connaît une croissance sou-
tenue, qui constitue la condition d’un rattrapage caractérisé par
des investissements élevés et un processus de transferts technolo-
giques et organisationnels, dans le cadre d’une convergence pro-
gressive des nations d’Europe de l’Ouest avec l’économie améri-
caine (1). Pour Jean Fourastié (1907-1990), dont le nom reste associé
à ces « Trente glorieuses » (2), Atala, symbole d’une France cultivée
et sensible mais peu faite pour la civilisation technique, conquiert
enfin sa place dans le monde automatisé, mécanisé et bien
encadré de Citroën (3) grâce à la (re)découverte de la notion de
productivité qui passe enfin du champ de l’économie politique à
celui de la politique économique. La productivité est pourtant loin
d’être une inconnue puisque, tour à tour, les Classiques, Marx, puis
l’Ecole de Vienne (4) ont cherché à en dégager la signification
avant qu’Albert Aftalion ne la définisse, en 1911, comme « le rapport
entre la production totale obtenue en un temps donné et
l’ensemble des agents employés à cette production » (5). Elle se
trouve également, à partir du « tournant taylorien de la société
française » (6), au cœur des préoccupations d’ingénieurs, de
patrons, voire d’ouvriers qui adaptent, de façon sélective, des
méthodes américaines de rationalisation et d’organisation à une
pratique proprement française de l’organisation du travail industriel,
qui repose sur le machinisme, le développement d’œuvres sociales
et le contournement des positions ouvrières (7). Toutefois, il faut
attendre la Deuxième Guerre mondiale et les travaux de l’ingé-
nieur-économiste André Vincent pour que la productivité s’impose
comme la mesure du progrès technique, à l’échelle d’une entre-
prise comme d’une nation, autorisant ainsi les comparaisons
internationales (8).
Après la guerre, alors qu’il s’agit de reconstruire tout en moderni-
sant, la productivité s’impose progressivement, grâce à Fourastié,
commele«nouveaumètreétalon»delapuissanceetcommeun
concept macro-économique, consubstantiel à la notion de crois-
sance. Au Plan, Fourastié participe à l’élaboration d’un programme
franco-américain de modernisation (9) animé par l’Economic Coo-
peration Administration (ECA), chargée d’administrer le plan Mars-
hall (10), et par le secrétariat d’Etat aux Affaires économiques où
le ministre MRP Robert Buron joue un rôle essentiel. Tous les centres
nerveux du pays sont touchés : grâce aux crédits américains, l’Asso-
ciation française pour l’accroissement de la productivité (AFAP) et
le Comité national de la productivité (CNP) créés en 1950 et, enfin,
le Commissariat à la productivité fondé en 1953, favorisent les
voyages aux Etats-Unis de missions françaises tripartites, censées
provoquer un « choc psychologique », et participent au finance-
ment de toutes les activités de modernisation. Ils aident les syndicats
ouvriers à constituer, sur des bases modernes, les bureaux d’études
économiques qui leur sont indispensables et soutiennent les efforts
des centres techniques des différentes industries ou des organisa-
tions multiples qui se créent dans le domaine de la gestion moderne
et de la comptabilité. Parallèlement, grâce aux essais économiques
grand public de Fourastié, les managers, les cadres et les techno-
crates considèrent désormais la productivité davantage comme
une stratégie de développement économique et social que
comme une simple rationalisation de la production (11).
JEAN FOURASTIÉ ET LA PRODUCTIVITÉ :
UNE TRIPLE LÉGITIMITÉ
Des Assurances au Plan
ou l’itinéraire d’un expert
Jean Fourastié naît en 1907 dans une famille aux racines pay-
sannes et croyante. Centralien atypique guère tenté par une
(1) Jean-Jacques Carre, Paul Dubois, Edmond Malinvaud (1972), La croissance fran-
çaise, un essai d’analyse économique causale de l’après-guerre, Paris, Seuil.
(2) Jean Fourastié (1979), Les Trente glorieuses ou la révolution invisible, Paris, Fayard,
p. 28.
(3) Jacqueline Fourastié et Béatrice Bazil (1994), Jean Fourastié entre deux mondes,
mémoires en forme de dialogue avec sa fille Jacqueline, Paris, Beauchesne,
p. 145-147.
(4) François Schaller (1966), Essai critique sur la notion de productivité, Paris, Droz,
p. 11-23.
(5) Il distingue huit « productivités », à savoir la productivité globale, puis celle de
chacun des trois facteurs de production et envisage, dans les quatre cas, soit la
productivité en nature, soit la productivité en valeur, Albert Aftalion (1911), « Les
trois notions de la productivité et les revenus », Revue d’économie politique, mars-
avril 1911 et mai-juin 1911.
(6) Patrick Fridenson, (1987), « Un tournant taylorien dans la société française
1904-1918 », Annales ESC, vol. 43, septembre-octobre, nº 5, p. 1032.
(7) Aimée Moutet (1997), Les logiques de l’entreprise, la rationalisation de l’industrie
française de l’entre-deux-guerres, Paris, EHESS.
(8) André Vincent (1944), Le progrès technique en France depuis 100 ans, Paris,
Institut de conjoncture. Cet ingénieur des Arts et métiers, né en 1900, mène dans
les années 1930 une carrière d’ingénieur tout en s’intéressant à l’économie en
autodidacte. Avec Alfred Sauvy à l’Institut de conjoncture, il définit la productivité
comme la mesure du progrès technique, développe l’idée d’une pondération par
les prix, montre les liens entre progrès technique et progrès social, et, enfin, souligne
l’intérêt des comparaisons internationales. SAEF, 1C32155, dossier de carrière
d’André Vincent.
(9) Gérard Bossuat (2002), « Les Etats-Unis et le bon gouvernement économique de
la France au temps des aides », in Dominique Barjot, Isabelle Lescent-Giles et Marc
de Ferrière Le Vayer (dir.), L’américanisation en Europe au XXesiècle : économie,
culture, politique, vol. 1, Lille, CRHENO, p. 113-136.
(10) Sur l’ECA, voir Jacqueline Mcglade (1995), The Illusion of Consensus : American
Business, Cold War Aid and the Industrial Recovery of Western Europe, 1948-1958,
Ph-D. Dissertation, George Washington University, William H. Becker (dir.).
(11) Nous nous permettons de renvoyer à Régis Boulat (2008), Jean Fourastié, un
expert en productivité et en modernisation (France, années trente - cinquante),
Besançon, PUFC.
histoire
No3-4 - Mars-Avril 2010 -
250

carrière d’ingénieur, il prépare à l’Ecole libre des sciences politi-
ques un doctorat en droit, mention économique (il ne s’intéresse
à la science économique que dans la mesure où elle décrit et
explique la réalité de la condition humaine, le phénomène de
dépopulation des campagnes en particulier) [12] avant de se
tourner vers les Assurances. Commissaire-contrôleur des compa-
gnies d’assurances, il effectue des vérifications financières et juri-
diques afin d’instruire les plaintes déposées par les assurés et
d’étudier la situation financière des entreprises (13). Sa thèse sur
le contrôle par l’Etat des sociétés d’assurances connaît un certain
succès et lorsque la procédure des décrets-lois permet à Gabriel
Chêneaux de Leyritz, directeur des Assurances, de faire la réforme
que Fourastié appelait de ses vœux en 1937, il est chargé des
décrets d’application. Ce travail dans les assurances lui fait
prendre conscience d’un fossé entre la science économique et
la réalité concrète (14). Fonctionnaire en vue dans sa spécialité
en 1939, Fourastié renforce encore sa légitimité d’expert pendant
la guerre (15) et, à la Libération, il est reconnu tant en matière
d’assurance que de comptabilité puisqu’il a participé aux travaux
du plan comptable et publié un « Que sais-je ? » sur le sujet.
La consécration arrive en 1945 avec L’Economie française dans
le monde (16), ouvrage dans lequel il montre que la productivité,
mesure du progrès technique, commande l’économique et le
social. Des comptes rendus flatteurs attirent l’attention de Jean
Monnet qui lui demande de rejoindre son « club des optimistes ».
Au Plan, Fourastié participe aux travaux de la sous-commission
productivité de la main-d’œuvre avant de se rendre aux Etats-
Unis. La constatation d’une disparité entre prix français et prix
américains explique l’apparition d’un dernier thème important :
sa formation d’ingénieur et de comptable lui permet, en effet,
de saisir l’importance des prix de revient (17). Parallèlement, il
découvre Colin Clark dont il fait son miel, croyant y trouver la
source de la théorie de la répartition de la population entre les
secteurs primaire, secondaire et tertiaire, ainsi qu’une doctrine du
progrès technique dont plusieurs éléments, en particulier la
théorie des crises, se trouvent en accord avec ses idées et justi-
fient ses mises en accusation de l’économie politique
traditionnelle.
Au Plan, il participe également à l’élaboration d’un programme
franco-américain de modernisation reposant sur la notion de pro-
ductivité. En effet, à la fin de l’année 1948, l’ECA, qui se félicite
d’avoir mis sur pied un programme (l’Anglo-American Council on
Productivity) dans lequel Britanniques et Américains coopèrent
afin d’accroître la productivité par un transfert de savoir-faire
innovants et l’adoption de nouvelles méthodes de management,
encourage les initiatives des experts français du Plan désireux de
bénéficier, eux aussi, de l’assistance technique (18). Alors que
l’échéance de 1952 donne à la question de la productivité un
caractère d’urgence pressante et face aux travaux lents et peu
productifs de la sous-commission productivité de la main-
d’œuvre dont les membres, non-désignés officiellement, sont peu
assidus (19), Jean Monnet a décidé de réunir un groupe de travail
chargé d’élaborer un programme d’accroissement de la produc-
tivité (20) dont sont exclus les représentants des organismes qui
font du conseil dans un but commercial depuis l’entre-deux-
guerres (Comité national de l’organisation française ou CNOF,
Bureau des temps élémentaires ou BTE et Commission générale
de l’organisation scientifique du travail ou CEGOS). Présidé par
Fourastié, ce groupe d’experts choisis en raison de leurs compé-
tences, de leur connaissance des Etats-Unis, de leurs liens person-
nels avec Monnet et, surtout, de leur volonté de la productivité
« la variable essentielle d’action de la société française sur elle-
même » (21), publie un rapport en décembre 1948 qui souligne
les facteurs handicapant la productivité en France et propose un
programme d’accroissement s’appuyant sur l’utilisation de
l’expérience américaine. Or, il est possible d’accroître de 70 % la
productivité française d’ici 1952 par l’application du Plan d’équi-
pement (20 %) et par une meilleure utilisation des moyens exis-
tants, c’est-à-dire par un programme d’accroissement de la
productivité (50 %). Une annexe qui précise la manière dont peut
être utilisée l’expérience étrangère conçoit les bases de l’envoi
des missions de productivité. En définitive, l’ensemble des mesures
préconisées doit créer un « choc psychologique indispensable à
une attitude d’efficience que les chefs d’entreprise, les ingé-
nieurs, les cadres et les ouvriers doivent prendre pour remplacer
par une conception dynamique de leur rôle l’esprit de routine qui
est une des causes de notre appauvrissement » (22). Ce pro-
gramme franco-américain de modernisation reposant sur la
notion de productivité se heurte à deux obstacles majeurs. Le
premier résulte de l’américanisation de la question, qui brise le
consensus existant jusque-là au sein de la société française sur la
question de l’accroissement de la productivité et amène la CGT,
par ailleurs consciente des enjeux, à dénoncer l’hégémonisme
américain (23). Le second concerne la diffusion même de la
notion de productivité : en effet, pour Monnet, la réussite du plan
nécessite une modification radicale dans la manière d’analyser
les phénomènes économiques et les rapports entre les différents
agents. Or, un tel effort exige un support conceptuel.
Vulgarisation et enseignement
Jean Fourastié met sa notoriété d’expert au service d’un genre
littéraire nouveau dont il est l’inventeur, l’essai économique grand
public. Le Grand Espoir du XXesiècle, sous-titré « progrès tech-
nique, progrès économique, progrès social », qui paraît en 1949,
présente une version aboutie de ses principales idées (24). Fou-
rastié prend la position d’un observateur dépassionné qui analyse
attentivement les faits économiques, en particulier la notion de
progrès technique et ses conséquences : « le lecteur apercevra
qu’il existe un ensemble de faits économiques et sociaux que l’on
ne peut expliquer que par cette notion et qui, inversement, s’expli-
quent et se décrivent facilement si l’on y a rationnellement
recours ». Le progrès technique, Fourastié l’évalue au moyen de
la productivité du travail « qui mesure la quantité de travail
obtenue dans une unité fixe (l’heure) de travail humain, quelles
que soient les autres conditions de la production ». Si l’intensité
inégale du progrès technique légitime sa division tripartite des
activités, elle est aussi à l’origine des migrations de la population
active, du mouvement séculaire des prix et du progrès écono-
mique en général.... Phénomènes qui tendent à démontrer pour
Fourastié que le monde est engagé dans une période transitoire
instable qui précède une civilisation humaniste tertiaire (25). Ainsi,
sous la plume de Fourastié, la notion de productivité devient le
principe unique d’explication d’une multitude de phénomènes
que, pour l’opinion publique, rien, a priori, ne rapprochait
jusqu’alors : « Désertification des campagnes, diminution de la
durée du travail, élévation des âges scolaires, crises périodiques
(12) Jean Fourastié (1966), « Le progrès technique et les activités économiques »,
Revue économique, nº 1 janvier, p. 115-126.
(13) SAEF PH 181-94-1, note sur la carrière de M. Fourastié.
(14) Jean Fourastié, art. cit., 1966, p. 115-126.
(15) Olivier Dard (2004), « Fourastié avant Fourastié : la construction d’une légitimité
d’expert », French Politics Culture and Society, vol. 22, nº 1, p. 1-22.
(16) Jean Fourastié et Henri Montet (1945), L’économie française dans le monde,
Paris, PUF, col. « Que sais-je ? ».
(17) Jean Fourastié (1961), « Remarques sur l’introduction de la notion de progrès
technique dans la science économique », Economie appliquée, p. 173-188.
(18) James M. Silberman, The History of the Technical Assistance Programs of the
Marshall Plan and Successor Agencies 1948-1961, p. 16.
(19) AN 80AJ 77, chemise « Documentation Magron », note du 17 septembre 1948
« Sous-commission de la productivité et groupe de travail de la productivité » remise
à Monnet le 17 septembre 1948.
(20) FJM, 13/3/13, lettre de Monnet au président du Conseil des ministres, 4 mars
1950.
(21) Konstantinos Chatzis et Vincent Guigueno (1993), Pensée technique et système
d’organisation industrielle en France de l’entre-deux-guerres aux années 70-80,
compte rendu de fin d’opération d’une recherche financée par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, p. 30.
(22) Ibid. p. 32.
(23) Sur l’antiaméricanisme en France, voir Philippe Roger (2002), L’ennemi améri-
cain. Généalogie de l’antiaméricanisme français, Paris, Seuil.
(24) Jean Fourastié (1949), Le Grand espoir du XXesiècle, Paris, PUF. Le titre est, en
fait, un écho à la Petite Peur du XXesiècle d’Emmanuel Mounier (Emmanuel Mounier
[1949], La Petite Peur du XXesiècle, Neuchâtel, La Baconnière et Paris, Seuil).
(25) Jean Fourastié (1949), op. cit., p. 11-26.
histoire
-N
o3-4 - Mars-Avril 2010
251

et chômage, évolution différentielle des prix dans l’espace et le
temps, répartition de la population active... Tous ces phénomènes
sont éclairés par la notion de productivité » (26).
Comme beaucoup d’autres travaux de Fourastié jusqu’aux Trente
Glorieuses, cet ouvrage est animé d’un « humanisme opti-
miste » (27) : « en libérant l’homme du travail servile, la machine
moderne le rend disponible pour les activités plus complexes de
la civilisation intellectuelle artistique et morale. La machine
conduit ainsi l’homme à se spécialiser dans l’humain » (28). Ce
livre fait l’objet d’une centaine de comptes rendus plutôt favo-
rables, en France comme à l’étranger, à gauche comme à
droite, qui témoignent de son réel succès. Cependant, on ne peut
s’empêcher de constater le silence assourdissant des revues
d’économie politique classique et les critiques de la revue
communiste La Pensée qui assimilent Fourastié à un « économiste
bourgeois » « présentant n’importe quelle théorie générale pour
ne pas examiner honnêtement la situation économique pré-
sente » (29). En définitive, les auteurs des comptes rendus favora-
bles savent gré à Fourastié de toucher un « grand public »
jusque-là peu familier des questions économiques et sociales, tout
en signalant que ses travaux, centrés sur l’étude de l’évolution du
monde contemporain sous l’influence du progrès technique, sont
très voisins de ceux de Colin Clark, bien que différents (30). Tou-
tefois, Fourastié ne se contente pas seulement de prophétiser
l’avènement d’une civilisation tertiaire humaniste et de vulgariser
la notion de productivité puisqu’il continue de jouer un rôle de
premier plan dans les négociations qui aboutissent à l’envoi des
premières missions de productivité aux Etats-Unis et de diriger le
travail d’un groupe de statisticiens censé mettre au point une
terminologie et des indices de productivité (31).
Grâce à son action de publiciste, Fourastié fait sortir la notion de
productivité du cadre de l’usine où l’enfermaient les organisa-
teurs des années 1930. Il y rattache étroitement l’évolution des
prix et du niveau de vie et en fait un synonyme de croissance et
de modernité. Il définit l’accroissement de la productivité comme
le moyen de la modernisation de la France et du rattrapage de
son retard alors que l’efficience et la technique constituent les
nouveaux critères décisifs d’une prise de décision rationnelle. Fou-
rastié fait donc de la productivité une notion transversale qui
explique un grand nombre de problèmes. Parallèlement, sans
compter sa participation aux préstages des missions de produc-
tivité (32), il multiplie les conférences de vulgarisation, en France
comme à l’étranger, devant des publics variés.
La productivité est enfin présente dans son activité d’enseignant
comme l’attestent ses cours du CNAM, de l’ENA ou de l’IEP et sa
direction de recherches à l’Ecole pratique des hautes études.
Leur rapprochement permet de mettre en évidence plusieurs
caractéristiques. Fourastié prend d’abord soin de présenter ses
travaux comme allant à contre-courant des théories classiques :
son cours à l’IEP est un « cours de combat » contenant des idées
paradoxales, à contre-pied des théories admises (33). Ayant souf-
fert du caractère dogmatique et froid de l’enseignement de Cen-
trale, il veut éveiller l’esprit critique de ses étudiants sur des phé-
nomènes négligés par la théorie économique traditionnelle. Les
conceptions « révolutionnaires » de Fourastié sur le progrès tech-
nique et sa méthode empirique constituent la deuxième carac-
téristique intéressante. L’étude du progrès technique est un outil
nouveau, « indispensable et facile à manier », au service de la
science économique, lié d’une part à la « notion comptable de
prix de revient » et, d’autre part, « à la notion humaine de pro-
ductivité » : « c’est ensemble que ces trois notions doivent être
introduites dans la science économique ; la productivité, étant le
prix de revient exprimé en heures de travail, est une mesure du
progrès technique ». Ainsi, Jean Fourastié exerce une influence
forte sur un public d’étudiants appelés à devenir cadres dirigeants
ou hauts fonctionnaires. Il leur enseigne que la productivité,
mesure du progrès technique, permet de transformer l’économie
politique en une science utile au chef d’entreprise et à « l’homme
d’action ("il ne s’agissait pas d’établir une définition qui aurait
enchanté un théoricien de faculté mais qui n’aurait pas servi au
président de la compagnie Electro-mécanique") » (34).
LE CENTRE FRANÇAIS
DE PRODUCTIVITÉ
Le temps de la propagande
et du « Bataillon sacré de la productivité »
Si Fourastié incarne mieux que quiconque l’époque des pionniers
de la productivité, il est loin d’être seul puisque son action n’est
pas dissociable de celle d’une nébuleuse modernisatrice ou, pour
reprendre la formule du ministre MRP Robert Buron, du « Bataillon
Sacré de la productivité ». Il s’agit d’une vingtaine d’hommes
appartenant à la même génération, celle qui a vécu à la fois la
dépression et la défaite, plus souvent ingénieurs que juristes mais
dont certains ont des formations atypiques, qui participent à toute
sorte de comités ou de commissions nés en marge de l’appareil
traditionnel (le directeur des programmes Pierre Grimanelli, le rap-
porteur de la commission productivité du CNPF Pierre Vallée, le
diplomate Rostislaw Donn...). Jusqu’en 1953, cette administration
« de mission », s’articule autour d’un Comité national de la pro-
ductivité et d’une Association française de la productivité (AFAP)
chargée d’organiser des missions de productivité tripartites
(patrons, cadres et ouvriers) aux Etats-Unis et de mener des
actions de propagande.
L’AFAP assure un large retentissement aux missions de productivité
grâce à des conférences de presse (35) et à la publication de
rapports via la Société auxiliaire de diffusion des éditions de pro-
ductivité (SADEP). Si leur nombre augmente rapidement (de 1 en
1950, on passe à 16 en 1951 et à 26 en 1952) [36], ces rapports
doivent être examinés avec circonspection en raison de leur opa-
cité technique, du statut indéterminé des auteurs et des diverses
possibilités de lecture. Instruments de propagande pour l’historien
américain R. Kuisel (37), on peut toutefois considérer, avec V. Gui-
gueno, que « derrière le jargon technicien et les relents d’un dis-
cours officiel mal digéré », se cache une vision partagée dans
laquelle les critiques contre les manières françaises de penser
l’organisation industrielle et la gestion des ateliers avant-guerre
côtoient l’intérêt pour les nouvelles techniques de gestion indus-
trielle, comme le contrôle statistique ou les diverses ruses mana-
gériales, sans compter les renseignements macro-économiques
(26) Konstantinos Chatzis et Vincent Guigueno (1993), op. cit., p. 35.
(27) Pierre Bize (1990), « L’humanisme optimiste de Jean Fourastié », Humanisme et
entreprise.
(28) Jean Fourastié (1949), op. cit. , p. 354.
(29) Claude Steinberg (1950), « Jean Fourastié : le Grand Espoir du XXesiècle », La
Pensée, nº 31, juillet-août, p. 140.
(30) En fait, le classement par secteur est, pour Fourastié, sans importance car seul
compte le classement des professions par ordre croissant ou décroissant de progrès
technique, or cette notion de progrès technique différente d’une profession à
l’autre est étrangère à Clark. Fourastié a découvert ce dernier en 1946 à travers
Les conditions du progrès économique. Voir Jean Fourastié (1961), art. cit.,
p. 173-188 et Jean Fourastié (1966), art. cit., nº 1, janvier, p. 115-126.
(31) Pour une approche historique de la terminologie de la productivité et ses
mesures, voir Régis Boulat (2006), « La productivité et sa mesure en France
1944-1955 », in Histoire et Mesure, vol. XXI, nº 1, p. 79-110.
(32) Aucun des 3 000 missionnaires de productivité ne part outre-Atlantique sans
avoir écouté au moins un exposé de Jean Fourastié.
(33) Jean Fourastié (1957), Le progrès technique et l’évolution économique, Paris,
Les Cours de droit.
(34) Ibid., p. 173.
(35) Utile à son origine (19 conférences de presse ont lieu en 1951, 14 en 1952), ce
vecteur s’avère de moins en moins efficace car, en dehors des précisions techni-
ques intéressant les milieux professionnels seulement, les conférenciers se bornent
le plus souvent à répéter ce qu’ont dit leurs prédécesseurs.
(36) Pour les mettre à la portée des militants syndicaux, des contremaîtres et des
ouvriers, un résumé en est systématiquement fait sous forme de cahier. Chaque
numéro de ces cahiers de la productivité est tiré à 20 000 exemplaires (à titre
d’exemple, 24 cahiers sont publiés en 1952).
(37) Richard Kuisel (1988), « L’American Way of Life et les missions de productivité »,
Vingtième siècle, nº 17, janvier-mars, 1988, p. 25 et (1996), Le Miroir américain, Paris,
Lattès, 1996 (chap. IV « Les missionnaires du plan Marshall »).
histoire
No3-4 - Mars-Avril 2010 -
252

sur les secteurs industriels dont les missionnaires sont issus (38). Ces
rapports soulignent aussi la difficulté d’établir un lien entre les
indices de productivité américains élevés et ce que les mission-
naires ont vu dans les ateliers : pour expliquer cette productivité
« introuvable », les missionnaires utilisent la métaphore de la « flui-
dité », tant pour désigner les techniques de production de masse
(vitesse, régularité et qualité de la production) que les rapports
sociaux car, dûment chapitrés par les autorités de l’ECA, les mis-
sionnaires croient observer que les usines américaines ont
dépassé les conflits nés de l’OST et communient dans l’utopie
d’un monde industriel sans tensions. L’impact des missions est
donc difficile à cerner : au sens strict, les résultats varient en fonc-
tion des branches et de la diffusion des résultats par les organisa-
tions professionnelles (39). Au sens large, la productivité définie
comme une mentalité devient un slogan ambigu synonyme de
croissance.
L’AFAP crée également Productivité française, luxueuse revue de
propagande présentant la politique française d’accroissement
de la productivité et ses plus chauds partisans (40). Le comité de
rédaction est dirigé par un normalien agrégé d’italien proche du
ministre MRP Robert Buron, le sulfureux Georges Pâques
(1914-1993) [41]. De 1952 à 1954, conformément au volontarisme
affiché par les représentants des syndicats libres (CNPF, CGT-FO,
CFTC, CGC) siégeant au CNP, Productivité française présente la
productivité comme seule capable d’entraîner une amélioration
des conditions de vie des Français, de « détacher » la classe
ouvrière de l’influence communiste et de pacifier les relations
sociales. Malgré la propagande multiforme valorisant les missions
de productivité et les « programmes pilotes » (fonderie, chaussure,
Centre Intersyndical d’études et de recherches en productivité
[CIERP]), les Français ne prennent que lentement conscience de
l’importance de la notion de productivité, confirmant ainsi les
craintes de Fourastié : « les mentalités comme autant de puits
dont on ne s’aperçoit pas qu’ils existent ». En 1953, avec la créa-
tion d’un commissariat chargé de gérer le Fonds national de la
productivité, on passe toutefois du temps de la propagande à
celui de l’action.
Le temps de l’action
Par l’accord Buron-Labouisse de mai 1953, la France s’engage à
mettre en œuvre un programme d’accroissement de la produc-
tivité au moyen d’une subvention de 30 millions de dollars, dont
90 % de la contre-valeur, soit 9,4 milliards de francs, seront versés
à un Fonds national de productivité et affectés à diverses sub-
ventions pour favoriser l’accroissement de la productivité. A cette
subvention s’ajoute la participation française à l’Agence euro-
péenne de productivité (42) et, enfin, la dotation d’un Fonds de
prêts de productivité (5,1 milliards de francs) censé octroyer des
prêts aux entreprises (43). Un décret du 24 mai 1953 crée, à titre
temporaire, un Commissariat général à la productivité dirigé par
Gabriel Ardant (1906-1977) [44] dont le profil n’est pas « celui de
l’emploi » pour certains membres « historiques » du Bataillon sacré
de la productivité (« Les dignitaires de l’Eglise ont leur utilité, mais
il ne faut pas leur confier des postes qui exigent une mentalité de
missionnaire ») [45]. Afin de faire de la productivité « l’instrument
d’une politique économique planifiée », le Commissariat absorbe
la direction des Programmes, entraînant le départ de P. Grimanelli
pour la direction du SEITA. A défaut d’occuper « un poste à sa
taille » dans le gouvernement Mendès-France chargé de nettoyer
les « écuries d’Augias » (46), G. Ardant ambitionne d’être à la fois
un « coordinateur et une conscience pour les individus ou les
organisations dont les progrès ne sont pas assez rapides ». Il espère
pourvoir instiller, « dans toutes les opérations du ministère des
Affaires économiques, un concept de productivité qui, jusque-là,
était resté limité aux actions relativement mineures du Comité
national de la productivité » (47). Ainsi, chargé de mener des
études favorisant l’accroissement de la productivité dans le
cadre du plein emploi, d’assurer la direction des programmes
économiques et de veiller à ce que la distribution du crédit tienne
compte des critères de productivité (critères à long termes sur-
tout), le Commissariat est doté d’un pouvoir de décision qui lui
permet d’arbitrer les conflits possibles, le CNP étant rendu à sa
vocation première d’organe consultatif.
Si Ardant se lance dans une vaste rationalisation des organismes
chargés de l’accroissement de la productivité, il doit également
gérer les demandes de crédits et de subventions. Les grandes
lignes de la répartition des subventions sont fixées dans l’accord
du 28 mai 1953. Le crédit est soumis à une double limitation de
volume et de durée (il doit être utilisé en deux ans et demi, trois
au plus). Pour Ardant « ces limitations [nous] imposent d’opérer
une sélection très stricte des bénéficiaires et de favoriser en prio-
rité les projets qui paraîtront les plus efficaces à moindre frais et
dans le laps de temps le plus réduit » (48). Si les subventions accor-
dées par le Commissariat ne sont pas susceptibles de compenser
des réductions budgétaires, elles n’ont pas non plus pour objet
de soutenir « d’une manière permanente, une opération devant
durer » (49). Outre le CREDOC, le Commissariat subventionne ainsi
le CADIPPE. Créé en janvier 1953 à l’initiative de chefs d’entre-
prises et de militants syndicalistes, le Comité d’action pour le
développement de l’intéressement du personnel à la productivité
des entreprises est animé par des représentants du monde
patronal et ouvrier. Le CADIPPE exerce une action de formation
générale et professionnelle sur les problèmes de productivité : il
ne vise pas à perfectionner une technique particulière mais à
permettre une étude d’ensemble des problèmes de productivité
au cours de sessions de courte durée qui réunissent des chefs
d’entreprises, des cadres et des salariés (50). Le CADIPPE entend
la notion d’intéressement au sens très large (« Tout ce qui peut
être entrepris pour que la participation du salarié à la vie de
l’entreprise soit plus active et pour qu’il se sente solidaire de cette
entreprise. La participation financière à l’amélioration des résul-
tats ne constitue qu’un moyen secondaire, quoi qu’inévi-
table » [51]). Son objectif essentiel est de concourir sur le plan des
(38) Vincent Guigueno (2003), « Une note de bas de page dans l’histoire industrielle
de la France, les récits des missions de productivité aux Etats-Unis au début du
siècle », MEFRIM, 115, 2, p. 525-533 et Vincent Guigueno (1994), L’éclipse de l’atelier,
Les missions françaises de productivité aux Etats-Unis pendant les années cinquante,
mémoire DEA, ENPC.
(39) Matthias Kipping et Nick Tiratsoo (éd.) [2002], Americanisation in 20th Century
Europe : Business, Culture, Politics, Lille, CRHENO et Dominique Barjot (éd.) [2002],
Catching up with America, Productivity Missions and the Diffusion of American Eco-
nomic and Technological Influence after the Second World War, Paris, PUPS,
p. 265-277, 278-285, 301-314, 359-384, 395-405, 405-413.
(40) AN 81 AJ 210, conseil d’administration de l’AFAP du 4 mars 1952. Parallèlement,
l’AFAP lance les Cahiers de la productivité, destinés aux milieux syndicaux ouvriers :
les traductions d’articles techniques américains côtoient les résumés des rapports
de mission.
(41) Il est ensuite chargé de mission à l’OTAN avant d’être arrêté en 1963 pour
espionnage au profit de l’Union soviétique et condamné à la détention criminelle
à perpétuité. En février 1968, De Gaulle réduit sa peine à vingt ans et il bénéficie
du régime de libération conditionnelle en 1970. Voir Charles Benfredj (1993), L’affaire
Pâques, Paris, J. Picollec et Georges Paques (1971), Comme un voleur, Paris, Julliard.
(42) Bent Boël (2003), The European Productivity Agency, Museum Tusculanum Press,
Copenhagen.
(43) SAEF, B 1436, décret nº 53-67 du 30 juillet 1953.
(44) Diplômé de l’ELSP en 1925, licencié en droit, il rejoint l’inspection des Finances
en 1929 tout en participant, jusqu’en 1938, à divers travaux de réforme administra-
tive. Lieutenant de chasseurs en 1939-1940, il rejoint l’Afrique du Nord au début de
l’année 1943 où il s’engage au sixième régiment de Tirailleurs marocains. Chargé
de mission en Corse lors de la Libération de l’île, il y procède à une expérience
d’échange monétaire, la première du genre dans l’Europe libérée. Rappelé à Alger,
il est ensuite délégué du GPRF pour l’administration financière des territoires libérés
(juin 1944) et participe aux négociations avec les Alliés et à la remise en état des
administrations financières. Au lendemain de la guerre, il est l’âme du secrétariat
général du Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services
publics (septembre 1946 - octobre 1953) et expose ses méthodes de rationalisation
des choix budgétaires dans plusieurs ouvrages. SAEF PH 181-94/7.
(45) AML, 19S93, chemise productivité, lettre manuscrite de Dayre à Buron, 26 juillet
1953.
(46) Jean Lacouture (1981), Pierre Mendès France, Paris, Seuil, p. 389.
(47) NARA, RG 469, box 170, Office memorandum from John W. Hoeveler (chief
Technical Assistance Division) to Henry R. Labouisse on the discussions with
G. Ardant, 3 décembre 1953, p. 2.
(48) CAMT, 72AS 1500, Commissariat général à la productivité, Note sur les principes
et les modalités de l’octroi des subventions prélevées sur le Fonds national de la
productivité, 9 février 1954.
(49) Ibid.
(50) Au cours de sa première année d’existence, il organise sept sessions d’initiation
dont cinq dans l’industrie, une dans le bâtiment et une dans le commerce.
(51) AN, 81 AJ 181, note du Commissariat à la productivité sur le CADIPPE, 7 avril
1954.
histoire
-N
o3-4 - Mars-Avril 2010
253

entreprises, des professions, et sur le plan interprofessionnel à créer
les conditions techniques et psychologiques propres à susciter le
développement de la productivité, par la mise en commun des
expériences et en favorisant les études communes entre chefs
d’entreprises, cadres et salariés.
Parallèlement une procédure est mise en place pour les prêts à
la productivité : les opérations de prêts sont combinées avec
d’autres opérations de crédit par l’intermédiaire du Fonds de
modernisation et d’équipement et par la Commission des inves-
tissements (52). Les entreprises désireuses d’obtenir un prêt de
productivité doivent établir un dossier devant comprendre,
notamment, des renseignements généraux sur l’entreprise, une
description du programme de productivité envisagé et un plan
de financement détaillant les parts d’autofinancement et de cré-
dits du banquier habituel (le prêt de productivité ne pouvant
porter que sur le solde). Au total, entre avril 1954 et mars 1956, le
Commissariat reçoit 593 demandes pour un montant représen-
tant plus de deux fois la dotation de son fonds de prêts. Sur ces
593 demandes, 515 sont examinées au premier stade de l’instruc-
tion par la commission compétente du Conseil de direction du
Fonds de développement économique et social : 189 sont reje-
tées (parmi ces dernières, 61 sont toutefois orientées vers d’autres
sources de crédit) et 16 ajournées. Sur les 310 demandes prises
en considération, 188 sont examinées pour décision définitive et,
après quelques refus (25), des ajournements (11) voire de rares
abandons après décision définitive d’octroi (7), 148 prêts sont
finalement accordés.
Conscient de la nécessité d’avoir une politique décentralisée sans
pour autant implanter systématiquement dans tous les grands
centres régionaux une organisation administrative uniforme, le
CGP octroie également des subventions et agit comme un pres-
tataire de services (envoi de documentation, d’appareils et de
films, mise à disposition d’experts...) afin de contribuer à la réali-
sation d’actions concrètes, d’informer et de conseiller les patrons
et d’élaborer des programmes d’ensemble adaptés aux pro-
blèmes régionaux. Au début de l’année 1954, deux centres régio-
naux de productivité fonctionnent à Marseille et Tunis. Le centre
de Marseille est né dès 1953 sous les auspices de la Société pour
la défense du commerce et de l’industrie. Il organise des confé-
rences d’information, accueille les patrons ou les cadres pour des
séminaires avant de fédérer une dizaine d’entreprises pilotes où
sont mises en œuvre diverses techniques d’amélioration de la
productivité. A la suite de cet exemple, des centres ou des
bureaux interprofessionnels de la productivité sont créés à Nancy,
Strasbourg, Toulouse et Montpellier... Au total, pas moins de
24 centres régionaux sont créés.
Malgré le succès de ces diverses actions, dont l’opération de
prêts qui sensibilise indéniablement les patrons français à ce dis-
cours nouveau sur la productivité et la croissance, le Commissa-
riat disparaît en 1959 « ayant accompli l’essentiel de sa
tâche » (53). Loin de passer inaperçue, la participation de G.
Ardant aux côtés de P. Mendès France à la manifestation de l’été
1958 « pour la défense de la République » a scellé son sort. En
février 1959, il est remplacé par un simple service de productivité
au sein du Commissariat général du Plan. Cette disparition
n’entraîne toutefois pas celle des centres professionnels ou régio-
naux. Pour poursuivre l’œuvre entreprise et coordonner les actions
en matière de productivité, un service allégé de productivité est
créé au sein du Commissariat général au Plan. Sous la tutelle de
Pierre Massé, ce service, dirigé par Francis Raison, s’intéresse alors
beaucoup à l’étude des problèmes de formation aux fonctions
d’encadrement, de gestion et d’organisation, mettant sur pieds
une Commission où l’on retrouve Pierre Tabatoni dont les propo-
sitions débouchent sur la création de la FNEGE (54). Avec la sup-
pression du Commissariat à la productivité et sa transformation
en un service du Commissariat du Plan, la question de la produc-
tivité perd toute autonomie : elle n’est plus un objectif en soi
pour devenir un paramètre parmi d’autres de l’action gouver-
nementale.
(52) CAMT, 72 AS 1500, lettre de R. Lartisien à P. Francin, 11 février 1954.
(53) Francis Raison (1995), Les actions menées en faveur de l’amélioration de la
productivité entre 1954 et 1966.
(54) Marie-Emmanuelle Chessel et Fabienne Pavis (2001), Le Technocrate, le patron
et le professeur, Paris, Belin, p. 32. Les auteurs montrent bien comment la naissance
de la FNEGE s’inscrit dans le débat du devenir des structures nées de la productivité
et de la concurrence entre différents ministères, sur les modes de modernisation de
la société et de l’économie française.
histoire
No3-4 - Mars-Avril 2010 -
254
1
/
5
100%