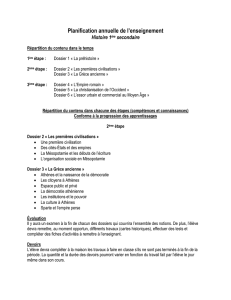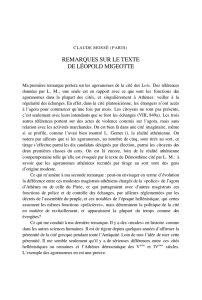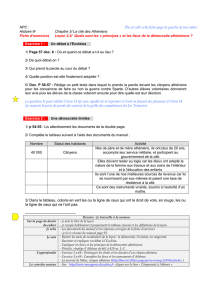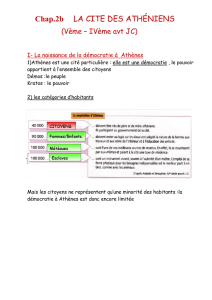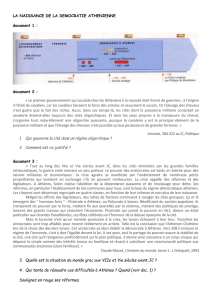atrides
publicité

ATRID~S
[1
105
A. R. W. Harrison, The Law of Athens, T. [1. Procedure,
Oxford, 1971. pp. 169-176,
M.H- Ha nsen, Apagoge. Endelx/s and Ephegesls aga/nst
Kakourgol, AI/mo/ and Pheugontes, Copenhague, 1976,
pp, 54-98.
r:ir Cité, Justice, Polileia.
ATRIDES
Les Atrides sont une célèbre famille dont le mythe a
nourri l'imagInation des grands poètes tragiques du V
siècle, Atrée, le fondateur de la famille, était fils de
Pélops et d ' Hippodamie, Pélops lui-même étail fils de
Tantale, lequel l'avait offert en festin aux dieux après
l'avoir préalablement découpé en morceaux, Les
dIe ux se vengèrent de lui en le condamnant à n'être
jamais rassasié (le supplice de Tantale), pUIS reconstituèrent le corps du j eune garçon, amputé toutefois
d ' une épaule que Déméter avait dévorée, Parvenu à
l'âge d'homme, Pélops tomba amoureux de la fille du
roi de PIsé, Œnomaos, appelée Hippodamie, Pour
décourager les prétendants à la maIn de sa fille,
Œnomaos leur imposait une épreuve, le va Incre à la
course de char, épreuve dont ils sortaient toujours
vaincus, le ur défaite entrainant leur mise à mort.
Pélops sut gagner l'amour d'Hippodamie, laquelle
Incita le cocher de son père à fausser les ro ues du char
ATRIDES
106
d'Œnomaos. Ainsi Pélops obtint-il la victoire et la
main d·Hippodamie.
Pélops et Hippodamie eurent deux ms, Atrée et
Thyeste. qu 'une violente haine sépara bientôt. Pour se
venger de Thyeste qu' il soupçonnait être l'amant de
son épouse Aeropè, Atrée tua les enfants que son frère
avait eus d'une Naïade, et, ayant fait bouillir leur
corps, les servit à Thyeste au cours d'un banquet.
Thyeste se vengea à son tour d'Atrée en le faisant
assassiner par un autre de ses fils. Égisthe.
Ainsi commence la malédiction des Atrides, avec au
point de départ, ce double crime qui relève de la
sauvagerie la plus bestiale, puisque Pélops comme les
enfants de Thyeste ont été offerts au cours d'un repas
sacrificiel corrompu, les victimes étant des êtres
humains. Cest d 'ailleurs un autre sacrifice humain
qu 'on retrouve dans la séquence suivante du mythe : le
sacrifice d'Iphigénie. Atrée. devenu roi de Mycènes,
avait eu deux fils, Agamemnon et Ménélas. Ce dernier
devint roi de Sparte par son mariage avec Hélène.
Quand celle-ci fut enlevée par Paris, le fils de Priam,
le roi de Troie, Agamemnon, organisa pour venger
son frère la fameuse expédition qu'on appelle la
guerre de Troie. Mais. alors que les navires grecs
étaient rassemblés à Aulis, des vents contraires les
empêchèrent d'appareiller pour l' Asie. Agamemnon
ayant consulté le devin Calchas, apprit de celui-ci
qu'il lui fallait sacrifier sa fille Iphigénie à Artémis.
ATRID~S
107
Agamemnon s'exécuta, malgré les protestations de
son épouse Clytemnestre, et celle-ci se vengea à son
tour lorsque, dix ans plus tard, Agamemnon vainqueur
rentra en Grèce : elle arma contre lui le bras de son
amant Egisthe, et le fit assassiner, ainsi que
Cassandre, la captive qu'il avait ramenée de Troie.
Devenu adulte, Oreste, le fils d'Agamemnon, aidé de
sa sœur Electre et de son ami Pylade, vengea son père
en assassinant Clytemnestre et Egisthe. Mais. devenu
fou et poursuivi par les Erynnies, Oreste dut s'enfuir
jusqu'à Athènes OÛ il fut jugé par le tribunal de
I"Aréopage, présidé par Athéna. qui l·acquitta. Selon
une version du mythe, transmise en particulier par
Euripide, Oreste et Pylade se seraient alors rendus en
Tauride oû ils retrouvèrent Iphigénie. sauvée au
dernier moment par Artémis qui lui avait substitué une
biche et en avai t fait sa prêtresse. Guéri de sa folie,
Oreste aurait épousé Hermione, la fille de Ménélas, et
régné avec elle sur Sparte jusqu'à sa mort.
L 'Orestie d 'Eschyle, l' Electrede Sophocle, l' Electœ
et les deux Iphigénie d' Euripide témoignent de l'importance que les Anciens accordaient au mythe des
Atrides. Les modernes y ont lu le témoignage du passage de la vie sauvage à la civilisation. de la condamnation des sacrifices humains et des pratiques
anthropophages, cependam que l'acquittement
d 'Oreste par le tribunal de l'Aréopage traduit le triomphe de la justice des hommes sous le patronage
d'Athéna.
BANAUSJJI
111
108
P. Vidal-Naquet, «Chasse et sacrifice dallS L'Orestie
d'Eschyle &, dans Mythe er tragédie en Grèce ancienne,
Paris, 1972, pp, 133-158,
r:ir Aréopage, Athéna, Héros et cycles héroïques. Schlie-
mannn, Troie (Guerre de) ,
BANAUSOI
Le temle est employé dans le même sens que
demiourgoi pour désigner les artisans, mais il est
chargé d'une nuance péjorative. On le rencontre
surtout chez les écrivains hostiles à la démocratie
comme Xénophon, Platon ou Aristote, lorsqu'ils s' interroge nt sur le bien-fondé d'un régime qui accorde
aux banausoï les mêmes droits qu' aux autres cito yens, « Les mé tiers d'artisans (banausikaij, dit
Socra te dans J'Économique de Xénophon, sont
décriés et il est certes naturel qu ·on les tienne e n
grand mépris dans les cités, Ils ru inent les corps des
ouvriers qui les exercent et de ceux qui les d iri ge nt en
les contraignant à une vie casanière, assis dans l'ombre de leurs ateliers, parfois même à passer toute la
j ournée au coin du feu . Les corps étant ainsi amollis,
les âmes aussi dev iennent bien plus lâches »
(Économique, IV, 3), à quoi fait écho Aristote affirmant dans la Politique (III, 1278a8) que « la c ité parfa ite ne fera pas du banausos un citoyen », La
BANQUU BANQUIERS
109
position de Platon est plus complexe, car s'il exclut
les artisans de la cité des Lois, il « fail de la fonction
artisanale, celle de Prométhée et celle d'Héphaïstos,
le centre de l'activité humaine, l'activité modèle par
excellence » (P, Vidal-Naquet), Pour les penseurs
grecs dans leur ensemble, l'activité « banausique ,. est
inco mpatible avec l'activité politique,
CI
p, Vidal-Naquet. ~tude d 'une ambigui'té : les artisans dans
la cité platonicienne. Le chasseur noIr, Paris, ]981. pp.
289-316.
r:ir Demiourgoi.
BANQUEIBANQUIERS
Le terme grec trapezitès que nous traduisons par
banquier tire son origine de la trapeza, la ]able des
changeurs qui, dans les grands ports du monde grec,
permetlaien] aux marc hands d'échanger les pièces
qu ' ils détenaien] contre de la mo nnaie locale, On ne
possède guère de renseignements sur les banques
grecques avant la fin du V' siècle, et on ne s 'étonnera
pas que ce soit une fois de plus pour Athènes que
notre information soit la plus abondante, Au IV siècle
en effet, une série de procès opposèrent le fils d' un
célèbre banquier il celui qui avait succédé il son père,
et les plaidoyers prononcés il l'occasion de ces procès
figurent panni les discours de Démosthène,
BANQUE/BANQUIERS
110
Ce banquier, nommé Pasion, était à l'origine, et le
fait est important, un esclave. Sa réussite dans la gestion des affaires de son maître lui valut d'être affran·
chi, et les services qu"il rendit il la cité de recevoir la
citoyenneté athénienne. Celui qui lui succéda à la tête
de la banque était son propre esclave, Phormion, qui
lui aussi fUi affranchi et fail citoyen, ce qui lui permit
de devenir l'époux légitime de la femme de son
ancien maître. Or celte situation semble bien n 'avoir
rien d·exceptionnel. Dans le discours composé par
Démosthène pour défendre Phormion contre les accusations de son beau-fils Apollodore, l·orateur fait la
constatation que le cas de Pasion et de Phormion sem·
ble assez banal: « II n'ignore pas. dit·il d· Apollodore,
il ne peut pas ignorer, pas plus que beaucoup d'entre
vous, que Socrate, le fameux banquier qui avait été
affranchi par ses maîtres comme le père d·Apollodore, donna sa propre femme e n mariage à Satyros,
son ancien esclave. Un autre banquier, Soclès, en usa
de même avec Timodémos, qui est encore en vie et
qui avait été égalemem son esclave. Et ce n·est pas
seulement à Athènes que pareille chose se pratique
dans le monde de la banque: à Égine, Strymodoros a
donné sa femme en mariage il son esclave Hermaios ;
et. après la mort de celle·ci, il lui donna encore sa
fille . On pourrait citer bien des cas semblables »
(pour Phormion, 28-29).
BANQUUBANQUIERS
111
Laissons cette curieuse pratique qui consistait 11 faire
don à l' esclave affranchi de la banque et de la femme,
Il n'en reste pas moins que l'origi ne servile de ces
banqu iers est révélatrice de la place qu'ils tenaient
dans la cité grecque, Même lorsqu'ils recevaient la
citoyenneté comme Pasion, ils n'en demeuraient pas
moins des « outsiders » , des gens dont le statut, quel
que fût le niveau de leur fortune , restait inférieur,
Ces banquiers étaie nt d'abord, on l'a vu, des changeurs, Au IV" siêcle cependant. les plaidoyers démosthéniens en fo nt foi. ils reçoivent aussi les dépôts de
riches clients, singulièremen t des marchands soucieux
de laisser leur arge nt à l'abri durant leur absence,
Mais, s'il leur arrive de servir d'intermédiaires entre
leurs clients et par exemple des marchands d ésireux
d'emprunter pour une expédition maritime vers le
Pont-Eux in ou quelque autre destination afin de rapporler du blé en échange de la cargaison que l'argent
emprunté leur a permis d' acquérir, ils ne gèrent pas
eux-mêmes l'argent déposé dans le urs coffres, et le urs
établissements ne sont en rien des organismes de
crédit. Quant 11 le ur fortune personnelle, elle n'atteignait pas toujours le niveau de celle de Pasion,
Démosthène cite le cas de nombreux banquiers qui
ont fait « faillite ». Et lorsque Phormion, qu i bénéficiait lui d'un grand crédit auprès de ceux qui lui confiaient leur argent, gérait la banque au bénéfice des fils
de Pasion, le profit annuel était de 160 mines, c 'est-à-
112
BARBARH
dire 16 000 drachmes, une somme importante certes,
mais sans commune mesure avec ce que pourraient
être les profits d ' un établissement bancaire d'aujourd'hui (rappelons qu'à la même époque un ouvrier travaillant sur un chantier de construction publique
reçoit entre une drachme et une drachme et demie de
salaire journalier),
L'époque hellénistique, avec l'accroissement de la
circulation monétaire, verra se multiplier les banques
privées, mais aussi se développer des banques publiques et sacrées, les cités et les temples se faisant
banquiers à leur tour.
[J
R. Bogaen , Banques el banquiers dalls les cllés grecques,
Leyde, 1968.
«La banque 11 Athènes au
XLIII , 1986, pp,19 sqq,
!V"
siè1:1e avant J.-c.
~, M.
H..
qr Commerce, Économie. Monnaie,
BARBARES
C'est sous ce vocable que les Grecs désignaient les
non-Grecs, ceux qui ne parlaient pas la même langue
qu'eux. Il est vraisemblable que l'origine du terme qui
remonte à Homère dérive d'une onomatopée, À l'époque classique, le monde barbare s'étendalt donc des
rives de la mer Noire aux côtes d'Espagne, Cepen-
BARBARES
113
dant, parmi ces barbares, il en était qui incarna ient par
excellence ces", autres » dont les Grecs tenaie nt à se
distinguer: à savoir les habitants de l'immense empire
perse. Les Grecs avaient eu à les affronter au cours
des deux g uerres médiques, et l' historien Hérodote,
qui écri vit ses Enquêtes pour en conserver la
mémoire, a plus que tout autre contribué à forger
lïmage du barbare, même s'il éprouvait pour ceux
qu'il qualifiait ai nsi non seulement de la curiosité,
mais même une sympathie que lui reprocheront ses
détracteurs.
Le barbare en effet est présenté par l' historien
d ' Halicarnasse comme", l'autre» par excellence. Ce
qui le distingue d'abord du Grec c'est sa soumission à
un pouvoir despotique, celui du roi, alors que le Grec
est un homme libre, C'est ensuite sa démesure, son
hybris, opposée au sens de l'ordre, propre au Grec. Le
récit de la bataille de Salamine est à cet égard édifiant:
face aux navires grecs qui avancent en bon ordre, les
navires perses se présentent dans le bruit et le désordre, et le urs pertes sont d 'autant plus lourdes qu ' ils se
re pliem sans conserver la moindre cohésion.
Mais cette altérité du barbare n'est pas nécessairement négative: elle est seulement l'inverse de la civilisation qu'incarne le Grec. Un passage d'Hérodote
est à cet égard sig nificatif: celui dans lequel il décrit
les mœurs de ces Égyptiens dom par ailleurs il
soulig ne la piété et l'ancienneté de la civilisation:
BARBARH
114
« Les Égyptiens qui vivent sous un climat singulier,
au bord d'un fleuve offrant un caractère différent de
celui des autres fleuves, ont adopté aussi presque en
taUles choses des mœurs et des coutumes à l'inverse
des autres hommes, Chez eux, ce sont les femmes qui
vont au marché et font le commerce de détail, les
hommes restent au logis et tissent. En tissant dans les
autres pays, o n pousse la trame vers le hau t, e n Égypte
on la pousse vers le bas, Les hommes y portent les
fardeaux sur la tête, les femmes sur les épaules, Les
femmes urinent debout, les hommes accroupis", Dans
les autres pays, les prêtres des dieux portent les
cheveux lo ngs, en Égypte, ils se rasent. Chez les autres
peuples, c'est la coutume en cas de deuil que ceux que
ce deuil atteint le plus directement se tondent la tête,
les Égyptiens quand les décês se produisent laissent
pousser leurs cheveux et leurs barbes, eux qui jusqu'alors étaient rasés", Les Grecs alignent les caractères d'écriture et les cailloux de compte en portant la
main de gauche à droite, les Égyptiens en la portant de
droite à gauche", » Ce texte est particulièrement
révélateur, car à partir de constatations réelles, comme
par exemple celle qui concerne l'écriture, l'historien
grec tire la conclusion générale de l'altérité absolue
des mœurs des Égyptiens par rapport à celles des
« autres hommes », c'est-à-dire en fait des Grecs,
Celte représentation du barbare comme l'autre
absolu se maintiendra, même après que l'aventure
BlBL/OrHEQUE
115
d'Alexandre aura fait accéder nombre de ces barbares
orientaux il la culture grecque.
[J
M. F. Basiez, «Le péril barbare~. dans La Grèce
ancienne. Paris. 1986, pp. 284-298.
r:ir Médiques (Guerres). Hérodote.
BIBLIOTHÈQUE
Une bibliothèque est il 1· origine un dépôt de livres.
Le terme n· est apparu dans la langue grecque que vers
la fin du IV siècle. On sait quïl désignera le célèbre
établissement fondé à Alexandrie par le premier
Ptolémée. C est sans doute il Athènes que furent constituées les premières bibliothèques privées. Platon
dans 1·Apologie évoque les livres du philosophe
Anaxagore que I"on pouvait acheter pour un prix
relativement modique. Mais c ·est probablement au
sein de 1· école aristotélicienne que l·habitude se prit
de rassembler des « livres » : dans les testaments des
philosophes de I"école. tels que les rapporte Diogène
Laerce, les livres apparaissent e n effet parmi les biens
distribués par le testataire à ses héritiers. Par ailleurs,
c·est il Athènes aussi qu 'est mentionné pour la première fois le souci de conserver une version officielle
d·un texte littéraire. L·auteur de la VIe de I"orateur
Lycurgue, qui fut le principal homme politique
116
cl' Athènes à l'époque d'Alexandre, lui attribue une loi
imposant la Iranscription des tragédies d'Esc hyle,
Sophocle et Euripide, une copie devant en être COI1 selVée dans les archives de la cité. Il ne faut pas
oublier enfin que, selon la tradition, la BibHothèque
d ' Alexandrie avait été fondée à l'initiative de ]' Athénien Démétrios de Phalère, disciple cl' Arisrote. qui se
réfugia auprès de Ptolémée après avoir été chassé de
la cité qu'il avait gouvernée pendant dix ans de 317 à
307. La bibliothèque d'Alexandrie avait pour mission
de rassembler la lotalllé de la littérature grecque, et
1'on sait quO elle finir par réunir plus de cinq cent mille
volumes.
(JI
H. Pfeiffer, His/ory of Class/cal Scholarshlp, Oxford.
1968.
E. A. Parsons. The Alex3ndrlan Llbrary. Londres. 1952.
r:ir Littérature. Philosophie.
BOULÉ
La boulè était dans la démocratie athênienne le
rouage essentiel pour assurer le bon fonctionnement
du régime. La tradition voulait qu·une première boulè
de quatre cents membres ait été fondée par Solon.
Mais on ignore tout de sa nature et de ses fonctions, et
117
[' on peUl il bon dro it douter de son existence. En
revanc he, c'est il Clisthène qu' on doit rétablissement
de la boulè des Cinq Cents, pièce maîtresse de sa réorganisation de la cité. Les cinq cents boule utes étaient
tirés au sort chaque année à raison de cinquante par
tribu, dans ]' ensemble des citoyens. il partir des listes
établies dans chaque dème. Il fallait pour être boule ute être âgé d'au moins tre nte ans et avoi r subi avec
succès la dokimasie, J'examen cl 'entrée en charge. On
ne pouvait être bouleute plus de deux fois dans sa vie.
ce qui ouvra it J'accès à celte charge à un nombre considérable de c itoyens. Depuis l'instau ration de la misthophorie par Périclès, la fonction de boule ute était
rétribuée par un misthos qui, il l' époque d'Aristote.
s'élevait il cinq oboles, et à une drachme pour les
cinquante bouleutes de la trib u qui pendant un dix ième
de l'année exerçait la PlYtanie.
Avant leur entrée en charge, les bouleutes prêtaient
senllent de demeurer fidèles à la constitution. On ne
sait exactement quand ce serme nt fut exigé d·eux,
peut-être au lendemain des deux révolutions oligarchiques de la fin du V siècle. Les bouleutes le prêtaient lors d e 1· entrée e n fonction du nouveau conseil
qui siégeait dans le bouleuterion, au sud de 1· Agora.
Les séances étaient, semble-t-il, publiques, mais les
spectateurs ne pouvaient inte rven ir dans le débat. A u
v' siècle, les séances é taie m présidées par les
cinquante bouleutes de la tribu exerçam la PlYtanie,
118
qui siégeaient en permanence el désignaient chaque
jour leur président, ]' épistale des prytanes, qui détenait les clefs des temples. Au IV" siècle, on modifia le
bureau du conseil qui fut désonnais constitué par neuf
proèdres appartenant aux tribus qui Il' exerçaient pas
la prylanie.
La fonction principale de la boulè consistait à préparer les décrets qui étaient soumis au vole de [' ecclesia. Ces projets étaient appelés probouleu11Iata.
L'assemblée populaire pouvait les amender mais 1'initiative revenai t touj ours, sauf cas exceptionnels. à la
boulè. En dehors de ce pouvoir cl 'initiative, la boulè
contrôlait directement ou par l'intermédiaire de commissions qui en émanaient toute la vie de la cité. C'est
devant elle que les magistrats étalent tenus de subir
l'examen avant leur entrée en charge et c 'est à elle
qu'ils devaient rendre compte de leur activité, De ce
fait, elle disposait de pouvoirs judiciaires très étendus,
bien que limités par rapport à ceux du tribunal populaire, si du moins il faut ajouter foi à ce que dit
Aristote dans la Constitution d 'Athènes et qui vaut
peut-être seulement pour son époque: à savoir que la
bou/è ne pouvait prononcer une peine de mort ou
d'emprisonnement, ni une amende supérieure à cinq
cents drachmes. La boule avait en oUire des pouvoirs
étendus en matière de politique extérieure : d'elle
dépendaient en effet les relations avec les autres états
grecs, la conclusion des traités de paix ou des
'"
alliances. Au V- siècle, c· est la boulè qui fixe le mOIllant des tributs payés par les alliés de la ligue de
Délos. C'est elle également qui contrôle l'organisation militaire de la cité, qui établit la liste des cavaliers, qui organise à partir du [V" siècle J'entraînement
des éphèbes. Elle surveille la construction des navires
el ]' état des arsenaux. désignant en son sein à cet effet
des commissions de lrieropoioi. C'est d'elle enfin que
relèvent 1'organisation financière, la surveillance des
rentrées d'impôt, les ventes publiques de biens confisqués. la vérification des comptes à chaque prytanie,
la mise en adjudication des travaux publics.
On a parfois supposé que les pouvoirs de la boule
avaient diminué au [V" siècle face à la toute-puissance
de l'assemblée et des tribunaux, et qu'en particulier
des décisions auraient été prises par l'assemblée sans
qu 'ait été présenté préalablement un probouleuma
émanant du conseil. Les quelques exemples de décrets
que l'on peut citer à l'appui de cette opinion ne
doivent cependant pas entraîner des conclusions trop
systématiques, Organe essentiel de la dé mocratie
athénienne, la boule instituée à la fin du VI' siècle
paraît bien avoir joué pleinement son rôle pendant les
deux siècles de l'apogée d'Athènes.
En dehors d'Athènes, on a des preuves de l'existence d ' une boule dans nombre de cilés démocratiques, Une inscription du début du vI' siècle fai t état
de la présence d 'une boule démosiè, d ' un conseil
CALL/STRATOS O'ALPHIDNA
120
populaire, à C hios, ce qui a conduit certains modernes
à conclure que Chios avait connu la démocratie avant
Athènes, Thucydide évoque, au livre III de la g uerre
du Péloponnèse, le massacre des bouleutes de Corcyre
par les oligarques qui avaie nt renversé la démocratie
dans 1ïle, On pourrait donner d 'autres exemples de
conseils démocratiques, surtout à partir du IV" siècle,
quand la démocratie devint la forme de régime la plus
répandue dans le monde des cités grecques,
[J
P.-J, Rhodes, The Athenlan Boule. Oxford, 1972,
R-A De Laix, Probouleusls at Achens. A 5cudy of PoIJtlcal Decision Maklng, Berkeley-Los Angeles, 1973,
r:ir Aréopage , Dokimasie, Ecclesia, Justice, Prytanes,
CALLISTRATOS D'ALPHIDNA
Cet homme politique athénien fut de ceux qui
contribuè rent au redressemem d'Athènes au début d u
IV' siècle, Neve u d ' Agyrrhios, homme politique influent qui avai t en particulier institué le misthos ecclesiaSlikos, le salaire rétribuant la présence aux séances
de J'ecclesia, il fut é lu stratège en 378, l'année même
où Athènes rétablissait son hégé monie dans l'Egée
par la constitution de la Seconde Confédératio n maritime, Mais on lui crédite plus particulièrement une
réorganisatio n des finances athéniennes, mises à mal
CALLISTRATOS D iuPfflfJNA
121
par la défaite et l'imerruption presque totale de l'exploitation des mines d'argent du Laurio n. C" est à lui
en particulier que serait due la mise en place du système des symmories, ces groupements de contribuables astreints à l·eisphora. Réélu plusieurs fois
slratège, CallistralOs soutinl d' abord une politique
énergique à l' enconlre de Sparte. Mais après la défaite
que subirent il Leuctres les Spartiates, vaincus par le
Thébain Epaminondas (371). il lui apparut que
Thèbes était désormais plus dangereuse que Sparte et
il préconisa un rapprochement avec cette dernière. Ce
qui lui valut l'hostilité du « parti JO thébain qui
rassemblait ceux qui continuaient à voir dans Sparte
l'ennemie de la démocratie. Un premier procès lui fut
intenté en 366. dont il sortit acquitté. Mais après avoi r
quelque temps regagné une certaine influence, il fut
de nouveau mis en accusation par ses adversaires et
condamné à mort (361 ). Il réussit à s'enfuir en Macédoine où il aurait. selon la tradition, réorganisé les
finances du roi de Macédoine, Perdiccas II . Il mourut
sans doute en Artique où il était rentré.
Callistratos est tout il fait typique des nouveaux
dirigeants de la cité au IV' siècle. Certes, il a été
plusieurs fois stratège, mais il ne s'est pas illustré de
façon particulière sur le champ de balaille. En
revanche, il apparaît comme un « technicien » des
affaires financières, au point de pouvoir mettre ses talents au service d'un souverain étranger. Sa fin,
CH4BRIAS
122
assombrie par une condamnation à mort, s'inscrit dans
le cadre de ces luttes tournant autour du maintien de
l'empire, qui s'expriment par la multiplication des
procès politiques et annoncent la fin prochaine de
l'hégémonie d'Athènes.
[J
R. Sealey, Callistratos of Aphidna and his Contem·
poraries, HIstorIa, V, 1956. pp. 178·203,
r7" Confédération maritime (Seconde), Eisphora, Symmories.
CHABRIAS
L'un des grands stratèges athéniens du IV" siècle, Il
était né vers 420, d'une famille apparentée à celle du
démagogue Cleon, Il fut réélu treize fois à la stratégie,
ce qu i témoigne à la fois de son prestige et de ses
qualités mililaires, Il fut l'un des artisans de la restauration de la puissance d'Athènes et de la formation de
la Seconde Confédération maritime, Il était personnellement lié avec Callistratos, dont il défendit avec
succès la politique, Comme les autres grands stratèges
du IV siècle, il sut utiliser les années de mercenaires
pour élaborer de nouvelles tactiques de combat. Mais,
chef de mercenaires lui-même, il n' hésita pas à se
mettre au service des rois de Chypre o u d'Ëgypte,
Appartenant à une riche famille, marié à la fille d'un
homme fortuné , il utilisa cette fortune pour des
CHABRIAS
123
largesses en faveur du démos. Non seulement. il s 'acquitta de nombreuses liturgies, mais en outre Plutarque, dans la Vle de Phocion (VI, 7). rapporte que.
pour commémorer la victoire quO il avait remportée en
376 à Naxos sur la flotte Spartiate, il faisait chaque
année, le jour anniversaire de sa victoire, une distribution de vin aux Athéniens. À la différence de la plupart des stratèges, fréquemment traînés devant les
tribunaux, Chabrias ne fut accusé qu'une seule fois,
en compagnie de Callistratos, et fut acquitté. Les
Athéniens. reconnaissants des bienfaits dont il les
comblait. lui accordèrent le bénéfice de l' atélie, de
l'exemption de charges, à la fin de sa vie. Il mourut en
357 Ai à la bataille de Chios. Chabrias est une figure
particulièrement révélatrice de l'évolution de la cité
démocratique au IV" siècle à un double titre: comme
stratège professionnel de la guerre. et comme bienfaiteur de la cité, précurseur de ces évergètes qui se multiplieront à l' époque hellénistique.
[J
H.-W. Parke. Greek Merrenal)" Sold/ers rrom che Earliest
TImes 10 the BauJe or Ipsos, Oxford. 1933.
w.-K. Prilchelt. The Greek Sales ac War. Il. Berkeley-Los
Angeles, 1974. pp. 72-77.
cr Stratèges.
CHA RES
124
CHARÈS
L'un des plus célèbres stratèges athéniens du IVsiècle avec Timothée et Iphicrate, Comme ce dernier, il
était un « homme nouveau », car on ne sait rien de son
père Theocharès, Il réussit cependant à acquérir une
fortune suffisante pour remplir diverses liturgies, dont
la triérarchie en 349/8, Il fut élu stratège pour la première fois en 367/6 et fut réélu de nombreuses fois à
cette charge, Comme les autres grands stratèges du IV"
siècle, il utilisait surtout pour combattre des mercenaires, et il dut. pour pouvoir les payer, se livrer à des
exactions qui lui valurent de solides inimitiés,
Isocrate dans le discours Sur la paix dénonce les pratiques auxquelles Charès avait recours en des termes
très sévères, En revanche, Démosthène semble l 'avoir
soutenu activement. Comme Iphicrate et d'autres
avant lui, Charès pour pouvoir conserver son armée
n' hésita pas à se louer au satrape perse Artabaze, Il
combattit à Chéronée et rut de ceux dont Alexandre
réclama en vain la livraison en 335, Il vivait encore
vers 324, mais il mourut avant que n'éclate la guerre
lamiaque, Il est particulièrement typique de ces COIIdoltieri que les nouvelles conditions de la guerre
allaient susciter au IV" siècle,
CHffWNEf: (Bataille de)
CI
125
K.-w. Prirchett, The Gœek States al [lnr. H, Berkeley,
]974. pp. 77 sqq.
Qr
Iphicrate. Stratèges. Timothée.
CHÉRONÉE (Bataille de)
La bataille de Chéronée, en août 338, est considérée
par la plupart des historiens modernes comme marquant la fin de la Grèce des cités et comme le prélude
à la fin de la démocratie athénienne, quelque seize
années plus tard. Pour en comprendre l·importance, il
importe de rappeler de quels événements elle était
l"aboutissemenl. En 359, PhiHppe II avait été reconnu
comme roi des Macédoniens, alors quïl exerçait la
régence au nom de son neveu. Peu après. en 357/6,
Athènes se heurtait à une révolte de ses principaux
alliés au sein de la Seconde Confédération maritime.
révolte qui s·achevait sur la défaite de la flotte athénienne à Embata et 1· obHgation pour Athènes de
reconnaître l 'indépendance de ses alliés. Amputée
d ' une partie de ce qui avait un moment paru être une
reconstitution de l'empire du V- siècle, en proie à des
difficullés financières grandissantes, Athènes avait vu
se préciser les menaces de Philippe sur les positions
qu'elle conservait encore dans le nord de 1· Egée, à
Amphipolis et Potidée en particulier. ainsi que sur les
CHfRONff: (SamiRe de )
126
petits royaumes thraces, traditionnels clients
d 'Athènes. Malgré les mises en garde de Démosthène,
les hommes qui dirigeaient alors la politique athénienne, autour d'Eubuie et de ses amis, avaient préconisé une politique de retrait qui ne put que favoriser
les entreprises du Macédonien. La guerre sacrée qui
éclata en Grèce centrale. pour le contrôle sur le sanctuaire de Delphes, permit à Philippe d'afTennir ses
positions, et la paix conclue en 346 en fut la sanction,
malgré la promesse faite par le roi de resti tuer Amphipolis, promesse d'ailleurs non tenue. Ce qui eut entre
autres pour effet de renforcer à Athènes la position de
Démosthène et de ceux qui comme lui préconisaient
une politique vigoureuse à l'égard du Macédonien.
Dans les années qui suivirent la conclusion de la paix,
Démosthène s'efforça de rassembler aUiour d' Athènes
une coalition grou pant aussi bien les cités continentales que les anciens membres de la Confédération,
allant méme jusqu 'à opérer un rapprochement avec
Thèbes qui se concrétisa par une alliance de fait lorsque Philippe en personne vint occuper la forteresse
d'Elatée en Béotie, pour contraindre les Thébains à
demeurer ses alliés. Démosthène, dans le même
temps. s'était efforcé de trouver des ressources pour
équiper une nouvelle floUe, en rétablissant e n particulier ["ancien système de la triérarchie. qui avait été
modifié e n 357. Les principales opérations cependant
se déroulèrent sur le continent où Philippe avai t. en
CHffWNEf: (Bataille de)
127
tant que membre du conseil amphictyonique qui
administrait le sanctuaire de Delphes, pris le commandement d'opérations contre les gens de la petite cité
d 'Amphissa, accusés d'avoir mis en cullure des terres
sacrées relevant du sanctuaire, C'était là pour le Macédonien un prétexte pour contraindre les Thébains à
rentrer dans son alliance, Mais ceux-ci, on l'a vu,
avaient choisi l'alliance athénienne, et c'est en Béotie
que se déroulèrent les opérations militaires qui
s 'achevèrent en août par l 'écrasement de l'armée
grecque à Chéronée, Athènes s 'apprêtait à soutenir un
long siège, et la boulè sur proposition des orateurs
anti-macédoniens, prit toute une série de mesures d ' urgence. Toutefois, la proposition faite par Hypéride de
libérer les esclaves et de leur donner des armes pour
défendre la cité ne fut pas adoptée, Cependant les promacédoniens négociaient avec Philippe, et l'on patvint
à la conclusion d'une paix dont le principal négociateur du côté athénien fut l'orateur Démade. Philippe se
montra relativement modéré dans ses exigences, laissant à Athènes sa liberté et son autonomie, Athènes dut
néanmoins accepter la perte de la Chersonèse de
Thrace, la dissolution de la Seconde Confédération
maritime, et fut contrainte d'adhérer à la ligue de
Corinthe, constituée par Philippe pour mener sous sa
conduite la guerre contre le roi des Perses,
Pendant les seize années qui suivirent la conclusion de
la paix de Démade, la démocratie subsista à Athènes et
CHfRONff: (SamiRe de)
128
la cité connut même, sous l'impulsion de Lycurgue,
une période de prospérité, Mais, alors qu'Alexandre,
qui avait succède à Philippe après l'assassinat de celuici en 336, partail à la conquête de l'Orient, Athènes
demeurait à l 'écart de la politique égéenne, repliée sur
elle-même et en proie aux règlements de compte politiques entre pro et anti-macédoniens, Pour qui lit les
discours que prononcèrent alors les grands orateurs
athéniens, Démosthène, Éschine, Hypéride, Lycurgue,
l 'impression qui s'impose est celle d'une continuité de
la vie politique athénienne. Alexandre est à peine évoqué, et Chéronée n'apparaît que comme une défaite
sans conséquence, Et pourtant de ces seize années, le
monde grec allait sortir profondément bouleversé, À
cet égard, les modernes sont justifiés de regarder
Chéronée comme le fait majeur de l' histoire athénienne
du IV' siècle, et 338 comme la date qui marque la fin de
la Grèce indépendante,
lJI
E, Will, C. Mossé, P. Goukowsky, Le monde grec el
l'Orient, T. IL Le W siècle et l'époque hel/énlsllque.
Paris, 1975,
p, Cloché, Un fondateur d'empire. Philippe II. roi des
Macédoniens, Paris, 1955,
G-l. Cawkwell, Demoslhenes'Policy after Ihe Peaœ of
Philocrates, Classlcal Quat1erly. Xlii. 1963, pp, 120 sqq :
200 sqq.
N,-G-L. Hammond. The Viclory of Macedon al Cheronea,
Swdles ln Greek Hlstory. Oxford, 1913, pp, 534 sqq.
<Jir Démosthène, Philippe Il.
CHIOS
'"
CHIas
Cette grande île, renommée dans l'Antiquité pour la
qualité de ses vins, fut colonisée par les Ioniens à la
fin du second millénaire, Au début de l'époque
archaïque, elle fut le centre d'une brillante activité
intellectuelle, et certaines traditions en faisaient la
patrie d'Homère, Chios prit une part active, aux côtés
de Milet, 11 la révolte de l' Ionie, Après les guerres
médiques la cité de Chios devint membre de la ligue
de Délos, Sa puissante marine lui permit d'être l'une
des rares cités alliées qu i n'étaient pas astreintes au
versement du tribut, puisqu'elle contribuait militairement à la défense commune, En 413 cependant, elle
se détacha d'Athènes et tous les efforts de celle-ci
pour la contraindre à rentrer dans l'alliance furent
vains, Néanmoins, quand en 378 Athènes reconstitua
son empire sous la forme de la Seconde Confédération maritime, C hios e n fit partie jusqu'en 357 où
elle fut avec Byzance à l'origine de la révolte des
alliés connue sous le nom de g uerre sociale,
Sur le plan politique, Chios semble avoir été la première cité grecque à avoir expérimenté la démocratie,
Une inscription de la première moitié du Vt' siècle
mentionne l'existence d'une bou/è démosiè, d'un
CHOREGIE
130
conseil populaire, et de démarques, Malheureusement, on ne sait rien des circonstances qui en
favorisèrent l'établissement. Mais, si l'on e n croit une
tradition tardive, Chios aurait aussi été la première
cité 11 utiliser des esclaves '" ache tés à prix d'argent »,
et Thucydide affirmail (VIII, 40, 2) qu'à son époque
'" les esclaves étaient nombreux 11 Chios JO, On aurait
donc, avec l'exemple de Chios, une sorte de doublet
de l'expérience athénienne, Ici comme là, l 'extension
de la liberté politique et la démocratie iraient de pair
avec la diffusion de l 'esclavage-marchandise, sans
qu'on puisse affirmer de manière catégorique lequel
des deux phénomènes est antérieur 11 l'autre, et s'II
existe entre eux une relation de causalité,
111
R Meiggs et D, Lewis, A SeJectlon or Greek HlslOrlcaJ
Inscrlpllons 10 the End orthe FlRh Cemury B.-C. , Oxford,
1969, pp. 14-17.
r7" Confédération maritime {Seconde}. Délos {Ligue de}.
Démocratie.
CHORÉGIE
La chorégie est de toutes les liturgies athéniennes
celle sur laquelle nous possédons le plus grand nombre dïnfonnations. Elle consistait 11 préparer et à
entretenir un chœur à l'occasion des grandes fêtes
CHOREGIE
131
re ligie uses, et singulièreme nt pour les concours d ramatiques qui avaient lieu lors des fêtes e n l' honneur
de Dionysos, C'est l'archonte éponyme qui désignait
les chorèges pour les concours de tragédie et de
comédie des Grandes Dionysies, et l' archonte roi
pour les concours des Lénéennes, Au IV" siècle, si l'on
en cro il le témoignage d 'Aristote, les cinq chorèges
pour les concours de comédie furent désormais
désignés par les tribus, Les trib us désignaient également les chorèges pour les chœurs d' hommes et d' enfa nts po ur la fête des Thargé lies (Constitution
d'Athènes, LVI, 3), Les chorèges, choisis parmi les
Athéniens les plus riches et âgés d'a u moins quarante
ans, étaie nt durant l'année de le ur chorégie exemptés
de toute autre liturgie. Ils rivalisaient entre eux lors
des concours, et de même q ue les auteurs, étaient
couronnés par le peu ple à lïssue d u concours, La
chorégie, d' abord tenue pour un honneur qui permettait de s'attire r les bonnes grâces du démos, finit par
deve nir comme les autres liturgies une charge très
lo urde à laq uelle o n s 'efforçait d'échapper par le
moyen de j'antidosis, de l'échange, Comme les au tres
liturgies aussi. la chorégie dis parut à l'époque de
Démétrios de Phalère, et l'organisation des fêtes fu t
désormais du ressort de magistrals élus, les agônothètes,
CiMON
[J
A. Pickard-C3mbridge, DramaUc Festivals
132
or Athens,
1968.
Qr
Comédie. Liturgies.
CIMON
Cimon était le fils de Miltiade, le vainqueur de
Mara thon. et d·une princesse thrace, Hégésipyle. Il
hérita de la très g rande fortune de son père, et c·est à
cette fortune, aux dires d'Aristote, qu"i l dut une partie
de sa popularité: « il s ·acquittait magnifiquement des
IilUrgies publiques et de plus entretenait beaucoup de
gens de son dème: c hacun des Lakiades pouvait ve nir
ch3que jour le trouver et obtenir de lui de quoi suffire
à son existence ; en outre auc une de ses propriétés
n'ava it de clôture, afin que qu i voulait pût profiter des
fruits » (Constitution d·Athènes, XXVII , 3). Il fut de
nombreuses fo is réélu stratège , et il contribua entre
478 et 463 à étendre la puissance d ·Athè nes, e n
faisant adhérer à la ligue de Délos les cités dont il
s·emparait. Il accrut e ncore sa popularité lorsque,
s·étant rendu maître de lïle de Skyros où fut établie
une co lonie athénienne, il en rame na en grande pompe
les ossements du héros Thésée. Sa victoire la plus
importante fut celle qu"il re mporta à 1· Eurymedon en
468, victoire qui entraîna la des truction de la flotte
133
perse et la mainmise d'Athènes sur une partie des
côles occidentales de l'Asie Mineure. Il réussit également, après un long siège de deux ans, il s' emparer de
Thasos qui avait tenté de sortir de ['alliance athénienne. C'est après son retour qu'il fUi une première
fois mis en accusation, pour n'avoir pas attaqué la
Macédoine. Il fut acquitté, mais ce fut le début d'une
rivalité avec Périclès qui allait durer jusqu'à sa mort.
En 461, Périclès et ses amis réussirent à le faire frapper d'ostracisme, sous prétexte qu'il avait échoué
dans une expédition envoyée sur son conseil pour
aider les Spartiates il venir il bout d'une révolte des
hiloles de Messénie: les Spartiates, soupçonnant des
complicités entre les soldats athéniens et les révoltés.
avaient renvoyé Cimon et son armée. Cimon prit le
chemin de l'exil et ne fut rappelé que quatre ans plus
lard. Il devait encore jouer un rôle comme négociateur
d'une paix avec Sparte, et mourut lors d'une expédition contre Chypre, en 450.
Cimon apparaît comme tout 11 fait caractéristique de
la première génération des dirigeants de la démocratie
athénienne. Appartenant 11 la riche famille des
Phil aides, il étaillié par ailleurs 11 deux aUlres grandes
familles athéniennes, celle des Alcméonides. 11 laquelle
appartenait sa première femme Isodikè, et celle de
Callias, fils d'Hipponicos. mari de sa sœur Elpinice.
Ce qui ne l'empêcha pas de contracter un second
mariage avec une femme arcadienne, et d'entretenir
134
CirE
des relations personnelles avec les cités étrangères
dont il était proxène, c'est-à-dire représentant de leurs
intérêts, Parmi ces cités figurait Sparte, la principale
rivale d'Athènes dans le monde grec du V' siècle, De
là vient sans doute la réputation de modéré, voire
d'oligarque que devail plus tard lui attribuer la tradilion dont Plutarque se fait l'écho, En fait, il appartenait au même milieu que Périclès, même si sa fortune
était plus importante, et leur rivalité étail plus une
rivalité familiale et personnelle que véritablement
politique, La politique qu'il mena en tant que stratège
illustre bien cette identité de vue, et ce commun souci
de la grandeur d'Athènes,
111
Ed, Will, Le Monde grec
el.
l'Orient, 1 - Le
l'
slkle,
Paris, 1972, pp, 134-139,
qr Impérialisme, Périclès. Thésée.
CITÉ
Nous traduisons par cité le terme grec polis par
lequel les Ancie ns désignaient. à l'époque classique,
un établissement humain généralement groupé autour
d' un centre urbain et contrôlant un territoire plus ou
moins étend u. La cité était alors la forme politique
caractéristique du monde grec. bien qu' il existàt des
groupements plus primitifs désignés par le terme
ClfE
135
d'elhnos, peuple, et dans certaines parties du monde
grec des rassemblements de cités appelés kolna, le
plus souvent rassemblements de cités de moi ndre
importance regroupées autour d'un sanctuaire
« fédéral », Les cités au sens plein du terme étaient
des états autonomes, ayant leurs propres lois, leur
mo nnaie et leurs divinités tutélaires,
Mais ce qui les caractérisait essentiellement c' était le
fait que ceux qui composaient la cité, les citoyens (en
grec polllai), se partageaient le territoire et prenaient
en commun les décisions qui engageaient la politique
de la cité. Or, il n'en avait pas touj ours été ainsi dans
le monde grec qui avait connu, entre le XVI' et le XII"
siècle, des formes d'organisation politique de nature
différente, oû l'autorité émanait du palais que dominait le wanax, le roi, entouré de ses conseillers et disposant d'une force militaire spécialisée et d'une
bureaucratie de scribes importante, Les tablettes en
Linéaire 8 découvertes dans les ruines des palais ont
permis de mieux comprendre l'organisation sociale et
économique du monde grec au cours de ces quatre
siècles d'apogée de la civilisation mycénienne, el de
confirmer ce que déjà laissaient entrevoir les travaux
des archéologues, c'est-il-dire que les structures
sociales et politiques du monde mycénien étaient sensiblement différentes de celles de la Grèce classique.
Les palais mycéniens disparaissem brutalement au
début du xu' siècle, el s 'ouvre alors pour le monde
CirE
136
grec une période de recul de la civilisation, ce que les
archéologues appellent « les siècles obscurs » , Et
c'est seulement vers la fi n du IX" siècle que recommence nt à se développer des établissements humains
qui dès l'origine révèlent, dans l'organisation même
de l'espace, une structure différeme : les Cilés,
On s' est beaucoup interrogé sur les facteurs qui
présidèrent il l'apparition de ce nouveau type d'organisation de l'espace et des hommes, On a évoqué la
géographie du paysage grec qui appelle au morcellement. On a mis en avant des facteurs religieux
(regroupement autour de sanctuaires ou de tombes
monumentales), culturels, économiques (le passage
d'une économie essentiellement pastorale il une
économie fond ée sur la culture des céréa les, de l' olivier et de la vigne), En fa il, tous ces facteurs ont pu
jouer à la fois pour la mise en place de cette fomle
nouvelle d 'organisation politique qui n'a llait pas
tarder à se développer à la faveur de ce qu'on a appelé
la colonisation grecque, Car le mouvement d'expansion des Grecs sur le pourtour méditerranéen, déterminé d'abord par le besoin d e !Touver des lerres, et
sans dOUle aussi de se procurer des métaux et autres
matières premières dont la Grèce était dépourvue,
aboutit à la créalion en un peu moins de deux siècles
de centaines de cités nouvelles, Et c 'esl bien souvent
l'exploration archéologique de certaines d'entre elles
(o n pense à Mégara Hy blaia en Sicile ou Métapome
ClfE
137
en Italie du Sud) qui a permis de dégager les caractères propres de la cité, ceUe communauté « d'égaux »
qui se partageaient la ville et son territoire, en préservant au cœur de la première l'espace libre de l' agora,
lieu où se rassemblaient les citoyens pour prendre en
commun les décisions qui engageaient la cité. Il n'est
pas exclu d·ailleurs que ces fondations nouvelles aient
été des « laboratoires d·expériences » qui inspirèrent
ensuite les législateurs chargés dans les cités de la
Grèce continentale et des îles de I" Egée de résoudre
les crises de croissance que connurent la plupart des
cités au VII" et au vI" siècle. Il faut bien souvent
recourir aux hypothèses, plus ou moins fondées sur
une documentation fragmentaire et des sources littéraires tardives, pour reconstituer les premiers siècles
de l"histoire des cités grecques. O n peut supposer que
la notion de citoyen ne s'est que lentement dégagée.
que dans les premiers temps de la cité une partie des
membres de la communauté étaient dans la position
de dépendants ou de « clients » d·une aristocratie
guerrière seule habilitée à prendre les décisions communes. Mais l 'élargissement de la fonction guerrière
à des couches plus vastes. en relation avec l'adoption
de la phalange hoplitique, une agitation sociale liée à
ce que les Grecs appelaient la stenochoria, 1· étroitesse
de la terre qu·on explique autant par l"accroissement
démographique que par le partage égalitaire des patrimoines. agi ta tion sociale débouchant parfois sur
CirE
138
l'établissement de régimes tyranniques, mais parfois
comme il Athè nes sur une réforme inspirée par un
législateur, tous ces faits allaient contrib uer à la mise
en place de structures juridiques qu i allaient donner
forme à la notion de citoyen,
C'est pour Athènes que nous sommes le mieux - 0"
le moins mal - infonnés, Les réformes de Solon, la
tyrannie de Pisistrate et de ses fils et enfin la « révolution » clisthénienne sont les étapes principales de
cette élaboration du statut civique tel que nous le connaissons au V et au TV' siècle, Les premières mirent
fin à la dépendance paysanne et établirent des lois
communes pour tous ; la tyrannie des Pisistratides
contribua à faire disparaître les particularismes locaux
et à renforcer l'unité de l'Attique autou r d'A thènes,
Quant il la révolution clisthénienne, elle fixa le statu t
de citoyen en substituant aux antiques groupements
religieux ou fondés sur la parenté une organisation
terri toriale, celle des d ix tribus et des dèmes, à l'intérieur de laquelle étaient répartis les citoyens désormais égaux devant la loi et par la loi, ce qu' exprime le
tenne d'isonomie, Une dernière étape dans la définition du citoyen sera réalisée par Périclès lorsqu'il
exigera la d ouble ascendance athé nienne, paternelle et
maternelle, comme fondement de la citoyenneté :
da ns l'Athènes d'après la loi de 45 1 seront c itoye ns
les enfants nés d'un père athénien et d 'une mère
athénienne, un is en légitime mariage,
ClfE
139
Cette défi nition de la citoyenneté faisait des citoyens
athéniens, au sein de la population de la cité, un
groupe privilégié face aux étrangers résidents
(métèques) et aux esclaves. À l'intérieur de ce groupe
privilégié, les hommes seuls étaient à propremelll parler des polirai, des citoyens. c'est-à-dire des gens qui
participaient aux assemblées et aux trib unaux et qui
pouvaient en fonction de leur âge et de leurs moyens
accéder aux diverses charges attribuées chaque année
par élection ou par tirage au sort. Les femmes et les
filles des citoyens se distinguaient certes des étrangères ou des esclaves, mais ne jouissaient d'aucun
droit politique et demeuraient juridiquement des
mine ures. Seule, leur participation à la vie religieuse
de la cité et le fait que seules elles pouvaient engendrer des citoyens caractérisaient leur statut.
On peut supposer qu'une organisation de la société
semblable ou voisine de celle d'Athènes se retrouvait
dans d'autres cités grecques, singulièrement celles qui
au V siècle firent partie de ce groupement de cités
dominées par Athènes, la ligue de Délos. Il existait
néanmoins des cités où la qualité de citoyen était
attachée soit à la possession d'un lot de terre - ce qui
à Athènes n'était pas le cas depuis au moins la fin du
Vt' siècle - soit à la possession d'un certain cens. ou
encore comme à Sparte au fait d 'avoir reçu une éducation particulière, ou comme à Thèbes d' avoir au moins
depuis dix ans cessé de pratiquer une activité arti-
CirE
HO
sanale. De ce fait, il y avait dans ces cités, au côté des
citoyens proprement dits, des gro upes d ·hommes li bres
qui sans être des étrangers n ·en demeuraient pas moins
en marge de la communauté politique, tels par exemple
les périèques lacédémoniens. Mais ceux qui formaient
le groupe des citoye ns de plein droit, et même dans les
cilés où le pouvoir réel était entre les mains d·ml petit
nombre de magistrats, participaient aux assemblées,
cette participation étant le signe même de leur qualité
de citoyen. On comprend ainsi pourquoi Aristote
définissait le citoyen comme celui qui alternativement
« pouvait gouverner el être gouverné ».
On le voit, les Grecs donnaient à la notion de citoye n
un contenu actif et positif qui impliqua it une participation réelle à la vie politique. On peut évidemment
se demander - et o n n·a pas manq ué de le fairequel était le degré réel de cette participation , même
dans une cité comme Athènes où le démos. le peuple,
c·est-à-dire l"ensemble des citoye ns, était souverain.
On se doute qu· une réponse catégorique est impossible. O n devine des moments de réelle participation
et d 'autres de désintérêt pour les affaires publiques. Il
n'en reste pas moins que les Grecs, ces inventeurs de
la politique, ont également inventé le c itoyen.
[J
M.l. Finley. L ·llIvenllon de la polfflque, Paris. 1985.
CI. Mossé, « Citoyens actifs et citoyens passifs dans les
cités grecques: une approche théorique du problème ~.
R.EA. LXXXI , 1979, pp. 241 sqq.
CLEON
141
r:Jr Atimie. Démocratie. Écclesia. Évergétisme. Graphè para
nomôn. Hippeis. Liberté (Eleutheria). Métèques. Misthophorie. Monarchie. Nomos. Ostracisme. Pénètes. Périclès.
Polis. Politeia. Politès. Prytanes. Zeugites.
CLEON
Cet homme politique athénien. qui dirigea la vie de la
cité dans les années qui suivirent la mort de Périclès.
était te nu par les Anciens pour le ty pe même du démagogue. À la différence des hommes politiques de la
période précédente, qui tous appartenaient à la vieille
aristocratie athénienne. Cleon était un « homme nouveau ». Certes, son père avant lui avait déjà rempli la
charge de stratège, ce qui témoigne quïl apparte nait à
la première classe du cens. Mais alors que les membres
des grandes familles athéniennes tiraie nt leurs revenus
de leurs domaines fonciers, Cleon avait hérité de son
père un ate lier de tannerie qui employait une cinquantaine d 'esclaves. Celte orig ine « banausique » (artisanale) de ses revenus explique les sarcasmes dont
I·accablaient les auteurs comiques, et singulièrement
Aristophane qui. dans Les Cavaliers. le représente
sous les traits d·un esclave paphlagonien qui flalte et
mène à sa guise son maître, le vieux Démos, et dont
chaque entrée est précédée par l 'odeur nauséabonde de
la tannerie. Cleon apparaît également dans le récit de
CLEON
14'
Thucydide, au moment où la cité devait se prononcer
sur le sort réservé aux Mytiléniens qui avaient tenté, au
début de la guerre du Péloponnèse, de sortir de l'alliance athénienne, L'historien lui prête des propos particulièrement cyniques sur la nécessité pour qui veut
exercer l'empire de ne pas tolérer la moindre défaillance, et par conséquent de sévir avec la plus extrême
rigueur contre les Mytiléniens, peuple et dirigeants
confondus, Cleon cette fois-là ne fut pas suivi par
l'assemblée, mais quelques années plus tard il réussit
à se faire confier le commandement de l'armée qui
s'efforçait en vain de s'emparer de la forteresse de
Pylos dans le Péloponnèse, Son entreprise fut couronnée de succès, ce qui lui valut un regain de prestige
dans le peuple, Ses coups d'éclat, la violence de son
langage, son attitude débraillée déplaisaient aux modérés, mais lui valaient, semble-t-iL les faveurs de la
foule, Il mena avec énergie la politique athénienne
pendant les dernières années de ce que l'on a appelé
« la guerre d'Archidamos ,., c'est-à-dire la première
partie de la guerre du Péloponnèse, Il échoua pourtant
devant Amphipolis en 421 et trouva peu après la mort
au combat. Quelques mois plus tard, Athéniens et
Spartiates concluaient la paix dite « de Nicias », du
nom du stratège qui avait dirigé les négociations du
côté athénien.
Malgré le portrait négatif qu 'en ont donné ses adversaires, Cleon semble bien avoir été le véritable con-
CU,ROUQUIES
143
tinuateur de la politique de Périclès. Mais il est en
même temps le premier de ces « nou veaux politiciens ,. d ·origine sinon modeste du mo ins non aristocratique qu i sont caractéristiques des dernières
décennies du V siècle.
~
W.-R. Cormot. The New Po!ltIclans of Flflh CenlUty
Alhens. Princeton. 1975.
r:ir Aristophane. Démagogues. Hyperbolos. Péloponnèse
(Gtœrre du).
CLÉROUQUIES
On désigne sous ce nom les colonies militaires
établies par Athè nes à partir de la fin du vr siècle sur
le territoire de certaines cités égéennes. À la difTérence des colonies Iraditionnelles. des apoikiai, qui
formaie nt autant de cités autonomes et indépendantes
de leur métropole, les clérouquies étaient en quelque
sorte des prolongements de la métropole. Les colons
ou clérouques demeuraient des citoyens athéniens. Ils
recevaient un lot de terre. ou c1eros. qui leur assurai t
un revenu annuel qu·on a estimé à deux cents drachmes, c'est-à-dire l'équivalent du cens des ze ugites.
Le plus souvent il semble qu ·i1s se soient contentés de
percevoir ce revenu, le sol continuant à être mis en
valeur par les anciens possesseurs. Les clérouques
ClfROUQUlf5
144
cependant résidaient sur le territoire de la cité où avait
été établie la clérouquie, y assurant un service de garnison. La plus ancienne clérouquie aurait été fondée
en Chersonèse de Thrace, sous la conduite de Miltiade
l'Ancien dans les dernières années du règne de Pisistrate. Mais c'est au V siècle surtout, à l"époque de la
ligue de Délos. que le système des clérouquies connut
un développement considérable. Des clérouquies
furent établies en Eubée, à Naxos, Lemnos, Andros,
Imbros, Lesbos, etc. Aux dires de Plutarque, plus de
dix mille Athéniens auraient été ainsi pourvus de terres à l'époque de Périclès, aux dépens de c ités qui
étaient aux mains des barbares ou qui avaient tenté de
sortir de l'alliance athénienne. La défaite d' Athènes à
la fin du V" siècle et l"effondrement de l"empire s'accompagnèrent de la disparition de la plupart des
clérouquies, seules les clérouquies de Lemnos, Imbros
et Skyros demeurant entre les mains d·Athènes.
Quand en 378 fut créée la Seconde Confédération
maritime, Athènes prit l' engagement de ne pas établir
de nouvelles clérouquies. Mais, dès la fin des années
soixante, les Athéniens s'installaient à Samos et à
Potidée, et quelques années plus tard rétablissaient la
clérouquie de Chersonèse de Thrace. Il n' est pas douteux que c'était là pour la démocratie athénienne un
moyen de donner des terres aux citoyens pauvres, à
tout le moins de leur assurer un revenu supplémentaire. O n possède quelques inscriptions émanant de
CUSTHfNf
145
ces clérouquies qui attestent que les clérouques
demeuraient des citoyens d'Athènes, mais qu'ils
avaient néanmoins sur place des organes de gouvernement local et désignaient leurs propres magistrats, Les clérouquies furent incontestablement une
des manifestations les plus controversées de l'impérialisme athénien, mais aussi une de celles qui lièrent le
plus étroitement l'Empire et la démocratie.
~
A..J. Graham, CoJony and Mother City ln Anclenl Gœece,
t964,
r:sr
Confédération maritime (Seconde), Délos (Ligue de),
Périclès.
CLISTHÈNE
Clisthè ne d'Athènes était le fils de l'Alcméonide
Mégaclès et de la fille du tyran Clisthène de Sicyone,
On sait peu de choses sur la vie de cet aristocrate
athénien jusqu'au moment où, après la chute e n 5 10
du fils de Pisistrate, Hippias, il devint le chef de ceux
pour qui le renversement de la tyrannie, obtenu avec
l'aide du roi de Sparte, Cléomène, ne s ignifiait pas
nécessairement un retour au passé et aux ptivilèges
exclusifs des grandes familles aristocratiques, Pour
vaincre son adversaire Isagoras, qui n'avait pas hésité
Cl/S THEIIE
146
il faire appel de nouveau aux Spartiates, Clisthène
« fit entrer le démos dans son hétairie» pour reprendre l'expression de l'historien Hérodote, c'est-il-dire
qu'il s 'appuya résolument sur le démos, Mais alors
que Pisistrate, qui avait agi de même un demi-siècle
plus tôt, avait gardé le pouvoir entre ses mains,
Clisthène ne se contenta pas de s'allier au démos, il
mit en place une complète réorganisation de la cité
destinée il assurer désormais la souveraineté il ce
démos,
Il n'est pas toujours aisé de reconstituer, à partir de
nos deux sources principales, Hérodote et Aristote, le
déroulement des événements qui permirent à l'AIcméonide, de retour d'exil, d'accomplir ses réformes,
en 508/7. Si l'on veut tenter de les caractériser. il sem·
ble que l'on puisse distinguer deux plans différents :
d'une part, une rêorganisation du corps civique et son
intégration dans des cadres nouveaux; d'autre part,
une modification des institutions destinées il rendre
effective la souveraineté du démos, La première série
de mesures eut pour effet de dessiner ce que des his·
toriens cOlllemporains Olll appelé un nouvel « espace
civique ». La base en était le dème, circonscription
territoriale, au sein de laquelle é tait inscrit chaque
citoyen qui y avail sa réside nce,
Si l'on en croit Aristote, c·étaillil un moyen d'inté·
grer à la cité les nouveaux citoyens, les neofXJ/ilai,
que Clisthène aurait fait entrer dans le corps civique
CUSTHfNf
147
pour accroître le nombre de ses partisans" Ces dèmes
étaient répartis e n trente groupes ou rrytties, dix trytties étant formées par les dèmes urbains ou suburbains, dix autres par les dèmes côtiers, dix enfin par
les dèmes de l"intérieur" Trois trytties prises dans chacune des trois régions géogra phiques formaient une
tribu, ce qui portait 11 dix le nombre des nouvelles
tribus qui remplaçaient désormais les quatre anciennes
tribus ioniennes" Le caractère systématique de ce
découpage du territo ire traduisait incontestablement
1" influence sur Clisthène de 1" esprit « géométrique »
des philosophes ioniens, mais avait aussi pour objet
de mettre fin aux solidarités régionales qui s"étaient
manifestées lors des conflits du vI' siècle, et de saper
par conséquent le pouvoir des vieilles familles aristocratiques"
C"est en effet sur cette nouvelle répartition des
citoyens qu "était désonnais organisé 1" ensemble des
institutions de la cité, et singulièrement le nouveau
conseil de cinq cents membres, recrutés à raison de
cinquante par tribu, qui allai t devenir r organe principal de la démocratie athénienne" C 'est également la
tribu qui servait de cadre à l"organisation militaire, les
hoplites d"une même tribu combattant côte à côte au
sein d ' une même unité" Il n"est pas exclu que les
tribus aient même été le cadre de certaines activités
politiques" Enfin, au fur et à mesure que se mettaient
en place les différentes archai, les différellles magis-
Cl/STHEIIE
148
tratures de la cité, c'est le système décimal instauré
par l' Alcméonide qui allait en être le fondement : il y
aurait dix stratèges, dix archontes, dix astyllomoi,
chargés du maintien de l'ordre et de l'entretien des
voies publiques, dix syrophylaqlles pour surveiller
l'approvisionnement en grains, etc.
De même, l'année allait être divisée en dix prytanies,
c'est-à-dire dix périodes de durée approximativement
égale pendant lesqueltes les cinquante bouleutes
d'une tribu assuraient la continuité du pouvoir dans la
cité et présidaient les séances de l' ecclesia dont la
périodicité était désormais fixée, Enfin, la tradition
attribuait à Clisthène la création de l'ostracisme, procédure qui consistait, par un vote de l'assemblée pour
lequel un quorum de six mille présents était nécessaire, 11 exclure de la cité pour dix ans tout homme qui
paraissait aspirer à la tyrannie, et qui mettait entre les
mains du démas une arme redoutable dont il altait se
servir dans les premières décennies du siècle suivant.
On ne sait ce qu 'il advint de Clisthène après qu 'il eut
établi ce qui allait être la matrice de la démocratie
péricléenne, Dans les déce nnies qui suivent, son nom
paraît presque oublié, Hérodote le memionne et nous
lui devons une partie de nOire information, mais il
ramène ses réformes il des mesures de circonstance et
n'en apprécie pas vraiment la portée, C est seulement
au IV" siècle, et avec la Constitlltion d'Athènes
d' Aristote que l'Alcméonide retrouve la place essen-
COHJNISATlCW GRECOUE
149
tieUe qui est la sienne dans l ' histoire d'Athènes, Alors
que Solon allait devenir dans l'imaginaire des Athéniens le « père fondateu r » de la démocratie, Clisthène
n 'en serait que le « restau rateur» après la période des
tyrans, L'historiographie contemporaine en revanche
a rendu à l' Alcméonide l'importance qu'il mérite, tant
par son action propre que par l 'étendue des réformes
qu 'il sut imposer à la cité,
[J
p, Lévêque et p, Vidal-Naquet. Clisthène l'Athénien,
Paris, 1964 ,
C,-w.-J, Eliot, The Coos/al DenJe:S ofAWca, A SlUdyofthe
Polley of Klels/henes, Toronto, 1962,
R, Osborne, Dell/VS, The Discovery or Classlcal AlIIka,
Cambridge, 1985.
r7" Alcméonides. Athènes. Dème. Orthagorides. Patrios
politeia. Tribu.
COLONISATION GRECQUE
On appelle colonisation grecque le vaste mouvement
d 'expansion des Grecs en Méditerranée, qu i débura
vers le milie u du VIII' siècle avant J,-C. et qui allai t
contribuer à répandre la c ulture et la civilisation
grecque du détro it de Gibraltar aux rives de la mer
Noire. On s 'est interrogé sur les raisons de cette
expansion. alors que le monde grec des deux rives de
l' Egée venait à peine d 'émerger des« siècles obscurs ».
CDHlN/SAnoN GRECQUE
150
ces quatre siècles qui séparent la destruction des
palais mycéniens de l'apparition d'un nouveau type
de groupement politique: la cité. Les sources anciennes
ne sont guère explicites. Hormis la sèche énumération
par Thucydide des cités qui colonisèrent la Sicile
orientale, il s'agit le plus souvent de récits plus ou
moins légendaires qui évoquent tantôt une crise
interne, tantôt une disette ou encore l'étroitesse du sol
(stenochoria). tantôt enfin des raisons privées qui
conduisaient un individu à s 'exiler avec quelques
compagnons. Les sources parlent aussi du rôle de
l'oracle de Delphes qui aurait, par ses réponses
ambiguës, orienté le choix des fu turs colons. Les
modernes ont évidemment cherché des raisons moins
anecdotiques. Certains ont mis en avant le besoin de
terres qui serait la conséquence d'un rapide accroissement démogra phique, peut-être aussi de certaines pratiques successorales qui contraignaient les cadets à
émigrer vers de riches terres agricoles. D'autres ont
privilégié au contraire des raisons commerciales: le
réveil des échanges en Méditerranée, la participation
des Grecs à ces échanges, la recherche de certaines
matières premières rares comme l·étain. En réalité,
lOutes ces raisons om pu jouer dans des proportions
variées selon les cités. Et sïl est vrai que certaines
fondations en Grande Grèce (Italie méridionale) et e n
Sicile répondent d'abord au besoin de tetTes nouvelles, d'autres (Rhegion et Zancle de part et d'autre
COHJNISATlCW GRECOUE
151
du détroit de Messine, Marseille) correspondent
incontestablement au désir de contrôler certaines
voies de passage ou le débouché de voies navigables
par où arrivait l'étain,
Il serait fastidieux d'énumérer toutes les fondations
grecques, Les plus anciens établissements furem ceux
d'Italie du Sud (Pithécusses, Cûmes, Rhegion) et de
Sicile (Syracuse, Naxos, Gela, Mégara), Les premiers
colons venaient des cités de nie d'Eubée (Chalcis et
Erétrie), du Péloponnèse (Corinthe, Sparte, Mégare)
puis des cités insulaires de l'Egée (Rhodes, Chios,
Thera) . Les cités grecques d'Asie Mineure (Milet,
Phocée) envoyèrem des colons en Propontide et dans
la région du Po nt-Euxin, ou dans le lointain Occident
(fondation de Marseille par les Phocéens à la fin du
VI I" siècle). En un siècle et demi e nviron, des centaines
d 'établissements furent ainsi fondés,
Ces établissements, et c'est là le fait essentiel. n'étaient pas de simples prolongeme nts de la cité mère
(métropole), mais de nouvelles cités indépendantes,
Certaines, certes, conservèrent des liens privilégiés
avec leur métropole, mais d'autres s'en détachèrent
très vite, voire, comme Corcyre, colonie de Corinthe,
lui devinrent hostiles. Il faut noter par ailleurs que, si
les premières fondations furent souvent le fail de
colons originaires d'une seule cité, lIès vile le groupe
des colons rasse mbla des Grecs venus de c ilés différentes, y compris de fondations récentes, On a ime-
CDHlN/SAnoN GRECQUE
152
rait pouvoir reconstituer avec précision le déroulement d'une fondation coloniale, Les récits transmis
par les sources, souvent tardives, évoquent, on l'a vu,
les circonstances qui présidèrent au départ des colons,
la consultation de l 'oracle de Delphes par le chef de
l'expédition, l' oikiste, la recherche parfois difficile du
lieu choisi pour lïmplantation de la nouvelle cité, les
relations avec les populations indigènes. Mais bien
des obscurités subsistent sur la façon dont étaient
réparties les terres entre les colons, sur la mise en
place d'institutions nouvelles, Sur le premier point,
les travaux des archéologues ont apporté des précisions qui sont l'objet de débats entre les modernes,
Les fouilles ont permis néanmoins d 'entrevoir certains modes de répartition du territoire de la cité et de
division du sol urbain, l'importance aussi des sanctuaires établis soit 11 proximité ou au sein de l'agglomération urbaine, soit aux limites du territoire, Il
n'est pas douteux en effet que l'un des premiers
soucis des colons était le transfert depuis la métropole
des objets sacrés destinés 11 perpétuer sur le sol de la
nouvelle cité les cultes de la cité d'origine,
Pour ce qui est des institutions en revanche, on ne
sail presque rien, Quelques noms de législateurs sont
rattachés 11 des cités de Grande Grèce: Zaleucos de
Locres, Charondas de Catane, Mais la tradition, taro
dive, les présente comme des arbitres ayant mis fin 11
une situation de crise qu'on place généralement vers
COHJNISATlCW GRECOUE
153
le milieu du VII" siècle. Et c· est seulement pour
l·époque classique qu·o n peut entrevoir certaines de
ces institutions qui sont le résultat d ·une évolution qui
nous échappe.
Beaucoup plus évidentes en revanche sont les conséquences de la colonisation grecque sur le plan culturel. La fondatio n de cités grecques sur le pourtour
de la Méditerranée se traduisit en effet par la diffusion
de la langue grecque. de ["art et de toutes les manifestations de la civilisation grecque. On insiste aujourd·hui sur le développement de caractères régionaux
qui témoignent de r originali té des différe nts foyers
de celle civilisation. En Italie du Sud, en Sicile. subsistent encore les restes impressionnants de monuments (Agrigente, Selinonte, Paestum) qui témoignent
de la fécondité de l·art grec dans cette région. On
pense aujourd·hui qu·une partie des objets, des vases
en particulier, retrouvés dans les ruines des cités coloniales grecques, étaient des productions locales, et
non comme on ["a cru longtemps des importations de
Grèce propre, ce qui atteste l"importance de ["artisanat dans ce monde colonial. La Grande Grèce fu t
aussi un intense foyer de vie intellectuelle. O n a déjà
évoqué les législateurs Zaleucos et C haro ndas. Mais il
fa ut rappeler que c'est en Grande Grèce que vint
sïnstaller le Samien Pythagore pour fonder à Crotone
une école philosophique, qu·Hérodote se voulait
citoyen de Thourioi. Il faut rappeler aussi \. école
CDHlN/SAnoN GRECQUE
154
éléate autour de Zenon, Empédocle d'Agrigente, Gorgias de Leontinoi et bien d'aulres.
Les populations indigènes subirent aussi cette innuence de la culture grecque. Les fouilles menées en
Italie du Sud, en Sicile, en Roumanie, en Russie
méridionale permettent de deviner des phénomènes
d'acculturation qui, dans certaines parties du monde
colonial. semblent avoir été très rapides. Au point que
dans nombre de ces cités une partie de ces populations
hellénisées s "intégrèrent à la communauté civique,
quand elles ne développèrent pas elles-mêmes leurs
propres cités. Tout cela, bien évidemment, ne se fit
pas sans heurts, comme le prouve encore au V siècle
le soulèvement des populations sicules derrière
Doukétios.
Le grand mouvement d·expansion grecque semble
s·être ralenti à partir de la seconde moitié du vI' siècle. À part quelques fondations comme Thourioi en
Italie méridionale et la colonie athénienne de Bréa
dans 1· Adriatique, les établissements nouveaux apparaissent plutôt comme des comptoirs ou des postes
stratégiques que comme des cités réellement indépendantes. Désormais, les limites du monde grec semblent fixées, et c ·est seulement l 'aventure d· Alexandre
qui ouvrira une nouvelle étape dans l"expansion de la
civilisation grecque.
COMEDiE
[1
155
Cl. Massé. La colon/sallon dans /'Anllquflé. Paris, 1970.
E. Lepore, « La colonlzzaz/one greca e 1 suol problem/~ ,
Stor/a e C!vlltà dei Grecl (R. Bianchi Bandinelli 00,), T.1.
Milan, 1978. pp, 230-253,
1. Malkin. Relig/on and Colon/zallon /n Ancien! Greece,
Leiden. 1987,
r:7" Cyrène, Grèce d'Occident, Marseille, Sicile, Syracuse,
COMÉDIE
La comédie grecque est née du cômos, c hœur parlé
et chanté qu i accompagnait les cérémonies du culte de
Dionysos, De nombreuses obscurités subsistent quant
â ses débuts, en Attique, mais aussi hors de l'Afrique,
â Mégare, en Sicile, à Sparte peut-être, On ne peut
vraiment s'en faire une idée précise qu 'avec la plus
ancienne comédie d'Aristophane, les Achal7liens,
représentée en 425 avant J,-C, Alors, chaque année,
trois pièces étaient présentées aux Grandes Dionysies,
et trois autres aux Lénéennes,
On disting ue habituelle me nt trois périodes dans
l'histoire de la comédie attiq ue: la comédie ancienne,
représentée essentiellement par Aristophane, le seul
auteur do nt nous possédions une partie importante de
l'oeuvre : la comédie moye nne, dont, â l'exceptio n
des deux dernières pièces d'Aristophane, nous n'avons
que des frag ments ; la co médie nouvelle enfin dont
COMtDlE
156
Ménandre est le principal représentant. La comédie
ancienne (seconde moitié du V siècle) se caractérise
par des situations imaginaires insérées dans un contexte politique très réel : les animaux parlent, les
dieux se mêlent aux nommes, les femmes s'emparent
de l'Acropole, etc. Mais à Ifavers ces silUations
extravagantes, les nommes politiques contemporains
sont brocardés, la guerre est mise en question, de même
que les institutions de la c ité, Nous ne connaissons
bien que le théàtre d'Aristophane, mais des fragments
d'autres comiques contemporains, Cratinos, Eupolis,
témoignent que c'était la loi du ge nre, Nous connaissons beaucoup moins bien la comédie moyenne, qui
occupe la plus grande partie du IV siècle, Des fragments qui sont parve nus jusqu'à nous, il ressort que
l'arrière-plan politique demeure prése nt dans un certain nombre de pièces, ainsi que les attaques contre les
politiciens en vue, et contre les philosophes, dans la
tradition des Nuées d'Aristophane, Mais les plaisanteries obscènes se font plus rares, l'étude des types
sociaux caractéristiques (le cuisinier, le soldat, la
courtisane, le parasite) annonce la comédie nouvelle,
de même que les sujets : affa ires privées, intrigues
amoureuses,
La coméd ie nouvelle appartient aux dernières décennies du Iv" siècle, Le principal représentant en est
Ménandre dont nous possédons quelques pièces et de
nombreux fragments dom la collection ne cesse de
COMMERCE
157
s 'enrichir. Les allusions politiques ont pratiquement
disparu, ce qui se conçoit aisément dans une Athènes
soumise à la domination macédonienne. En revanche,
les intrigues amoureuses, les reconnaissances d'enfants perdus, les courtisanes au grand cœur tiennent la
première place. Le chœur a complètement disparu et
l'articulation de la pièce en cinq actes devient
générale. Cest cette comédie nouvelle qui connaîtra
un grand succès dans tout le monde hellénistique, et
dont s "inspirera la comédie laUne.
(J
K.-J. Dover. anicle • Comedy (Origin of. Old. Middle,
New) .. dans The Oxfam Class/cal D/cflanaty. Oxford,
]970. pp. 268-271.
F.-H. Sandbach, The Comlc Theatre ofGœece and Rome,
Londres. ]985.
r:sr
Aristophane. Chorégie. Littérature. Ménandre. Théâtre.
COMMERCE
Quelle place occupait l"activité marchande dans la
Grèce antique? Le problème a suscité de nombreuses
controverses, singulièrement il la fin du XIX" et au
début du xX'" siècle. Deux conceptions s 'opposaient :
une conception « moderniste » qui appliquait il l'étude
du commerce grec les schémas élaborés par les spécialistes de l"histoire européenne, et voyait dans le
COMMERCE
158
développement des échanges et l'invention de la monnaie le point de départ des transformations de la
société grecque entre le Vil !" et le v I" siècle avant notre
ère: une conception « primitiviste » qui au contraire
mellaitl'accent sur l'importance de la vie rurale et de
la relation à la terre dans le monde des cités grecques,
et faisait par conséquent du commerce une activité
marginale exercée par des outsiders, Les sources dont
nous disposons pour trancher dans ce débat s'avèrent
délicates à manier, Car, en dépit de quelques textes
concernan t Athènes et l'activité marchande du Pirée,
il faut raiso nner à partir des trouvailles de vases ou de
monnaies sur le pourtour méditerranéen, ce qui risque
de conduire 11 des hypothèses hasardeuses et peut
fournir aux tenants de l'une et l'autre thèses des arguments tout aussi valables ou tout aussi contestables, Il
n'est pas douteux que l'on constate un réveil des
échanges dans le monde grec à partir du VIII' s iècle, et
que l'expansion grecque en Méditerranée, si elle
visait d 'abord à proc urer des terres à ceux qui en
étaient dépoUlvus, n'était pas pour autant exempte de
préoccupations mercantiles, Encore faut-il s 'emendre
sur ce que cela signifie, En fait, il semble bien que les
Grecs aiem d'abord cherché, e n parcourant les mers,
à se procurer ce qu'ils n'avaient pas chez eux : des
métaux, des grains, et à partir d'un certain mome nt de
la main-d'œuvre servile, des objets de luxe aussi,
fabriqués en Orient et recherchés par une société aris-
COMMERCE
159
tocratique, celle qui alors dominait les cités. En
échange, et avant que la mon naie ne devienne l'inslrument privilégié de l'activité marchande, les Grecs
pouvaient proposer des vases, des armes et certains
produits agricoles comme l'h uile o u le vin, à quoi o n
peut ajouter des matériaux comme le marbre,
Quels étaient ceux qui se livraient à ce co mmerce ?
Sur ce point aussi les avis divergent. Pourtant, à lire
les quelques textes qui fo nt allusion à l'activité
marc hande pendant la période archaïque, il semble
que celle-ci ne soit encore qu 'exceptionnellement le
fai t de « professionnels », Dans son poème intitulé
Les travaux et les jours, Hésiode donne à son frère
Perses des conseils sur la faço n de gérer son domaine
rural, et aussi sur la meille ure période pour prendre la
mer avec une cargaison s'il veut rêaliser un bon profit.
D'autres indications laissent supposer que dans certaines cités ce sont les membres de l'aristocratie,
essentiellement des propriétaires fonciers, qui annent
un navire pour transporter les surplus qu'ils iront
échanger contre des objets de luxe ou des produits
rares, On a supposé que ces aristocrates ne naviguaient pas eux-mémes, mais confiaiem le ur cargaison à des esclaves o u des dépe ndants, O n a pourtant
des exemples d'aristocrales prenant eux-mêmes la
mer pour commercer, tels le frère de la poétesse
Sapho qui fréquentait le port de Na ucratis e n Égypte,
tels surtout ces Phocéens qui n'hésitaient pas, à en
COMMERCE
160
croire Hérodote, à utiliser leurs navires de guerre rap ides pour aller chercher dans le lointain Occident l' étain, ce métal rare qui entrait dans la composition du
bronze: c'est pour en contrôler les débouchés qu'ils
auraient fondé Marseille vers 600 avant j .-c'
À partir d'un certain moment pourtant, on constate
l'existence de marchands professionnels. C'est Athè nes
qui sur ce point nous offre le tableau le plus vivant de
ce qu'était le commerce grec au V et surto ut au !V siècle, Le Pirée est alors devenu un marché vers lequel
amuent commerçants grecs et barbares, et Périclès
peut se vanter dans les propos que lui prête Thucydide, de ce qu'Athènes jouit de tous les produits du
monde connu, Il est bien certain qu'à ce développement du Pirée l'hégémonie qu'exerce Athè nes en
mer Egée depuis le lendemain des guerres médiques
n'est pas étrangère, Mais le développement du commerce athénien est lié aussi à la nécessité pour une
cité en pleine expansion de se procurer les grains
indispensables pour l'alimentation de sa population,
On sait que c'est seulement sur cette activité marchande que la cilé exerçait un contrôle par lïntermédia ire de magistrats spéciaux appelés sitophylaques,
contrôle desti né à éviter la spéculation et à assurer le
ravitaillement de la cité,
Nous entrevoyons, à travers les plaidoyers du !V siècle, et singulièrement ceux du corpus démosthénie n,
ce monde des commerçants qui fréquentaie nt l' empo-
COMMERCE
'"
rion, le port marchand du Pirée. La grande majorité
d'entre eux étaient des étrangers, établis à demeure à
Athè nes avec le statut de métèque, o u étrangers de
passage. Mais il y avait aussi panni eux des Athéniens, généralement de condition modeste, l"activité
marcha nde n'étant pas particulièrement prisée.
D'autres Athéniens étaient partie prenante dans l'activité marchande, mais de manière indirecte. en prêtant de 1" argent aux commerçants. moyennant un
intérêt élevé. Le prêt maritime en effet était une institutio n bien établie : de riches particuliers, anciens
commerçants enrichis ou citoyens étrangers au monde
du commerce, faisaient ainsi fructifier leur argent en
prêtant « à la grosse ». Ces prêts étaie nt garantis par
u ne hypothèque sur la cargaison et seules des
circonstances exceptionnelles, un naufrage par exemple, pouvaient libérer le débiteur de ses obligations
envers son créancier. Souvent, un marchand. un
emporos, désireux d'acquérir une cargaison et de payer
son passage sur le navire d' un naukleros, s'adressait 11
plusieurs créanciers, ce qui risquait de créer des
problèmes épineux. si le marchand ne pouvait s 'acquitler de ses deites. De tels problèmes se traduisaient
généralement par des procès devam le tribu nal présidé
par les thesmothètes. La fréquence de ces procès. la
nécessité pour la cité de ne pas retenir trop longtemps
des marchands souhaitant reprendre la mer. expliquent que dans la seconde moitié du IV' siècle les
COMMERCE
162
actions commerciales (dikai emporikai) aient bénéficié d'une procédure accélérée. Cela traduit incontestablement l'importance q ue revê tait l'activité
marchande dans la cité, sans que cela implique l'existence d'une classe de commerçants influençant les
décisions politiques de la cité. À cet égard, un texte de
Xénophon, les Revenus, précise bien où se situait l' intérêt d·A thènes. L'activité marchande fournissait des
reven us par le biais des taxes levées à rentrée et à la
sortie des navires, et la présence de nombreux étrangers était une autre source de revenus tant pour la c ité
que pour les particuliers. Intérêt fiscal par conséquent
plus que propremen t économique, mais qui explique
le souci des Athéniens de créer les conditions les plus
favorables au développement de cette activité.
On peut supposer qu"il en allait de même dans les
autres cités qui devaient à leur position géogra phique
la présence d'un port de commerce actif: Corinthe,
Syracuse, Milet, Marseille pour n'en citer que
quelq ues-unes. Dans le dern ier quart du IV' s iècle
cependant, la prééminence commerciale du Pirée sera
quelque peu affaiblie face à deux cités, qui à l'époque
hellénistique occuperont la première place dans les
échanges en Médilerranée orienlale, Rhodes et surtout
Alexandrie. L'un des derniers plaidoyers attribués à
Démosthène est à cet égard significatif. qui révèle les
spéculations d'un certain Cléomène de Naucratis sur
le commerce du blé. Mais il s'agit déjà du monde né
CONFEDERATION MAfllTlME (Seconde)
163
des conquêtes d' Alexandre. un monde démesurément
élargi qui donnera au commerce méditerranéen une
ampleur jamais atteinte auparavant.
CI
M. L Finley. L 'économle 3nllque. Paris. 1974.
Ph. Gauthier. « Le commerce des grains il. Athènes et les
fonctions des sitophylaques~ , R.D. , UX 1981, pp. 5 sqq.
r:ir BanquelBanquiers. ~conomie . Emporoi. Monnaie. Nauk-
leroi.
CONFÉDÉRATION MARITIME (Seconde)
La Seconde Confédération maritime fut constituée
au tour d'Athènes en 378/7, Le texte du décret de fondation, rédigé sur proposition d' un certa in Aristotélès,
nous a été conservé, Il précisait d'entrée de jeu ce
qu'était le but de l'alliance: contrai ndre les Lacédémoniens « à laisser les Grecs vivre libres et autonomes
et avoir la jouissance complète de le ur territoire ».
Quiconque, Grec ou Barbare, adhérait à l'alliance,
demeurerait « libre et autonome en conservant la
politeia qu'il voudra, sans recevoir de garnison, sans
être soumis à un archonte, sans payer de tribut ». Les
Athéniens ne pourraient posséder aucu n bien sur un
territoire allié. Aucune décision concernant les alliés
ne serait prise sans l 'accord du synedrion. du conseil
des alliés. Par ce texte, les dirigeants et la cité tout
CONFEDtRAT/ON MARITIME (Seconde)
164
entière s'engageaient donc à ne pas revenir aux
erreurs et aux pratiques qui avaient e ntraîné le mécontenteme nt et la défection au sein de la ligue de Délos,
et semblaient guidés par le seul souci de préserver
l'autonomie des Grecs contre la menace Spartiate,
En réalité, la constitutio n de la Seconde Confédération maritime était l'aboutissement d'une politique
qui, dès le lendemain de la resta uration démocratique,
en 403, avait été e ntreprise par certains dirigeants de
la cité, conscients du lien qui existait entre le régime
et le maintien de l'hégémonie maritime d' Athè nes, Il
s'agissait d'abord de reconquérir certaines positions
dans le nord de l' Egée afin d 'assurer à Athènes la
sécurité des convois de blé vers le Pirée, Dès 399,
Thrasybule à la tête de quarante navires rétablissait le
contrôle d'Athènes sur les Détroits, favorisait l'étab,
lissement à Byzance d'un régime démocratique et
s'emparait de l'île de Lesbos, Peu après, Iphicrate
entreprenait la reconquête de la Chersonèse de
Thrace, L'élan se trouva quelq ue peu interrompu par
la conclusion de la paix du Roi. en 386, imposée aux
Grecs par le roi des Perses et par les Spartiales et qui
réaffirmait le principe de l'autonomie des cités, Mais
les circonstances allaient bientôt favoriser la constitulion d'une alliance autour d'Athènes, Sparte en effet
se lançait dans une politique expansionniste, tam dans
l'Egée que sur le continent. Les tenants du retour à
l'impérialisme, le fils de Conon, Timothée, le neveu
CONFEDERATION MAfllTlME (Seconde)
165
d'Agyrrhios Callistratos, les stratèges lphicrate et
Chabrias profitèrent du désarroi provoqué par une
tentative de coup de main Spartiate sur le Pirée pour
recréer une alliance militaire au tour d' Athènes. Il imporlait cependam de rassure r ceux qu'inquiétait, à
Athènes et ailleurs, un retour aux pratiques du siècle
précédent. D 'où les clauses évoquées plus haut, et la
création d'un organe représentatif des alliés. Ce synedrion où chaque cité alliée ava it un représentant,
siégeait à Athènes. Des inscriptions permettent de
reconstituer la procédure qui était suivie lorsqu'il falla it prendre une décision commune. La boule préparait le décret qui était soumis au vote des alliés. Si le
texte était adopté par le synedrion. il était ensuite
soumis à l' ecclesia. Les alliés pouvaient introduire
des amendements au texte proposé par la boule, mais
c 'est [" ecclesia qui décidait en dernier ressort du
maintien de ces amendeme nts. Le fait que le
synedrion se réunissait à Athènes, ["égalité de la
re présentation des cités, petites ou grandes, assuraient
aux Athéniens une suprématie réelle au sein de ["alliance. C'est le synedrionqui décidait de l'admission
de nouveaux membres au sein de la confédération, et
qui réglait les différends e ntre alliés, ou o pposant une
cité alliée à Athènes.
Il semble que pendant les années qui suivirent immédiatement la conclusion de l'alliance, les Athéniens
aient respecté les engagements pris dans le décret
CONFEDtRAT/ON MARI TIME ( Seconde)
166
d 'Aristotélès, D'où l'adhésion de nouvelles cités au
pacte fédéral , panni lesquelles il faut noter les cités de
la côte thrace, Perinthe, dans la Propontide, et à
l'ouest Corcyre, et aussi des cités continentales menacées par les ambitio ns Spartiates comme les cités
ac héennes, Mais la défaite Spartiate à Leuctres, en
371, devant le Thébain Epaminondas, défaite qui
allait entraîner à brève échéance la perte de la
Messénie et le déclin de la cité lacédémonienne, en
même temps qu 'elle faisait disparaître l"une des
raisons de l'alliance, donnait naissance à un nouveau
danger pour Athènes, celui que représentait Thèbes,
dont les ambitio ns hégémoniques n 'allaient pas tarder
à se manifester. Devant ce danger et aussi pour faire
face à des difficultés financières grandissantes,
Athènes allait très rapidement revenir aux pratiques
du siècle précédent. En 365, la tentative de sécession
de la petite île de Keos était durement réprimée, Des
clérouquies étaient établies à Samos, à Sestos, et à
Crithôté, à Potidée, Enfin, la clause qui pennettait en
cas de besoin de lever sur les alliés des contributions
ou syntaxeis fut l"occasion pour les stratèges chargés
de les lever d'un retour à des pratiques brutales corn'
parables à celles qu'entraînait auparavant la levée du
Iribut. Il n'esl donc pas surprenant que des défections
se soient produites, d'abord sporadiques, puis beaucoup plus graves lorsqu'une coalition rassembla,
autour de Byzance el du satrape de Carie Mausole,
CONFEDERATION MAfllTlME (Seconde)
167
Chios, Rhodes et Cos auxquelles se joignirent bientôt
Périnthe et Selymbria, Au début de l'armée 356, les
coalisés attaquèrent les dérouquies athéniennes de
Lemnos, Imbros et Samos. Athènes risposta en e nvoyant une flotte commandée par ses meilleurs stratèges,
Iphicrate, Timothée et Charès, Mais, il la s uite d' un
désaccord entre eux, le seul Charès affronta les coalisés et fut battu il Embata, À l'été de 355, Athènes dut
reconnaître l'indépendance des cités révoltées,
La Seconde Confédération maritime ne disparut pas
pour autant. et l'on possède des décrets postérieurs il
355 qui attestent l'existence du synedrion. Mais,
privée des grandes îles de l' Egée et des cités commandant les Détro its, elle n'était plus que l'ombre d'ellemême, et les conquêtes de Philippe cherchant il assu rer
sa façade maritime au nord de l'Egée allaient lui être
fatales, Par ailleurs, la défaite d'Embata et la reconnaissance par Athènes de l'indépendance de ses princ ipaux alliés marqua ient l'échec du « parti
impérialiste », C'est il partir de 356 qu'Eubule et ses
amis, partisans d' une politique « pacifiste » et de
re nonciation il l'em pire des mers, prerment en mains la
direction de la cité, s'efforçant de compenser par certaines mesures financières les pertes matérielles q u 'entraînait la renonciation il une politique extérieure
active, et par une réglementation plus sévère du commerce du blé les difficultés accrues d'approvisionnement qu'entraînait la perte du contrôle des Détroits,
CORINTHE
[J
168
P. Cloché. La fXJlJllque extérleured"Alhènes de 404 a338.
Paris. 1934.
S. Accame. La lega a/enlese deI secolo IV. AC. , Rome.
1941.
E. Will, C. Mossé. P. Goukowsky. Le monde grec el
l'Orient. T. Il - Le IV siècle el l'époque hellénlsllque,
Paris, 1975. pp, 27 sqq, 176 sqq,
r:ir Callistratos d 'Alphidna, Chias, Clérouquies, Impérialisme,
CORINTHE
Située sur lïsthme du meme nom, cette cité allait
étre, au cours de son histoire, une des plus puissantes
du monde grec, C'est surtout pendant l'époque
archaïque que, grâce â sa position, géogra phiq ue,
importante tant du point de vue stratégique qu'économique, Corinthe mérite l'épithète d'opulente que
lui attribue le catalogue des vaisseaux de l'Iliade,
Sous l'oligarchie des Bacchiades d'abord, la tyrannie
des Cypsélides e nsuite, Corinthe occupe en effet une
place de premier plan, C'est â Corinthe que, aux dires
de Thucyd ide, furen! construites les premières trières,
ces vaisseaux de guerre rapides qui allaient faire la
force de sa marine avant celle d'Athènes, Maîtresse
de l'isthme et des deux ports qui regardaient à l'est
vers l' Egée et à l'ouest vers la mer Ionienne, Corinthe
prélevait sur les navires qui y relâchaient o u qui
CORiNTHE
'"
empruntaient le dio/kas, ce chemin empierré qui les
réunissait, des taxes qui alimentaient le trésor de la
cité. Aux vu' et vI" siècles, la céramique fabriquée
dans les ateliers corinthiens se retrouvait sur tous les
sites grecs, d'une extrémité à l'autre de la Méditerranée, Sous les tyrans, Corinthe par ailleurs poursuivit la politique, inaugurée par les 8acchiades avec la
fondation de Syracuse, d'expansion vers l'Occident
en établissam des colonies dans \' Adriatique,
Néanmoins, malgré cette richesse et cette puissance
maritime, Corinthe ne réussit pas vraiment à jouer un
rôle politique important dans le monde grec. Durant
tout le V" siècle, Corinthe demeura alliée fidèle de
Sparte au sein de la ligue péloponnésienne, et s'engagea à ses côtés dans la guerre du Péloponnèse,
Toutefois, après la victoire de Sparte, Corinthe se rapprocha d'Athènes, et pendant une brève période un
régime démocratique y fut établi, Mais l'oligarchie ne
tarda pas à se réinstaller au pouvoir, une oligarchie
qui maintint Corinthe dans une prudente neutralité au
cours des luttes du IV siècle, entre cités et contre
Philippe de Macédoine, C'est sans doute la raison
pour laquelle ce dernier choisit le sanctuaire de
l'isthme pour y convoquer les Grecs après sa victoire
et conclure avec eux l'alliance que nous appelons
ligue de Corinthe, La cité devait connaître un regain
de prospérité à l'époque hellénistique, puis après la
conquête romaine devenir la capitale de la province
d 'Achaie,
C f/HE
(JI
170
Ed. Will , Korlmhlaka, Paris. 1955.
r:r Cypsélides.
CRÈTE
La Crèle a élé à l'âge du bronze le centre d'une brillante civilisation que, à la suite de l'archéologue
anglais Sir Arthur Evans, on appelle minoenne, du
nom de Minos. le roi légendaire auquel on altribuail
un pouvoir étendu sur toute la Méditerranée orientale
et ["élaboration d'un code de lois. La période de plus
grand développement de la civilisation minoenne se
place entre environ 2200 et 1450 avant J.-C. C'est
l'époque des grands palais de Cnossos. de Phaestos,
de Mallia, centres d'un pouvoir royal reposant sur des
structures économiques et sociales comparables à
celles des états de l'Orient ancien. La nature de ce
pouvoir est altestée en particulier par un usage précoce de ["écriture. d'abord hiéroglyphique. puis syllabique (Linéaire A). Une première fois détruits vers
1700, les palais furent reconstruits et connurent une
seconde période d 'apogée jusque vers 1450 avant J .-c.
À ce moment, comme ["attestent les tablettes en
Linéaire B découvertes dans les ruines du palais de
Cnossos, une partie de lïle tomba entre les mains des
Mycéniens qui imposèrent leur langue et firent de
Cnossos le centre de leur domination. Le dernier
CRETE
171
palais de Cnossos fUi détruit au début du XIV" siècle,
qui inaugure une période de déclin de l'île, les habitants se réfugiant sur des sites défensifs de l'intérieur,
La Crète n'en demeura pas moins une région de fort
peuplement : Homère parle de « la Crète aux cent
cités », Les plus importantes de ces cités durant les
premiers siècles du premier millénaire étaient
Cnossos, Gortyne, Lyttos, Cydonia, Mallia, Phaistos,
L'aristocratie qui dominait ces cités était « dorienne »,
Le célèbre code de Gortyne, une longue inscriplion
qu'on date de la première moitié du V" siècle, mais
aussi les remarques d'Aristote au livre II de la
Politique attestent l'existence dans les cités Crétoises
d'une importante population dépendante, dont le statut
était inlermédiaire entre la condition d 'homme libre et
l'esclavage et qui porte des noms divers selon les
cités, oikees à Gortyne, clarotes ou périèques ailleurs,
Les anciens les comparaient aux hilotes de Sparte, et
on peut penser que, comme ces derniers, ils étaient
des paysans attachés aux lots de terre des citoyens,
Les philosophes vantaient les institutions des cités
Crétoises souvent comparées à celles de Sparte également. La tradition prétendait même que Lycurgue, le
législateur légendaire de la cilé péloponnésienne, s'en
était inspiré, Les cilés étaient dominées par une aristocratie de propriétaires parmi lesquels se recrutaient
les magistrats appelés cosmes. Les femmes, à Gortyne
au moins, jouissaient d'une plus grande indépendance
CR1TIAS
172
que dans le reste du monde grec : elles pouvaient en
particulier hériter d'une partie du patrimoine paternel.
et la fille épiclère (unique héritière en l'absence
d ' héritier mâle) n'était pas tenue d'épouser son plus
proche parent dans la lignée paternelle.
Si les cités Crétoises semblent avoir joui d'une paix
réelle pendant toute la période archaïque et classique.
ce ne serait pas seulement la conséquence de l'excellence de leurs institutions, comme le prétendaient les
auteurs anciens, mais plutôt dû au fait qu'elles demeurèrent à l'écart des événements qui secouèrent le
monde égéen, certaines cités se contentant de fournir
aux belligérants des mercenaires, ces fameux archers
crétois particulièrement recherchés au IV" siècle,
111
H, Van Effenterre, Les Egéens, Paris. 1986:
La Crèle et le monde grec de Platon à Polybe. Paris,
1948,
ER. Willets, Arlstocrallc Society ln Anclenl Crele,
Londres, 1965,
r:ir
Evans,
CRITIAS
Cet homme politique athénien est certainement l'un
des représentants les plus caractéristiques de l'opinion
antidémocratique. Il appartenait à une vieille famille
CRITIAS
173
aristocratique d'Athènes et était l'oncle de Platon, Lié
à la jeunesse dorée d'Athènes, il figure parmi les disciples de Socrate O'un des dialogues de Platon porte
son nom), Poète, auteur en particulier de tragédies, il
avait subi, outre l'influence de Socrate, celle des
sophistes, et un court fragment d'une tragédie dont il
est l'auteur, intitulée Sisyphe, exprime une opinion
non conformiste quant à l'origine des dieux, e n qui il
voit des créations de l'homme, destinées à maintenir
l'ordre et le respect des lois dans la société,
Comme beaucoup d'hommes de sa génération et de
son milieu, il se trouva mêlé à l'affaire des Hermès,
puis à la première révolution oligarchique. C'est peutêtre au lendemain de celle-ci qu'il fut condamné à
l'exil, et qu'il séjourna en Thessalie où il aurait
fomenté une révolte des pénestes, des paysans dépendants, contre leurs maîtres, Mais c ' est surtout après la
défaite d'Athènes en 404 qu'il joua un rôle de premier
plan,
I! fut en effet l'un des Trente qui gouvernèrent
Athè nes sous l'oligarchie, et le plus influent semblet-il. Xénophon, dans les Helléniques. lui prête des
propos qui ne laissent aucun doute sur ses opinions,
La démocratie est pour lui un régime « néfaste » et la
plus belle des constitutions est celle des Lacédémonie ns, à laquelle il consacra d'ailleurs une étude,
malheureusement perdue, La révolution qu'il préconise doit être implacable pour ses ennemis, et il
C YPSELIDES
174
n ' hésita pas à faire exécuter son complice Théramène,
quand celui-ci manifesta quelque hésitation devant
l'accumulation de crimes dont les Trente se rendaient
coupables. Critias devait mourir peu après l 'exécution
de Théramène, lors d·un e ngagement contre les
démocrates qu i ve naient de s 'emparer de la forteresse
de Mounychie au Pirée.
[)
P. Salmon, L 'établJssement des Trente Il Athènes,
Anllquflé Cl assique, XXX VIII , 1969, pp, 497 sqq ,
r:ir Oligarchie, Théramène, Trente.
CYPSÉLIDES
Les Cypsélides sont les tyrans qu i rég nèrent à
Corinthe à la fin du VII' et au début du VI' siècle, Nous
devons à Hérodote le récit des origines de la tyrannie
corinthienne, La cité était alors dominée par une
famille , celle des Bacchiades, qui monopolisait toutes
les charges et pratiquait l'endogamie. On a beaucoup
discuté à propos de la nature du pouvoir de ces
Bacchiades, qui reposait peut·être en partie sur les
revenus des taxes qu 'ils prélevaient sur les marchands
qui empruntaient l'isthme pour se rendre dans le
bassin occidental de la Méditerranée, Le récit d'Hérodote relève de ce qu 'on pourrait appeler le fol klore
tyrannique: une Bacchiade, Labda, qui. comme son
C YPSEL IDES
175
nom l'indique, était boiteuse, se maria en dehors de la
famille, enfreignant ainsi la règle de l'endogamie, Un
oracle ayant prédit que de cette union naîtrait un danger pour Corinthe, les Bacchiades s'efforcèrent de
s'emparer de l'enfant de Labda, Mais celle-ci réussi t
à le cacher, et, deve nu grand, il s'empara du pouvoir
à Corinthe, réalisan t la prédiction de l'oracle, L'histoire est belle, mais elle ne re nd pas compte des
raiso ns qui favorisèrent l'avènement de la tyrannie,
Aussi s'est-on efforcé de comprendre ce qui avait
provoqué la chute des Bacchiades : des échecs militaires, en particulier une défaite navale deva nt
Corcyre, colonie corinthienne, devenue dans l'Adriatique la rivale de sa métropole, mais aussi là comme
ailleurs da ns le reste du mo nde grec une crise agraire
et celte revendication égalitaire liée à l'adoption de la
phalange hoplitique, Une autre source nous apprend
en effet que Cypsélos, lorsqu'il s'empara du pouvoir,
était polémarque, Indication intéressante, parce
qu 'elle témoigne qu 'étant Bacchiade par sa mère,
Cypsélos avai t pu accéder à une fonction importante,
mais surtout que celle fonction était celle d'un chef de
guerre qui savait pouvoir s'appuyer sur le démos des
hoplites. Sur la tyrannie de Cypsélos on ne sait pas
grand-chose, Y eut-il, comme on l'a supposé, un
partage des terres confisquées aux Bacchiades ? Nos
sources n'en fo nt pas mention, En revanche, un passage de l'Économique du Pseudo-Aristote évoque une
C YPSELIDES
176
curieuse mesure auribuée au tyran. Il aurail fait vœu
de consacrer à Zeus les biens des Corinthiens, et pour
ce faire aurait prélevé pendant dix ans une dîme,
façon détournée de respecter son vœu, tout en laissant
les Corinthiens en possession de leurs biens. Cypsélos
fut enfin peut-être le créateur des premières monnaies
corinthiennes. Il aurait également favorisé 1· établissement de colonies dans 1· Adriatique, Leucade, Anactorion, Ambracie, dans 1· intention de résoudre le
problème agraire, mais aussi pour assurer la sécurité
de la navigation corinthienne dans 1· Adriatique et
rapprovisionnement en métaux précieux provenant
de I·arrière·pays illyrien.
Cypsélos transmit en mourant la tyrannie à son fils
Périandre. Celui·ci semble avoir donné à son pouvoir
un caractère plus autori taire, s·appuyant sur une garde
personnelle de trois cents doryphores. Il aurait déve·
loppé la floUe corinth ienne et mené une politique
d'expansion en mer Egée. Il aurait pris également à
1· encontre des riches des mesures somptuaires. leur
interdisant I·achat massif d· esclaves et obligeant leurs
épouses à se dépouiller de leurs bijoux et de leurs
riches vêtements. La Iradition donne de Périandre une
image controversée. Certains le fOIl! figurer au nom·
bre des Sepl Sages de la Grèce, tandis que d·autres
sources lui attribuent des mœurs scandaleuses el une
infinie cruauté. Périandre put néanmoins à sa mort
Iransmettre le pouvoir à son neveu Psammétique.
CYRENE
177
Mais celui-ci ne rég na que trois ans et mourut, tué par
les Corinthiens. Une source ancienne précise : « Le
peuple détruisit la maison des tyrans, confisqua leurs
biens,jeta le cadavre de Cypsélos (Psammétique) pardelà la frontière, sans sépulture. viola les tombeaux de
ses ancêtres et en vida les ossements. »
La Iyrannie qui avait pu un temps résoudre la crise
que traversait Corinlhe au milieu du vu' siècle,
s'achevait donc dans la violence et laissait place à un
régime oligarchique modéré qui se maintint pendanl
les deux siècles suivants.
~
Ed. Will , Korlnthlaka. Paris. 1955.
Cl. Mossé , La tyrannie dans la Grèce amlque, Paris, 2'
éd. 1990 : pp. 25-36.
r:ir Corinthe. Hérodote- Onhagorides. Tyrannie.
CYRÈNE
Cyrène fut la plus imporlante des colonies grecques d'Afrique du No rd. Elle fut fondée ve rs 630
par des gens venus de Théra (Santo rin). à la suite
d'une disette. Hérodote se fait l'écho de traditions
diverses quant à lïnstallation des premiers colons
sous la conduite d 'un certain Ballos qui fut le fondateur de la dynastie qui allait régner sur Cyrène pendant de ux siècles. jusqu'à ce que le dernier roi,
C YRENE
178
Arcésilas IV, soit déposé vers 440 et que soit établi un
régime démocratique sur le modèle athénien.
L'histoire de Cyrène semble avoir été particulièrement mouvementée, Les premiers colons eurent à
affronter les indigènes libyens, mais très vite les
Cyrénéens réussirent à étendre le territoire de la cité,
ce qui leur permit de recevoir de nouveaux colons, et
par la suite de fonder de nouveaux établissements sur
la côte libyenne, à Barcè et Euhespéridès. Cyrène
devint une cité prospère, Son territoire, riche en blé,
produisait également une plante recherchée comme
condiment, le silphium,
L'histoire intérieure de Cyrène fut durant le premier
siècle après sa fondation marquée par des luttes
opposant entre eux les fils de Ballos, Le petit-fils du
fondateu r, Battos Il , fut le contemporain d'une législation nouvelle dont l'auteur fut un certain Démonax
de Mantinée, Il semble, aux dires d'Hérodote, avoir
réparti les habitants de la cité à l'intérieur de trois
tribus et confisqué une partie des terres appartenant au
roi pour les mettre à la disposition de la communauté
civique, La répanilion nouvelle avai t pour objet d'intégrer à la cité les cololls venus d'autres parties du
monde grec (Pélopollnésiens, Crétois, Insulaires, en
particulier des Rhodiens), ainsi que des éléments
indigènes, Mais la constitution mise en place limitait
les pouvoirs du roi. et elle fut contestée par Arcésilas
III qui s· exila à Samos où il recruta des troupes en leur
C YRENE
179
promettant des dis tributions de terres. Revenu à
Cyrène. non seulement il ne tin t pas ses promesses.
mais encore il se livra à de telles exactions à 1· encontre de ses adversaires qu 'il dut se réfugier à Barcè o ù
il fUi assassiné. Ici se place un curieux épisode.
O· après HérodOle, Cyrène, après le départ d· Arcésilas
III , fu t pendant quelque temps gouvernée par la mère
de celui-ci, Phérétimè, qui assistait même aux séances
de la boulè, du conseil mis en place par Oémonax.
Après la mort d ·Arcésilas, elle s·enfuit en Égypte.
Elle organisa alors une expédition contre les gens de
Barcè pour en tirer ve ngeance, puis retourna en
Égypte où elle trouva la mort dans des conditions
qu·Hérodote rapporte avec une certaine complaisance: « toute vive, elle fourmilla de vers, tant il est
vrai que les ve ngeances poussées à 1·excès attirent sur
les hommes la haine des dieux ». Lïntérêt de l" anecdote est évident aux yeux d·Hérodote. Cyrène était
une cité grecque, mals la vie politique y revêtait des
fonlles qui r appare ntait plutôt au monde barbare.
Oe fait, Cyrène tombai t alors sous la domination des
Perses. Elle s'en libéra au lendemain des guerres
médiques e t connut une période de splendeur sous le
règne d ' Arcésilas IV, c hamé par Pindare, règne qui fu t
le dernier de la monarchie des Battiades. Cyrène
demeura indépendante jusqu·à Alexandre, puis fu t
intégrée aux possessions des Lagides.
otws (Ligue de)
111
180
F. Ch3moux. Cyrène sous la monarchie des Balliades,
P3ris. 1953.
Cir Colonisation grecque.
DÉLOS (Ligue de)
On désigne sous ce nom l'alliance défensive rassemblant 3utour d 'Athènes les cités égéennes au lendemain des guerres médiques. C'est en 478 que la ligue
fut constituée. Son centre était le sanctuaire ionien
d 'Apollon d3ns 1"île de Délos. Les cités alliées conservaient en principe leur indépendance par rapport à
la cité hegemoll qu' était Athènes. En fait , à part les
g randes îles (Chios. Lesbos, Samos) qui conservaient
leur propre flotte et fournissaient des contingents pour
3ssurer la défense commune contre le Barbare, les
3utres alliés se content3ient d'acquitter un tribut destiné à couvrir les frais d' équipement de la flotte. Le
premier tribut fut établi par Aristide et fixé à 460 talents. Il allait fournir à Athènes les moyens d'une
g rande politique égéenne. Après la disparition de la
scène politique d'Aristide et de Thémistocle. qui
3vaient été les artisans de l'ét3blissement de la ligue,
ce fut principalement Cimon qui contribua à e n
3ccroître les membres et l' importance, en particulier
en ve nant à bout de la résistance de Thasos. et en étab-
DI,WS (Ligue de)
'"
lissant des colonies militaires e n Thrace et en
Chersonèse. En 468. la victoire remportée par Cimon
à l'Eurymédon assura définitivement à Athènes le
contrôle sur la région des Détroits et sur la côte N .-0.
de l'Asie Mineure. En 449, à la suite d'une ambassade
menée par Callias, un accord fut conclu entre la ligue
et l'empire perse: c'était la reconnaissance par le roi
des positions acquises par Athènes dans l'Egée. On a
parfois douté de l'authenticité de cette « paix de
Callias ». Il est frappant en tout cas de constater à partir de ce moment l'établissement d ' un modus vivendi
entre le roi et Athènes. Cependant Périclès était désormais le principal acteur de la politique athénienne.
Avec lui. le caractère de l'alliance allait changer
insensiblement, la prédominance d'Athè nes au sein
de la ligue se manifestant de plus en plus ouvertement. À l'origine, il avait été prévu que les décisions
communes seraient prises lors d'assemblées réunissant les représentants de toutes les cités alliées, qui
conservaient ainsi leur souveraineté. Mais après la
conclusion de la .. paix de Callias », il semble que de
plus en plus souvent les Athéniens aient pris l'habitude de décider seuls des opérations qui engageaient
l' ensemble des alliés, Déjà auparavant. en 454, le trésor de la ligue avait été Iransféré de Dé los à Athènes,
sous prétexte de le mettre à ["abri d'un coup de main
des Perses. Désormais, les finances de la ligue se confondraient avec celles d' Athènes. assurant à la cité des
otws (Ligue de)
182
ressources importantes qui servaient les buts de sa
politique et assuraient le fonctionnement harmonieux
du régime" C'est vraisemblablement pour faciliter la
levée du tribut qu"à partir de 443, au plus tard, les
cités membres de la ligue furent groupées en cinq districts. Le district ionien comprenait les cités de la côte
occidentale de I"Asie Mineure d"Assos à Phasélis, le
district carien, les îles de Cos et Rhodes et les cités
côtières entre Phasélis et Halicarnasse: les Cyclades
et les trois îles à clérouquies de Lemnos, Imbros et
Skyros formaient un troisième district, les cités de la
côte thrace un quatrième: enfin un district de I"Hellespont était constitué par la Chersonèse de Thrace,
les cités du Bosphore et de la Propontide" Désormais,
c"est l"ecclesia d' Athènes qui fixait le montant du
tribut. Les sommes dues par les cités alliées étaient
apportées 11 Athènes lors de la célébration des Grandes
Dionysies" En cas de retard dans le paiement, une
escadre athénienne était envoyée pour forcer les récalcitrants à s"acquitter de la somme due, généralement
accrue d"une lourde amende" Grâce aux listes de tributs qui nous SOIl! parvenues, on a pu faire une double constatation: d"une partie montant global du tribut
a peu varié entre 454 et 431 : en revanche" les variations d" une cité 11 l"autre, et pour une méme cité d "une
année 11 l"autre pouvaient être sensibles: ainsi. Thasos
qui ne payait que trois talents au lendemain de sa
rébellion en payait-elle trente quinze ans plus tard"
DI,WS (Ugue de)
183
On conçoit aisément que les cités aient supporté de
plus en plus difficilement de telles charges, assorties
de la perte de leur indépendance, et ce d'autant plus
que]' empire perse avait cessé d'être menaçant. Aussi
ne faut -il pas s'étonner qu' à plusieurs reprises des
défections se soient manifestées, On a déjà évoqué le
soulèvement de Thasos et son écrasement par Cimon,
Les cités eubéennes, Samos également, se rebellèrent
dans les années qu i suivirent la conclusion de la
« paix de Callias » : la ligue de Délos avait perdu sa
raison d' être puisq ue l'adversaire contre lequel elle
était dirigée n'existait plus. Le soulèvement e ubéen
fut reprimé à la suite d'une expédition dont Périclès
lui-même avait pris le commandement et une clérouquie fut établie sur le territoire d'Histiae, Et c 'est
également Périclès qui, quelques années plus tard,
vint à bout de la révolte de Samos,
Pour éviter le re nou vellement de telles défections, les
Athéniens renforcèrent la surveillance exercée s ur
leurs alliés : garnisons, magistrats athé niens furent
envoyés dans les cités de la ligue, Certaines de ces
garnisons n'avaient pour o bjectif que d'éviter toute
velléité d'indépendance dans des c irconstances précises, Mais d 'autres étaient établies à demeure, sur
des terres confisquées et partagées entre les clérouques
qui constituaient la garnison : de telles clérouquies
existaient à Naxos, à Andros, en Eubée, ainsi que dans
les petites îles d'Imbros, Lemnos et Skyros, véritables
prolongements du territoire athénien.
otws (Ligue de)
184
La ligue de Délos s'acheminait ainsi vers sa transformation en empire athénien. Les clérouquies, la
nécessité pour les alliés de venir à Athènes plaider
devant les juges athéniens les conflits qui les opposaient à la cité, qui se trouvait ainsi à la fois juge et
partie, l'obligation d'utiliser la monnaie athénienne
qui privait les alliés de ce qui était d 'abord un signe de
souveraineté. le poids des tributs et le recours à des
méthodes peu orthodoxes pour en assurer la rentrée,
autant de faits qui témoignent de la transformation de
la ligue de Délos, On comprend dès lors que la guerre
du Péloponnèse, destinée d'abord à défe ndre les intérêts d' Athènes. soit apparue aux alliés comme un
poids particulièrement insupportable, et que les défections aient repris à la faveur des difficultés rencontrées par les Athéniens, L'alliance subsista néanmoins
jusqu'à la fin de la guerre, et c'est seulement la défaite
et la conclus ion de la paix avec Sparte qui entraînère nt sa disparition.
[J
Ed, Will, Le monde grec el 1Drlenl 1 - Le V s/éele, Paris.
1972, pp. ]31 sqq.
J,-A.-O- Larsen, The Constlwtlon and Ihe Original
Purpose of Ihe Dellan League, Hal'Varo Swdles ln
Classlcal Phllology. LI. 1940, pp. 175 sqq.
R. Sc3ley. The Orlgln of the Dellan League, Swdles pœsemed 10 V. Ehœnberg. Oxford, 1966, pp. 233 sqq.
qr Chios. Clérouquies. Impérialisme.
DELPHES
185
DELPHES
Situé sur les pentes méridionales du Parnasse, le
sanctuaire de Delphes a joué un rôle considérable
dans l'histoire du monde grec. Le site était déjà
occupé à l'époque mycénienne. Mais c' est seulement
à partir du VII I" siècle quïl est devenu le centre
religieux du monde grec, grâce en particulier à l'oracle que l'on venait consulter pour recueillir la parole
du dieu Apollon. Le sanctuaire était administré par un
conseil composé de délégués des différents peuples
grecs, le conseil Amphictyonique. Tous les quatre ans
se déroulaient les jeux pythiques qui comportaient
non seulement des compétitions athlétiques, mais aussi
des concours musicaux. Mais ce sont essentiellement
les consultations oraculaires qui faisaient la renommée de Delphes. Les réponses étaient données par une
prêtresse, la Pythie, qui se tenait sur un trépied, à
proximité d'une crevasse et non loin d'une pierre
sacrée, romphalos. qu' on disait être le centre de la
terre habitée. La prêtresse, à l'origine une jeune fille.
mais à l'époque classique une femme àgée, répondait
en état de transe aux questions posées. Ses réponses
étaient, si ]" on en croit les oracles rapportés par la tradition littérai re, généralement énigmatiques, et
DHPHES
186
devaient en conséquence être interprétées par les
prêtres et les consultants, et parfois l'interprétation
était sujette il caution. Les consultants étaient soit des
particuliers, soit les représentants officiels de telle ou
telle cité. On attribuait il l'oracle un rôle important
dans la colonisation grecque, et l 'on a beaucoup
débattu pour savoir quelle signification donner il ce
rôle, qui suppose de la part du clergé delphique des
connaissances géographiques, en particulier en ce qui
concerne la Méditerranée occidentale, C'est également
il l'oracle que se seraient adressés les législateurs qui
aux VII-VI" siècles s'efforcèrent d'établir un certain
ordre politique et social dans les cités, C'est ainsi que
le dieu aurait dicté 11 Lycurgue, le fameux législateur
de Sparte, la Grande Rhetra qui fixait les règles de la
constitution de la cité, On connaît aussi l'anecdote
rapportée par Hérodote de la consultation de l'oracle
par les Athéniens au moment de l'expédition de
Xerxès. Une première réponse invitant les Athéniens
il abandonner le ur ville aurait j eté la terreur dans le
cœur des ambassadeurs sacrés, les théores, Ils revinrent consulter l'oracle une seconde fois et la réponse
laissa espérer une issue favorable: « Quand sera conquis tout le reste de ce qu 'enferment la colline de
Cecrops el l'antre du divin Citheron, Zeus au vaste
regard accorde il Tritogenie (Athéna) qu ' un rempart
de bois soit seul inexpugnable, qui sauvera toi et tes
enfants ... », Au retour des ambassadeurs, les Athéniens
DELPHES
187
délibérèrent pour savoir ce que signifiait ce « rempart
de bois », Aux Anciens qui pensaient quïl s 'agissait
de I"antique palissade qui entourait I"Acropole, s'opposa Thémistocle pour qui le « rempart de bois » ne
pouvait que désigner les navires récemment construits à son initiative, Etl"o n sait ce quïl en advin t: la
victoire décisive remportée à Salamine par la flotte
athénienne, qu i entraîna l'échec de l'expédition de
Xerxès, On a là un exemple de l'ambiguïté des
réponses de l'oracle, qu i permettait toutes les justifications a posteriori. Les prêtres de Delphes se trouvaient par là même investis d'une grande au torité, et
ils furent souvent mis à contribution par les états grecs,
C'est ainsi que certains tyrans, comme Clisthène de
Sicyone, bénéficièrent de I"appui du clergé delphique,
À Athè nes, la puissante famille aristocratique des
Alcméonides, en aidant à la reconstruction du temple
d'Apollon détruit en 548 par un tremblement de terre,
fut également soutenue par le clergé delphique, et c'est
à ]" oracle de Delphes que 1" Alcméonide Clisthène, le
réformateur athé nien, demanda de désigner les héros
éponymes des dix nouvelles tribus créées par lui. Le
prestige de Delphes fut quelque peu éclipsé après les
guerres médiques, l'oracle ayant été accusé de «
médisme », Mais il relrouva un certain prestige au IV"
siècle lorsq ue Thèbes d'abord, puis Philippe d e
Macédoine, firent de l'Amphictyonie delphiq ue
l'instrument de leur politique en Grèce centrale,
DfM4GOGUfS
188
L'importance de Delphes dans l'histoire de la civilisation grecque est attestée par la majesté des monuments do nt on peut encore aujourd'h ui admirer les
ru ines, Le grand temple d'Apollon, plusieurs fois
reconstruit dans l'antiquité, dominait le site et était
l' aboutissement de la voie sacrée empruntée par ceux
qui ve naient consulter le dieu, Le lo ng de cette voie
sacrée, des trésors, petits monuments en pierre, abritaient les offrandes des particuliers et des cités, Un
petit théâtre permetta it le déroule ment des concours
musicaux et poétiques, À l'extérieur du sanctuaire
proprement dit, le stade était destiné aux concours
athlétiques, dont la réputation était comparable à celle
des jeux olympiques, Encore aujourd'hui, la majesté
du site de Delphes impressionne les visiteurs,
[J
J. Defradas, Les thèmes de la propagande delph/que,
Paris, 1954,
M, Delcourt, L'oracle de Delphes, Paris, 1955,
G Roux, Delphes, son oracle el ses dieux, Paris, 1976,
r:sr
Apollon. Dieux. Oracles. Religion civique. Sanctuaires.
DÉMAGOQUES
Le terme démagogue n'a pas à l' origine le sens péjoratif qu'il ne tardera pas à acquérir. Les démagogues.
ce sont d'abord ceux qui « conduisent ,. le démos, les
DEMAGOGUES
'"
hommes politiques attachés à la défense de la démocratie et qui gagnent la faveur populaire en préconisam les mesures les plus propres à satisfaire les
intérêts de la grande masse des citoyens. En ce sens,
et comme d'ailleurs le dira Platon, Périclès, dont Thucydide se plaisait à souligner les mérites et la hauteur
de vues, est un dé magogue.
Mais, après la mort de Périclès, le terme allait se
charger d'un sens qui ne fera que se confirmer au siècle suivant: le démagogue n' est plus seulement celui
qui défend les intérêts du peuple, c'est aussi celui qui
flatte le démas pour e n tirer le maximum d'avantages
pour lui. À cette transformation, une raison: le changement dans le personnel politique. Alors que jusqu'à
Périclès inclus, les dirigeants de la démocratie
appartenaient aux vieilles familles athéniennes, à partir de 429, des hommes « nouveaux » apparaissent sur
le devan t de la scène politique, qui lirentleurs revenus
d 'activités artisanales décriées: Cleon est tanneur,
Hyperbolos, fabricant de lampes, Cléophon, luthier:
c'est-à-dire en fai t qu'ils utilisaient une main-d' œuvre
selVile qualifiée dans ces différentes activités, Leurs
adversaires, parmi lesquels le plus ac harné fut le poète
comiq ue Aristophane, ne manquaient pas de souligner
leur manque de te nue, leur mauvaise éducation, ainsi
que le soin avec lequel ils flattaient le peuple et
allaient a u devant de ses désirs. Au IV' siècle, ]" attaque
contre les démagogues viendra des théoriciens hos-
190
OfMf
tiles à la démocratie, qui. n' osant attaquer les fondements mêmes du régime. feront des démagogues,
serviles serv iteurs du démos, les responsables de tous
les maux qui accablaient la cité, Les démagogues constituaient cependant, comme le remarque le grand historien Moses Finley, « un élémem structurel d u
système politique athénien », Dans une démocratie,
les conflits entre intérêts opposés sont une des manifestations nécessaires du libre jeu des institutions, car,
écrit encore Finley, « c' est le conflit combiné avec
l' assenti ment, et non l'assentiment à lui seul, qui évite
à la démocratie de se transformer à la longue en oligarchie, ,. Les démagogues ne sont donc pas une tache
au front pur de la démocratie. Défenseurs des intérêts
du démos, ils e n som une des composames essentielles,
[J
MA, Fin[ey, Démagogues athéniens, dans Économie et
Société en Creee ancienne, Paris, 1984, pp, 89-119.
r:ir Cleon. Hyperbolos, Orateurs.
DÈME
À l'origi ne, le terme signifie village, mais à partir de
la fin du vI' siècle, à Athènes et e nsuite dans d' autres
cités comme Érétrie ou Rhodes, le dème devie nt une
circonscription administrative. C' est à Clisthène que
'"
[' on doit la réorganisation des dèmes de ]' Afrique. On
ne sait exactement quel était leur nombre, certainement supérieur il cent, peUl-être égal il cent cinquante.
Les dèmes, à l'intérieur de chacune des dix tribus
créées par Clisthène, étaient répartis en trois groupes :
les dèmes urbains. les dèmes côtiers, les dèmes de
\' intérieur. Leur superficie et leur population pouvaient être très inégales. D'où l'inégalité de leur
représentation au sein de la boulê: un document du
IV" siècle témoigne que le dème cl' Acharnes, un des
plus étendus. était représenté à la bou/è par vingt-deux
bouleutes. Le dème Il' était pas seulement une circonscription administrative, il était aussi le cadre d'une
vie « municipale » où se manifestait une démocratie
directe, au sein des assemblées présidées par le
démarque, qui pouvaient prendre des décisions concernant la vie locale, l'affermage des terres communales, l'entretien des sanctuaires, et aussi la révision
des listes des citoyens membres du dème et aussi des
métèques qui y avaient leur résidence. Tout Athénien
en effet. lorsqu "il avait atteint sa majorité, devait être
inscrit sur les registres du dème qui tenait également
un registre des propriétés. À 1· origine, chaque Athénien avait été inscril dans le dème où se trouvaient ses
biens patrimoniaux. Mais, avec le développemem de
1· agglomération urbaine et du Pirée, avec aussi une
plus grande mobilité sociale à partir de la fin du V' siècle, la coïncidence entre l'appartenance au dème et la
OfMErER
192
localisation des bie ns cessa d'être totale. Nombre
d 'Athéniens demeuraient inscrits dans des dèmes où
ils ne résidaient plus, l'appartenance au dème étant
héréditaire. Cela bien entendu était surtout vrai de la
population urbaine, car dans les campagnes la mobililé était beaucoup plus faible. Mais cela permettait
aussi des elllrées en fraude dans le corps civique, sur
lesquelles no us renseignent certai ns procès. Le dème
demeure néanmoins un des fondements essentiels du
fonctionnement de la démocratie athénienne.
[1
B. HauSSDuliet. La vie municipale en AWque. Paris. 1884.
J .-S. Trait, The Palweal Organlzalfan afAWea. A Study of
the DenIeS, Trfllyes and Phylal .1nd Ihetr RepresentaI/on
ln the A/henlan Caunell, Princeton. 1975.
r7" C listhène.
DÉMÉTER
Déméter est l'une des divinités les plus importantes
du panthéon grec. Sœur de Zeus, de Poséidon et
d 'Hadès, elle est aussi et surtout la déesse de la fécondité. celle qui a donné aux hommes le blé. base principale de le ur nourriture. C'est aussi en tant que telle
qu'elle est particulièrement vénérée par les femmes.
lors de la fête des Thesmophories. Un texte de la fin
du VII" o u du début du vI" siècle, l' Hymne homérique
DfMfTER
193
à Déméter. raconte l'épisode essentiel de sa légende:
le rapt par Hadès de la fille qu'elle avait eue de Zeus,
Perséphone. Accablée de douleur, la déesse parcourt
la terre à la recherche de sa fille. Parvenue à Eleusis,
sous l'apparence d'une vieille femme. elle s'engage
comme nourrice chez le roi du pays. Kéleos. Elle finit
par se faire reconnaître du roi et de son épouse Métanire, et obtient des gens d' Eleusis qu 'ils lui élèvent un
temple. Mais, ayant appris que sa fille est entre les
mains d'Hadès, elle se refuse désormais à faire pousser le blé, privant les hommes de leur nourriture et les
dieux de leurs offrandes. C 'est pourquoi Zeus se décide
à intervenir et dépêche auprès d ' Hadès Hermès, avec
mission d' obtenir du roi des Enfers qu 'illaisse Perséphone rejoindre sa mère pendant un tiers de l'année.
Et. conclut l'HynUle, Déméter « fit aussitôt des labours
féconds lever le grain: tout entière, la vaste terre se
chargea de feuilles et de fleurs ». En même temps, la
déesse révélait aux Anciens d'Eleusis « les rites
augustes qu'il est impossible de transgresser. de
pénétrer, de divulguer », ces rites auxquels seuls les
initiés pouvaient accéder lors de la célébration des
« Mystères » dans le sanctuaire sacré d·Eleusis.
Si les fêtes en l'honneur de Déméter étaient en effet
essentiellement liées aux travaux agricoles, en particulier les Thesmophories, fêtes des semailles. les
Chlaia, fêtes de la verdure nouvelle, les Thalysies,
fêtes de la moisson. les cérémonies qui se déroulaient
DfMErER
194
à Eleusis avaient un caractère un peu différe nt. Fêtes
religieuses de l'état athénien, présidées par quatre
prêtres dont deux étaient désignés par l'assemblée du
peuple et les deux autres appartenaient aux deux
fa milles sacerdotales des Eumolpides et des Kerykes,
les Mystères d 'Eleusis étaient d'abord une cérémonie
initiatique qui devait assurer à ceux qui y participaient , comme le dit le rhéteu r Isocrate « des
espérances plus douées pour la fin de la vie et pour
toute l'éternité », Depuis l'Antiquité, on s'est efforcé
de découvrir e n quoi consistait celle initiation, Mais le
secret gardé par les Mystes rend hasardeuses toutes
les hypothèses qui ont pu être avancées, Il reste que
l'initié se voyait promis à une félicité éternelle, ce qui
est révélateur du lien qui existait entre la religion
éleusinienne et les rites de fécondité , mais aussi entre
le culte de Déméter et tou t ce qui avait rapport avec
l'au-delà et la mort, Le my the de l'enlèvement de
Perséphone est à cet égard essentiel. comme aussi
l'association à Eleusis de Déméter avec Dionysos, lui
aussi dieu de la fécondité et de l'au-delà,
[1
L. Séchan, P. Lévêque, Les grandes dlvlnllés de la Croce,
Paris, 1966,
M, Détienne, .. Déméter _, Dlcl10nnalre des Mythologies,
Paris, Flammarion, 1981, T. J, pp, 219-282,
r:ir Religion civique. Thesmophories,
DEMIDURGOI
195
DEMIOURGOI
Le terme désigne le plus souvent les artisans. et
quelquefois les magistrats de certaines cités. On le
trouve employé dans le sens d'artisans dans les
poèmes homériques, appliqué aussi bien au forgeron
ou au charpentier qu 'à l'aède. Les demiourgoi sont
alors des spécialistes itinérants, étrangers à la structure de l' oikos, même si une partie des activités artisanales se déroulent à l'intérieur du domaine. Dans la
cité de l'époque classique, le tenue désigne cette fraction de la population qui ne vit pas du travail de la
terre, réside généralement en ville et se livre aux
diverses activités indispensables à la vie de la communauté. À Athènes, comme dans la plupart des cités
démocratiques, les artisans font partie du démos.
Depuis quand y ont-ils été admis? C'est là une question quasi insoluble, en dépit de certaines indications
de nos sources. Ainsi, Plutarque affirme-t-il que Solon
aurait attiré à Athènes et accordé le droit de cité à des
étrangers qui venaient y exercer un métier (Vte de
Solon. XXIV, 4), et que par ailleurs il invita les
citoye ns à se faire artisans. entourant les métiers
(technai) d'une grande considération (Id., XXII , 1-3).
Aristote dans la Constitution d'Athènes rapporte que.
'JaApd ua,s
ap au ad apuE.!8 aun ~IP e[lnod l!eJas aJ anb la saqJjJ
sua8 sap IUa!el~ sal!ewpdOJd-uou saJ ap alqwou anb
J!O[eA I!es!e] J! : alE.!JOw~p malelO un UO!SeDO allaJ
~ e3uouOJd anb Se!s,{l Jed ~sodmoJ SJnoJs!p a[ suop
-~ssod snoN 'SOlllfJP np uO!l!soddo,[ ~ e)Jnaq as lal~p
aJ anb ]!leJU!u8!s SU!OlU uou Isa JI 'SlapUO] SiJl!ewpd
-old s[nas xne sanb!l![od Sl!OJp sap aJplaxa, [l!eU8!all
-saJ !nb lal~p un ~odOJd Ile SO!S!WlOqd U!ellaJ un
anb!lE.!Jow~p u0!lemelsal e[ ap u!ewapua[ ne, nb ]!leJ
-U!u8!s lsa JI 'sed IUa!eldaJJe,u snOI anb 'aIUellodm!
<l.Enldru aun 'a.ual e[ ap UO!ssassod e[ ~ ?lauua,{OI!J
e[lle![ !nb uompe.n e[ ~ uoddel let:! '~[ Ilew,:) 'ap
- ~!SJ\ ne anb!Ap SdlOJ a[ suep SUeS!lle,p a[qelsaluoJU!
aJuas~ld e[ aIW-lnad an b![dxa 'xneaAnou sua,{ol!J
sap 'WJ![OOœll sap lU [! IUOp SIUap!s?J SJa8uell~
sap al!npo.!IU! ,{ mod ~IP e[ ap sampllllS sap uones!U
-e&o?J e[ ap ~luoJd Ile 'sues!ued sas ap aJqwou
a[laJJO] Ual Jnod 'au'1qIS![::) anb l!e[nOA !nb UO!l!pell
el 'lossa ap!dE.! un l!eUUOJ 'apalOd e[ IUaWal~![n8UJs
'Ua!U~4Ie leues!ue,1 anb la addo[aA~p as sau~qIV,p
aWA e1 anb ap~!s .IA np luemOJ a[ suep lsa. J
anb luepuadaJ xnalnop set:! Isa. u JI 'slwOJdwoJ aJ
ap ?I![e~l e1 ~ luenb sanbnda:>s IUOS saulapom xnazq
-wou ap SleJAl ,(z 'mx 'SiJlli!lfJV,P llOnm!lS11oJ) loB
-Jr/O!wap xnap la (sues,{ed) !oJ{!wBe SIOII 'sapIJIet:!n3
bup allua leluoqJle,1 ea8elJed uo 'sa[qnoll ap apop~d
aun IIlUUOJ ~IP e[ 'UO[OS ap ued~p a1 s~de anbslO[
96l
1œJ 1I1J01I'f~a
197
DEMOCRATIE
De fait, si à Athènes la grande majorité des artisans
étaient des petites gens travaillant de leurs mains dans
leurs boutiq ues ou dans leurs ateliers, assistés de
quelques esclaves, il y avait cependant des artisans
riches, tels ces armuriers qu'évoque Xénophon dans
les Mémorables on, 10, 9) ou lels encore les fameux
démagogues de la fin du V" siècle, Cleon le tanneur,
Hyperbolos, le fabricant de lampes, Cleophon le
luthier, L'existence d'artisans riches posait d 'ailleurs
un problème aux théoriciens de la c ité comme Aristote, partisans d'un régime censitaire, mais forcés de
constater qu'un tel régime n'exclurait pas de l'activité
politique ces mêmes artisans,
[J
K, Murawaka, Demiourgos, Historia, VI. ]957, pp, 385405 ,
qr Banausoi.
~conomie.
DÉMOCRATIE
Le mot démocratie est apparu assez tard dans le
vocabulaire politique grec, Hérodote, dans le célèbre
dialogue perse, au livre III des HislOires, parle d'isonomie à propos du régime où le peuple est souverain,
Mais dans les Suppliallles d'Eschyle, représentées
vers 468 avan t J.-c., se trouvent pour la première fois
acco lés les deux mots qui ont formé le terme démo-
DEMOCRATIE
198
cralie, 11 savoir démos, le peuple et kratos, le pouvoir,
pour évoquer la décision prise dans la pièce par le
peuple d'Argos d'accueillir les Danaïdes venues
demander asile, À la fin du V" siècle, avec Thucydide
et Andocide, le tenne devient d ' usage courant pour
désigner le régime athénien, Mais si le mm lui-même
n'est apparu que tardivement, la chose, elle, est en
place depuis le début du V" siècle, peut-être même
avant à Chios, où une inscription du milieu du vI" siècle mentionne déjà l'existence d'un conseil populaire,
en tout cas assu rément 11 Athènes, depuis la révolution
opérée par Clisthène en 508, le remodelage de
l'espace civique et lïnstilution de la boulè des Cinq
Cents, Les guerres médiques, en affirmant le poids du
démos qui fournissait les rameurs de la nolte, les
réfomles opérées par Ephialte en 461, qui privaient le
conseil aristocratique de l'Aréopage de l'essentiel de
ses pouvoirs politiques, l'institution par Périclès de la
misthophorie, palliatif des inégalités sociales, parachevèrent l'œuvre de l'Alcméonide, Au terme d' un
siècle et demi de luttes politiques le démos athénien
devenait le maître de l'autorité souveraine dans la cité,
On a beaucoup discuté sur la valeur et la réalité de
celle démocratie, de celte forme de régime politique
« inventée ,. par les Athéniens et que nous connaissons 11 Iravers les écrils des philosophes, les discours
des orateurs, les plaisanteries des Comiques, et aussi
les nombreux témoignages gravés sur la pierre que
DEMOCRATIE
'"
sont les décrets émanant de ce pouvoir populaire.
Pour les Athéniens déjà, elle était un sujet de discussions, souvent âpres. Si le sophiste Protagoras, un
étranger venu enseigner à Athènes. semblait la justifier en affirmant que tous les hommes possédaient la
politikè technè, c'est-à-dire la capacité de porter un
jugement politique, si Périclès, dans la célèbre
Oraison funèbre que rapporte Thucydide au livre II de
son Histoire de la guerre du Péloponnèse, mettait l'accent sur 1· égalité de tous devan t la loi et sur la valeur
du principe majoritaire, d·autres en revanche en
dénonçaient les méfaits. Pour le Vieil Oligarque, elle
était le gouvernement des pauvres et des méchants
dans l' intérêt des pauvres et des méchants, au détriment des riches et des bien-nés. Pour Platon, elle
remettait le pouvoir de décision entre les mains d·une
foule ignorante, versatile et prête à suivre ses mauvais
conseillers, les démagogues qui ne pensaient qu 'à la
flatter. Arguments repris par presque tous les écri vains
de I"Antiquité, et aussi par nombre de modernes,
influencés tant par la lecture des auteurs anciens que
par les problèmes propres à leur époque: on pense ici
aussi bien aux historiens .. bourgeois,. du XIX' siècle
qu·aux universitaires contemporains, dans les années
qui suivirent I·agitation de mai 1968.
Qu· en était-il en réalité de cette démocratie grecque,
ou plus justement alhénienne, puisque c· est la seule
dont nous puissions discUler réellement? 11 importe
DEMOCRATIE
200
d'abord de se débarrasser d'un problème que l'on ne
manque pas de soulever périodiquement, celui de
l'esclavage, Il est bien évidelll que la démocratie
athénienne était une démocratie esclavagiste, que le
dé mos qui exerçait la souveraineté au sein des assemblées et des tribunaux ne constituait qu'une paflie de
la population de l'Attique, qu'en étaient exclus la
masse des esclaves, dont le nombre était au moins
égal à celui des hommes libres, mais aussi les
femmes, cette moitié de la cité comme dit Plato n, à
laquelle toute activité politique était refusée, C est
bien là précisément ce qui permet de mesurer la distance qui nous sépare des sociétés de l'Antiquité,
Mais le démos n 'en était pas moins, pour reprendre
une formule de Pierre Vidal-Naquet, .. un vrai
peuple », et .. les luttes de classe qui le traversaient
étaient de vraies luttes » (Tradition de la démocratie
grecque, p, 43) . Le démos athénien Il' était pas en effet
une classe privilégiée d 'oisifs vivant des revenus du
travail de leurs esclaves, Seule une infime minorité de
riches vivait ainsi. La grande masse de ceux qui co mposaielll le démos était formée de Iravailleurs,
paysans, artisans, boutiquiers, commerçanlS, dont les
intérêts n'étaie nt pas toujours identiques: on le voit
au début de la guerre du Péloponnèse, quand les
paysans assistent impuissants aux razzias lacédémoniennes sur leurs champs et mettent en question la taclique préconisée par Périclès: on le voit au IV" siècle,
DEMOCRATIE
201
quand les riches sur qui repose le poids des charges
occasionnées par les opérations maritimes s 'opposent
de plus en plus nettement à la politique impérialiste
qui sert au contraire les intérêts du démos urbain et
des plus pauvres.
Certains modernes pourtant, reprenant à leur compte
les attaques des auteurs anciens, ont mis en doute la
réalité de ce pouvoir populaire : face aux querelles
personnelles qui opposaient orateurs et démagogues.
le démos aurait été un spectateur impuissant, balloté
au gré de ses emballements successifs. Or si l'on ne
saurait nier l"existence à Athènes d'une classe politique, dont il faut toutefois souligner qu'elle ne constituait en aucune manière une oligarchie fennée, et
que ses rangs ne cessèrent de se renouveler au cours
des deux siècles de ]" histoire de la démocratie athénienne, il ne faut pas manquer de rappeler que ceux
qui la composaient étaient investis de leur autorité par
un vote populaire, et que les décisions prises à leur
initiative pouvaient constamment être remises en
cause. Cela tenait d 'abord au fait que toutes les
charges publiques étaient annuelles, collégiales et
soumises à reddition de comptes. Même Périclès qui
domina la politique athénienne pendant près de trente
ans é tait tenu de justifier chaque année sa politique.
Cela tenait ensuite au fait quO il s'agissait d'une démocratie directe: aucune .. représentation,. ne s' interposait entre les dirigeams et la masse du démos. De ce
DEMOCRATIE
202
fait, celui-ci, constamment appelé à se prononcer sur
routes les décisions engageant la communauté, avait
acquis ce que Moses Finley appelle « une familiari té
avec les affaires publiques que même les citoyens
portés à l'apathie ne pouvaient éluder en une telle
société, restreinte, en face à face » (Démocratie
antique el démocratie moderne, p" 60) " Cela tenait
enfin à lïmportance que revêtait dans ce système
politiq ue la parole, le contact direct e ntre dirigeants et
dirigés, lïmportance du débat oral avant la prise de
décision, 1"importance des discussions de l'agora"
Finley donne à ce propos l"exemple d "Athè nes à la
veille du départ de 1" expéditio n de Sicile, et cite
Thucydide (VI. 24" 3-4) pour illustrer cette participation de tous aux débats politiques: « Tous furent pris
d'une même fureur de partir, les hommes d"âge à la
pensée qu "o u bien l'on soumettrait la contrée pour
laquelle o n s"embarq uait, ou que, du moins, de puissantes forces militaires ne couraient auc un risque ; la
jeunesse en âge de servir, dans le désir d"aller au loin
voir du pays et apprendre, la confiance s'y joignant
d" en reve nir sain et sauf : la grande masse des soldats"
dans l"espoir de rapporter, sur le moment, de l'argent,
et d'acq uérir de surcroît une puissance qui leur garantirait des soldes indéfinies" Cet engouement du grand
nombre faisait que ceux-là même qui n"approuvaient
pas craignaient" en votant contre, de passer pour mauvais patriotes et se tenaient cois » {trad" J" de
DEMOCRATIE
203
Romilly). Thucydide avait préalablement fait parler
Nicias et Alcibiade devam I"assemblée, le premier
hostile à I"expédition, le second favorable. Le démos
suivit Alcibiade, mais désigna aussi Nicias pour
partager avec lui le commandement de l' expédition. Il
ya là une indication particulièrement intéressante, car
elle démontre que la violence des antagonismes n' entraînait pas le désordre permanent. La décision une
fois prise. la minorité s "inclinait devant le vote de la
majorité. Ce qui n "interdisait pas la remise en question d'une décision. Mais là encore, cette remise en
question n' était pas arbitraire: elle résultait d'une disposition légale, la graphè para nomôn. par laquelle le
démos avait la possibilité de reconsidérer une décision
prise par lui-même. Il faut donc se garder de tenir la
démocratie athénienne pour cette anarchie institutionnalisée dénoncée par ses adversaires. Le fait qu' elle
ait fonctionné, et bien fonctionné , pendant près de
deux siècles, est à cet égard suffisamment éloquent.
Cela dit, il serait absurde de ne voir de la démocratie
athénienne que ses aspects positifs, et surtout de la
présenter comme un modèle. Et il serait vain d"ignorer aussi une évolution au cours des deux siècles de
son histoire, les conséquences en particulier quO eurent
sur son fonctionnement la guerre du Péloponnèse et
les deux révolutions oligarchiques de la fin du V siècle : aggravation des antagonismes sociaux. liés aux
difficultés financières, elles-mêmes conséquences de
DEMOCRATIE
204
la perte de l 'empire : professionnalisation accrue de la
vie politique se traduisant en particulier par la séparation croissante des fonctions militaires et des fonctions civiles, désintérêt d ' une partie du démos pour les
luites souvent stéri les de l'assemblée, Il faut certes se
garder d'exagérer l'importance de celte .. crise ,. de la
démocratie athénienne au TV' siècle, Elle a continué à
fo nctionner pendant près d'un siècle, Mais on ne
saurait non plus la nier, et qu 'elle explique en partie
l'échec d'Athènes devant la menace macédonienne,
La rupture du consensus que l'empire ava it su créer
au V' s iècle témoignait aussi du lien étroit qui pendant
la période d'apogée de la démocratie athénienne avait
existé entre le régime et l'hégémo nie exercée par la
cité sur le monde égéen,
111
CI, Mossé, La fin de la démocralle athénienne, Paris,
PUF, 1962, Histoire d 'une démocralle " Athènes, Paris,
Seuil. 1971.
M, -1. Finley, Démocralle anllque et démocralle moderne,
précédé de Tradition de la démocratie grecque par P.
Vidal-Naquet. Paris. PayOl, 1976.
L 'Invenllon de la pollllque, Paris. Flammarion. 1985.
Pour une image négative de la démocratie athénienne. ].
de Romilly. ProbMmes de la démocralle grecque. Paris.
Hermann, 1975.
r:ir Alcibiade. Chios. Cité. Démos. Ecclesia. Egalité. Esclavage. Evergétisme. Graphè para nomôn. Im périalisme.
Liberté. Marine. Métèques. Misthophorie. Oligarchie.
DfMOS
205
Oligarque (Le Vieil). Ostracisme. Péloponnèse (Guerre
du). Pénètes. Périclès. Platon. Polis. Politès. Protagoras.
Socrate. Solon. Sykophantes. lbeorikon. Thésée. Trente.
Tyrannie.
DÉMOS
C·est là un tenne ambigu. car il désigne en fait deux
ensembles différents. D·une part. et singulièrement
dans les intitulés de décrelS, il désigne la totalité des
membres de la communauté civique, qui, réunis en
assemblée, détiennent dans une démocratie le pouvoir
de décision. Mais d·autre part, dans les textes littéraires ou dans les discours des orateurs, le mot démos
se charge d'un contenu différent: c· est la masse du
périr peuple, opposé aux riches (plousioi). aux puissants (dunalOi). aux ge ns en vue (gnôrimoi). etc. Le
terme même de démocratie se ressent de cette
ambiguïté, car il peut vouloir dire aussi bien le régime
où la souveraineté appartient à la communauté des
citoyens: que le régime où le pouvoir est aux mains
de la masse des pauvres. À cette première ambiguïté
s 'en aj oute une seconde: quand les auteurs anciens
parlent du démos athénien du ..,. et du TV" siècle, il
s 'agit à n·en pas douter de la gra nde masse des
citoye ns de la ville et de la campagne. mais quand ils
évoquent le démos du temps de Solon ou de Pisistrate.
DfMOS
206
ou quand il est question dans les poèmes homériques
du démosd'Ithaque ou de Schérie, nous ne savons pas
exactement ce que recouvre ce terme. Certes, dans
l'un et l'autre cas. il s 'agit toujours des petites gens
opposés aux puissants. Mais nous ignorons quelles
catégories sociales sont incluses dans ce démos " les
Ihètes et les artisans en particulier en font-ils partie,
ou bien seuls ceux qui vivent des produits de la terre,
ou encore ceux qui ont la capacité hoplitique ? À
toutes ces questions. il est pratiquement impossible de
répondre. Tout au plus doit-on admettre comme vraisemblable que dans nombre de cités grecques le
démos ne se composait que des seuls propriétaires
fonciers. qu 'à Athènes et peut-être dans d 'autres cités
il englobail également les artisans et les petits commerçants. au moins à partir de la fin du vI" siècle. Et
que, dans les cités démocratiques, il avait conquis le
pouvoir de décision.
[)
C. Leduc, La ConsllwlIon d'Athènes allrJbuée a
Xénophon, Paris. 1976, pp. 119 sqq.
r:ir Démocratie. Ecdesia. Ostracisme. Pénètes. Politès. Sololl.
Theorikon. Tyrannie.