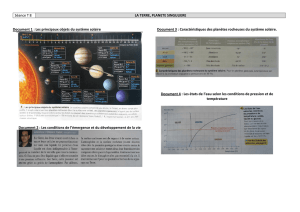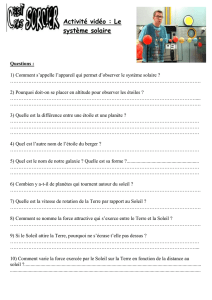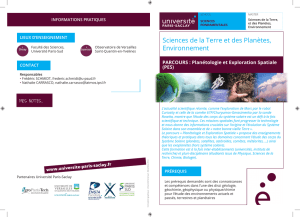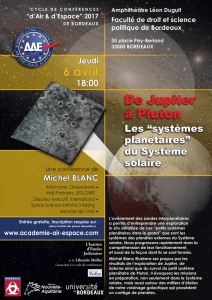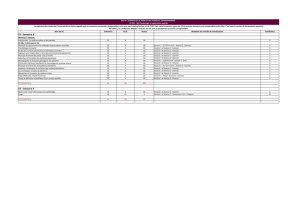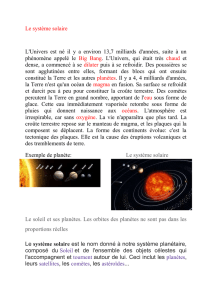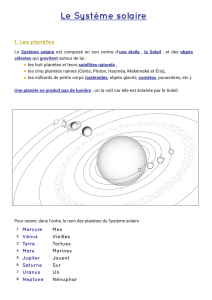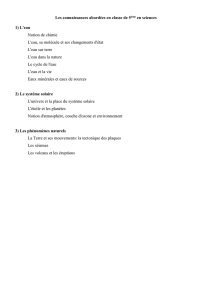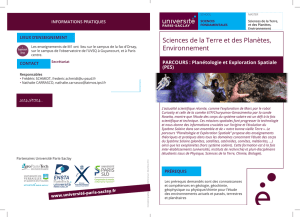N°1 : Juin 2004 - Université Paul Sabatier

dOSSIER
>>> Le système solaire (Illustration NASA)
Planétologie
La vie dans le
système solaire
et au delà :
C’est le thème d’une nouvelle
discipline, l’exobiologie (ou
astrobiologie), qui s’interroge
sur l’origine de la Vie sur Terre
mais aussi sur la possibilité
de son émergence en
d’autres lieux.
Dans le système solaire,
ce questionnement amène
sur la piste des noyaux
cométaires, composés en partie
sans doute de matière organique
complexe synthétisée dans le
milieu interstellaire,
qui ont pu « ensemencer »
les environnements planétaires
primitifs au début de l’histoire
du système solaire. Il nous dirige
à nouveau vers Mars, qui a
peut-être offert au début de son
histoire des conditions propices
à l’émergence de la Vie et,
plus loin, vers Europe et Titan,
satellites des planètes géantes.
Contact : [email protected]
>>> Michel BLANC, astronome de l’OMP/UPS,
planétologue au CESR.
page 4 Paul Sabatier - Le magazine scientifique - numéro 1
Les systèmes
planétaires :
origine, formation,
évolution
Comment ont-ils émergé à partir
des nuages moléculaires géants
du milieu interstellaire ?
Comment se sont-ils structurés
en objets de types différents
(planètes géantes, planètes
telluriques, petits corps, anneaux
de gaz et de poussières, etc.) ?
L’objet de référence de cette
réflexion est bien sûr notre
système solaire, dont le scénario
de formation est progressivement
mieux cerné. Est-il un
« cas moyen » de système
planétaire, ou au contraire une
singularité ? Les petits corps
du système solaire, comètes et
astéroïdes, sont des témoins
précieux des conditions qui
régnaient à l’époque de la
formation des planètes, tout
comme les systèmes
des planètes géantes.
Les planètes
telluriques :
formation et évolution
Les planètes du système solaire
interne (Mercure, Vénus et Mars)
sont des objets « rocheux »
comme la Terre, formés à partir
des matériaux les plus
réfractaires de la nébuleuse
pré-solaire et de compositions
chimiques initiales relativement
proches. Comment ont-elles
suivi des évolutions divergentes
pour aboutir aux planètes
si différentes que nous observons
aujourd’hui ?
C’est le questionnement central
de la « planétologie comparée »,
qui fait appel à l’ensemble
des sciences de la Terre et
de l’environnement. L’objet de
référence de cette réflexion, parce
que le plus proche de la Terre et
sans nul doute le plus fascinant,
est Mars, cible d’un vaste
programme d’exploration
impliquant les principales
agences spatiales.
Les enjeux
de la planétologie
La planétologie est un champ de recherche interdisciplinaire
en pleine expansion. Le développement des moyens spatiaux
à la fin du XXesiècle a permis d’envoyer des sondes
interplanétaires vers presque toutes les planètes du système
solaire, de survoler comètes et astéroïdes et d’approcher
les frontières qui séparent le système solaire du milieu
interstellaire. Au tournant du siècle, le champ d’action de la
planétologie s’est encore élargi, avec la découverte des
premières planètes extra-solaires : on en connaît plus de cent
vingt aujourd’hui, réparties dans un grand nombre de systèmes
planétaires.
La planétologie peut donc être définie aujourd’hui, comme
l’étude des systèmes planétaires, des objets qui les composent,
de leur origine, de leur formation, de leur évolution. On peut
distinguer plusieurs grands axes de recherche :

Planétologie
Contact : sylvestre.maurice@cesr.fr
>>> Sylvestre MAURICE, Astronome-adjoint
à l’OMP/UPS, planétologue au CESR
dOSSIER
Les recherches
en planétologie
à l’UPS
L’étude des corps du Système Solaire repose sur les moyens
d’observation à distance des astronomes, mais aussi sur les techniques
d’observation in situ de la physique des plasmas et des sciences
de la Terre. Ainsi pour le succès d’un projet de planétologie, il faut
rassembler un ensemble d’expertises scientifiques, les « savoirs »,
et une variété de compétences techniques, les « savoir-faire »,
qui peuvent avoir des origines bien différentes.
Les articles qui suivent présentent les « savoirs » propres à l’UPS,
qu’ils viennent de l’astronomie ou des sciences de la Terre. Le but
n’est pas de vouloir tout faire mais de se concentrer sur certaines
thématiques qui sont nées d’opportunités et d’une politique de
formation et de recrutement. Quant aux « savoir-faire », à Toulouse
comme ailleurs, il est souhaitable de développer l’ensemble des
compétences techniques qui permettent d’être des acteurs de premier
plan d’un grand projet de planétologie.
Ces différentes contributions sont menées soit simultanément, soit
séquentiellement. L’interprétation scientifique est la finalité naturelle
de tous les efforts. L’ensemble des activités s’articule le plus souvent
autour d’un projet spatial des agences nationales et internationales
(CNES, ESA, NASA, etc.).
page 5
Le potentiel de l’UPS
A Toulouse, les projets de planétologie résultent de nombreuses thématiques : Géophysique planétaire interne
(géodésie, convection, oscillations des géantes) ; Surfaces planétaires (composition chimique et minéralogique,
géomorphologie et photométrie, pétrographie, champs magnétiques, analyses en laboratoire) ; Géophysique
planétaire externe (atmosphères denses, ionosphères, magnétosphères, physique des plasmas, expériences de
laboratoire) ; Origines (enveloppes cométaires, glaces, gravité des astéroïdes, exo-planètes).
Ces activités sont portées par une trentaine de chercheurs (pour un équivalent-plein-temps ~15)
et une vingtaine d’ingénieurs et techniciens (pour un équivalent-plein-temps ~10).
Pour favoriser les échanges et faciliter l’émergence de projets communs et l’animation transverse, quatre
laboratoires : LA2T (UMR UPS/CNRS), CESR (UMR UPS/CNRS), LMTG (UMR UPS/CNRS/IRD) et LDTP (UMR
UPS/CNRS), ont créé le Pôle de Planétologie de l’OMP (Observatoire Midi-Pyrénées). Il est doté de moyens
particuliers (PPF, actions spécifiques des conseils scientifiques de l’OMP et de l’Université) qui lui permettent
de cibler des actions scientifiques et de financer certains équipements.
Cette année l’accent est mis sur Mars pour l’étude multi-satellite/multi-instrument de sa surface et
de son atmosphère, mais aussi sur la Lune.
>>> Le Pôle de planétologie de l’UPS

dOSSIER
Planétologie
Dans le cas où le champ
magnétique de la planète dévie
le vent solaire, une magnétosphère
se crée. Dans cette immense cavi-
té (10 à 100 fois le rayon
de la planète) se développent des
processus complexes de création,
de transport et de perte de
plasma. Ainsi autour des
planètes magnétisées (Mercure,
Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune), plusieurs générations
de satellites étudient les
environnements de particules
chargées et de champ
magnétique. Les chercheurs du
CESR ont réalisé récemment un
instrument pour CLUSTER, une
mission de l’ESA à quatre
satellites identiques séparés
par des distances ajustables, qui
permet pour la première fois de
séparer les variations spatiales et
temporelles. Les magnétosphères
des planètes géantes sont encore
plus riches à étudier. Voyager
1 et 2 nous ont donné une
première impression de ces
environnements. Le satellite
Galileo de la NASA est resté
presque 10 ans autour de
Jupiter pour en savoir plus.
Les chercheurs toulousains ont
longuement étudié les données
de ces trois sondes. Forts de cette
expérience, ils participent à la
science de 5 sur 12 instruments
de la mission Cassini (voir
encadré) qui explorera pendant
4 ans le système de Saturne.
Une atmosphère est un obstacle
moins solide au vent solaire.
La frontière qui dévie le vent
solaire est dans l’atmosphère elle-
même, au niveau de la partie
ionisée appelée ionosphère.
Ce cas donne lieu à une
structure resserrée autour de l’ob-
stacle, mais qui s’étend très loin
dans la direction anti-
solaire. On parle dans le cas bien
connu des comètes de queue de
Contact : henri.reme@cesr.fr
plasma et de champ magnétique.
Le passage de Halley en 1986 fut
l’occasion de détailler cette inter-
action et de mettre en évidence
ses différentes frontières : choc,
frontière d’empilement magné-
tique, ionopause grâce à l’expé-
rience du CESR à bord de la
sonde. Cette expérience a aussi
permis de découvrir que des
molécules organiques complexes
existaient déjà dans le milieu
interstellaire lorsque les comètes
se sont formées il y a
4,5 milliards d’années.
La mission Rosetta de l’ESA
vient d’être lancée vers une
comète.
Il lui faudra une
dizaine d’années pour arriver
à bon port et produire
de nouveaux résultats.
Par ailleurs l’expérience MAG/ER
embarquée sur le
satellite Mars Global Surveyor
a permis de montrer que
la planète rouge, non
globalement magnétisée,
avait une interaction
avec le vent solaire comparable
à une comète.
page 6 Paul Sabatier - Le magazine scientifique - numéro 1
>>> Henri REME, Professeur à l’UPS,
planétologue au CESR
>>> Instrument plasma réalisé au CESR
pour les quatre satellites CLUSTER.
CASSINI est la mission la plus ambitieuse jamais entreprise
pour l’exploration du système de Saturne,
sous la direction de deux agences spatiales, l’ESA et la NASA. Les objectifs scientifiques du
projet sont nombreux : l’étude in situ de la magnétosphère de Saturne, le sondage à distance
de son atmosphère et l’exploration de ses anneaux et de ses satellites de glace. Le plus gros de
ses satellites, Titan, est un objet fascinant car il possède une atmosphère dense qui nous
cache sa surface. L’orbiteur Cassini le survolera plus de 40 fois. Grâce à son radar, nous sau-
rons ce qu’il y a sous les nuages ; on imagine que la surface est en partie couverte d’un océan
d’hydrocarbures... De son côté, la sonde de descente Huygens aura à peine 3 heures de mesu-
re pour tout nous apprendre de cette atmosphère qui ressemble à celle de la Terre à ses
débuts. Parti en 1997, le couple Cassini-Huygens est en vue de Saturne. La mise en orbite
aura lieu en juin 2004 et la descente de Huygens à la surface de Titan en janvier 2005. Puis
l’orbiteur Cassini restera au moins 4 ans autour de Saturne.
Mission Cassini/Huygens
Environnements
Planétaires
La couronne du Soleil s’étend dans tout le Système Solaire sous
forme d’un flux de particules appelé vent solaire. L’interaction
du vent solaire avec les planètes et les petits corps est un
extraordinaire laboratoire de physique des plasmas. Son étude
représente une thématique prioritaire de la planétologie
toulousaine.
>>> La satellite Cassini/Huygens
à l’approche de Saturne (vue d’artiste, NASA)

dOSSIER Planétologie
>>> Régions géochimiquement et
minéralogiquement homogènes de la Lune,
obtenues à partir des données de Lunar Prospector
et Clementine (résultats du LA2T et du LDTP)
Surfaces
planétaires
L’étude des surfaces est une clef en planétologie
pour placer des contraintes sur les théories de
formation et d’évolution des planètes et de leurs
satellites. En effet, les surfaces intègrent au cours du temps l’histoire planétaire et les interactions
avec l’environnement. La connaissance récente des surfaces de la Lune, Mars, Vénus, Mercure, et
de quelques satellites des planètes géantes, quoique fragmentaire, progresse très rapidement et
devrait s’accroître nettement dans la décennie à venir, comme le montrent les observations
orbitales actuelles de Mars. L’image acquise à la fin du XXème siècle est que si la majorité des
processus connus sur Terre (volcanisme, tectonique, cratérisation, érosion, écoulements…) sont
partagés par les planètes telluriques, ils le sont à des degrés divers et conduisent à des résultats
très différents car les environnements (atmosphère, hydrosphère, champ magnétique…) et les
caractéristiques de ces planètes (taille, source d’énergie interne, distance au soleil, obliquité…)
diffèrent. La confrontation des situations observées conduit à une démarche comparée
extrêmement riche qui permet de généraliser la compréhension des processus et in fine de
relativiser le cas terrestre.
Ces dernières années, le Pôle de
Planétologie de l’OMP/UPS a été
étroitement associé à l’étude
détaillée de la lune par les mis-
sions américaines Clémentine et
Lunar Prospector, en utilisant l’i-
magerie spectrale et la géochimie
orbitale pour documenter la
période la plus ancienne de l’his-
toire géologique des corps plané-
taires, comprendre les processus
de fabrication d’une croûte pla-
nétaire et le rôle des gros
impacts météoritiques. Les équi-
pes du LDTP et du CESR sont
maintenant engagées sur la mis-
sion européenne Smart-1, déjà
en route vers la Lune. Dans le
même temps, les équipes du Pôle
de Planétologie participent à
l’exploration de Mars. Elles sont
présentes sur tous les fronts : à
ce jour, 3 orbiteurs (Mars Global
Surveyor et Mars Odyssey de la
NASA, Mars Express de l’ESA)
et 2 atterrisseurs mobiles
américains (Spirit et
Opportunity) collectent
des données remarquables de
physico-chimie, de minéralogie,
de photogéologie et de
photométrie. Des résultats
spectaculaires ont été obtenus :
découverte d’un champ magné-
tique rémanent, cartographie
d’énormes concentrations d’hy-
drogène traceur de glace d’eau,
etc. Les objectifs de ces missions
sont de découvrir la paléoclima-
tologie martienne et d’aborder de
façon comparée le rôle fonda-
mental de l’hydrosphère et de la
cryosphère d’une planète dans
son évolution géologique et
vis-à-vis de l’émergence
d’une biosphère.
L’exploration des surfaces
planétaires est toujours
spectaculaire. Les images à haute
résolution de la glace d’Europe
autour de Jupiter, des volcans de
page 7
Vénus, ou de lits fluviaux
asséchés sur Mars
interpellent le scientifique et
font rêver tous les publics.
Contact : duston@cesr.fr et
>>> Lionel DUSTON, Directeur de recherche CNRS,
planétologie au CESR
>>> Patrick PINET, directeur de recherche CNRS,
planétologue au LDTP
>>> Découverte d’eau au pôle de la Lune,
obtenue par la mission Lunar Prospector et
la participation du LA2T.
>>> Carte du champ magnétique à la surface
de Mars obtenue par la mission Global Surveyor
avec la participation du CESR.

dOSSIER
Planétologie
Les météorites
Pendant longtemps considérés
comme des objets exotiques, les
trois dernières décennies ont vu
un développement important de
l’étude des météorites en
laboratoire. Des analyses
pétrologiques, minéralogiques et
géochimiques très poussées ont
fait avancer notre compréhension
de la formation du Système
Solaire et ont même permis
de déterminer son âge de
4,56 milliards d’années. On a
appris à les classer d’après leur
appartenance à des corps parents
hypothétiques, notamment grâce
à la mesure de leur composition
isotopique en oxygène : la
confrontation des études en
laboratoire avec les résultats des
mission humaines sur la Lune et
des mission robotiques sur Mars
nous ont appris que parmi les
météorites recueillies sur le sol
terrestre, se trouvaient des pierres
de Lune et très probablement des
roches martiennes!
Parmi les nombreuses analyses
de météorites menées au LMTG,
la composition isotopique du fer
par spectrométrie de masse à
source à plasma a montré que la
Lune avait une composition
isotopique de fer plus lourde que
la Terre. Pour expliquer cette
observation il faut imaginer que
la Lune est passée par une étape
partiellement fondue, voire
gazeuse, au cours de son
histoire. Seul un phénomène
cataclysmique, comme la
collision entre deux planètes,
peut fournir l’énergie nécessaire
à la vaporisation partielle d’une
planète. Ces résultats isotopiques
sur le fer étayent donc l’idée que
la Lune s’est formée à la suite
d’un extraordinaire impact
d’une planète sur la Terre !
Contact :
Franck POITRASSON,
Chargé
de recherche CNRS au LMTG
franc[email protected]
>>> Michel FESTOU, directeur de recherche CNRS,
planétologue au LA2T
page 8 Paul Sabatier - Le magazine scientifique - numéro 1
Petits corps et
origine du Système
Solaire
Les systèmes planétaires se forment à partir de la contraction
d’un disque de gaz et de poussières autour d’une étoile jeune.
Au centre du disque, où la température est élevée, les grains
s’agglomèrent et forment des « planètésimales ». Au bout de
quelques millions d’années, ces objets ont atteint des centaines
de kilomètres de diamètre. C’est à partir de leurs collisions que
les planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre, Mars) se sont
formées. A l’extérieur du disque, comme il fait beaucoup plus
froid, l’eau se condense et enrichie les planètésimales en glace.
C’est à partir d’elles que se sont formées les planètes géantes
(Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune).
>>> Comète LINEAR observée par le télescope spatial Hubble.
Le noyau de la comète s'est fragmenté en plusieurs morceaux.
(Space Telescope Institute).
Dès que Jupiter s’est formée, la
planète qui aurait dû se former
entre les orbites de Mars et de
Jupiter n’a pu s’agglomérer car
les perturbations de Jupiter
empêchaient ce processus d’aller
à son terme. C’est ainsi que
sont nés les astéroïdes. Enfin,
au delà de l’orbite de Neptune,
la densité de matière est
insuffisante et les objets qui se
forment sont faits de glaces et
de roches. Ce sont
principalement les comètes et
des milliers d’objets « trans-
neptuniens » qu’on commence
à découvrir.
L’étude des petits corps
(astéroïdes, comètes, trans-
neptuniens) permet donc de
comprendre l’origine du Système
Solaire il y a 4,56 milliards
d’années. L’OMP/UPS participe
au développement de cette
thématique par divers moyens :
spectroscopie des petits corps
(LA2T), structure interne des
astéroïdes (LDTP), observations
télescopiques des comètes (LA2T)
et analyses in situ des chevelures
cométaires par notre
participation aux sondes Giotto
(CESR) et Rosetta (CESR, LA2T,
LDTP).
Contact :
 6
6
1
/
6
100%