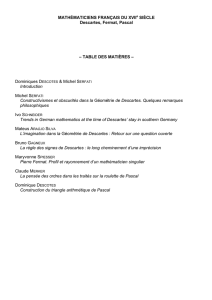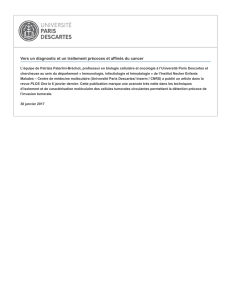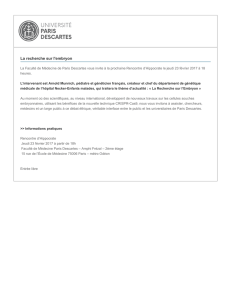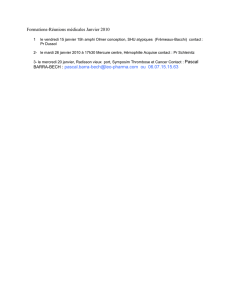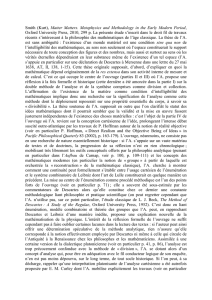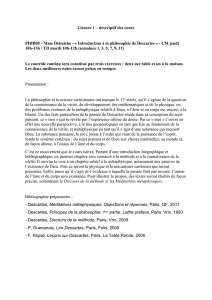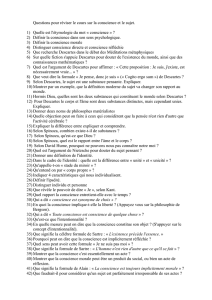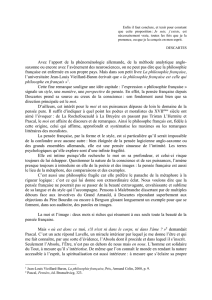LE COUPLE DESCARTES PASCAL Il importe, de temps à autre, de

LE COUPLE DESCARTES PASCAL
Il importe, de temps à autre, de remonter aux sources et de s'abreuver à
leurs eaux. Pour un philosophe les sources sont nombreuses sur le chemin
qui va jusqu'à Aristote et Platon. S'il est de culture française, il trouve
nécessairement sur sa route deux philosophes du XVIIe siècle qui font
figure de grands ancêtres : Descartes et Pascal. Ce sont non seulement
deux des plus grands mathématiciens de tous les temps, deux hommes de
science prestigieux, mais aussi deux penseurs dont le rayonnement a
traversé et éclairé trois siècles. Notre intention ici n'est pas de présenter
leur pensée, mais de les comparer et de faire voir qu'ils se complètent,
forment un couple, et qu'on devrait toujours les étudier ensemble.
Il y a quelque chose de royal chez Descartes. Voilà un esprit qui se maitrise
parfaitement et qui, même à l'aide d'idées qui sont devenues fausses par
la suite, domine tout à fait les sujets dont il traite. Du moins c'est
l'impression qu'il nous donne. L'assurance qu'il possède devrait faire
l'envie de tous les philosophes actuels. Mais elle n'est plus possible : la
raison a trop perdu de plumes depuis ce temps. Ce ton de Descartes est
beau, même s'il implique une certaine naïveté et une certaine injustice.
Naïveté de ne pas soupçonner que ses idées pourraient un jour être
réfutées, et injustice de croire qu'il en est l'auteur ou l'inventeur, même
lorsque, manifestement, il n'est pas le premier à penser ce qu'il pense.
Le fait est que Descartes entend recommencer à zéro et mettre toute la
philosophie, ainsi que la pyramide des sciences empiriques, sur une base
nouvelle. Et il y parvient assez bien pour acquérir une incontestable
originalité, mais tout de même pas une originalité complète : son cogito
se trouve déjà chez saint Augustin, sa principale preuve de l'existence de
Dieu chez saint Anselme et son idée d'une science universelle, chez
Raymond Lulle. Néanmoins, Descartes reste un des penseurs les plus
originaux qui soient. Si nous sommes parfois portés à en douter, c'est
parce qu'il est en même temps d'une clarté et d'une simplicité
remarquables.
Descartes doute, mais au point de départ seulement et pour dégager les
bases solides de la pensée. Ensuite il procède avec une tranquille
assurance. Pascal, lui, au contraire croit, et ce qui est plus grave, cherche
à faire croire. Pas en n'importe quoi, il faut dire, mais en la religion

chrétienne, en l'ensemble des dogmes et des enseignements de l'Église,
qui lui apparaissent capables d'élever l'homme au-dessus de la nature.
Autre façon d'acquérir cette maitrise de la nature que Descartes, à la suite
de Bacon, propose comme le nouvel idéal de l'homme moderne. Maitrise
qui ne se ferait pas par science, technique, raison ou calcul, mais par foi
et charité. Or, nous pourrions sans doute reprocher à Pascal de ne pas
trop regarder aux moyens, lorsqu'il s'agit de croire et surtout de faire
croire. Car lui aussi se débarrasse assez rapidement du doute et,
contrairement à Descartes qui se meut ensuite avec calme et sérénité, lui
se meut avec ardeur, fougue, zèle enflammé.
Descartes a toujours fui autant que possible les querelles de théologiens,
qui, à cette époque, étaient particulièrement virulentes et pouvaient
conduire un homme, parfois au bucher, souvent en prison. C'est pourquoi,
parait-il, il décida de s'installer en Hollande où, du fait qu'il était étranger,
il jouissait d'une plus grande liberté. Ainsi il arrive que le plus grand
philosophe français soit non seulement mort à Stockholm, auprès d'une
reine à qui il donnait des leçons de philosophie très tôt le matin, mais a
vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger, ce qui est tout de même
paradoxal.
Pascal, au contraire, n'a pas fui les querelles de théologiens. Après sa
conversion, il plongea même avec toutes ses forces dans le différend qui
opposait les jansénistes à l’Église officielle. Pendant un an et demi, sous
un pseudonyme, il va publier une série de pamphlets virulents et
étincelants, qui s’en prenaient principalement aux jésuites, adversaires
des jansénistes. Ce qui donna les Provinciales. Les jésuites furent pris à
partie comme représentants une conception molle et libérale à l’excès de
la morale et de la religion chrétienne, ce qui était injuste. Ces « lettres »
secouèrent la France littéralement, et firent rire, non seulement les
jansénistes qui triomphaient, mais la population. Ce choix idéologique
était tout de même malheureux, et Pascal s’en rendit compte à la fin. Tout
dans ce qu’il écrivit n’était pas honnête et, en pourfendant les autorités
en place, il ouvrait une brèche dans laquelle bientôt, non des rigoristes,
mais des libertins allaient entrer.
Comme écrivain, Pascal se tient devant Descartes, dont la phrase est
encore toute latine. Comme chrétien par contre, ou plus généralement
comme croyant, Descartes à notre avis passe devant. Entendons qu'il est
nettement plus moderne. La foi de Pascal ne semble pas s'accommoder

de l'incrédulité des autres, tandis que celle de Descartes semble tout
imprégnée de tolérance. Est-elle moins pure pour cela ? À la lecture du
récit de sa mort, écrit par son ami Chanut, nous découvrons que sa foi
était, à ce moment-là en tout cas, intense et sincère. Par contre, à voir ce
qu’il advint du mouvement janséniste et du tort peut-être irréparable que
ses Provinciales allaient causer à la Société de Jésus et l’Église de France,
celle de Pascal, à ce moment-là au moins, était obnubilée et même
pervertie.
Si par sa passion pour les questions théologiques et morales, Pascal est un
homme du Moyen Âge, par certains aspects de son œuvre scientifique il
est nettement plus moderne que Descartes. Dans sa façon de procéder
tout d'abord, il se montre véritablement empiriste, opposé aux systèmes
et aux vérités à priori. Dans son gout pour la technique ensuite : c'est lui
qui fabriqua et commercialisa, sous le nom de Pascaline, la première
véritable machine à calculer, capable de faire les quatre opérations
fondamentales. Et quand on compare le rapport qui existe entre l'œuvre
mathématique de chacun et sa représentation générale du monde, on
voit que Pascal est plus près de nous que Descartes.
En effet, la géométrie cartésienne, qui permet de donner une formulation
algébrique à toute espèce de figures et de mouvements, en les rapportant
à un système d'axes, conduit à un système du monde, grandiose peut-
être, mais terriblement réducteur, puisque toute la nature devra selon lui
se ramener en dernier ressort à des figures et à des mouvements. Par
contre, la fondation du calcul des probabilités, qui est l'une des œuvres
les plus importantes de Pascal, a été faite afin de pouvoir trouver un
moyen de faire fortune à la roulette. Ce n'est donc pas tout à fait par
hasard que Pascal demandera à l'incroyant de « parier » sur l'au-delà et
sur la religion : sa représentation du monde et de la vie fait une place au
jeu. Elle est à l'opposé de la grande mécanique cartésienne, laquelle est
depuis longtemps sur le tas de ferraille de l'histoire des idées.
Pascal possède une âme de feu dans un corps malade. Par là il ressemble
à son frère ennemi, Nietzsche. Mais il s'oppose à Descartes, homme fort
qui possédait une bonne santé et dont le premier texte publié fut un
manuel d'escrime. Les deux hommes sont d'une grande hardiesse et ils
sont libres. Ni l'un ni l'autre ne s'est marié, chose plus étonnante chez
Descartes, qui néanmoins fut père d'une petite fille. Ni l'un ni l'autre n'a
été clerc, chose plus étonnante chez Pascal, qui brulait d'un zèle ardent

pour répandre la doctrine du Christ. Ni l'un ni l'autre n'a enseigné dans
l'école, ce qui sans doute les préserva de maints travers qui auraient terni
l'éclat de leur œuvre. Par l'esprit ils sont l'un et l'autre vigoureux et ils ont
du panache.
Mais l'optimisme de l'un contraste avec le pessimisme de l'autre.
Descartes croit en la science, en sa valeur pour ainsi dire absolue, car en
elle et par elle il retrouve la pensée de Dieu, ou du moins une pensée
garantie par Dieu. La science prend ainsi une dimension mystique. La
vérité dont nous faisons l'expérience en elle est du même ordre que celle
dont la Bible nous fait la révélation ; elles ne diffèrent l'une de l'autre que
par les objets sur lesquels elles portent. Aussi le philosophe et l'homme
de science sont-ils intimement unis chez lui, puisque toutes les
connaissances, tant métaphysiques que physiques, se tiennent et peuvent
se déduire les unes des autres. Or cette épistémologie n'est que le reflet
de l'être lui-même, dans lequel tout communique avec tout. Au monde
des idées claires correspond une nature toute limpide, dépourvue de
fantômes, d'esprits, de vertus, de puissances, etc., que l'imagination des
hommes enfante et projette ensuite en elle. Descartes purifie la nature, il
la purge avec son mécanisme, comme il purge l'intelligence avec son
doute méthodique. Il n'y a pas de vide, pas de trou, donc pas de mystère
ni dans l'intelligence qui fonctionne bien ni dans la nature. Tous les maux
qui affectent la pensée naissent de l'imagination, « maitresse d'erreurs et
de faussetés ».
Pour Pascal il y a au contraire du vide dans la nature, et tout d'abord dans
le haut du tube de verre rempli de mercure qu'on retourne dans une cuve
contenant elle aussi du mercure : le métal contenu dans le tube descend
alors dans la cuve, mais jusqu'à un certain point, toujours le même pour
une altitude donnée. Ainsi était découverte la pression atmosphérique,
ou la pesanteur de l'air. Si la nature n'a pas horreur du vide, comme
Descartes le croit, elle n'a pas horreur du mystère non plus, et il y a dans
le monde plus que ce que la raison peut connaitre. Il s'y produit
notamment des miracles, que Dieu accomplit pour manifester sa
puissance. La nature n'est pas une mécanique et devant le « système » de
Descartes, Pascal laisse tomber ce jugement péremptoire : « Inutile,
incertain et pénible », que la postérité ratifiera.
Considérant l'infini des espaces cosmiques nouvellement découverts,
Descartes s'enthousiasme, Pascal lui s'effraie ! Nous ne sommes que des

« roseaux », dit-il, d'une faiblesse extrême, tous remplis de
contradictions. Quelle audace de penser dominer la nature ! La science
qui nous monte l'esprit de cette façon est une puissance tout à fait
dangereuse. L'homme qui lui confie son âme est un insensé. Ce n'est pas
de science que l'homme a besoin, pense Pascal, mais de religion, et plus
précisément du christianisme, qui enseigne l'humilité, la petitesse, la
déchéance de l'homme, sa misère même, tant qu’il ne s’allie pas avec
Jésus pour monter vers Dieu.
Ce n'est pas seulement le monde qui l'effraie, c'est la folie de l'homme qui
croit qu'avec sa raison il est devenu tout-puissant et qu'il peut se passer
de Dieu. Si l'on croit avec Nietzsche que Dieu est mort, dans la culture de
l'Occident au moins, il est à peu près sûr que la chose s'est produite en ce
début du XVIIe siècle et que Pascal est le premier qui en ait eu une claire
conscience. L'arme du crime – la raison – Pascal s'acharne à nous montrer
qu'elle n'est pas la seule ni la plus haute puissance spirituelle en l'homme.
Il y en a une autre qui la surpasse et qu'il appelle le « cœur » ! Il faudra
attendre deux siècles et la révolution romantique pour qu'une telle
théorie trouve l'écho qu'elle méritait.
Pour Descartes l'homme a assurément une âme, il est même le seul être
à en posséder une. Mais que fait cette âme ? Elle pense seulement et
continuellement. Elle est un esprit et sa seule affaire est de connaitre.
Descartes ne se souvient pas, semble-t-il, que les fondements mêmes de
toute sa pensée lui ont été donnés en rêve, dans une sorte d'extase. Pour
lui l'intérieur de l'âme, tout comme l'intérieur du monde, est transparent.
Peut-être est-ce à cause de son influence que la pensée française a mis
tellement de temps à reconnaitre la psychanalyse. Si cette pensée avait
suivi Pascal plutôt, qui a lui aussi connu l’extase – une extase proprement
mystique – qui le détourna de la science, elle y serait arrivée plus
rapidement. L'âme est d'abord pour lui ce qui vit, lutte, souffre, désire,
croit, et de plus, elle est souvent divisée contre elle-même, pleine de ruses
et de mensonges. L'inconscient et le refoulement, il les connaissait bien,
il nous les décrit presque.
Il n'est pas nécessaire d'avoir écrit de nombreux et lourds traités pour
entrer dans l'histoire de la philosophie, il suffit d'avoir découvert et mis
en lumière quelque chose d'essentiel, qui n'a pas été suffisamment
remarqué par les autres penseurs. Pascal est donc un philosophe, même
s'il répudie la philosophie et se présente plutôt comme un apologiste de
 6
6
 7
7
1
/
7
100%