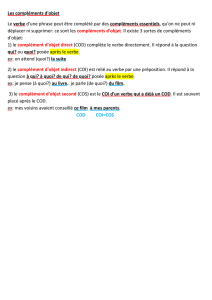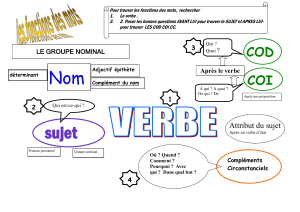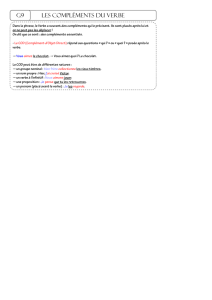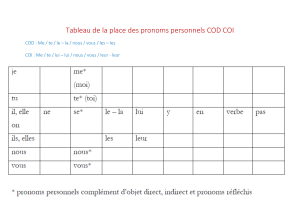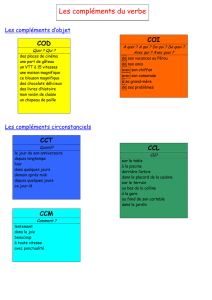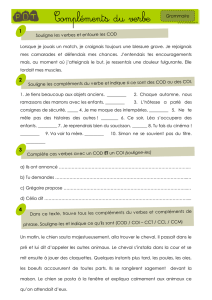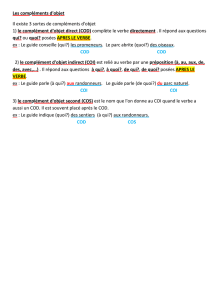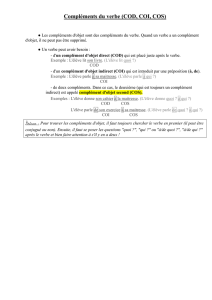Fiches Grammaire française - ALL

Université*Jean‐Monnet* Licence*LEA*/*Arts*Plastiques*2012‐13*
Sem.*1*(automne)*GRAMMAIRE'FRANÇAISE
Les constituants immédiats (CI) de la phrase simple
4. Les compléments du verbe
4.1. Des compléments essentiels
Constituants qui fonctionnent dans la phrase par rapport au verbe (forment avec ce dernier le groupe verbal, GV) :
GN(Ce libraire) GN GV(vend des journaux)GV.
Ces compléments, essentiels au verbe, ne doivent pas être confondus avec :
— les compléments non essentiels / « accessoires » / « de phrase » (circonstanciels) ;
— les compléments de détermination d’un autre constituant (Nom, Adj, Adv).
4.2. Caractéristiques communes à tous les compléments essentiels
Les compléments du verbe sont placés à proximité de celui-ci :
À gauche pour les Pron. sans Prép., y et en :
Vous nous le direz demain. J’y vais. Bernard en vient.
À droite pour les GN, GP, Adv :
elle achète GNun livreGN / parle GPà son voisinGP / habite AdviciAdv.
4.2.1. Complément d’objet (COD, COI)
Le COI se construit avec une préposition (Emma parle à Issam), contrairement au COD (Emma parle le polonais). Un
verbe peut avoir Ø, 1, 2, 3 CO (mais un seul COD).
Pronominalisation
GN COD le, la, les. GN
avec art. indéfini en…
(un(e)). J’ai lu ton roman je
l’ai lu ; Betty a lu un roman
Elle en a lu un.
GN COI prép. +
lui/elle(s)/eux (à + N lui,
leur). Betty reste avec Günther
avec lui. Betty parle à Günther
lui parle.
Suppression
Les CO ne sont pas facile-
ment supprimables (*Nous
accaparons), sauf s’ils sont im-
plicites (Charles mange [un
repas/des aliments /*un porte-
avion…].
Certains CO implicites peu-
vent orienter ou changer le
sens du verbe (Charles boit ;
Yves a changé [les rideaux]).
Commutation
Le CO d’un verbe ((je
préfère…) peut être GN (… la
franchise), pronom (… cela),
infinitif (… continuer comme ça),
subordonnée (… qu’il vienne),
jamais adjectif :
*je préfère importante
utile
comportementaux.
Passivation
En cas de transformation
passive, seul le COD devient
sujet (La ville a subventionné ce
projet Ce projet a été subven-
tionné par la ville). Impossible
avec le COI en français (mais
possible dans certaines lan-
gues : This problem is often
referred to by many.)
Nota bene : La question Quoi ? n’est pas pertinente pour reconnaître un COD (Tu deviens quoi ? attribut du sujet !)
4.2.2. Complément essentiel de lieu
(CEL)
Complément qui indique le lieu avec un verbe de
déplacement (aller, venir, arriver…) ou de situation
dans l’espace (être, se trouver, résider, habiter…). Il n’est
ni déplaçable, ni supprimable (*la poste se trouve,
*Dans la rue vous êtes).
Ne doit pas être confondu avec un circonstanciel
de lieu, qui porte sur la phrase ([CCLÀ la cam-
pagneCCL,]Cunégonde habite CELchez sa grand-mèreCEL
CCLChez sa grand-mèreCCL, elle habite CELà la
campagneCEL). Le CEL ne peut construire une ques-
tion de type Que faites-vous… ? (*Que faites-vous là-
bas ? — Je me trouve/j’habite).
Le CEL est généralement un GP, parfois un GN
(habiter rue Tréfilerie), remplaçable par un adverbe (j’y
habite, tu en viens, elle se trouve là-bas).
4.2.3. Compléments essentiels divers
(mesure, coût…)
Expriment des caractéristiques du sujet (taille,
valeur, odeur…). Placés après les verbes (mesurer,
coûter, sentir, durer) ils n’acceptent pas les tests des
COD auxquels ils ressemblent :
Pronominalisation : J’ai senti (perçu) cette odeur
je l’ai sentie. Cette pièce sent (exhale) le chou-fleur *elle le
sent.
Passivation : Le géomètre a mesuré (estimé) ce champ
ce champ a été estimé par le géomètre ; le géomètre mesure
1m83.
Forme de ces compléments : GN (l’odeur),
mais aussi expressions de mesure (1m83) et adjectifs
adverbiaux (sentir bon, fort) impossibles avec les
COD.
EXERCICE 4
5
10
15
20
25
30
Alexis imagina la fierté de ses parents lorsqu’il leur crierait, dès le
seuil, qu’il était deuxième en composition française. Jamais encore il
n’avait remporté un tel succès dans ses études: quinze sur vingt !
D’habitude, il se contentait de la moyenne. Et soudain, le voici sur
le podium. M. Colinard l’avait félicité devant toute la classe : « Alexis
Krapivine, vous êtes en progrès. Votre copie est même excellente.
S’il n’y avait eu vos défaillances en orthographe, je vous aurais mis
premier ex æquo avec Thierry Gozelin. »
Pour Thierry Gozelin, c’était normal : il écrasait la classe par son
savoir et son intelligence. Toujours le nez dans des livres. Alexis, lui
aussi, aimait lire. Mais pas au point d’oublier les autres plaisirs de
l’existence. Il se remit à courir, dépassa l’église Saint-Pierre, la mairie
et s’arrêta, avenue Sainte-Foy, au pied d’une façade grise, sévère,
anonyme, percée de fenêtres toutes semblables. Dédaignant
l’ascenseur, il gravit trois étages d’un seul élan et se planta, le cœur
battant vite, devant la porte. Une carte de visite était fixée par des
punaises au dessus de la sonnette : Georges Pavlovitch Krapivine.
Alexis reprit sa respiration. Une phrase lui brûlait les lèvres :
« Maman, papa, je suis deuxième en français ! » Il dirait cela en
russe, bien sûr. Ses parents craignaient qu’il n’oubliât sa langue
maternelle, au lycée. Eux-mêmes parlaient le français avec aisance,
mais ils n’avaient jamais pu se corriger de leur accent. Alexis les
reprenait parfois en riant. Pour lui, le russe faisait partie du folklore
familial. On s’en servait à la maison, mais la langue de la vie, la
langue de l’avenir, c’était celle qui bourdonnait dans la rue, au lycée.
Il sonna. Pas de réponse. Deux fois, trois fois. Rien… Heureusement,
en cas d’absence, la clé était sous le paillasson. Il ouvrit la porte, entra
et, aussitôt, une odeur casanière lui remua le cœur. Sans doute ses
parents étaient-ils sortis juste avant le déjeuner pour faire une course
dans le quartier. Ils n’allaient pas tarder à revenir.
Henri Troyat, Aliocha, 1993, Éd. J’ai Lu.
— Indiquez les compléments essentiels du verbe dans tout le texte.
1
/
1
100%