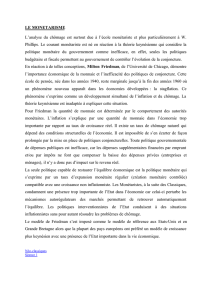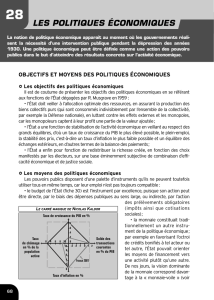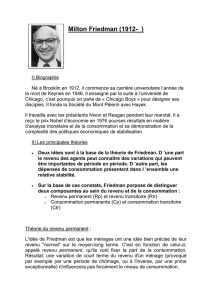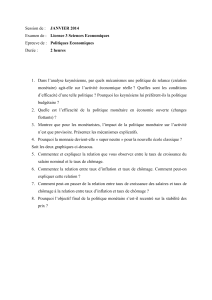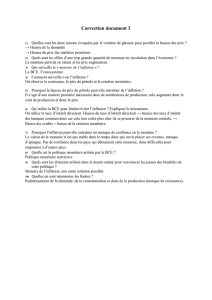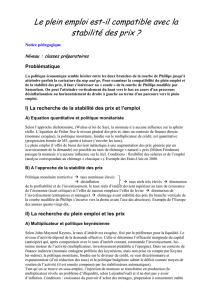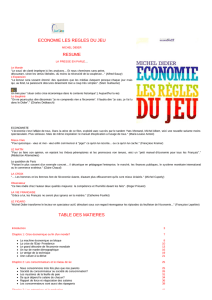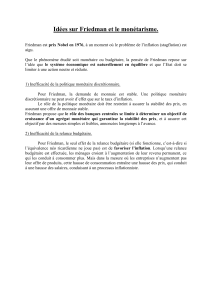Friedman et le monétarisme - Gestion et Finances Publiques

Jean-Marc DANIEL
Professeur d’économie - ESCP-EAP
Friedman et le monétarisme
L’économiste américain MILTON FRIEDMAN nous a quittés l’année der-
nière, le 16 novembre 2006. Il était né à New York le 31 juillet 1912 dans
une famille pauvre venue d’Europe centrale. Sa jeunesse est studieuse,
c’est celle méritante d’un bour-
sier et celle enthousiaste d’un
étudiant qui rêve de devenir
chercheur. Dans un premier
temps, il pense se consacrer à la
physique et aux mathémati-
ques. Mais un de ses professeurs,
l’économiste Arthur Burns,
l’incite à rejoindre l’université de
Chicago pour y étudier l’éco-
nomie plutôt que les sciences
dites dures. Ce passage à Chi-
cago est déterminant. C’est là
qu’il fait son choix de carrière,
c’est aussi là qu’il rencontre
Rose Director, sa future épouse.
Ayant obtenu en 1946 un Ph.D,
il devient professeur d’abord à
New York, puis dans le Minne-
sota, avant son retour à Chi-
cago, où il acquiert la notoriété comme théoricien de référence du moné-
tarisme. Mot récent – il apparaît dans la littérature économique en 1968 –
le terme de monétarisme désigne une idée qui elle n’est pas récente, qui
est même peut-être la plus vieille idée qui ait jamais été formulée en
économie. Cette idée est que toute augmentation de la quantité de
monnaie en circulation se traduit par une augmentation du niveau
général des prix, c’est-à-dire par de l’inflation. Ou, autrement dit, que la
monnaie est un instrument de l’échange qui n’a pas d’influence sur les
mécanismes réels de création de richesse. Ce que les économistes résu-
ment en disant qu’il y a neutralité de la monnaie.
La légitimité de cette affirmation repose sur l’équation quantitative de la
monnaie qui peut s’écrire : MV = pT, où M désigne la quantité de monnaie
en circulation, V la vitesse de circulation de la monnaie, ple niveau
général des prix et T l’ensemble des transactions effectuées.
Mais si de cette équation, certains tirent la conclusion que tout accrois-
sement de la masse monétaire est synonyme de hausse des prix, pour
d’autres, quand M augmente, le volume des transactions peut aussi aug-
menter. D’où les deux positions de principe sur lesquelles se sont construites
les grandes écoles théoriques qui rivalisent dans la formulation des politi-
ques économiques souhaitables. Il y a ceux qui tiennent pour toujours
vérifiée la thèse ancienne selon laquelle une augmentation de la masse
monétaire conduit à une augmentation des prix : ce sont eux qu’on
appelle désormais les monétaristes ; il y a ceux qui en revanche sont per-
suadés qu’une augmentation de M se traduit par une augmentation des
transactions et donc des quantités produites : ce sont les keynésiens.
Le monétarisme est une version modernisée de l’économie classique, qui
se veut à la fois mode de raisonnement théorique et volonté politique
assumée de combattre le keynésianisme.
Milton Friedman fonde la dimension scientifique de sa démarche sur une
analyse historique de l’évolution des prix et la quantité de monnaie en
circulation aux Etats-Unis entre 1867 et 1960, travail colossal qu’il mène en
collaboration avec Anna Schwartz. Des masses de statistiques utilisées et
interprétées, il tire deux conclusions :
– à court terme, la vitesse de circulation de la monnaie est constante ;
– en tout temps et en tout lieu, l’inflation est un phénomène monétaire,
assertion qui va le rendre célèbre.
A partir de là, Friedman développe un arsenal théorique capable à ses
yeux d’anéantir le keynésianisme, et ce sur deux aspects fondamentaux :
l’analyse de l’inflation, du chômage et de leur rapport, d’une part, les
recommandations de politique économique, d’autre part.
La relation entre l’inflation et le chômage constitue ce que les économistes
appellent la courbe de Phillips – du nom de l’économiste néo-zélandais
qui l’a étudiée sur un plan statistique. En pratique, la courbe de Phillips
s’obtient en portant sur un graphique année après année en abscisse le
taux de chômage et en ordonnée le taux d’inflation. On dessine ainsi
empiriquement une courbe décroissante assimilable à une hyperbole,
dont l’interprétation économique simple est de constater que l’inflation et
le chômage évoluent en sens inverse : toute hausse de l’un s’accom-
pagne d’une baisse de l’autre.
Pour les keynésiens, tant que le taux de chômage n’est pas nul, les prix
sont stables et toute politique économique accroissant la masse moné-
taire et donc la demande se traduit par une baisse du chômage. La
courbe de Phillips keynésienne est une droite horizontale. Pour les moné-
taristes, pour augmenter la demande, il faut d’une façon ou d’une autre
injecter de la monnaie dans le circuit économique. Cette demande sup-
plémentaire se heurte aux rigidités de l’organisation de la production. Les
entreprises répondent aux modifications de leur environnement par ce qui
est pour elles le plus facile, à savoir l’augmentation des prix. L’inflation
augmente tandis que le taux de chômage reste constant : la courbe de
Phillips monétariste est une droite verticale.
Cette verticalité signifie simplement qu’une politique économique qui pré-
tend réduire le chômage en augmentant la masse monétaire est vouée
à l’inflation. La bonne politique est de mettre strictement en circulation la
quantité de monnaie qui correspond à l’augmentation des transactions,
augmentation elle-même liée à la dynamique de la croissance due aux
gains de productivité.
Si l’idée que l’on se fait en général de Friedman est celle d’un théoricien
de la politique monétaire, il faut savoir que son combat anti-keynésien a
porté sur tous les aspects de la politique économique. Pour ce qui est de
la politique de change, il rejette la dévaluation dans le cadre d’un système
de changes fixes, dévaluation supposée augmenter les débouchés à
l’exportation et donc la demande globale, avec comme conséquence
un effet de relance. Pour lui, cette vision keynésienne est erronée et les
varia
814

changes fixes sont dépassés : le prix d’une devise relève du marché. Il
préconise l’adoption des changes flottants, devenus la réalité du système
monétaire international depuis 1973.
Quant à la politique budgétaire, il l’analyse à partir de sa théorie du revenu
permanent. Il considère que chaque consommateur inscrit ses dépenses
dans une perspective longue prenant en compte l’évolution probable de
son revenu tout au long de sa vie. Toute mesure de relance par une
augmentation des dépenses publiques ou une baisse des impôts modifie
la situation des revenus à court terme, mais n’affecte pas fondamentale-
ment le revenu permanent. Elle n’a aucun effet durable, si ce n’est souvent
d’endetter l’Etat et de réduire les moyens dont il dispose pour faire fonc-
tionner les services publics.
En fait, ce qu’il reproche à Keynes et à ses disciples, c’est de croire que
l’Etat peut réguler l’économie. Pour lui, l’Etat perturbe le marché et en
réduit l’efficacité. L’efficacité du marché n’est d’ailleurs pas pour
Friedman qu’économique, elle est aussi politique. La liberté d’entre-
prendre conduit inexorablement à la démocratie et au respect des libertés
publiques. A ceux qui ont stigmatisé son soutien au régime de Pinochet
au Chili, il a toujours répondu que le libéralisme économique adopté par
la junte militaire finirait par l’emporter, affirmation que l’histoire a
confirmée.
Friedman a obtenu le prix Nobel en 1976. Cette reconnaissance n’a jamais
entamé son besoin de réfléchir et de débattre. Parmi ses derniers combats,
le plus remarquable fut celui pour la dépénalisation de la drogue. Au nom
de la responsabilité des individus d’abord. Et aussi parce que là encore,
l’Etat, en prétendant sauvegarder par la prohibition la santé publique, nuit
à l’harmonie sociale : il favorise l’apparition d’un gangstérisme extrême-
ment violent gérant le trafic de drogue et les sommes colossales qu’il
génère.
EPISTOLOGIA
par Ludovic ASSIER
La Revue du Trésor a beaucoup de plaisir à présenter le premier ouvrage de notre jeune collègue
Ludovic Assier, ancien élève de l’ENT (2001), chef de service des collectivités locales à la trésorerie
générale de la Sarthe.
Cet essai est un coup de maître, ce roman épistolaire dont le style est agréable, vif et élégant, permet
au lecteur de plonger au cœur d’une intrigue cornélienne mais réaliste.
Epistologia nous fait découvrir le parcours de quelques personnages et leurs ambitions respectives, dans
la « bonne société ». Dans ce milieu, les phrases sont nécessairement sophistiquées puisque la réputation
de la classe en dépend.
Dans ce jeu de correspondances, chaque lecteur et chaque lectrice vont devoir cerner les phrases
sibyllines, les métaphores et les images pour percevoir les pensées profondes et dégager le vrai du faux.
Ludovic Assier nous offre un mélange de sentiments et de politique, dénonçant le Politique qui ne se sert
que lui-même. Il porte un regard lucide sur des êtres, un jugement modéré et réfléchi sur l’organisation
de la société.
Notre ami a un réel talent, une grande maîtrise de l’écri-
ture ; c’est un début prometteur et nous l’encourageons
vivement à persévérer. Un nom à retenir... Il rejoint la
« cohorte » des auteurs qui se sont illustrés au sein des
services du Trésor Public. André GIRAULT.
Editions Paulo-Ramand
28, rue Fouré - 44000 Nantes
Tél. 02 40 20 56 97
100 pages - Prix : 14 hTTC
varia
815
1
/
2
100%