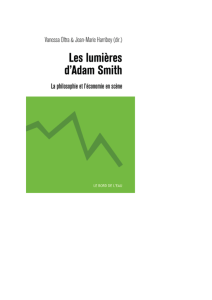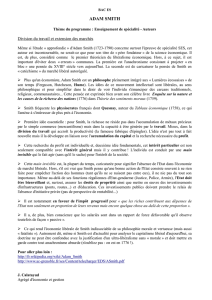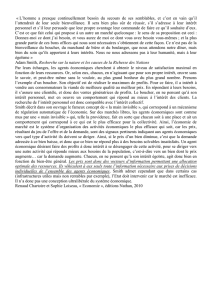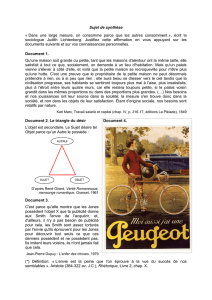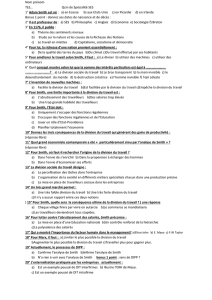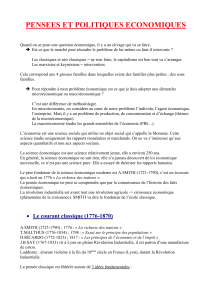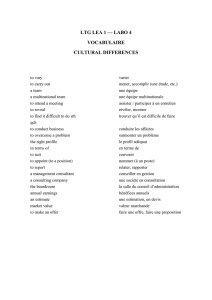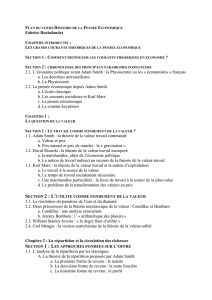Chapitre 2 Division du travail et extension des marchés

—————————————————————————
Magnard – complément au manuel de spécialité (édition 2003)
1
Sciences économiques et
sociales Terminale ES
Chapitre 2 Division du travail et extension des marchés
Adam Smith
[pp. 26-39]
Document A – L’économie est indissociable de la philosophie morale
Ce texte met en évidence une nouvelle lecture de l’analyse d’Adam Smith et peut figurer dans la
1re partie (ou partie I).
L’enrichissement résulte des progrès de la productivité du travail et de la proportion de la
population occupée à des tâches productives. Or c'est l’accumulation du capital (les moyens de
subsistance et les moyens de production) qui permet d'employer toujours plus de personnes à des
tâches productives. Elle est motivée par la recherche du profit des marchands. Le désir
d'enrichissement d'une classe de la société, les marchands, devient compatible avec l'intérêt
général et même y contribue. C'est cette idée qu’illustre « la main invisible », mécanisme par
lequel certains actes individuels contribuent au bien commun indépendamment de toute intention
bienveillante.
La main invisible est souvent interprétée comme étant au fondement du libéralisme
économique : le maximum de liberté accordée aux agents économiques, marchands en particulier,
c'est-à-dire le minimum d’intervention de l’État dans l'économie, conduit au maximum de bien-
être pour tous, grâce à ce mécanisme qualifié alors de « providentiel ».
[…] Avec A. Smith, les désirs d’enrichissement de quelques-uns étant favorables à tous,
il devenait possible d'étudier les mécanismes marchands en ignorant la question morale liée à
l'enrichissement, et de séparer ainsi la science économique de la philosophie morale.
Cette vision de l’histoire de la science économique est désormais battue en brèche par les
historiens de la pensée économique et par des philosophes. Allant à l’encontre d’une telle lecture,
le philosophe Michaël Biziou montre ainsi que l’idée avancée par A. Smith sous la métaphore de
la main invisible n'est pas celle d'une providence bienveillante : les comportements individuels ont
des conséquences inattendues, qui peuvent aussi bien être bénéfiques que nuisibles à la société. Et
l’opinion en réalité négative de A. Smith à l’égard des marchands1 s'explique précisément par le
fait que leurs comportements, s'ils ne sont pas encadrés par l’État, sont globalement nuisibles. Et la
vertu joue un rôle dans la régulation sociale, dont l'analyse ne se réduit pas à celle des mécanismes
marchands.
[…] La Richesse des nations, désormais plus souvent étudiée en relation avec la Théorie
des sentiments moraux […] ne peut plus simplement être considérée comme l’ouvrage qui a rendu
possible l’indépendance de l'économie par rapport à la philosophie morale, en épargnant aux
individus le soin d'être vertueux et assignant à la seule main invisible le rôle d’assurer comme par
miracle la meilleure régulation possible des sociétés marchandes.
D. Picon, « A. Smith, de la morale à l’économie », Sciences Humaines n° 179, février 2007.
1. A. Smith écrit : « Toute proposition d'une loi nouvelle ou d'un règlement de commerce, qui
vient de la part de cette classe de gens, doit toujours être reçue avec la plus grande défiance, et ne
jamais être adoptée qu’après un long et sérieux examen, auquel il faut apporter, je ne dis pas
seulement la plus scrupuleuse, mais la plus soupçonneuse attention. Cette proposition vient d'une
classe de gens dont l'intérêt ne saurait jamais être exactement le même que l'intérêt de la société,
qui ont, en général, intérêt à tromper le public et même à le surcharger et qui, en conséquence, ont
déjà fait l'un et l'autre en beaucoup d'occasions ».
Questions
1. À quel phénomène l’image de la « main invisible » renvoie-t-elle ?
2. Pourquoi la lecture longtemps faite de Smith permet-elle de séparer la science
économique de la philosophie morale ?

—————————————————————————
Magnard – complément au manuel de spécialité (édition 2003)
2
3. Quels sont les effets de la nouvelle lecture de Smith concernant la régulation sociale ?

—————————————————————————
Magnard – complément au manuel de spécialité (édition 2003)
3
Document B – A. Smith est avant tout un philosophe
Ce texte met en évidence une nouvelle lecture de l’analyse d’Adam Smith et peut figurer dans la
1re partie (ou partie I).
A. Smith désigne lui-même sa démarche théorique sous l’appellation de philosophie.
Cette dernière se définit comme une pensée systématique qui tente de relier les divers domaines du
savoir à partir de lois générales. Elle unifie ainsi des disciplines que nous considérons comme
séparées. Les intérêts de A. Smith sont suffisamment larges pour l’amener à écrire, outre son
célèbre ouvrage d'économie, des textes sur l’esthétique, la linguistique, la rhétorique, la théorie de
la connaissance, la morale et la politique, ainsi que le droit. […] En les étudiant, on comprend que
tous ces domaines sont reliés entre eux parce qu'ils sont régis par les lois de ce que A. Smith
nomme la nature humaine. L’économie est donc une partie de la philosophie en ce sens qu'elle
étudie certaines lois de la nature humaine, celles qui permettent la production et l'échange de la
richesse. A.Smith ne pratique pas l'économie pour elle-même, comme une science autonome, mais
pour enrichir une compréhension aussi globale que possible de la nature humaine.
[…] Certes, les économistes qui, aux XIXe et XXe siècles, ont œuvré à constituer
l'économie en science autonome, ont largement puisé dans les concepts élaborés par A. Smith.
Mais cette autonomisation n'est pas un projet de A. Smith lui-même. […] La vérité est que son
économie entretient un rapport indissociable avec la philosophie morale et politique exposée par la
Théorie des sentiments moraux. Ce dernier ouvrage a pour but de montrer que l'ordre social est
d’autant plus stable et harmonieux que les hommes font preuve des trois vertus fondamentales que
sont la prudence, la justice et la bienveillance.
Or l’activité économique n'est pas isolée de l’ordre social, elle s’y inscrit pleinement et
s'appuie donc nécessairement sur les vertus qui le rendent possible. Cela est évident pour les deux
premières vertus : peut-on imaginer une économie où les hommes agissent sans le minimum de
prudence, c'est-à-dire recherchent leur intérêt sans jamais éviter les illusions de la démesure ou les
attraits de la jouissance à court terme ? Peut-on imaginer une économie où les hommes agissent
sans le minimum de justice, c'est-à-dire sans jamais respecter leur parole ou sans s'abstenir de la
propriété d'autrui ? Quant à la bienveillance, A. Smith concède qu’elle est superflue dans les
échanges marchands proprement dits. Mais elle s’avère quand même nécessaire à la conduite de
l’État quand elle prend la forme de l'esprit public, lequel motive l’accomplissement des devoirs
régaliens (sécurité nationale, paix civile, travaux d'utilité publique) indispensables à la bonne
marche de l'économie.
Est-ce à dire que les « agents économiques » doivent être moraux ?
Oui, mais ne tombons pas dans l’angélisme. A. Smith distingue en gros deux degrés de
moralité : un degré idéal, où les hommes pratiquent les vertus à la perfection, et un degré minimal,
où les hommes se permettent de très nombreux écarts. Or ce degré minimal suffit pour que la
société et le marché subsistent, et même prospèrent malgré bien des à-coups et des crises. Comme
nous constatons dans l'expérience commune, cela ne fonctionne pas trop mal si les gens sont
médiocrement prudents, médiocrement justes, et très peu bienveillants. Mais A. Smith ne renonce
jamais à l’idée que la société et le marché pourraient mieux fonctionner si les hommes, qu’il
s'agisse des agents économiques ou de ceux qui sont à la tête de l’État, étaient plus vertueux.
M. Biziou, « A. Smith est avant tout un philosophe », Sciences Humaines n° 179, février 2007.
Questions
1. Quelle est la place de l’économie dans l’analyse de Smith selon l’auteur du document ?
2. Quelles sont les vertus qui fondent un ordre social stable et harmonieux pour A. Smith ?
3. L’économie échappe-t-elle au besoin de ces vertus ?.

—————————————————————————
Magnard – complément au manuel de spécialité (édition 2003)
4
Document C – Une nouvelle division du travail ?
Ce texte permet d’actualiser la partie II.2. en complément du document 14 du manuel.
La thématique de la « participation » ne doit pas faire oublier la persistance d’une
division hiérarchique du travail qui, bien loin d’avoir disparu, reste une condition de l’efficience
productive. Si dans certains secteurs le travail ouvrier s'enrichit, il se rigidifie ailleurs où le modèle
taylorien de division des tâches additionnées reste la règle ; singulièrement dans les petites et
moyennes entreprises. Cette diversité des situations a conduit certains interprètes à proposer le
modèle d'un marché de l’emploi fortement segmenté entre un noyau central, le coeur de
l'entreprise, fait des fonctions les plus rémunératrices et les plus qualifiées (bureau d’études,
d’ingénierie, et certaines activités tertiaires), et un ensemble d’emplois périphériques, les moins
qualifiés, les moins stables, concernant des travailleurs et des tâches dévalorisés. Cette division est
aussi une césure entre l’intérieur de l’entreprise, aux fortes méthodes d’implications, et l’extérieur
représenté par la sous-traitance et les entreprises d’intérim. Césure dont les effets de concurrence
et de hiérarchie se font sentir principalement sur les salariés les moins bien intégrés. La division
s'est en quelque sorte déportée vers l’extérieur de l’entreprise, celle-ci ne cessant de se présenter
sous la figure paradoxale d'une communauté de travail aux exigences unanimement partagées.
On ne saurait donc dissocier la division technique du travail telle qu'elle a été
pensée dès le XVIIIe siècle jusqu’à ses développements contemporains de celle qui joue,
tout au long du XIXe siècle et jusqu’à nos jours, entre les travailleurs eux-mêmes sur le
marché du travail. Pour la période contemporaine, il est sûr que l’une est la condition de
l’autre : la réactivité des entreprises, leur flexibilité d’organisation, l’implication requise
et l’unité revendiquée, reposent en grande partie sur la segmentation d'un marché du
travail où la répartition des compétences, des savoir-faire et des disponibilités autorise les
ajustements les plus drastiques. On sait que la division des tâches dans la manufacture
d’épingles, comme celle des porteurs de fonte de l’industrie taylorienne dépossède les
ouvriers de leurs savoir-faire et de leur métier ; il faut convenir aujourd’hui que la
division des salariés sur le marché du travail en dépossède un grand nombre du minimum
de stabilité que l'entreprise moderne ne réserve qu'à quelques uns.
Sous la direction d’A. Bruno, Introduction aux débats économiques et sociaux contemporains,
Ellipses, 2004.
Questions
1. Expliquez la phrase soulignée.
2. Quelles sont les conséquences sociales pour les salariés, individuellement et
collectivement, de cette nouvelle division du travail ?

—————————————————————————
Magnard – complément au manuel de spécialité (édition 2003)
5
Document D – De Smith à la théorie de la croissance endogène
Ce texte permet d’actualiser la partie II.3. en complément du document 16 du manuel.
La théorie économique avait beaucoup de mal à comprendre la croissance du produit par
tête en longue période, sauf à la rapporter simplement au deus ex machina d’un trend de progrès
technique exogène inexpliqué et tombé du ciel. Les idées d’Adam Smith sur les effets de la
division du travail sur la richesse des nations ont fini par ressurgir : il affirmait en effet que
produire à grande échelle permettait d'accroître la division du travail et donc la productivité, ce
qu’il illustrait en décrivant le fonctionnement d’une manufacture d'épingles.
Une manière moderne de comprendre ces idées est de considérer que l’élargissement de
l’échelle de la production permet d'en réduire le coût, parce qu’elle donnera lieu à des phénomènes
de réorganisation ou d’apprentissage que les économistes appellent des « externalités positives »,
car ils sont bénéfiques sans « rien coûter » à personne. Par exemple, les ingénieurs qui discutent le
soir dans les cafés de la Silicon Valley diffusent entre eux les innovations technologiques
auxquelles ils se livrent, sans rien coûter à leurs patrons, alors qu’ils ne pourraient le faire si
chacun dans son coin se livrait à une recherche « à petite échelle ».
Ces phénomènes sont au cœur des théories modernes de la croissance endogène, qui ont
mis l’accent sur l’importance de l’éducation et du secteur de la recherche et développement dans
l’explication de la croissance. Elles concluent généralement à l’importance du rôle de l'in-
tervention de l’État, pour soutenir ces secteurs porteurs d’externalités positives et vont à rencontre
des politiques de développement visant avant tout à réduire les déficits publics et l'implication des
États dans l'économie.
D. Picon, « A. Smith, de la morale à l’économie », Sciences Humaines n° 179, février 2007.
Questions
1. Quelle est l’hypothèse implicite en termes de rendements sur laquelle se fonde la 1re
phrase soulignée ?
2. Définissez « externalités positives » et traduisez par un concept la 2e phrase soulignée.
3. Recherchez dans un dictionnaire économique ce que sont les théories de la croissance
endogène et dites ce qui fait de Smith un précurseur de ces théories ?
 6
6
1
/
6
100%