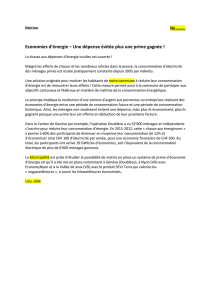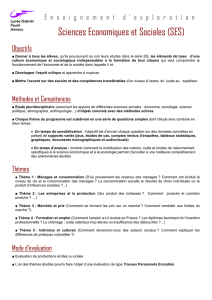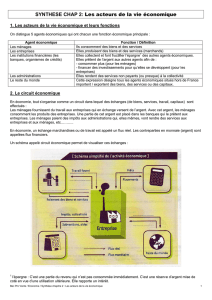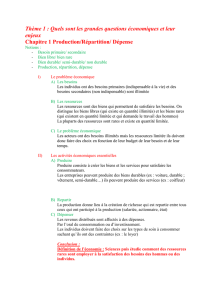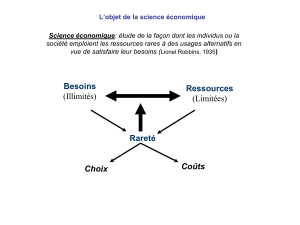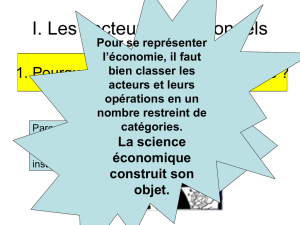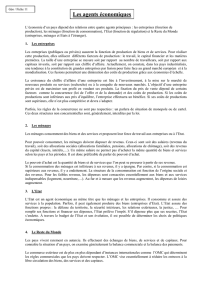La consommation et son évolution

La consommation
et son évolution
La consommation est rendue possible par l’activité de
production. Elle capte la majorité des revenus. Toutefois, toutes
les consommations ne sont pas supportées intégralement par
les ménages ; certaines le sont par l’Administration.
I. Qu’est ce que la consommation ?
!"
La nature de la consommation
La consommation est une utilisation plus ou moins prolongée
d’un bien ou d’un service aboutissant à sa destruction.
La consommation peut également être l’épargne en ce sens où
il s’agit d’une consommation future.
Traditionnellement, on recense deux types de consommation :
• d’une part la consommation finale qui désigne l’usage d’un
bien économique qui n’engendre pas la production d’autres
biens et qui est utilisé pour la satisfaction des besoins des
ménages ;
• et d’autre part la consommation intermédiaire qui est
l’ensemble des biens et services économiques utilisés au
cours d’un processus de production. Il convient de noter
que ce type de consommation peut être individuelle : qui est
financée par les revenus des ménages ; et/ou collective qui
est financée par les impôts comme l’école ou les routes.
L‘INSEE distingue elle aussi deux types de consommation ; la
dépense finale des ménages et la consommation socialisée
qui correspond aux dépenses des ménages supportées par
l’Administration Publique (services gratuits, remboursement de
frais…).
!"
La mesure de la consommation
Comme toute variable économique, la consommation fait l’objet
d’évaluations. Pour cela, l’économiste dispose de deux
instruments.
• Les propensions à consommer. La propension moyenne à
consommer tout d’abord qui se mesure par le rapport
consommation / revenu, il s’agit de la part du revenu qui est
consommée. Ensuite, la propension marginale à consommer
mesure l’effet induit sur la consommation d’un supplément de
revenu ; elle se mesure par le rapport (variation de la
consommation) / (variation du revenu).
• Le coefficient budgétaire (en %). Il représente la part de la
dépense totale d’un ménage qui est consacré à un poste
budgétaire Ex : Alimentation, logement.... On le calcule ainsi :
(dépense du poste budgétaire) / (dépense totale de
consommation).
II. Evolution de la consommation
!"
Tendances générales
De 1945 à 1975, la consommation des ménages a fortement
augmenté (+110 %). Ceci tient à la forte élévation du niveau de
vie des ménages mais aussi à l’amélioration de la situation
sanitaire et sociale et des dépenses de l’Etat ayant pour objet la
réduction des inégalités. C’est la consommation de masse. A
partir de 1975, on parle de consommation de crise.
Afin d’analyser l’évolution de la structure des ménages, on
utilise la loi d’Engel qui met à jour 2 types de biens. Les biens
inférieurs constitués des biens indispensables à la vie
(alimentation, logement…) et les biens supérieurs acquis en
derniers et qui concernent la santé, les loisirs…
!"
Evolution de la structure de la consommation des
ménages
Sur la période 1960-1998, les dépenses de loisirs, logement,
habillement augmentent régulièrement alors que les dépenses
alimentaires voient leur coefficient budgétaire diminuer.
Les facteurs expliquant cette évolution de la structure de la
consommation sont multiple : élévation du revenu,
développement de la sécurité sociale ou encore baisse des
prix.
Coefficients budgétaires des ménages en 1970 et 1997
1970 1997
Alimentation 26% 17,9%
Logement 15,3% 22,5%
Loisir 6,9% 7,4%
Source : INSEE, Données sociales, 1999
III. Inégalités de consommation
Les inégalités peuvent se faire jour au regard des dépenses
engagées par les ménages ou au regard du taux d’équipement
des ménages.
!"
Dépenses des ménages
Les inégalités de consommation sont dues essentiellement aux
inégalités de revenu. Ainsi, selon L’INSEE, en 1995, la dépense
annuelle par ménage cadre est 2 fois supérieure à celle d’un
ménage ouvrier. Toutefois, ceci ne reflète pas les disparités qui
peuvent exister entre les différents postes budgétaires. En effet,
s’agissant des dépenses de vacances, les cadres dépensent en
moyenne 4,6 fois plus que les ouvriers.
!"
Taux d’équipement des ménages
Précédemment, nous avons pu constater des différences
flagrantes de consommation. Toutefois, au regard des taux
d’équipement des ménages ces différences sont moins
présentes. L’équipement en automobile par CSP par exemple
est très proche. Ainsi, 92% des ménages « cadre » possèdent
une voiture cela concerne 90% les ouvriers.
Cet instrument ne reflète toutefois pas le mode d’acquisition du
bien à savoir au comptant ou à crédit.
Editeur : MemoPage.com SA © / 2006 / Auteur : Sébastien KNOCKAERT
1
/
1
100%