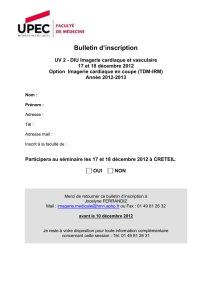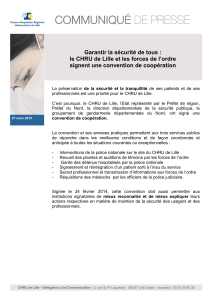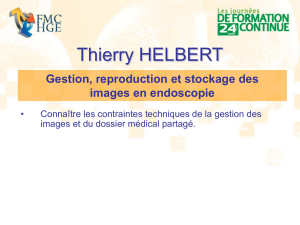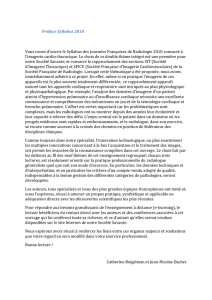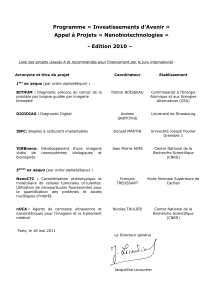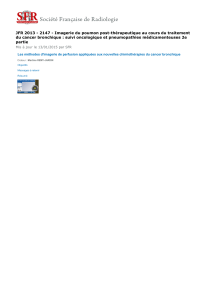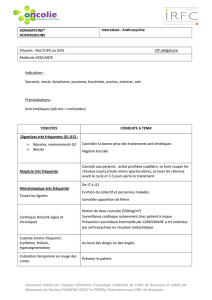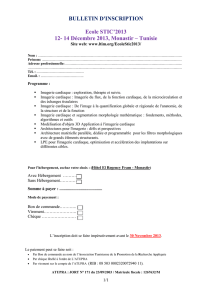Cancer du sein : la double mastectomieen questions

V
Nos actions
Don d’organes
Donner un rein
de son vivant,
c’est possible !
L
e développe-
ment de l’activité
de greffe de rein à
partir de donneurs
vivants est une priori-
té de santé publique.
La loi de bioéthique
2011 a élargi le cercle des donneurs vivants
potentiels et introduit la notion de don croisé*.
Au CHRU, c’est le service des prélèvements mul-
ti-organes, coordonné par le Dr Laurent Muller,
qui a la responsabilité des greffons. Chaque an-
née, environ 60 prélèvements sont effectués sur
une quinzaine de patients décédés. Mais qu’en
est-il des donneurs vivants ? Le recours à ces der-
niers permet aujourd’hui de faire face à une cer-
taine pénurie d’organes. 8 % des greffes rénales
s’appuient sur des donneurs vivants.
Les patients et leur entourage peuvent légitime-
ment se poser la question de l’éventualité d’une
greffe à partir de donneurs vivants et s’informer
sur le sujet auprès du personnel médical. Méde-
cins, personnel soignant et familles peuvent aussi
recueillir de nombreuses informations sur ce
type de greffe via l’Agence de la biomédecine.
« Donner un rein n’est pas un geste anodin. Si le
patient en attente de greffe fait l’objet d’un suivi
médical strict, le donneur vivant est lui aussi suivi
par l’équipe médicale. Une fois la décision prise
et la faisabilité de l’intervention confirmée, une
procédure garantit un accompagnement médi-
cal et juridique du donneur vivant », explique-t-on
à l’Agence de la biomédecine. La procédure dure,
en moyenne, huit à dix mois entre la première
rencontre avec l’équipe médicale et la greffe.
Plus d’informations sur l’activité de greffe rénale à
partir de donneurs vivants sur le site :
www.agencebiomedecine.fr
*Lorsque le don n’est pas possible au sein d’un
binôme familial A (ex : le père à son fils) en rai-
son d’une incompatibilité sanguine ou immuno-
logique, le donneur A donne son rein au receveur
d’un binôme B dans la même situation d’incom-
patibilité intra familiale mais compatible avec le
donneur A ; de même le donneur du binôme B
donne son rein au receveur A, à condition, éga-
lement, de compatibilité. Il s’agit donc d’un don
à partir d’un donneur vivant à quelqu’un de non
apparenté.
Mi-mai, la nouvelle faisait le tour du monde.
L’actrice américaine Angelina Jolie subis-
sait une double mastectomie (ablation des deux
seins) afin de prévenir un risque avéré de cancer
du sein. Cette prise de position, loin d’être anodine, a
replacé le sujet du cancer du sein à la « une » des médias
internationaux mais a surtout ouvert le débat sur cette
intervention chirurgicale radicale. Si la démarche de l’ac-
trice permet de sensibiliser les femmes
à la mastectomie, elle est également
motivée par le fait qu’une reconstruc-
tion des seins après une intervention
prophylactique, et donc sans traite-
ment complémentaire de chimiothéra-
pie et radiothérapie, est réalisée avec
des techniques plus simples, moins
agressives et plus esthétiques à long terme. Au CHRU,
ce type d’intervention (double mastectomie) est assez
rare. En moyenne, trois opérations de ce genre sont réa-
lisées chaque année.
Selon les médias, le risque pour Angelina Jolie de
contracter un cancer du sein serait passé de 87 % à
5 % suite à cette intervention. Qu’en est-il exactement ?
« Le risque zéro n’existe pas. Certes, l’intervention réduit
fortement les risques de cancer mais
cette opération est très lourde phy-
siquement, si bien que beaucoup
de femmes y sont opposées. Une
ablation des seins porte atteinte
à la féminité. Parallèlement aux
conséquences physiques, il y a un
aspect psychologique qu’il ne faut
surtout pas occulter. C’est pourquoi,
au CHRU toute une équipe pluridis-
ciplinaire (gynécologue chirurgien
cancérologue, chirurgien plasticien,
généticien, psychologue, etc.) assure
la prise en charge des patientes
appelées à subir ce type d’interven-
tion. Bien entendu, en amont, l’équipe médicale évalue
la pertinence de l’opération en concertation avec la
patiente et ses proches », explique le Dr Catherine Mar-
sollier-Ferrer, chirurgien gynécologue et cancérologue.
Une sensibilisation à renforcer
Dans la population générale, 10 % des femmes sont
susceptibles de développer un jour un cancer du sein
après 50 ans, beaucoup moins un cancer de l’ovaire
(4430 nouveaux cas/an). L’immense majorité des ces
cancers sont de nature « sporadique » mais 3 à 5 % des
ces cancers surviennent dans un contexte génétique de
prédisposition héréditaire aux cancers : qui sont, sur le
plan médical, ces femmes « menacées » ? « La plupart
de ces personnes sont porteuses d’une mutation des
gènes BRCA1 ou BRCA2 ; gènes de prédisposition au
cancer du sein et de l'ovaire » précise le Dr Chiesa, onco-
généticien. 12 000 femmes en France sont concernées.
Lorsque ces mutations génétiques sont présentes, une
tendance accrue à développer des cancers du sein ou
des ovaires, dans une moindre mesure du pancréas ou
de la peau est observée. Chez ces femmes porteuses
de mutations de ces gènes, le risque de développer un
cancer du sein avant l'âge de 70 ans est de 65 à 85 %.
Pour les femmes ayant déjà déve-
loppé un cancer du sein, le risque
de déclarer un cancer dans l'autre
sein est augmenté de 50 % par rap-
port aux femmes non porteuses de
mutations.
Quant au cancer des ovaires, le
risque est de 25 à 40 % pour les
femmes avec des mutations dans le gène BRCA1 et de
15 à 25 % pour les femmes avec des mutations dans
le gène BRCA2. Le seul moyen de réduire de manière
drastique ce risque est la mastectomie et l’annexecto-
mie (ablation chirurgicale des trompes de Fallope et
des ovaires).
Ces interventions sont plus communément envisagées
pour les femmes âgées de plus de 50 ans. Pourtant ce
sont les jeunes patientes porteuses de ces gènes qui
peuvent tirer le plus grand bénéfice de cette chirurgie
prophylactique, mais à quel prix ! L’objectif pour l’équipe
médicale est alors de repousser au maximum toute
intervention chirurgicale tout en préservant l’état de
santé de la patiente par une surveillance rapprochée
(mammographie, échographie et IRM chaque année à
partir de 30 ans) car chacune sait combien l’ablation du
sein est une épreuve difficile.
Une chose est sûre : une meilleure prise en charge
du cancer du sein passe par un renforcement de
la sensibilisation du grand public au dépistage (ex :
une mammographie prise en charge par la sécurité so-
ciale tous les deux ans pour les femmes de plus de 50
ans). Aujourd’hui, seules 35 % des femmes réalisent
cette mammographie
Génétique / Chirurgie
z L'équipe pluridisciplinaire composée de Lydie Bernhard,
des Docteurs Jean Chiesa, Catherine Marsollier-Ferrer,
Dominique Saunière, Dina Lucelly Diaz Huertas et de Yuliya Petrov.
Cancer du sein : la
double mastectomie en questions
Au CHRU, ce type
d'intervention est assez
rare. En moyenne,
trois opérations
de ce genre sont
réalisées chaque année.

AGENDA
V
Le fil de l'information
• Directeur de la publication :
Jean-Olivier ARNAUD
• Rédacteur en chef : Anissa MEGZARI
• Concept : Service Com. 04 66 68 30 52
• Photos : Département Audiovisuel
• Maquette / Impression : Pure Impression
Flash Infos
Maïeutique : le modèle nîmois
inspire le Viêt-Nam
Valérie Courtin, directrice de l’école de maïeutique
L’équipe pédagogique de l’école de maïeutique a ac-
cueilli, du 1er au 31 mars, le Dr Nguyen Thi My Phuoc,
pédiatre et enseignante à l’école de sages-femmes de Hué
(Viêt-Nam). Ce stage d’observation à visée pédagogique a
été organisé grâce au concours de l’association « Les lam-
pions ». Les bénévoles pédiatres et sages-femmes de cette
association souhaitent, en effet, favoriser la formation des
élèves sages-femmes à Hué.
Durant son séjour, le Dr Nguyen a assisté à des enseigne-
ments théoriques et pratiques mais aussi à des séances de
simulation. De quoi lui faire découvrir des méthodes péda-
gogiques différentes, « un enseignement très formateur »,
des dispositifs modernes de surveillance sans oublier une
relation entre professionnels de santé et patients tournée
vers l’écoute et l’information.
Une bulle de joie
Pour la troi-
sième année
consécutive et
dans le cadre
du 12e Salon
européen de la
bande dessinée organisé à Nîmes, les enfants hospitali-
sés dans le service Pédiatrie et l’unité de pédopsychiatrie
du CHRU ont pu découvrir l’art de la bande dessinée.
Vendredi 26 avril, Serge Carrère, dessinateur et scé-
nariste, créateur de la série Léo Loden, était invité par
l’hôpital pour rendre visite aux enfants. Il a partagé avec
eux quelques techniques de dessin et a offert à chacun
d’entre eux un album de bande dessinée.
Comme des poissons « sur » l’eau !
Samedi 22 juin, le Challenge des entreprises, organisé à
la base nautique du Vidourle par l’association Aviron Terre
de Camargue, a réuni une trentaine d’équipages qui se
sont affrontés dans une ambiance sportive et conviviale.
L’équipage, formé par cinq agents de l’hôpital de réédu-
cation, de réadaptation et d’addictologie du CHRU au
Grau-du-Roi, a porté haut les couleurs de l’établissement
en se classant deuxième du classement général dans leur
catégorie derrière l’équipage du Collège d’Aigues-Mortes.
Bravo à Edwige Seguin, cadre de santé ; Claire Belloncle,
ergothérapeute ; Marie Morales, assistante médico-admi-
nistrative ; Anne Rouvier-Clément, assistante sociale ; Cyril
Vergely, ergothérapeute !
Les métiers de la santé
et du social attirent
Fin mars, se te-
nait, au parc des
expositions de
Nîmes, le 6e Salon
Travail, Avenir et
Formation (TAF)
organisé par le
Conseil régional,
en partenariat avec le Conseil général, les missions locales
et Pôle emploi. L’Institut de Formation aux Métiers de la
Santé du CHRU était présent afin de promouvoir ses offres
de formation et d’évoquer les débouchés vers des carrières
dans les milieux hospitaliers. Les formations courtes, de
type « aide-soignant » ou « auxiliaire de puériculture », ont
été fortement plébiscitées. L’intérêt porté par les visiteurs
de ce salon pour le CHRU, 1er employeur du Gard, s’est
une nouvelle fois manifesté par un nombre important de
candidatures spontanées remises lors de ces journées.
13 000 € sous le signe
de la solidarité
La traditionnelle fête de Printemps de Saint-Chaptes,
organisée par le Comité des fêtes de la ville présidé par
Guy Chanéac, s’est tenue les 13 et 14 avril au profit de
Vendredi 5 juillet :
Inauguration de l’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes) Petite Camargue à Beauvoisin.
Mercredi 10 juillet :
Lâcher en mer des tortues soignées par le Centre d'études et de sauvegarde des
tortues marines de Méditerranée du Grau-du-Roi et suivies par les enfants pris en charge à la Villa Terrone
dans le cadre du projet initié par l'association Hévae.
Le projet
d’établissement
du CHRU,
un cas d’école !
Le 19 juin 2013
a été publié
par la maison
d’édition Elsevier
Masson SAS, le
Tome 2 des Fiches
d’activités sciences
et techniques sani-
taires et sociales
– Terminale ST2S.
Dans cet ouvrage
co-écrit par Evelyne Bersier, Joëlle Guerrero
et Sabrina Karadaniz, il est fait référence au
projet d’établissement 2012-2016 du CHRU
de Nîmes. En effet, la présentation du projet
d’établissement, effectuée par Jean-Olivier
Arnaud, Directeur général et publiée sur le site
internet du CHRU, a été reprise pour exemple
« d’une vision de l’hôpital public et de ses mis-
sions d’intérêt général. »
Ce manuel scolaire, dans un premier temps
édité à 6000 exemplaires, s’adresse aux étu-
diants de Terminale Sciences et Techniques
Sanitaires et Sociales
LE
PATIENT
AU CŒUR DU
PROJET D’ÉTABLISSEMENT
2012-2016
Pour partager vos dé-
placements en voiture
avec d’autres agents du
CHU, rendez-vous sur :
www.covoiturage-chu-nimes.fr
la recherche clinique du CHRU. En réponse à l’appel
solidaire lancé par Laurent Rey, cadre au sein de l’unité
de production culinaire au CHRU et de Carole Grandon,
responsable du secrétariat à la Direction générale, les
bénéfices de la manifestation, parrainée cette année par
Patrick Timsit, ont été reversés au Fonds de dotation pour
la recherche du CHRU. L’argent financera une partie du
projet national de recherche sur la sclérose en plaques
mené par le Dr Eric Thouvenot.

Dans ce numéro…
N° 35 • juillet 2013
Voilà des mois que le CHRU prépare minu-
tieusement la procédure de certification
2013. Une préparation qui s’est accélérée, fin
2012, avec le début de l’auto-évaluation. Pendant
quatre mois, des séminaires thématiques par type
de prise en charge (Court séjour ; Santé mentale ;
Hospitalisation à domicile ; Soins de suite et de
réadaptation et soins de longue durée), ras-
semblant plusieurs référents-experts dans une
logique de pluridisciplinarité, ont été organisés.
Dix-sept groupes de travail spécifiques à chaque
Pratique Exigible Prioritaire (PEP) se sont égale-
ment réunis pour évaluer la performance de ces
PEP. « Cette auto-évaluation s’est fondée sur une
logique d’expertise plus efficiente au moment
de synthétiser les informations recueillies. Lors
de cette phase de synthèse, il s’agissait de digé-
rer l’ensemble des informations récoltées pour
répondre aux interrogations contenues dans
le manuel de certification transmis par la HAS.
Le rapport global d’auto-évaluation du CHRU
a ensuite été remis à la HAS », explique Julien
Delonca, ingénieur qualité – gestion des risques.
Les conclusions de cette auto-évaluation sont
plutôt flatteuses avec des cotations oscillant entre
A et B. Peut-on pour autant parler d’autosatisfac-
tion ? En aucun cas, selon Julien Delonca : « Cette
notation est l’application stricte des critères et
éléments d’appréciations définis par la HAS.
Cela ne signifie pas que tout est parfait mais
tout simplement que notre organisation répond,
a priori, au niveau d’exigence standard requis par
la HAS ».
Une évaluation collective,
pas un jugement individuel !
La visite aura lieu du 18 au 27 septembre. « Les
experts vérifieront que les PEP (s) définies par la
HAS sont parfaitement appréhendées au sein
de l’établissement. Plu-
sieurs critères tirés au
sort feront également
l’objet d’un examen
détaillé au sein de plu-
sieurs services. Cela peut
être le don d’organes ou
le respect de l’intimité »,
précise Julien Delonca.
Il s’agit d’accompagner
les experts-visiteurs dans
leur découverte des
pratiques et modes de
fonctionnement de l’éta-
blissement. Les experts-
visiteurs vont collecter
un ensemble d’informa-
tions lors des visites de
services, au cours de la
lecture de dossiers de patients, lors des entre-
tiens avec les professionnels et lors de la consul-
tation des documents preuves mis à leur disposi-
tion (procédures, modes opératoires, instructions
en vigueur). Ces éléments seront confron-
tés au rapport global d’auto-évaluation fourni
par l’établissement. Un premier retour de
cette visite sera réalisé lors de la séance de
restitution à laquelle l’ensemble du •••/
Edito
Préparer une visite
de certification
demande beaucoup
d’investissement et
du temps. Depuis
plusieurs mois, l’en-
semble du personnel
s’implique en prévi-
sion de la venue en
septembre des experts-visiteurs de la Haute
Autorité de Santé. Cette mobilisation se montre
à la hauteur de l’enjeu que représente cette
visite pour un établissement comme le nôtre
où la qualité et la sécurité des soins apportés
aux patients sont des priorités.
Dans ce cadre, la Direction de la Qualité et
de la Gestion des Risques s’est engagée aux
côtés de tous les services de l’établissement
dans une procédure d’auto-évaluation. Cette
première étape vers la certification a mis en va-
leur les qualités organisationnelles et de fonc-
tionnement du CHRU au regard des attentes
transmises par la HAS. Ces résultats traduisent
toute l’efficacité de votre action quotidienne
dans l’amélioration de la prise en charge des
patients. Fin septembre, il s’agira de confirmer
cette auto-évaluation très satisfaisante. D’ici là,
chacun doit rester mobilisé pour mener à bien
les actions correctives envisagées en interne.
Véritable moteur de concertation pour tous les
professionnels de l’hôpital, la visite de certifica-
tion est le gage de la politique de qualité conti-
nue à l’égard des personnes en grande fragilité
physique et psychique. Elle n’est donc qu’une
étape dans la démarche de qualité globale sui-
vie par l’établissement.
Conscient des efforts déjà fournis et en prévi-
sion des échéances à venir, je vous souhaite
d’excellents congés d’été.
Jean-Olivier Arnaud
Directeur Général
V
Un CHU, une politique
La prochaine arrivée
Le CHRU accueillera, fin septembre, les experts-visiteurs de la Haute Autorité
de Santé (HAS) pour la certification 2013.
Certification : la dernière ligne droite
Réanimation : quelle place pour les proches ?
Télémédecine : la prescription d’imagerie
connectée, un bond qualitatif
Efficience médico-économique : sur la piste
des bouteilles à oxygène
Génétique / Chirurgie : la double mastecto-
mie en questions
Certification 2013
z Pour l’heure, la certification V2010 a été obtenue
par 16 % des établissements visités.

V
Organisation
/••• personnel est convié. Si l’établisse-
ment répond aux références de qualité, la
HAS le certifiera. Elle peut aussi décider de
certifier l’établissement avec recomman-
dation ou réserve. Il faudra alors s’engager
dans des actions d’amélioration pour les
domaines identifiés comme probléma-
tiques par les experts-visiteurs.
Jusqu’ici le CHRU a été certifié à deux re-
prises, se classant même parmi les six CHU
ayant eu le moins de remarques formulées
lors de la dernière certification.
E
n attendant la venue des experts-visi-
teurs, des équipes d’« experts internes »
constitués par la Direction Qualité et la
Direction des soins, accompagnés par
un représentant des usagers, visitent
l’ensemble des services d’hospitalisation.
Il s’agit pour eux d’identifier d’éventuels
dysfonctionnements et d’accompagner le
personnel pour rendre les procédures et or-
ganisations plus sûres et plus efficientes
Bon à savoir :
EPP : Evaluation des Pratiques
Professionnelles
Le terme EPP regroupe un ensemble
de méthodes de travail (audit, suivi
d’indicateurs) dont l'objectif est l'amé-
lioration des pratiques.
RMM : Revue Morbi-Mortalité
Le principe des RMM est d'étudier
de façon collective un cas de prise
en charge d’un patient, jugé comme
particulièrement intéressant, et d'en
déduire des actions d’amélioration.
CREx : Comité de Retour
d'Expérience
Un CREx est un dispositif localisé de
gestion des événements indésirables
propres à un secteur. Il s'appuie sur
des signalements réalisés par les pro-
fessionnels, à partir d’une fiche de
déclaration spécifique. L’analyse de ces
évènements, lors des réunions plu-
ridisciplinaires du CREx, donne lieu à
des actions d’amélioration.
RCP : Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire
Les RCP reposent sur une méthode
de travail permettant à un médecin
de prendre des décisions concernant
la prise en charge d’un patient en
confrontant son avis à celui d’autres
confrères.
V Un CHU, une politique
Prise en charge en réanimation
Ouvrons la porte
aux proches des patients !
Dr Fannie SANTONI, service de rééducation et de réadaptation fonctionnelle gériatrique ; Pr Jean-Yves LEFRANT, chef
du service Réanimations
La place de l’hôpital dans la société a évolué. Il y a quelques dizaines d’années,
le médecin généraliste était accueilli au domicile converti en lieu de soin. Le
patient en fin de vie, allongé sur son lit, était entouré de son médecin et des ses
proches. Certains ont encore en mémoire d’anciennes lithographies représentant
la scène.
La médecine moderne a allongé la durée de vie sans en compromettre la qua-
lité. Dans le même temps, dans « les déserts médicaux », plus aucun médecin
de famille ne fait la « tournée » des patients. Résultat : plus de 70 % des décès
surviennent à l’hôpital, parfois après une longue prise en charge sans place réelle
pour l’entourage. Certains services comme la réanimation ont même des horaires
très réglementés pour les visites des proches.
Or, aucun argument ne plaide pour cette conduite rigoureuse ! Le risque infectieux
est inexistant pour les patients (hormis les patients en aplasie évidemment). Pourtant, la présence des proches diminue
le stress et le risque coronarien dans les unités de soins intensifs en cardiologie.
Les unités de pédiatrie l’ont parfaitement compris et ont ouvert leurs portes aux
parents qui deviennent acteurs de soins en complément des soignants.
Des proches partenaires des soignants
Lorsque les horaires de visite sont élargis dans les unités de réanimation, les
proches passent paradoxalement moins de temps auprès du patient mais
viennent à des moments privilégiés (moments adaptés à leur emploi du temps
sans déranger l’activité des soignants ni l’intimité du patient). De plus, la pré-
sence des proches lors de certaines situations d’urgence extrême diminue les
conséquences psychologiques chez ces mêmes proches qui souhaitent surtout
être informés.
Malgré tout, à l’heure actuelle, les soignants restent assez hermétiques à ces
demandes. « L’approche des proches » est, il est vrai, peu enseignée dans les
cursus universitaires. Les proches doivent devenir des partenaires pour les soignants, à condition d’organiser les rôles
respectifs de chacun, de prévoir des « temps de communication » entre soignants et famille. Et enfin, d’ouvrir les portes
de nos esprits à la nouveauté et en pratique, de nos services
Communication
Une lettre d'informations
pour la communauté médicale
I
l existait le journal interne « Flash Infos »
transmis à l’ensemble du personnel ; la
lettre d'informations « Connexion cadres »
s’adressant au personnel d’encadrement du
CHRU ; le magazine « Réactif Nîmes » traitant
de l’actualité de la recherche et des projets
menés par les professionnels de santé de l’hôpital. Il manquait un outil d’informations dédié aux médecins. C’est
pour cela qu’il y a huit mois, la lettre d'informations médicale baptisée « Inter’MED » voyait le jour. Elaborée en parte-
nariat avec la sous-commission communication de la CME, elle favorise la circulation de l’information médicale tant
en interne au sein des services qu’en externe vers la médecine de ville. En effet, cette publication est également
envoyée aux médecins de ville souhaitant la recevoir
z Le Pr Jean-Yves LEFRANT, chef
du service Réanimations
z Dr Fannie SANTONI, service
de rééducation et de réadaptation
fonctionnelle gériatrique
Suite de l'article

La demande
d'examens en radiologie
est désormais informatisée.
Exactitude et rapidité
V
Organisation
Dossier du patient
L’accès aux images du patient
facilité au sein de la CHT !
Emilie BARDE pour la direction du système d’information et Jean-Paul BEREGI
pour le service d’imagerie
P
our faciliter les échanges d’informations au sein de la CHT et principale-
ment entre les établissements disposant de service d’accueil des urgences,
les services d’imagerie et les services informatiques du CHU, du CH d’Alès et
du CH de Bagnols-sur-Cèze ont mis en place un système léger permettant
de consulter les données
d’imagerie à distance. Une
console, localisée au sein
du service d'imagerie du
CHU, permet de visualiser
les données d’imagerie du
CH de Bagnols-sur-Cèze
et du CH d'Alès. Cette
console a pour principale
vocation de faciliter les avis
avant transfert mais peut
éventuellement être utili-
sée pour certaines interpré-
tations d’imagerie
V
Organisation
L
e CHU de Nîmes est un site à forte activité en imagerie des urgences. Près
d’un passage sur deux aux urgences s’accompagne d’une demande d’acte
d’imagerie, cette fréquence s’accroît pour les pathologies les plus sévères et les
plus urgentes à traiter : polytraumatisme, AVC, douleurs abdominales aiguës… qui
nécessitent une prise en charge prioritaire. Pour l’année 2011, 30 000 examens
ont été réalisés pour le service d’accueil des urgences et ce chiffre est en progres-
sion continue.
Dans ce contexte, la demande d‘examens d’imagerie constitue un élément primordial
de la relation entre cliniciens et imageurs. La qualité des informations contenues dans
la demande, la fluidité de sa circulation et la mise à jour des données concernant les
patients hospitalisés conditionnent l’efficacité de la programmation et de la réalisation
de l’examen d’imagerie.
Un grand nombre de difficultés à la fois d’ordre fonctionnel et relationnel entre cli-
niciens et imageurs est occasionné par les défauts de qualité du remplissage des
demandes d’examens d’imagerie. Des études ont ainsi démontré que 5 à 25 % des
demandes comportent des renseignements cliniques manquants ou insuffisants. Les
résultats de l’étude nationale COMPAQ-HPST de 2006 ont montré qu’en moyenne
seulement 62.7 % des demandes d’examens d’imagerie comportent une justification
médicale avec motif et finalité de la demande. C’est pour progresser sur ces éléments
qualitatifs et faciliter les liens entre leurs deux services que les urgentistes et les radio-
logues ont osé le double challenge de revoir le contenu des demandes d’imagerie et
d’informatiser ces demandes.
Une demande de qualité
La demande d’imagerie est très encadrée par la réglementation (décret de mars
2003, guide de bon usage des examens d’imagerie élaboré par la SFR, manuel
de certification V2010…) et de nombreux champs doivent obligatoirement être
renseignés.
La pertinence du résultat attendu est avant toute chose liée à la pertinence de la
demande. Les demandes d’examens d’imagerie illisibles ou avec des renseignements
cliniques manquants ou insuffisants peuvent conduire à une mauvaise réalisation ou
une mauvaise interprétation des résultats de l’examen.
Un travail important des urgences et de l’imagerie, s’appuyant sur les conseils métho-
dologiques du service de santé publique et la délégation qualité, a été réalisé pour
progresser sur la qualité de la demande d’imagerie. L’objectif est de répondre au
mieux à l’indicateur CDEI « conformité des demandes d’examens d’imagerie » déve-
loppé par la HAS. Cet indicateur intègre 8 éléments obligatoires pour que la demande
soit jugée conforme et nécessaire à la réalisation d’un examen d’imagerie.
Sur un support technique facilitant
L'utilisation d'un support papier présente de nombreux défauts et inconvénients :
mauvaise lisibilité, renseignements parfois incomplets voire absents, absence de tra-
çabilité, nombreuses manipulations, nécessité de classement, et perte possible ! Pour
les services, il n’y a pas de maîtrise des délais ni de traçabilité de la prise en compte
de la demande. Ce qui conduit parfois à renouveler une demande sans réponse. La
prescription connectée doit améliorer considérablement chacun de ces points.
Plusieurs études ont démontré que l’informatisation améliore la qualité de rédaction
de la demande d’examens d’imagerie. 66,3 % des demandes informatisées sont
conformes à l’indicateur CDEI contre 47,6 % pour la demande manuscrite.
C’est sur ces constats que le service des urgences et le service d’imagerie ont accepté
d’ouvrir le 3e et dernier chantier Do.Pa.Nîmes (Dossier Patient Nîmes) : la prescription
connectée. Le logiciel Cyberlab, déjà connu des professionnels qui l’utilisent pour
consulter les résultats de laboratoire, est donc utilisé depuis le 4 juin pour les de-
mandes d’imagerie faites aux urgences. Cette informatisation doit bien évidemment
permettre de consolider la démarche qualitative. Mais l’informatisation offre égale-
ment l’opportunité de supprimer les tâches répétitives (envoi de bon papier, coups de
téléphone pour planifier le rendez-vous, etc.), d’automatiser les circuits et de fiabiliser
l’information sur le déroulement de l’acte demandé. Un atout pour simplifier et accé-
lérer la réalisation des actes prescrits !
La généralisation de la prescription connectée d’imagerie est prévue sur l’ensemble du
CHU en novembre 2013
Le groupe projet prescription connectée (Jean-Paul BEREGI, Zoheir ABIDAT,
Francesco MACRI, Agnès AMBLARD pour le service d’imagerie, Patrick RICHARD et
Emma BUSTARA pour le service des urgences, Rémi SANZ et le CODIR DPI pour la
direction du système d’information)
z Logiciel CYBERLAB - Prescription d'un examen d'imagerie
z La console permet au personnel du service
d'imagerie du CHRU de visualiser à distance
les données d’imagerie des CH d’Alès et de
Bagnols-sur-Cèze.
 6
6
1
/
6
100%