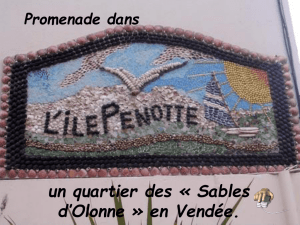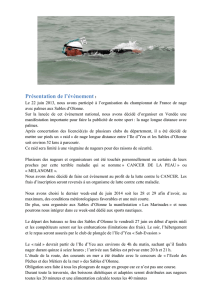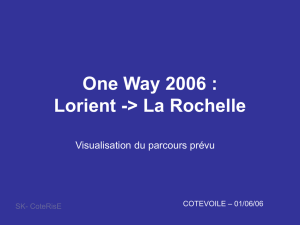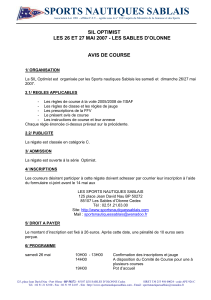Télécharger - Musée de l`Abbaye Sainte

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix
Les Sables d’Olonne
----------
DOSSIER DE PRESSE
Jean Launois, En terrasse sur le font de mer, vers 1921
Lavis d’encre de Chine, musée de l’Abbaye Sainte-Croix
L’heure du bain.
L’architecture balnéaire aux Sables d’Olonne
et sur le littoral vendéen
(8 juillet – 10 novembre 2012)

Communiqué de presse
L'histoire des Sables d'Olonne est tout entière tournée vers la mer. Son développement économique et
urbain, longtemps dépendant de la pêche et de l'emprise capitale de son port, s'est considérablement
modifié au début du 19
ème
siècle avec l'apparition des bains de mer et l'invention du tourisme balnéaire.
La construction du remblai entreprise en 1768 puis sa prolongation progressive, à partir de 1850, jusqu'au
bout de la plage sont symptomatiques de ce phénomène, né dès le 18
ème
siècle en Angleterre, qui essaime
alors sur les côtes françaises. Les premiers baigneurs arrivent aux Sables d'Olonne vers 1823 ; ils logent
chez l'habitant et se contentent un temps de structures balnéaires légères, comme quelques cabines de
bains à roulettes posées là pour l'été ou une piste d'hippodrome éphémère et improvisée sur la plage. Mais
en 1866, avec l'arrivée des Chemins de fer de Vendée dans la station, le mouvement s'emballe, les hôtels
de voyageurs se multiplient, la ville s'organise et ouvre un établissement de bains, les premières villas
voient le jour. En 1900, un tramway électrique circule et dessert, depuis la gare, le long du remblai, les
deux principaux casinos de la ville. La ruée vers l'est, qui suit les courbes de la plage, s'accélère et les
maisons de villégiature remplacent les vieux moulins du bout de ville ou la forêt de la Rudelière,
aménagée en 1923 par Maurice Durand pour le seul plaisir des estivants. Après-guerre, suite à la
promulgation des congés payés, les vacances en bord de mer se démocratisent et connaissent un essor
sans précédent. La nouvelle ère du tourisme de masse bouleverse l'équilibre de la station qui s'adapte à
l'afflux et aux nouveaux besoins des estivants. De nouveaux lotissements se développent sur les derniers
espaces laissés en friche, non loin des colonies et des campings. La ville se modernise, relooke ses casinos
et propose des activités de loisirs au goût du jour aux baigneurs, une piscine en plein-air, des terrains de
tennis et quelques cinémas. Faute de pouvoir s'étendre au sol, elle grandit désormais en hauteur,
diligentant l'apparition des premiers immeubles à appartements de plus de cinq étages. En 1850, la station
accueille quelques centaines de villégiateurs aristocratiques. Sa capacité d'hébergement, évaluée à 15.000
estivants vers 1900, monte à 55.000 vers 1950.
Ce phénomène de démocratisation des bains de mer et de massification du tourisme, est sensible ailleurs
sur le littoral vendéen, où l'appropriation de bord de mer s'est affirmée surtout dans la seconde moitié du
20
ème
siècle. Loin des villas d'architecte, ce sont de véritables quartiers qui ont été créés, entraînant
construction et urbanisation de zones vierges jusqu'alors.
C'est sur ce bouleversement dont les répercussions urbanistiques et architecturales sur la forme d'une ville
et d'un territoire sont colossales que revient en images cette exposition estivale qui vous fera revivre, entre
deux baignades, l'histoire balnéaire de la station.
L'exposition, conçue en partenariat avec le Service du Patrimoine de la Région des Pays de la Loire,
présentera une partie des résultats de l'inventaire du patrimoine balnéaire, réalisé sur les deux
départements littoraux de la région Loire-Atlantique et Vendée. Une autre exposition, à Saint-Nazaire,
présentera les résultats de l'opération pour cette zone. Une publication, dans la collection « Images du
patrimoine » fera la synthèse des recherches menées à l'échelle régionale.

L'histoire des Sables d'Olonne est tout entière tournée vers la mer. Son développement économique et
urbain, longtemps dépendant de la pêche et de l'emprise capitale de son port, s'est considérablement
modifié au début du 19ème siècle avec l'apparition des bains de mer et l'invention du tourisme balnéaire.
En 1866, avec l'arrivée des Chemins de fer de Vendée dans la station, le phénomène prend de l’ampleur :
la ville s'organise et ouvre un établissement de bains, les premières villas voient le jour. La ruée vers l'est,
qui suit les courbes de la plage, s'accélère après 1900 et les maisons de villégiature remplacent les vieux
moulins du bout de ville ou la forêt de la Rudelière, aménagée en 1923 par Maurice Durand pour le seul
plaisir des estivants. Après-guerre, les vacances en bord de mer se démocratisent et connaissent un essor
sans précédent. La nouvelle ère du tourisme de masse bouleverse l'équilibre de la station qui s'adapte à
l'afflux et aux nouveaux besoins des estivants. Faute de pouvoir s'étendre au sol, elle grandit désormais en
hauteur, diligentant l'apparition des premiers immeubles à appartements de plus de cinq étages.
Ce phénomène de démocratisation des bains de mer et de massification du tourisme, est sensible ailleurs
sur le littoral vendéen, où l'appropriation du bord de mer s'est affirmée surtout dans la seconde moitié du
20
ème
siècle. Loin des villas d'architecte, ce sont de véritables quartiers qui ont été créés, entraînant
construction et urbanisation de zones vierges jusqu'alors.
C'est sur ce bouleversement dont les répercussions urbanistiques et architecturales sur la forme d'une ville
et d'un territoire sont colossales que revient cette exposition, présentant dans un premier temps les
équipements publics liés à l'essor de la pratique balnéaire avant de se concentrer sur la question de
l'habitat individuel et des villas.
Au bord de la mer
Le phénomène des bains de mer, lié à une approche thérapeutique et romantique de l’élément marin,
apparaît en France au début du 19
ème
siècle. Il se manifeste par la domestication de la plage, l’apparition
d’équipements réservés à la cure marine et l’aménagement du remblai.
Aux Sables-d’Olonne, dès 1816, plusieurs établissements voués aux bains d'eau douce et d'eau de mer,
ouverts exclusivement en saison, sont édifiés sur le remblai. La même année, l’occupation de la plage est
réglementée par arrêté municipal : elle est divisée en deux zones, l’une pour les bains nus, l’autre pour
les bains en costumes. Les premiers baigneurs extérieurs arrivent dès les années 1820, poussant le préfet
à demander au Consul de France en Grande-Bretagne un modèle de bathing machine, cabine de bains
roulante utilisée communément sur les plages anglaises et encore inconnue en France. D’abord pratiqués
à l’intérieur de ces « machines », les bains de mer peu à peu se libèrent et les cabines servent de lieux de
rangement. Aux premières cabines en bois succèdent les cabines couvertes de toile, puis la tente de plage
s’allège en parasol et enfin en simple serviette. La pratique exclusive du bain, qu’il soit de mer ou de
soleil, prend alors le pas sur les nombreuses activités organisées sur la plage aux 19
ème
et 20
ème
siècles :
courses de chevaux ou d’ânes, pêche, sport.
La promenade du remblai est construite par tranches successives du 18
ème
siècle à la Seconde Guerre
mondiale. En 1768, le premier remblai est construit à l'ouest de la ville sur les dunes les plus proches du
port, utilisées jusqu'alors pour le séchage des filets de pêche. En 1850, l'ouvrage est prolongé vers l'est,
tandis qu'un arrêté municipal fixe un alignement en front de mer pour les constructions nouvelles. Le
remblai est progressivement agrémenté de trottoirs et de garde-corps. En 1896, une ligne de tramway
électrique est mise en place, permettant de relier la gare au casino et aux nouveaux quartiers balnéaires
du Bout de Ville. Son exploitation, interrompue pendant le premier conflit mondial, est définitivement
abandonnée en 1925. A partir des années 1920 le remblai, jusque-là voué à la déambulation des
promeneurs, est envahi par les automobiles dont la présence se fait de plus en plus importante.
L’organisation de la station
Les Sables d’Olonne connaissent un développement balnéaire précoce. Le pôle attractif de la ville se
détourne progressivement du port pour se déplacer vers le front de mer où viennent s’implanter les
commerces saisonniers et les premières villas. La forêt domaniale devient un lieu privilégié pour la
promenade et l’aménagement de lotissements paysagés. Grâce au chemin de fer, qui arrive aux Sables
d’Olonne en 1866, la station devient facilement accessible et attire un grand nombre d’estivants. La ville
est érigée en station climatique et touristique en 1923.

Le déplacement du principal pôle d’activité depuis le port vers la plage entraîne une extension de la ville
vers l’est et le développement d’un quartier saisonnier. Après 1900, l’urbanisation progresse rapidement
au-delà de l’enceinte, les maisons de villégiature s’élevant à l’emplacement des anciens moulins à vent le
long de nouvelles voies rectilignes. En 1924, la forêt domaniale du Château d’Olonne est vendue afin de
permettre la construction du lotissement paysagé de la Rudelière.
Au cours du dernier quart du 19
ème
siècle, quelques magasins saisonniers, construits en matériaux légers,
s’installent sans concertation sur les parcelles résiduelles du remblai. Certains s’ouvrent dans une partie
du rez-de-chaussée des villas (Palazzo Clementina, Mirasol ou Gelf) ou des immeubles. Une vie
commerciale très active existe aux Sables d’Olonne avant le début des bains de mer et certaines
enseignes décident d’ouvrir une succursale sur le remblai, comme le grand magasin des Nouvelles Galeries
en 1905. Au cours des années 1920, le renouveau commercial de la station relance non seulement les
commerces saisonniers du remblai mais aussi les commerces traditionnels de la rue des Halles, dont les
devantures sont ornées de mosaïques Art Déco par les architectes Maurice Durand ou Henri Bertrand.
Les premiers casinos au cœur de la station
Le casino, qui regroupe jeux, théâtre, concert, etc., fait partie des édifices fondateurs d’une station
balnéaire, avec les établissements de bains et les grands hôtels, dès lors qu’il ne s’agit plus seulement de
s’y baigner mais aussi d’y développer loisirs et sociabilité. Outre l’établissement de bains Lafeuille,
consacré aux activités d’hôtel et de casino plus que de bains thérapeutiques, quatre casinos se succèdent
aux Sables d’Olonne de la seconde moitié du 19
ème
siècle à nos jours.
Construit en 1875-1876 par Germain Sallard, sur un gros œuvre de Gustave Eiffel, le Grand Casino fait
partie d’un projet d’aménagement global de la Compagnie des chemins de fer de Vendée, désireuse de
lancer la station. L’édifice comporte un étage et une vaste terrasse donnant sur la mer. La salle de
théâtre, avec son couvrement pyramidal, domine l’ensemble. Après la Seconde Guerre mondiale,
l’édifice, occupé puis bombardé, est très endommagé et reste à l’état de ruine pendant plus de cinq ans.
La reconstruction du Casino, jumelée à la construction d’une piscine d’eau de mer sur le remblai, est
confiée à Maurice Durand et s’achève en 1951. Le programme de décoration intérieure et extérieure est
réalisé par Henry Simon. La façade de style Art Déco est remaniée en 1978 selon le goût du moment.
Démoli en 1997, l’ancien édifice est remplacé par un nouveau casino inauguré en 1998 et toujours en
place aujourd’hui.
Le Casino des Pins est édifié en 1898, en même temps qu’un hôtel de voyageurs, sur un terrain boisé.
L’existence de ce « complexe touristique » dont le maître d’ouvrage est l’entrepreneur sablais Nicot, est
conditionnée à la construction de la ligne de tramway électrique des Sables d’Olonne qui mène du Grand
Casino à la Rudelière. L’établissement, concurrencé par l’ouverture du Casino des Sports à proximité,
ferme ses portes en 1929 et est démoli en 1944.
La seconde vague des casinos
Au cœur du projet de lotissement et de parc sportif de la Rudelière, le Casino des Sports est édifié en
1928 par Maurice Durand, qui transforme l’ancien buffet du parc des sports. Les impératifs liés au bail
signés en 1923 imposent une construction en matériaux légers. De style Art Déco, l’architecture du casino
opte pour un parti monumental avec corps central flanqué de pavillons d’angle octogonaux. En 1964, la
société du Casino des Sports, contrainte par un établissement devenu dangereux, confie la construction
d’un nouveau casino à l’architecte sablais Michel François. L’actuel Casino des Pins, édifié en 1998 par le
cabinet d’architectes Durand, Ménard et Thibault, occupe le terrain de l’ancien casino des sports tout en
reprenant le nom du premier établissement de loisirs de la Rudelière.
En novembre 1924, La Construction Moderne publie un article sur le projet des architectes Mouret et
Chimkevitch de construction d’un casino-hôtel sur le front de mer aux Sables d’Olonne, dans le quartier
neuf de la Rudelière. L’ensemble doit être porté par une structure métallique et construit en béton armé.
En dépit des maîtres d’œuvres dynamiques et volontaires, le casino de la Rudelière reste à l’état de
fondation. L’hôtel, lui, n’est jamais commencé. Abandonné, le squelette du casino est définitivement
démonté en 1939.

L’essor de l’hôtellerie
D’abord logés chez l’habitant, qui déménage le temps de la saison des bains dans une partie annexe de
son habitation, les baigneurs trouvent progressivement des lieux plus adaptés pour les recevoir. Les
premiers hôtels de voyageurs ont des allures de palaces et privilégient le luxe et la modernité en offrant à
leur clientèle des salles de bal et de spectacle. Progressivement, ce type d’hébergement collectif revient
à des dimensions plus modestes pour accueillir une clientèle plus populaire.
Les hôtels de voyageurs se développent en front de mer à partir de 1848, privilégiant la vue sur mer à la
proximité de la gare de chemin de fer. En 1835, un rapport sur les bains de mer aux Sables d’Olonne
propose la construction d’un établissement pour les baigneurs. Destiné à accueillir des étrangers amateurs
de bains de mer, l’établissement Lafeuille ouvre en 1844, rassemblant les activités de bains et
d’hôtellerie. Le dessinateur Adolphe d’Hastrel réalise en 1852 une gravure de l’intérieur de
l’établissement, à visée plus mondaine que thérapeutique. La grande hôtellerie balnéaire fait les beaux
jours de la station à partir de la décennie 1860 (Hôtel de la Plage, 1865 ; Splendid Hôtel, 1977). L’Hôtel
du Remblai et de l’Océan est construit en 1875 en front de mer, au cœur de la station où il acquiert
rapidement un rôle central. En 1929, l’architecte Maurice Durand remanie entièrement l’édifice,
notamment l’intérieur, dans le style Art Déco.
Après 1910, tandis que les maisons de villégiature se construisent en grand nombre dans les quartiers est
de la ville, les grands hôtels du remblai sont peu à peu délaissés pour des établissements de taille plus
réduite. Après 1920, la petite hôtellerie se développe dans les secteurs plus éloignés du remblai,
privilégiant le modèle de la pension de famille où de l’hôtel avec restaurant. L’hébergement collectif en
hôtel régresse à partir de 1950 au profit des immeubles à appartements. Les premiers hôtels de voyageurs
de la station sont pour la plupart, aujourd’hui, divisés en appartements.
La naissance des colonies de vacances
Les colonies de vacances apparaissent sur le littoral vendéen dès les années 1900. Répondant initialement
à une vocation thérapeutique, sociale et pédagogique, elles évoluent en même temps que la pratique
balnéaire vers les loisirs et le dépaysement. Parallèlement, leur architecture se transforme pour répondre
à ces missions : d’inspiration militaire ou hospitalière au départ, les plans et les élévations de ces
bâtiments se libèrent progressivement des compositions symétriques pour privilégier l’aération et
l’ensoleillement.
De nombreux établissements, initialement situés dans des bâtiments privés réaffectés, reprennent
l’inspiration pittoresque ou régionaliste propre aux maisons de villégiature. C’est le cas de la colonie Ker
Netra qui s’installe en 1933 au Château d’Olonne, dans un pavillon de chasse construit dans un style néo-
normand par Maurice Durand, auquel sont adjoints l’année suivante des bâtiments annexes de style Art
Déco. Les colonies à vocation thérapeutique utilisent les règles de l’architecture hygiéniste des années
1930 : circulation de l’air et de la lumière, cloisonnement des espaces selon leur fonction, utilisation de
matériaux modernes, simples d’entretien. Le préventorium Saint-Jean d’Orbestier, construit en 1934, en
est tout à fait représentatif dans son architecture comme dans son décor. A Longeville-sur-Mer, la colonie
La Touraine est construite en 1937 selon ces mêmes principes. A la fin des années 1960 et au cours des
années 1970 naissent de nouvelles formes d’architecture proposant des programmes plus petits, souvent
en rez-de-chaussée, où les espaces ne sont plus séparés par niveaux mais par bâtiments intégrés à leur
environnement. La recherche de fonctionnalité et le dialogue avec la nature sont mis en avant, d’un point
de vue architectural et éducatif. Les bâtiments de la colonie de la ville de Bezons, initialement construits
en 1969 à Saint-Hilaire de Riez en matériaux préfabriqués, témoignent aujourd’hui de ces nouvelles
perspectives.
La planification des lotissements
Implantés sur des terrains vierges (dune, forêt domaniale ou terrain inculte), les lotissements suivent le
plus souvent un plan organisé autour d’avenues parallèles et de carrefours en étoile. Alors que les
premiers exemples des Sables d’Olonne datent de la seconde moitié du 19
ème
siècle et sont réalisés par
des entrepreneurs locaux, les lotissements aménagés dans les autres stations vendéennes, plus récents,
sont confiés à des promoteurs immobiliers.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%