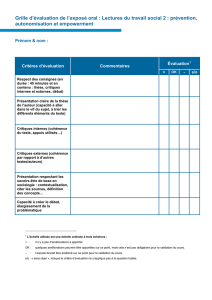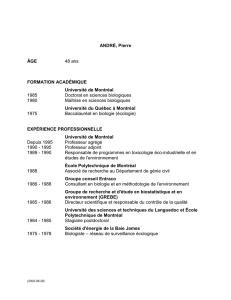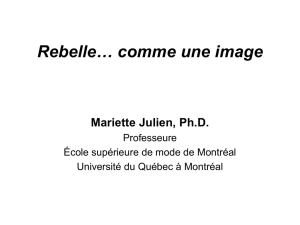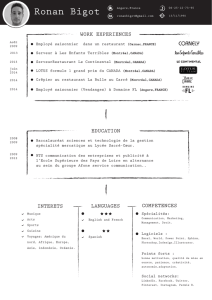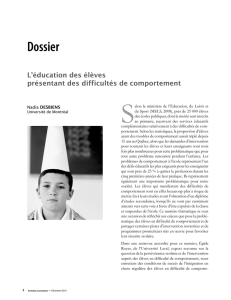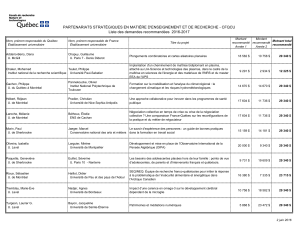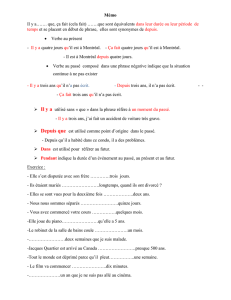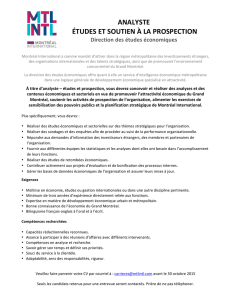la maitrise - Bibliothèque et Archives Canada
publicité

DÉPARTEMENT DES LEITRES ET DES COMMUNICATIONS
Faculté des lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke
LA CRITIQUE THÉÂTRALEÀ MONTRÉAL EN 1994 :
QUATRE JOURNAUX, QUATRE DISCOURS?
par Sophie DesHaies
Bachelière ès lettres (études françaises)
r-/-pf5
MÉMOIRE PRÉSENTÉ
pour obtenir
LA MAITRISE
ÈS ARTS (ÉTUDES FRANÇAISES)
Sherbrooke
Janvier 2000
Acquisitions and
Bibîbgraphic Services
Acquisitions et
services bibliographiques
L'auteur a accordé une iicence non
exclusive pmnettant à la
Bibliothtpue nationale du Canada de
reprodune,*,
di!3trî%uerou
vaidrr des copia de cette thése sous
la f m e de microfiche/film, de
repodnction sur papier on sur fonriat
ei-e.
The author retains owaasbip ofthe
copyright in this thesis. Ncither the
thesis nor substantial extracts h m it
may be printed 04 otherwise
fepfoduced without the author's
peimission.
la popneté du
droit d'auteur qui protège cette thése.
Ni la thèse ni des extraits substantiels
de celle-ci ne doivent être imprimés
ou autrement reproduits sans son
autorisation.
L9aiite\aCU-
COMPOSITION DU JURY
LA CRITIQUE THÉÂTRALE À MONTREAL EN 1994 :
QUATRE JOURNAUX, QUATRE DISCOURS?
par Sophie DesHaies
Bachelière ès lettres (études françaises)
Ce mémoire à été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
M. Pierre Hébert
M. Gregory Reid
Sous la direction de :
M. André Marquis
(Département des lettres et des communications,
Faculté des lettres et sciences humaines)
Je tiens à remercier mon directeur monsieur André Marquis pour son expertise,
ses judicieux conseils et ses encouragements.
Merci à Hervé Dupuis pour m'avoir aidée à lancer ce projet
en dirigeant ce mémoire avant de prendre sa retraite en 1998.
Merci à mes parents pour avoir cru en moi.
Merci a Isabelle Laplante pour son aide lors de mes recherches.
Merci à André Gaudreau pour ses nombreuses relectures.
Merci à Martial Gaudreau pour sa patience et son soutien.
Ce mémoire examine les différents sujets abordés par la critique théâtrale québécoise.
Notre corpus contient quatre journaux montréalais dont trois quotidiens (Le Journal de
Montréal, La Presse et Le Devoir) et un hebdomadaire ( Voir). Nous avons recueilli plus
de cent textes publiés lors de la rentrée automnale 1994. À l'aide d'une grille, divisée
en treize points, nous avons décortiqué le contenu de ces critiques.
Notre méthode de calcul tenait compte de trois facteurs : la fréquence d'apparition
(nombre de fois que chaque point est traité par un critique dans l'ensemble de ses
articles), I'espace global (I'espace qu'occupe un point dans la production entière d'un
critique) et I'espace ciblé (I'espace octroyé à un point dans un article).
Nous avons analysé les donnés sur le corpus en général. puis sur chacun des quatre
journaux, pour nous concentrer ensuite sur les journalistes-vedettes et. finalement, sur
les cinq pièces que ces journalistes-vedettes ont tous critiquées.
Nous constatons que, à l'exception de La Presse, les journaux tiennent un discours en
conformité avec leurs orientations éditoriales
Sommaire
Page
Liste des figures
1
Introduction
Premier chapitre
Méthodologie et corpus
Deuxième chapitre
Analyse globale du contenu des articles
Troisième chapitre
Analyse des articles en fonction du journal d'appartenance
Quatrième chapitre
Analyse des articles des journalistes-vedettes
Cinquième chapitre
Analyse des cinq pièces critiquées par les quatre journalistes-vedettes
63
Conclusion
88
Annexes
92
Bibliographie
98
Table analytique des matières
109
LISTE DES FIGURES
Page
Figure 2.1
Comparaison des 13 points sur l'ensemble du corpus
Figure 3.1
Le Journal de Montréal
Figure 3.2
La Presse
Figure 3.3
Le Devoir
Figure 3.4
voir
Figure 4.1
Carmen Montessuit
Figure 4.2
Jean Beaunoyer
Figure 4.3
Robert Lévesque
Figure 4.4
Luc Boulanger
29
INTRODUCTION
Au Québec, l'information théâtrale dans les journaux commence à circuler dès le 18=
siècle. Elle paraît surtout sous forme publicitaire, car, la plupart du temps. les journaux
ne font que retranscrire les communiqués de presse. Les journalistes d'alors, qui n'ont
pas de formation spécialisée pour rédiger de véritables critiques, servent plus les
intérêts des journaux que ceux du théâtre.
Aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup changé.
La critique théâtrale n'occupe
qu'une bien petite place dans les quotidiens, et cette rubrique journalistique est
rarement assumée par des professionnels de la question. Du moins est-ce l'avis des
praticiens et praticiennes de théâtre. À ce sujet, Daniel Roussel écrivait dans
de théâtre Jeu :
J'ai souvent l'impression que la critique, c'est comme l'iceberg : la grande partie
qu'on ne voit pas, c'est l'incompétence, et la pointe de l'iceberg, c'est la
méchanceté. Alors la pointe, forcément, est extrêmement visible; elle repose
souvent sur une grande base d'incompétence, c'est-à-dire sur des gens qui ont
acquis le poste de critique par progression syndicale, par courant d'air. Ce sera,
au mieux. quelqu'un qui a une bonne tête, qui informe bien, qui prend bien le
pouls du public, qui représente la majorité.'
Et il ajoute :
Si l'on demandait aux critiques, un par un. quelle est leur formation, il y
aurait des joues qui rougiraient. Leur formation est extrêmement limitée.
u2
En effet,
aucun programme collégial ou universitaire ne forme des critiques de théâtre.
Mais la scolarité, la formation et la culture ne garantissent pas qu'un critique sera pour
autant respecté et apprécié. Souvenons-nous de la pétition qu'a fait circuler un groupe
3
d'artisans du théâtre québécois demandant le renvoi de Robert Lévesque du journal Le
Devoir. Ces 156 personnes, surtout réunies autour de la Compagnie Jean-Duceppe, la
Compagnie de Quat'sous et le Théâtre d'Aujourd'hui, s'insurgeaient non pas contre le
jugement du critique, mais bien contre la manière dont il procédait, du ton souvent
employé. Ces pétitionnaires refusaient de discuter avec les représentants du Devoir et
incitaient les autres compagnies à les imiter. Ce qui semble avoir mis le feu aux
poudres est une critique de Robert Lévesque sur la pièce Visite Libre présentée au
théâtre de Quat'sous. En effet, le critique recommandait clairement l'abstention a ces
représentations :
Que l'auteur se rassure, nous serons cc aussi discrets que possible quant à
l'intrigue >>. comme il nous le demande au programme. Tellement discret, que
nous irons jusqu'à recommander à tous les Montréalais ou visiteurs de passage
dans la métropole d'éviter le coin Coloniale et des Pins, de ne pas investir un
sou au guichet du Quat'sous pour en savoir plus?
Aussitôt, la compagnie a cessé sa publicité dans Le Devoir et a proposé aux autres
compagnies de faire de même.
II s'agissait d'une sorte de chantage, puisque les
artisans voulaient poursuivre leurs moyens de pression jusqu'à ce que le journal cesse
de faire paraître des critiques peu élogieuses. Bien que cette pétition, sans doute
stratégiquement malhabile, n'ait pas regroupé toutes les compagnies théâtrales. elle
démontre le malaise qui existe entre la communauté théâtrale et les critiques.
Au-delà de ces esclandres particuliers, on peut se demander si la critique journalistique
est tributaire du journal d'appartenance. auquel cas existerait une sorte d'a priori du
jugement. Ainsi, tout farouche qu'il soit de sa liberté, le critique jugerait à la lunette du
journal qui l'embauche. C'est, en tout cas. ce que ce mémoire entend vérifier.
Or nous savons que chaque journal vise un public cible précis et qu'il privilégie. à
travers ses articles, certains secteurs d'informations dans un style et un ton qui lui sont
propres. Nous émettons donc l'hypothèse que cette spécificité se répercutera aussi
dans le contenu des articles de critique théâtrale.
Ainsi. nous vérifierons si les éléments théâtraux traités par les critiques divergent en
fonction du journal où ils travaillent. Pour ce faire, nous nous limiterons à la critique
théâtrale montréalaise, plus précisément aux quatre journaux suivants : Le Journal de
Montréal, La Presse, Le Devoir et Voir.
Nous établirons la fréquence des sujets
abordés dans les critiques et déterminerons l'espace qui est accordé à chacun. Afin de
restreindre notre corpus. nous avons choisi de décortiquer ies critiques parues lors de
la rentrée théâtrale de 1994.
Permettons-nous de présenter en quelques mots les journaux retenus4 Le Journal de
Montréal est un quotidien de format tabloïd visant un grand public et faisant une large
place aux sports et aux faits divers. II s'agit du quotidien le plus vendu au Québec. La
Presse, un journal de grand format, rejoint aussi un assez large public. Ce quotidien
couvre plusieurs domaines généraux d'information, répartis en divers cahiers.
Le
Devoir n'atteint qu'une faible fraction des ventes des deux autres quotidiens
montréalais, mais jouit en contrepartie d'un prestige indéniable auprès de l'intelligentsia
et des gens au pouvoir. Le Devoir s'adresse essentiellement à des lecteurs instruits et
met l'accent sur les nouvelles politiques et culturelles. Enfin, Voir. un hebdomadaire
distribué gratuitement, s'est donné pour mandat de scruter de fond en comble le
domaine culturel montréalais. Serons-nous à même de démontrer que ces quatre
journaux véhiculent quatre discours différents?
Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes appuyée sur une grille
d'analyse que M. Hervé Dupuis, spécialiste de théâtre, a utilisée pour indexer des
critiques à la revue de Cahiers de théâtre Jeu. Cette grille répertorie les éléments
pouvant être évalués dans une critique. Même si elle est exhaustive. cette grille ne
permet pas d'entreprendre une analyse interprétative des critiques, mais fait plutôt
ressortir de façon factuelle les divers points décortiqués par un critique. Ainsi, si un
paragraphe traite de racisme ou de féminisme, il sera classé sous l'étiquette "contenu
du texte".
Notre mémoire est divisé en cinq chapitres.
Le premier explique la méthodologie
employée et le corpus examiné lors de la recherche. Celui-ci regroupe plus de cent
textes rédigés par dix-sept journalistes. Ce chapitre présente aussi la grille d'analyse
mise au point par Hervé Dupuis et donne des exemples pour chacun des éléments qui
la compose.
Le deuxième chapitre compile les résultats obtenus à la suite de
l'application de la grille à i'ensernble du corpus. Le troisième expose les résultats en
tenant compte du journal dans lequel les articles sont publiés. Le quatrième chapitre
s'attarde aux journalistes-vedettes des quatre journaux à l'étude.
Le dernier met
l'accent sur des pièces de théâtre précises : George Dandin, Les Muses orphelines,
Après la chute, Jeanne Dark et Don Juan.
Plusieurs membres de la communauté
artistique et journalistique affirment.
positivement ou négativement, que la critique de théâtre est indispensable a ia survie
du milieu, paradoxalement, peu d'individus semblent accepter la façon de faire de ces
journalistes. Comme personne n'a examiné le contenu réel des textes critiques portant
sur le théâtre au Québec. nous croyons qu'il est important de préciser de quels sujets
ils traitent et en quelles proportions.
d'ordre méthodologique.
Mais d'abord apportons quelques précisions
Notes
1-ROUSSEL, Daniel, cc En pratique : de la création a la critique. Table ronde avec des praticiens
critiques , Cahiers de thbâtre Jeu, no40, Montréal, 1986, p. 197.
3-LÉVESQUE, Robert. cc Visite libre, au Quat'sous.
Montréal.16 septembre 1983, p. 5.
Le crime de monsieur Faure
»,
Le Devoir,
4- Le guide annuel des rnédias 1994-1995. Info Presse et Le conseil des directeurs médias du Québec,
Montréal, 1994, 136 p-
PREMJER CHAPITRE
METHODOLOGIE ET CORPUS
Pour effectuer cette recherche, nous avons analysé les critiques de pièces de
théâtre de la rentrée montréalaise a l'automne 1994. parues dans quatre
journaux quebécois : Le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir et Voir.
Nous avons retenu l'année 1994 parce que, au moment où nous avons
commencé notre recherche, c'était I'année la plus récente.
Plutôt que de
procéder à un échantillonnage sur toute l'année, nous avons cru plus pertinent
d'examiner la saison automnale, puisque. à cette époque de l'année. l'activité
théâtrale est la plus intense.
Les articles retenus regroupent la totalité des critiques parues entre septembfe
et décembre 1994 (peu importe l'auteur), à l'exception des chroniques et des
entrevues. En effet, comme nous voulons approfondir le contenu des critiques
des pièces, nous avons éliminé les chroniques et entrevues qui relatent
davantage la vie de l'artiste et ses projets futurs plutôt que d'apporter un regard
critique sur les pièces elles-mêmes.
Pour retracer les critiques de La Presse et du Devoir, nous avons consulté les
microfilms de ['Université de Sherbrooke. Les articles du Journal de Montréal
ont été recueillis à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal. Pour ce qui
est du journal Voir, nous avons dû nous contenter des textes disponibles sur le
réseau Internet. C'est pour cette raison que le numéro de la page n'est pas
indiqué et qu'aucune image n'est rattachée à ces textes. De plus, nous avons
constaté que les articles parus sur Internet sont raccourcis quelque peu
comparativement à la version originale du journal.
En fait, le premier
paragraphe, servant de tremplin au texte et reprenant des informations
contenues dans le reste de la critique, est souvent absent.
Par souci
d'homogénéité, même si nous possédions certains textes originaux. seules les
versions d'l nternet ont été retenues.
Ces quatre journaux ont publié 100 textes, critiquant 48 spectacles produits par
plus de 30 compagnies et présentés dans plus de 25 lieux (salles, maisons de la
culture, musées, etc.). Ces spectacles n'ont pas seulement été vus a Montréal.
mais aussi à Québec ainsi qu'à Paris. En effet, au journal Le Devoir, Rémy
Charest occupe le poste de correspondant de Québec et Christian Rioux. celui
de Paris.
De plus, ce journal fait paraître une chronique d'olivier Schmitt
provenant du journal français Le Monde. Robert Lévesque a également assisté
à quelques pièces présentées à Québec. Puisque nous nous concentrons sur
le contenu des critiques et non pas sur les pièces critiquées ni sur leurs lieux de
production, ces écarts géographiques ne biaisent pas notre recherche.
Ils
témoignent plutôt d'une ouverture d'esprit des journalistes.
Dans chaque journal, sauf au Journal de Montréal, la critique théâtrale est
assurée par une équipe de journalistes. Même si nous avons retenu toutes les
critiques pour notre tableau d'ensemble, les critiques eux-mêmes ne sont pas
tous considérés sur le même pied. Pour entrer dans la catégorie de critiques
principaux, le journaliste devait avoir fait paraître plus de quatre critiques
pendant la période qui nous intéresse. Ainsi, au journal La Presse, il s'agit de
Jean Beaunoyer et d'Yves Thériault. Pour Le Devoir, nous retrouvons Robert
Lévesque et Rémi Charest.
Au journal Voir, il y a Luc Boulanger, Isabelle
Mandalian et Marie Labrecque.
Le Journal de Montréal n'a qu'une seule
personne attitrée, Carmen Montessuit. Évidemment, parmi la catégorie dite de
critiques principaux, certains sont plus réguliers que d'autres. Nous avons établi
la catégorie de journalistes-vedettes pour tous les critiques qui signent plus de
12 textes.
II s'agit de Carrnen Montessuit, de Jean Beaunoyer, de Robert
Lévesque et de Luc Boulanger. Les critiques occasionnels, n'ayant écrit qu'un
texte. proviennent souvent d'une autre section du journal ou d'un autre média.
Ainsi, La Presse a fait voir un spectacle pour enfants B Sonia Sarfati, elle-même
auteure de romans pour la jeunesse.
Les autres critiques occasionnels de
théâtre sont, à La Presse, Manon Richard, Jocelyne Lepage et Jooned Khan;
puis, au journal Le Devoir, Christian Rioux, Marie-Michèle Cron, Michel Bélair et
Jacques Larue-Langlois.
Notre corpus regroupe ainsi 17 journalistes.
Le chapitre deux analysera les
données globalement (sans distinction de journal ni de journaliste).
Ceci va
nous permettre d'observer les sujets abordés dans l'ensemble des critiques.
Notre troisième chapitre séparera les données par journaux.
Ce chapitre va
nous indiquer si le contenu des critiques varie d'un journal à un autre. Dans le
quatrième chapitre, nous allons recouper les résultats en fonction des
journalistes-vedettes. Ainsi, nous pourrons comparer ces résultats avec ceux
des chapitres précédents et vérifier si ces journalistes-vedettes donnent le ton
au journal entier.
Pour analyser les critiques, nous nous sommes semi d'une grille bâtie par Hervé
Dupuis dans le cadre de son cours Critique de théâtreg. Cette grille comporte
13 points qui touchent tous
les aspects pouvant être présents dans une critique
théâtrale écrite. Ces points sont : l )l'auteur, 2) la fable, 3) la qualité du texte.
4) le contenu du texte, 5) le lieu théâtral. 6) la troupe, 7) la mise en scène, 8) la
scénographie, 9) le jeu,10) la réaction du public, 11) les mises en relation,
12) les impressions sur l'ensemble du spectacle et 13) la recommandation ou
non d'assister au spectacle. Notre travail consistera à décortiquer les articles
en fonction de cette grille. Voyons maintenant ce que recouvre chacun des
points de la grille.
Afin que le lecteur puisse se faire une idée claire de la
signification des points, nous les avons fait suivre d'exemples tirés de notre
corpus*
1) L'auteur
Ces informations sur I'auteur concernent sa vie personnelle, ses études, ses
engagements politiques, ses influences, etc. Ces indications biographiques,
facilement repérables, servent souvent d'entrée en matière à la critique. Parfois
ces données sont comparées avec la pièce vue ou avec l'œuvre de l'auteur.
« Dariel Dorfman, citoyen chilien exilé aux États-unis après le coup d'État de
1973, a écrit un suspense politique traduit en 20 langues [...].
N 'O
2) La fable
La fable, ou l'histoire, peut être racontée en entier, en partie ou seulement
dévoilée par une mise en situation.
« Donc, Claude, Simon et Suzanne arrivent dans ce chalet, dont le confort est
assez rudimentaire d'ailleurs (au grand dam de Suzanne), et qui ne comporte
même pas le téléphone. »"
3) La aualité du texte
Ce point est abordé lorsque le critique porte un jugement sur les aspects
esthétiques et littéraires du texte. II ne se limite pas à dire si la pièce est bonne
ou non. mais il se prononce sur la qualité du texte, la vivacité des dialogues. la
crédibilité des personnages. etc.
« La forme n'est guère mieux que le contenu. II y a un grave problème de
structure. Les personnages sont mal développés. »'*
4) Le contenu du texte
II ne faut pas confondre les deux derniers points. Le critique s'intéresse ici aux
valeurs politiques. sociales ou culturelles véhiculées par le texte.
« Ce théâtre en est un de la dérision totale, de l'ironie pure [...].
»13
5) Le lieu théatral
Ce point rassemble les informations portant sur la salle et sur la scène. Ce qui
touche à proprement parler au décor est abordé au point huit.
K
[...] sur la très large s c è n e du Théâtre d'Aujourd'hui [...].
d4
6) La troupe
Les informations apportées sur les producteurs et sur la troupe traitent des
budgets, des choix artistiques, du développement de la compagnie théâtrale, de
son historique, etc.
« [...] la directrice du Théâtre du Nouveau Monde a cru bon sortir des tiroirs [...]
Sainte-Jeanne-des-Abattoirs [..-1. Alors pourquoi un tel choix? »
'
7 ) La mise en scène
Sont regroupés ici les informations techniques et les choix artistiques assumés
par le metteur en scène ou sa formation.
« [...] la metteure en scène crée un rythme qui ne se dément jamais, ou l'action
réelle et le combat intérieur exprimés par chacun se mêlent sans transition et
composent des images saisissantes.
d6
8) La scénoaraphie
La scénographie englobe tout ce qui touche les arts de la scène,
a l'exception
- du jeu et de la mise en scène : les décors, les accessoires, les costumes, les
masques, les maquillages, les éclairages, la musique, la bande sonore, les
projections, les marionnettes et leurs concepteurs. Ce point de la grille a pris
une ampleur insoupçonnée en
raison des nombreux développements
technologiques des dernières années.
« Le décor change aussi à l'aide de grandes toiles peintes qui changent selon le
lieu où l'on se trouve. Le coup d'œil est très beau. d7
9)Le ieu
Les commentaires sur le jeu. très attendus des lecteurs, prennent différentes
formes, mais sont toujours facilement repérables.
« Au niveau du jeu des comédiens, il faut bien dire que France Castel évite de
surcharger le drame que vit son personnage et c'est, dans les circonstances, la
bonne attitude à prendre. »"
10) La réaction du public
Les réactions du public donnent une bonne indication de l'aspect général du
spectacle. II s'agit des rires, des applaudissements, des chahuts. des ovations,
etc.
« Et à la fin de la représentation, tout le monde s'est levé spontanément pour
applaudir chaleureusement les comédiens qui le méritaient bien.
dg
11) Les mises en relation
Le critique compare le texte a un autre texte, la production actuelie à une
production antérieure, la mise en scène à une autre du merne individu. etc. Ce
point permet d'enrichir la critique et de donner des repères aux lecteurs.
« Esprit libre, comme son grand prédécesseur Anton Tchekhov. et comme lui
médecin ayant choisi la littérature. Boulgakov avait naturellement un regard
critique sur son pays [.. -1. »20
12) Les im~ressionssur l'ensemble du s~ectacle
Ce point englobe les impressions générales sur l'ensemble du spectacle et qui
n'ont pu être insérées sous une autre catégorie (jeu, texte, fable, etc.)- C'est
l'opinion générale du critique sur la pièce a laquelle i f vient d'assister-
« II manque une vision forte et unique qui réussirait à resserrer toute cette
matière. n2'
13) La recommandation d'assister ou non au s~ectacle
N'est retenue sous ce point que la recommandation faite en termes clairs et
explicites et non pas celle que le lecteur déduit en analysant le ton employé ou
les propos tenus.
((
Une pièce à voir de grâce pour ne pas rater un souffle nouveau, un désespoir
génialement récupéré par le rire. »=
Précisons que les différents aspects d'une pièce ne devaient pas être
simplement évoqués mais bien critiqués par le journaliste pour être considérés
dans nos données. Ainsi, « La première pièce de Moliére, mise en scène par
Patrick Quintal, est fort divertissante » ne constitue pas une critique de la mise
en scène. Par contre, l'ajout suivant « La première pièce de Molière, mise en
scène par Patrick Quintal d'une façon très équivoque, est fort divertissante D"
comporte une critique du travail de mise en scène. Quelques mots font parfois
toute la différence.
Nous avons pu vérifier, grâce à notre recherche. I'exhaustivité de la grille
d'Hervé Dupuis : aucun point n'a été oublié et aucun point n'est superflu. Seule
la scénographie. comme nous l'avons mentionné plus haut, a dû être précisée.
En effet, puisque les hologrammes. les projections vidéo et autres médias sont
de plus en plus utilisés, il fut nécessaire d'ajouter ces éléments dans notre
inventaire touchant la scénographie.
Si la grille semble claire, elle est assez délicate à mettre en pratique.
Un
paragraphe n'équivaut pas nécessairement à un point précis, puisque souvent
l'auteur passe d'un sujet à un autre dans un même paragraphe, voire dans une
même phrase. II suffit d'un ou deux mots pour sauter d'un sujet à un autre. Par
exemple, Robert Lévesque écrit à propos de la pièce N Prise de sang » : « [...]
ce spectacle [...] aura manqué d'une idée principale, en plus d'un texte clair,
pour que l'affaire ait une colonne vertébrale théâtrale et un sens clair. nZ4. NOUS
passons donc du point 12 (impressions sur l'ensemble du spectacle) au point 3
(qualité du texte, en gras) pour revenir au point 12. Nous avons donc dû ranger
chaque mot ou groupe de mots de la critique sous l'un des treize points.
Par la suite, nous avons compté les mots présents dans chacune des catégories
et nous avons établi des pourcentages sur la fréquence et I'espace occupé par
chacun des 13 points dans l'ensemble de notre corpus. Nous présentons nos
pourcentages sous forme de tableaux afin d'en faciliter la compréhension.
Nous avons effectué trois types de calcul : la fréquence d'apparition. I'espace
global et I'espace ciblé.
Ces trois opérations se distinguent par de subtiles
différences. La fréquence d'apparition concerne le nombre de fois que chaque
point est traité par un critique dans l'ensemble de ses articles. L'espace global
désigne I'espace qu'occupe un point dans la production entière d'un critique. Et
I'espace ciblé indique I'espace qu'un point accapare dans les textes où il est
abordé. Par exemple, nous pouvons calculer qu'un point occupe 8% d'espace
dans un texte, mais, si nous ne tenons compte que des articles dans lesquels ce
point est traité (par exemple 4 articles sur IO), alors le pourcentage d'espace
ciblé grimpe à 13%.
Nos méthodes de calcul sont purement statistiques. Pour connaître la fréquence
d'apparition d'un point dans la production d'un journaliste, nous divisons le
nombre de fois qu'un point est présent par le nombre total de critiques. Par
exemple, le point 1 revient cinq fois parmi les 22 critiques de Carmen
Montessuit, pour un pourcentage de 22% (5 1 22 X 100 = 22%). Le point sur
l'auteur est aborde 22% des fois dans les articles de cette journaliste du Journal
de Mont&al.
Pour obtenir les résultats de I'espace ciblé ou global, le calcul se complexifie.
Tout d'abord, nous calculons le nombre total de mots de la critique. Ensuite
nous subdivisons l'article en autant de points qu'il contient et répartissons les
mots en conséquence.
Ces premiers calculs complétés, nous divisons le
nombre de mots pour chaque point par le nombre total de mots de l'article et en
établissons le pourcentage.
Ainsi, le nombre de mots traitant du point 1 dans la critique Havel... sous le
manteau de Carmen Montessuit est de 30, ce qui représente un pourcentage de
9% (30 1 322 X 100 = 9%). Nous avons procédé de cette façon pour chacun
des points dans l'ensemble de notre corpus.
Afin de déterminer l'espace global, nous additionnons les pourcentages de
chaque point, puis les divisons par le nombre total d'articles du critique examiné.
Par exemple, le point 1 apparaît à l'intérieur de cinq critiques de la production de
Carmen Montessuit, avec 9% dans une première critique, 9% dans une
seconde, 8% dans une troisième, 7% dans une quatrième et 1% dans une
cinquième pour un total de 34%.
Comme nous avons recensé 22 articles
cette critique, ce point occupe 1,5% de l'espace de ces écrits. Cependant,
point n'étant développé que dans cinq articles, l'espace ciblé affiche plutôt 6.8%
(34% / 5 = 6,8%).
En général, la cueillette des données n'a pas posé trop de problèmes, sauf
lorsque le critique abordait des sujets peu connus. Dans ce cas, il a été plus
ardu de classer tel ou tel fragment dans un point précis de la grille.
Par
exemple. Robert Lévesque écrit, dans une critique sur The Master and
Margarita, un premier paragraphe sur la vie de l'auteur de la pièce, Mikhaii
Afanassievitch Boulgakov, puis il enchaine avec un paragraphe portant sur
Courteline, dans lequel il fait allusion aux "messieurs-les-ronds-de-cuir".
II
revient ensuite à la vie de Boulgakov. Si le lecteur ne connaît pas l'écrivain
Georges Courteline, auteur de Messieurs les ronds-de-cuir, il lui est ditficile de
comprendre que Robert Lévesque met en parallèle sa vie avec celle de
Boulgakov. Le lecteur peut même croire qu'il s'agit d'un résumé de la fable, car
nulle part ailleurs le critique n'en reparle.
Lors de notre recherche, nous n'avons pas tenu compte de la mise en page du
texte, de sa place dans le journal, ni des images pouvant accompagner les
articles. Ce travail s'éloignait de l'étude de contenu que nous nous proposions
de faire. D'ailleurs, le journaliste n'a aucune emprise sur de telles décisions
rédactionnelles.
Nous ne cherchons pas à établir dans cette étude si un critique est meilleur
qu'un autre. ni si un point de fa grille est plus essentiel qu'un autre.
Nous
voulons uniquement recenser le contenu des articles de théâtre critiqués. Nous
ne croyons pas non plus que le nombre de points traités dans une critique
puisse servir d'indicateur de qualité. Même si en moyenne le nombre de points
abordés dans une critique est de sept, nous avons retrouvé, dans une même
critique. onze points différents. Nous vous proposons, dans le chapitre suivant,
une analyse globale du contenu des articles retenus.
9-Ce cours portait le sigle FRR 109 et était donné à I'Universite de Sherbrooke dans le
baccalauréat en Études françaises. Nous l'avons suivi pendant la session d'hiver 1996.
10-BEAUNOYER, Jean. c La jeune fille et la mort:
sagement », La Presse, 3 novembre 1994, p. 013.
une excellente pièce montée trop
11-MONTESSUIT, Carmen. K Claude ou les désarrois amoureux : un nouvel auteur plein de
talent servi par de bons comédiens D, Le Journal de Montréal, 14 septembre 1994, p. 56.
12-BOULANGER. Luc.
<< Prise de sang: Pas de veine
D,
Voir, 15 septembre 1994.
13-LÉVESQUE, Robert. Havel... sous le manteau : Jouer Havel ouvertement », Le Devoir,
15 septembre 1994, p. B8.
14-BEAUNOYER, Jean. a Les Muses orphelines :
québécoise », La Presse, 21 octobre 1994, p- A10.
Une belle pièce de la dramaturgie
15-LEVESQUE.Robert. <( Jeanne Dark : Un Brecht à {'esthétiquetotalitaire », Le Devoir,
22 novembre 1994, p. B8.
16-MANDALCAN, Isabelle.
(C
Eddy : Coup de cœur
D,
Voir, 20 octobre 1994.
17-MONTESSUIT, Carmen. « Arlequin, serviteur de deux maîtres : Étourdissant! D, Le Journal
de Montréal. 18 novembre 1994, p. 49.
18-BEAUNOYER,Jean. u Johnny, Carlotta et Kiki : Un Trernblay qui se digère fort bien »,
La Presse, 12 novembre 1994, p. ES.
19-MONTESSUIT, Carmen. K Claude ou les désarrois amoureux : Un nouvel auteur plein de
talent servi par de bons comédiens B, Le Journal de Montréal, 14 septembre 1994, p. 56.
25
20-LÉVESQUE, Robert. a Un Courteline de Moscou ID, Le Devoir, 6 octobre 1994, p. B8.
21-MANDALIAN, Isabelle. a Haché menue comme chair à pâté », Voir,27 octobre 1994.
22-BEAUNOYER, Jean- a Tout va pour le mieux : Au Rideau Vert. La surprise de la saison
La Presse, 12 novembre 1994, p. E l 5.
23-11 ne s'agit pas de citations réelles, mais d'exemples forgés de toutes pièces24-LEVESQUE, Robert. « Un Zone des années néonazies », Le Devoir, 19 septembre 1994,
p. B8-
P.
DEUXIÈME CHAPITRE
ANALYSE GLOBALE DU
CONTENU DES ARTICLES
Dans ce chapitre, nous examinerons chacun des treize points de la grille
d'analyse en fonction de l'ensemble de notre corpus. Nous les présentons en
ordre décroissant de fréquence d'apparition. soit du jeu jusqu'au lieu théâtral. La
figure 2.1 (voir la page suivante) donne une vision globale des résultats. Pour
illustrer nos propos, nous avons parfois ajouté quelques exemples probants.
LE JEU, 89%
Des remarques concernant le jeu sont présentes neuf fois sur dix dans une
critique.
Évidemment ce jugement reste assez subjectif.
Un critique peut
trouver qu'une comédienne n'a pas de présence sur scène, tandis qu'un autre
peut affirmer le contraire. Cela s'est produit. par exemple, pour Maude Guérin
dans la pièce Après la chute.
Les termes pour décrire le jeu ne varient pas beaucoup d'un article à l'autre.
Les plus fréquents sont. bien entendu, les adjectifs passe-partout tels que
"bon", "juste", "professionnel" et "crédible". « Tous les deux jouent d'ailleurs
avec une grande justesse et une grande sobriété. Josée-Frédérique Plourde
est également très bonne (. ..). »"
Parfois les critiques choisissent des adjectifs plus relevés lorsqu'ils abordent la
dimension "émotive" du jeu. II sera alors question de jeu "cinglant", "solide" et
"intense". « (...) interprété avec fougue par Robin Aubert (. ..).
»26
28
Figure 2.1
Comparaison des 13 points sur l'ensemble du corpus
O Frtquence d'appannon
!
Espace
I
global
.OEspace cible
Ces qualificatifs sont suivis ou précédés par des termes qui leur donnent une
connotation positive ou négative. Plus fréquemment, les blâmes touchent la
direction d'acteur ou la mise en scène. et l'acteur récolte la plupart du temps des
félicitations pour sa performance.
LA QUALITE DU TEXTE. 80%
Présente quatre fois sur cinq dans les critiques, la qualité du texte n'occupe
cependant pas un très grand espace.
II s'agit généralement de quelques
groupes de mots surgissant, ici et là, dans le texte.
Par exemple, Jean
Beaunoyer de Le Presse a écrit au sujet de la pièce La jeune fille et la mod :
« Voilà le suspense de cette pièce admirablement écrite [...] ». II ajoute un peu
plus loin : u Un texte d'une qualité indiscutable [...]
remarque :
K
D.
II termine par cette
La pièce est longue (deux heures et demie) avec des répétitions
dans le texte de Paulina .»'?
tes critiques ne cherchent pas nécessairement à blâmer ou à défendre les
textes écrits en français international ou en joual, mais plutôt à justifier le choix
de la langue en fonction des intentions de l'auteur. La critique de la qualité du
texte touche également au rythme, aux dialogues, aux répétitions, au
vocabulaire et à l'aspect général du texte.
LES IMPRESSIONS SUR L'ENSEMBLE DU SPECTACLE. 72%
En troisième position vient le point douze, les impressions sur l'ensemble du
spectacle, ex æquo avec la mise en scène. C'est sans doute l'un des points
qui intéressent le plus le lecteur et l'éventuel spectateur.
Habituellement, ce
point est traité en entrée en matière ou en conclusion d'une critique.
tA MISE EN SCÈNE. 72%
La mise en scène arrive également en troisième position avec un score de 72%.
Partie intégrante de toute représentation, elle colore le spectacle, lui donne tout
son sens. Le critique peut donc difficilement l'ignorer.
S'ils reconnaissent son importance, les journalistes n'en parlent pas tous avec la
même acuité. Nous pouvons les ranger en deux groupes : ceux qui condensent
leurs opinions en quelques mots et ceux qui utilisent près du quart de l'espace
pour étayer leurs propos. Nous pourrons vérifier ces faits dans les chapitres
suivants.
LA FABLE. 71%
II semble important pour les critiques de narrer la fable de la pièce. En fait, ils le
font sept fois sur dix. Aborder ce sujet dans un article est souvent un incitatif à
aller voir ou non la pièce.
La plupart du temps, les critiques résument la
31
situation, présentent les différents personnages et ne dévoilent jamais
clairement le dénouement. La fable occupe aussi près du quart de l'espace de
l'article.
Les critiques n'abordent pas la fable dans le cas de pièces
expérimentales, difficilement "résumables", ni lorsqu'ils insistent sur le contenu
du texte.
LE CONTENU DU TEXTE. 69%
Bien qu'en général ce point soit présent a 69% dans les articles, tous les
critiques n'y font pas référence systématiquement. Rappelons que ces chiffres
sont des moyennes, ainsi certains journalistes en parlent six à dix fois sur dix,
tandis que d'autres se contentent de deux a cinq fois sur dix. Précisons que les
résultats du contenu du texte et ceux de la fable sont en général inversement
proportionnels. Certains, par exemple, vont préférer traiter de l'aspect politique
de la pièce plutôt que d'en raconter l'histoire.
Si les critiques insistent près de six fois sur dix sur des éléments de la
scénographie, ils approfondissent rarement le sujet. Les journalistes se limitent
souvent à des généralités, voire à des banalités. Nous avons droit à de simples
descriptions du décor et des accessoires ou à quelques appréciations vagues,
32
telles que a [...] au décor sans invention ni charme B~~ et a des éclairages
soignés. une musique soutenue »".
LES MISES EN RELATION. 56%
Présent plus d'une fois sur deux, ce point ne reçoit pas la même attention selon
le journaliste, comme nous le verrons dans le chapitre quatre. Contentons-nous
de mentionner pour l'instant que quelques-uns y font rarement référence (par
exemple, Isabelle Mandalian avec 9%). tandis que d'autres lui accordent une
assez grande attention en ne lui laissant pas nécessairement beaucoup
d'espace (comme Carmen Montessuit avec 36% d'utilisation et 8% d'espace) et
qu'un petit nombre en font leurs choux gras (Jean Beaunoyer avec 91%
d'utilisation et Robert Lévesque avec 100%).
Tous n'insistent pas sur les mêmes éléments. Certains comparent la pièce avec
des textes de répertoire ou des œuvres littéraires, d'autres font des
rapprochements avec des pièces plus populaires. Nous sommes conscient que
le public visé par chaque journal peut avoir une influence sur les propos tenus
par les critiques.
LA TROUPE. 38%
Malgré le fait que des renseignements sur la troupe soient inclus dans les
programmes et documents de présentation des pièces, les critiques en parlent
rarement dans leurs articles.
La mention même du nom de la troupe est
souvent absente. peu importe que les troupes soient reconnues ou nouvelles.
Les thèmes abordés sous ce point tournent essentiellement autour des
décisions de la direction : choix de la distribution. choix de la pièce, choix du
metteur en scène, etc.
LA RECOMMANDATION D'ASSISTER OU NON AU SPECTACLE, 35%
Plusieurs personnes associées a la colonie artistique affirment que la
fréquentation d'un spectacle ou le fait qu'une pièce soit retirée de l'affiche
découle en grande partie des critiques.
travail du critique est
guichet.
tc
Jean-Claude Germain croit que le
précieux par la relation étroite qu'il entretient avec le
II est précieux dans le sens que, de ses critiques, dans le cas de
certains critiques, dépend la fréquentation du théâtre. ngO Or nous avons
constaté que les critiques ne donnent clairement leur recommandation qu'en
moyenne trois fois sur dix. De plus, dans les trente critiques où cet avis est
présent, quatre seulement déconseillent le spectacle au lecteur. Que faut-il en
déduire? Que les lecteurs se font souvent une opinion à partir du ton général de
34
.
la critique? Sans doute. Mais il faut aussi tenir compte de la forte influence des
critiques radiophoniques et télévisuelles ainsi que du bouche à oreille,
phénomène indiscutable mais difficilement vérifiable.
Bref, la destinée d'une
pièce de théâtre ne dépend pas uniquement d'une recommandation d'un
journaliste.
L'AUTEUR, 31%
La vie d'un auteur, les conditions dans lesquelles il a écrit son œuvre, l'époque
où iI a vécu, ses influences littéraires, sa vie politique, voilà autant d'éléments
qui peuvent nous éclairer sur le contenu d'une pièce, sa signification et sa
portée. Pourtant le point sur I'auteur est à peine présent trois fois sur dix et
n'occupe environ que 5% du texte.
La notoriété d'un auteur sera parfois exploitée par un critique dans l'espoir sans
doute d'amener le lecteur à lire tout l'article. Le nom de l'auteur figurera alors
en début de texte. Le nouvel auteur n'aura pas cette chance, puisque son nom,
lonqu'il sera mentionné, passera souvent inaperçu à l'intérieur de l'article.
LA RÉACTION
DU PUBLIC. 20%
La réaction du public est peu évoquée dans les critiques théâtrales que nous
avons dépouillées. En fait, plusieurs journalistes évacuent totalement ce point.
Ceux qui l'abordent se contentent de mentionner les ovations, le nombre de
rappels. la chaleur et la durée des applaudissements,... Même les pièces qui.
en général, suscitent de fortes réactions du public (théâtre expérimental. théâtre
pour enfants, etc.) ne modifient en rien les habitudes des critiques.
LE LIEU THÉÂTRAL. 14%
Le lieu théâtral est \e point le moins souvent abordé dans notre corpus. II ne
récolte qu'un maigre 14%.
mention.
Certains journalistes n'en font même jamais
Tout au plus le sujet est-il parfois effleuré!
Jean Beaunoyer, par
exemple, a écrit à propos de la pièce Les Muses orphelines : « Une table pour
chacun des quatre personnages sur la très large scène du Théâtre
d'aujourd'hui. »31 Parfois un commentaire sur le lieu théâtral sert à d'autre fins.
Ainsi la remarque suivante concernant la pièce Les noces d'Antigone porte
davantage sur le jeu d'un acteur: a Dans une si petite salle, un travail visant à
livrer le maximum d'émotion se perd parce qu'il en fait trop.»32 Ce point est
généralement exploité par les journalistes qui écrivent de France. Ils prennent
soin de transmettre des indications sur des salles que la plupart des Québécois
n'ont jamais visitées.
Comme nous venons de le voir. les treize points ne sont pas tous traités de la
même façon ni dans les mêmes proportions.
Cependant, les données
changent-elles lorsque nous les distribuons en fonction des journaux et des
critiques? Dans le chapitre trois. nous ciblerons l'analyse des treize points en
fonction des journaux-
Note
25-MONTESSUIT, Carmen. a Havel... sous le manteau : une pièce "interdite », Le Journal de
Montréal, 12 septembre 1994, p. 47.
26-MANDALIAN, Isabelle. u Eddy : Coup de cczur
y,
Voir, 22 octobre 1994.
27-BEAUNOYER, Jean. a La jeune fille et la mort :
sagement », La Presse, 3 novembre 1994, p. D l 3.
28-LÉVESQUE, Robert. a Le temps des mouettes.
mise en scène », Le Devoir, 4 octobre 1994, p. B8.
29-BOULANGER, Luc.
K
une excellente pièce montée trop
Retour décevant d'André Brassard a la
Prise de sang. Pas de veine n Voir, 15 septembre 1994.
30-GERMAIN, Jean-Claude.
1979, p. 74-75.
((
Entretien (s) u, Cah~ersde théâtre Jeu, no13, Montréal, automne
31-BEAUNOYER, Jean. (( Les Muses orphelines : une des belles pièces de la dramaturgie
québécoise », La Presse, 21 octobre 1994, p. A10.
32-CHAREST, Remy. La Brigade du nie contre-attaque, Fe Devoir, 4 octobre 1 994, p. 87.
TROISIÈME CHAPITRE
ANALYSE DES ARTICLES EN FONCTION
DU JOURNAL D'APPARTENANCE
Le chapitre précédent démontre que les treize points de la grille d'analyse ne
sont pas présents dans les mêmes proportions ni à la même fréquence. Nous
répartissons cette fois nous donnée en fonction du journal d'appartenance des
articles. Nous pourrons vérifier si chaque journal insiste davantage sur certains
sujets plutôt que d'autres. Les quatre journaux ont fait l'objet d'une figure où
sont regroupées les différentes statistiques de leurs journalistes respectifs.
Carmen Montessuit signe à elle seule les 22 critiques de théâtre du Journal de
Montréal pendant la période qui nous intéresse. Dès le premier coup d'œil. les
points 2 (la fable) et 9 (le jeu) ressortent. Ce sont eux aussi qui occupent le plus
d'espace global et ciblé. En effet, ils accaparent 42% et 24% d'espace global et
ciblé. tandis que les autres points ne prennent qu'entre 13% et 0'4%.
Peu importe qu'on utilise la fréquence, I'espace global ou I'espace ciblé, les
mêmes points se classent toujours au même rang les uns par rapport aux
autres, sauf le lieu théâtral. Le point 5 arrive dernier en fréquence et en espace
global, mais huitième en espace ciblé. Ainsi, lorsque ce point est présent dans
une critique, il occupe beaucoup d'espace.
Si nous comparons ces données avec celles de tous les journaux confondus
(voir le chapitre précédent), nous constatons que Le Journal de Montréal parie
Figure 3.1
Le Journal de Montréal
9
Jeu
~UFr6qucncedappanhon
!.Espace
global
I O k ~ a c cible
e
1 du wblic i
relation
1
sions
!mandabon/
beaucoup moins du point six (la troupe) et insiste davantage sur la fable, la
réaction du public et la recommandation d'assister ou non au spectacle.
Les points que Carmen Montessuit critique le plus fréquemment (la fable. le jeu,
la réaction du public et les impressions générales) n'exigent pas une longue
démonstration. Nous avons l'impression que cette critique tente de répondre
simplement aux attentes de ses lecteurs
(K
Était-ce bon? m), sans toutefois
s'encombrer de longs arguments qui étaleraient sa culture
À La Presse, six journalistes se partagent la tâche d'aller au théâtre. Ils signent
21 articles du 11 septembre au 29 décembre 1994. pour une moyenne de 1.3
pièce par semaine, soit un peu moins que Carmen Montessuit du Journal de
Montréal. Ils semblent se diviser les productions en fonction de leur genre : le
premier assiste surtout aux productions classiques des compagnies reconnues
(Théâtre du Nouveau Monde, Théâtre d'aujourd'hui, Théâtre Jean-Duceppe); le
second, à des pièces un peu plus en marge (Prise de sang, Equus) et,
finalement, les quatre autres se partagent le théâtre pour enfants, le théâtre
anglophone et le théâtre expérimental.
Leurs commentaires sur les pièces
s'avèrent presque toujours positifs, parfois légèrement mitigés, mais jamais
négatifs (à l'exception d'un article de Jean Beaunoyer).
Figure 3.2
La Presse
Pour avoir une vue d'ensemble de la critique de La Presse, nous avons
regroupé les données en un seul tableau. sans différencier les journalistes.
Comparées aux statistiques générales sur l'ensemble du corpus (figure 2.1). les
fréquences d'apparition. d'espace global et d'espace ciblé dans le journal La
Presse se ressemblent beaucoup. Ainsi. la mise en scène. la fable et le jeu sont
aux premiers rangs, tandis que l'auteur, la réaction du public et le lieu théâtral
amvent bons derniers. Les deux seules différences concernent le point quatre
(le contenu du texte théâtral) et le point deux (la fable). En effet. ces points se
classent en première et deuxième positions au journal La Presse, tandis qu'en
général, ils n'occupent que la quatrième et la cinquième positions. Pour les
critiques de ce journal. l'histoire et les messages (ou les morales)
des pièces
paraissent capitaux.
Au journal Le Devoir, sept personnes ont rédigé des critiques de théatre. Les
publications de leurs articles se sont échelonnées du 15 septembre au 28
décembre 1994, soit plus d'une critique par semaine.
Le critique le plus
important, en termes de quantité, est Robert Lévesque qui, à lui seul,a signé 18
critiques et vu 19 spectacles en 11 semaines (la plupart à Montréal et quelquesuns à Québec). Sa productivité se compare à celle de Carmen Montessuit du
Journal de Montréal. Rémy Charest, pour sa part. a sufiout couvert la
production théâtrale de Québec. II a vu quatre pièces entre le 30 septembre et
le 11 novembre 1994.
Les cinq autres pièces ont été critiquées par cinq
joumaiistes différents, entre le 11 octobre et le 28 décembre 1994, dont un
correspondant de France.
Comme pour le journal La Presse, nous avons regroupé les statistiques de tous
ces critiques pour définir le portrait de la critique théâtrale au journal Le Devoir-
Cespace global étant presque l'équivalent de I'espace ciblé, les données varient
peu selon le point de vue adopté. Aucun point, par exemple. n'apparaît qu'une
seule fois et accapare tout I'espace d'un article. Les éléments semblent être
traités avec une égale assiduité.
En comparant les résultats de fréquence du Devoir avec ceux de l'ensemble du
corpus, nous constatons aussi peu de variantes : qualité du texte, jeu et mise en
scène figurent dans les premières positions; le lieu théâtral et la réaction du
public se classent en dernière position; tandis que les autres points se
retrouvent entre ces deux pôles. La seule grande exception concerne la mise
en relation (point onze).
En effet, ce point arrive en tête de liste avec une
moyenne de 93%, alors qu'en général, il n'est présent qu'un peu plus d'une fois
sur deux. De plus, l'espace occupé par ce point est au moins deux fois plus
important que pour les deux autres quotidiens de notre corpus.
Faut-il se
Figure 3.3
Le Devoir
surprendre de ce résultat? Afin de bien traiter de la mise en relation, le critique
doit posséder une vaste culture théâtrale. littéraire et générale. De même, pour
apprécier le contenu, les lecteurs doivent jouir d'une connaissance assez élevée
du milieu théâtral.
Comme la très grande majorité des lecteurs du Devoir
possèdent un diplôme universitaire, nous voyons là une confirmation du rôle
intellectuel que joue Le Devoir dans la société québécoise.
Pour le journal Voir, nous avons tenu compte des 32 critiques signées par trois
journalistes, qui se sont réparti respectivement 15, 11 et 6 articles entre le 15
septembre et le 15 décembre 1994.
Voir, le plus jeune journal de notre corpus, a critiqué 11 pièces dont ses
concurrents n'ont pas parle.
Même Le Devoir, qui mise pourtant sur un
correspondant a Paris et un autre à Québec, n'atteint pas un swre aussi élevé.
En assistant à des pièces moins publicisées ou moins connues, Voir innove et
donne un portrait plus complet de l'activité théâtrale de Montréal. Mentionnons
toutefois que cet hebdomadaire distribue gratuitement jouit d'une spécificité
"cuIturelle" que
ne détiennent pas les trois quotidiens de notre corpus. Les
résultats de la fréquence d'apparition et de l'espace global 8 ce journal
respectent la même distribution. Les points les plus fréquents, tels que la mise
en scène, le contenu du texte, le jeu et la qualité du texte, occupent aussi le plus
d'espace.
Cependant, lorsqu'on examine l'espace ciblé de chaque point, un écart notable
s'impose en ce qui concerne le lieu. En espace global et en fréquence. ce point
arrÏve au onzième rang, tandis qu'en espace ciblé. il trône au premier rang. En
fait. ce point est rarement présent dans les critiques. mais, lorsqu'il est abordé. il
occupe une très grande place.
Les résultats concernant la fréquence des points dans Voir ressemblent assez
aux résultats de l'ensemble de notre corpus, a l'exception du point quatre, le
contenu du texte. Tous journaux confondus. ce point arrive en sixième position.
alors qu'à Voir, il se classe troisième. De plus, il couvre une grande place dans
les critiques puisqu'ii décroche la deuxième position dans les tableaux d'espace
global et ciblé. Inversement. le point sur la fable, présent une fois sur trois, se
retrouve en septième place au lieu de la quatrième position au classement
général.
Nous en concluons qu'au journal Voir, le contenu du texte théAtral est
primordial. Les idées et les messages véhiculés dans une pièce priment sur
l'histoire qu'elle raconte. Ce qui confirme l'orientation culturelle de cet
hebdomadaire.
Figure 3.4
Voir
1O
Jeu
Trois journaux sur quatre se démarquent donc par au moins un point de notre
grille d'analyse. Le Journal de Montréal laisse beaucoup de place à la fable et
au jeu, Le Devoir favorise les mises en relation, le journal Voir insiste sur le
contenu du texte, Seule La Presse touche un peu à tout et ne se distingue pas
vraiment par rapport aux autres journaux et, de ce fait, du corpus global.
Nous nous proposons maintenant d'examiner le contenu des articles des
journalistes-vedettes des quatre journaux, puis de les comparer aux résultats
déjà obtenus. Nous serons ainsi en mesure d'établir si la production individuelle
corrobore les données recueillies pour chaque journal.
QUATRIÈME CHAPITRE
ANALYSE DES ARTICLES
DES JOURNALISTES-VEDETTES
II est très fréquent qu'un acteur soit identifié a une troupe de théâtre précise,
comme Michel Dumont à la Compagnie Jean-Duceppe. II en va de même pour
certains journalistes. Quiconque lit des critiques de théatre associera Carmen
Montessuit au Journal de Montréal et Robert Lévesque, au journal Le Devoir (du
moins pour la période étudiée), parce qu'ils signent la plupart des articles. Ce
sont les critiques de théâtre vedettes de ces journaux.
Les deux autres que
nous avons retenus, sur la base du critère quantitatif, sont Jean Beaunoyer (La
Presse) et Luc Boulanger (Voir).
Nous cherchons à vérifier si le contenu des critiques de ces journalistesvedettes va dans le sens des résultats obtenus dans les chapitres précédents
ou s'il démontre une certaine singularité. De plus, nous nous intéresserons à
l'appréciation générale que les critiques font des différentes pièces (positive.
négative ou mitigée). Nous verrons si les réputations de chacun sont fondées.
Puisqu'au Journal de Montréal il n'y a qu'une seule personne attitrée à la
critique de théâtre (Carmen Montessuit), nous renvoyons le lecteur au début du
chapitre précédent s'il désire consulter à nouveau les données.
Nous
reproduisons toutefois les résultats à la page suivante.
Le critique principal du journal La Presse, Jean Beaunoyer, signe à lui seul 12
articles entre le 14 octobre et le 20 décembre 1994. Nous pouvons classer en
Figure 4.1
Carmen Montessuit
trois groupes les thèmes qu'il aborde. Beaunoyer, un homme de lettres, accorde
beaucoup d'importance au texte, qu'il décortique 9 fois sur 10 grâce aux points
2, 3 et 4 (la fable, la qualité du texte et son contenu). Le deuxième groupe
touche la partie
spectacle » de la pièce, soit les points 7, 8, 9 et 12 (la mise en
scène, la scénographie, le jeu et les impressions sur l'ensemble). II traite de ces
points en moyenne 8 fois sur 10, c'est-à-dire à 75% pour la mise en scène, à
66% pour la scénographie, à 100% pour le jeu et à 75 % pour les impressions
sur l'ensemble.
Le dernier groupe englobe les éléments extérieurs à la
représentation : les références sur l'auteur (point 1, 41%), le lieu théâtral (point
5, 25%), la troupe (point 6, 41%), la réaction du public (point 10, 25%) et la
recommandation d'aller ou non au spectacle (point 13, 33%).
Seule la mise en
relation, point plus fréquent chez Jean Beaunoyer que chez la majorité des
critiques de La Presse, ne fait partie d'aucun des trois groupes.
En effet,
comme son nom l'indique, elle met en relation différents points (le jeu avec un
autre jeu, un texte avec un autre, un genre avec un autre, etc.). Ce point, avec
une présence très élevée de 91%, sert surtout au critique à faire des
rapprochements entre la production présente et des productions antérieures ou
avec d'autres œuvres (cinématographiques, littéraires, etc.).
Jean Beaunoyer écrit des textes assez homogènes, c'est-à-dire qu'aucun point
n'occupe la majorité de l'espace, tous ont une place équitable si on se réfère
Figure 4.2
Jean Beaunoyer
'OFrûquena d'appamn
I Espace giobar
ia Espace cible
aux données réparties sur l'ensemble du corpus.
D'ailleurs, i f existe peu de
différences entre les résultats de l'espace global et ceux de l'espace ciblé.
Robert Lévesque, le plus connu des critiques que nous étudions, s'avère sans
doute aussi le moins apprécié de la communauté théâtrale. Il aime rarement les
pièces qu'il voit (seulement 6 pièces sur 19) et formule sans ménagement ses
commentaires. Lors de ses études à ['Université Laval, il a fait partie de la
Troupe des Treize.
comédien.
II connaît donc bien les enjeux reliés au métier de
Cultivé et lettré, il élabore longuement sur presque chacun des
points de notre grille, qui reviennent entre 61% et 100%.
Seuls trois points
attirent rarement ou jamais son attention : le point 13 (la recommandation
d'assister ou non au spectacle, 11%), le point I O (la réaction du public, 5%) et le
point 5 (le lieu théâtral, 0%). II est l'unique critique à toujours faire des mises en
relation et à leur consacrer beaucoup d'espace (global et ciblé), soit 13,2% en
moyenne.
Robert Lévesque aborde pratiquement tous les points, même s'il ne leur laisse
pas toujours un grand espace. S'il se positionne souvent en marge des autres
critiques et de la communauté théâtrale, il argumente en long et en large pour
justifier ses points de vue.
Figure 4.3
Robert Lévesque
Au journal Voir, Luc Boulanger a assisté à 15 pièces sur une période de deux
mois, ce qui donne près de deux critiques par semaine.
Les fréquences
d'apparition mettent en valeur les mêmes points que I'espace global. Ainsi la
qualité et le contenu du texte, la mise en scène et le jeu surviennent
fréquemment et prennent beaucoup de place, tandis que la réaction du public et
la recommandation arrivent en queue de peloton. Cependant, en espace ciblé,
il en est tout autrement. Par exemple, le lieu théâtral, qui n'occupe que peu
d'espace global (3.1%) et dont la fréquence paraît faible ( 6.7%), accapare le
plus d'espace réel (46%)! La même chose se produit avec le point sur la troupe.
À obsewer les critiques de Luc Boulanger, nous constatons qu'il ne respecte
pas de canevas de base. Aucun point ne revient dans tous ses textes. Le point
le plus présent (la mise en scène, avec 93%) s'étend en moyenne sur 17.5% de
l'espace (global et ciblé), tandis que le point le moins souvent critiqué (le lieu
théâtral, avec 6%) prend près de la moitié du texte (46%) dans lequel il apparaît!
Boulanger semble insister sur certains points de notre grille en fonction des
aléas des représentations davantage que d'habitudes rédactionnelles bien
intégrées.
Les critiques abordent les mêmes points, mais dans des proportions et des
pourcentages bien différents.
En comparant ces résultats avec ceux des
chapitres précédents, nous confirmons que le critique-vedette colore nettement
Figure 4.4
Luc Boulanger
le journal pour lequel il travaille. Tout en ne perdant pas de vue qu'il s'agit de
pourcentage, Carrnen Montessuit. par exemple, met l'accent sur le jeu et la
fable. Jean Beaunoyer, par l'homogénéité de ses textes, reflète bien le contenu
des critiques théâtrales de son journal. De son côté, Robert Lévesque multiplie
les mises en relation autant, sinon plus, que le reste de ses confrères au DevoirFinalement, Luc Boulanger présente les éléments qui l'ont le plus frappé, en
accordant une place de choix au texte et à l'aspect culturel d'un spectacle, par
l'utilisation des points 3 et 4.
Nous n'avons pas encore abordé le point qui porte sur la cote générale de la
critique, à savoir si elle est positive, négative ou mitigée. II est assez aisé de les
coter.
Si la majorité des points critiqués le sont de façon favorable, nous
considérons l'article comme positif. II en va de même pour une cote négative.
Si par contre, l'opinion émise est plutôt partagée, nous attribuons la cote
mitigée. II est arrivé, quelques rares fois, que nous avons dû prendre une
décision en fonction du ton général employé par le critique dans l'article. Peutêtre est-ce là que résident les plus grandes différences entre les critiques?
Sur vingt-deux critiques répertoriées au Journal de Montréal dans la période
donnée, seize sont positives, cinq négatives et seulement une est mitigée. De
plus, dans ces six dernières critiques, la journaliste s'excuse de ne pas avoir
vraiment apprécié le spectacle (pour différentes raisons) : u C'est vrai que dans
les pièces classiques on a chacun sa vision sur la façon de jouer ou sur la
distribution. (. ..) Mais les avis sont partagés là-dessus! ng C a n e n Montessuit
conseille toutefois aux lecteurs d'assister quand même au spectacle pour se
former
leur propre opinion : « Bref,
c'est
un
style de théâtre que,
personnellement, je ne prise pas beauwup, mais peut-être aimerez-vous ça! »"
Ainsi Carmen Montessuit donne quelques commentaires, mais elle invite les
gens a aiguiser eux-mêmes leur sens critique.
Jean Beaunoyer a critiqué douze pièces de théâtre : sept ont reçu une cote
positive, une seule fut négative et quatre furent mitigées. Lorsque nous
examinons de plus près les cn'tiques non positives, nous constatons que le
journaliste déplore certains jeux ou éléments de mise en scène qui n'émeuvent
pas ou paraissent inégales, ainsi que tout ce qui touche au texte, soit les
thèmes, les sujets et la traduction. Au journal La Presse, très peu de pièces
semblent inintéressantes ou carrément mauvaises. Presque toutes mériteraient
d'être vues.
Tout comme Carmen Montessuit, Jean Beaunoyer multiplie les
critiques favorables aux spectacles.
Robert Lévesque du Devoir représente l'image type du critique aguerri. C'est
sans doute celui qui a assisté au plus grand nombre de spectacles différents et
qui a lu et vu beaucoup de pièces d'ici et d'ailleurs. Nous serions portée à croire
qu'il serait aussi le plus respecté par la communauté artistique. Or tel n'est pas
le cas! En fait, Robert Lévesque est plutôt craint et détesté par la gent théâtrale.
Certaines personnes ont même exigé, par pétition, son renvoi du Devoir. Le
journal n'a pas acquiescé à cette demande, mais a alimenté le débat dans la
presse écrite? Cette image de critique redoutable se confirme-t-elle dans notre
corpus? Sur 19 pièces critiquées, six reçoivent les éloges du critique, onze se
font descendre et deux obtiennent une appréciation mitigée. Ce palmarès est
éloquent. Robert Lévesque ne critique pas pour autant à la légère. II étoffe son
propos d'exemples, de citations et de mises en relation qui portent sur le jeu, la
mise en scène, le décor et le texte. II semble bien que la compétence ait un
prix.. .
Luc Boulanger, du journal culturel Voir, suit la voie tracée par Robert Lévesque.
Sur quinze critiques, seulement quatre sont positives. Les onze autres se voient
attribuer une cote mitigée (trois) ou négative (huit).
Peu importe son
appréciation. Luc Boulanger commente toujours les textes (contenu ou mise en
forme), les mises en scène et, parfois, les jeux. Que le texte soit contemporain,
ciassique, québécois ou étranger, qu'il ait aimé ou non, Luc Boulanger ne bâtit
pas sa critique
en fonction d'un canevas de base, mais bien selon ses
appréciations et ses intuitions du moment.
Après ces résultats plus généraux, nous avons choisi de nous concentrer sur
des textes plus spécifiques. Nous examinerons plus attentivement, dans le
chapitre suivant, les pièces que les quatre journalistes-vedettes ont vues, soient
George Dandin (TNM), Les Muses orphelines, Après la chute, Jeanne Dark et
Don Juan. Bien que chaque journaliste aborde certains points au détriment
d'autres, emploie des termes différents et développe un style bien à lui, peutêtre verrons-nous ressortir une certaine homogénéité dans l'appréciation
générale?
33-MONTESSUIT, Carmen- (C La Mouette : Spirituel, grave et tragique », Le Joumal de
Monfréal , 6 octobre 1994, p. 47.
34-MONTESSUIT, Carmen.
15 septembre 1994, p. 52.
(î
Prise de sang : Du théâtre violent », Le Joumal de Montréal,
35-À ce sujet, consultez les textes suivants :
ANONYME. (c Le Théâtre de Quat'sous et Le Devoir: Buissonneau explique son boycott »,
Le Devoir, Montréal, 3 février 1984, p. 3.
ANONYME. Un blâme à l'endroit des artisans de théâtre », Le Devoir, Montréal, 18 février
1984, p. 5.
ANONYME. Les droits du critique », Le Devok, Montréal, 18 mai 1984, p. 3.
BISSONNETTE, Lise. Pétition contre Le Devoir N, Le Devoir, Montréal, 24 janvier 1984, p. 7BISSONNETTE, Lise. Le Devoir et le théâtre n, Le Devoir, Montréal, 27 janvier 1984, p 12.
CORMIER, Guy. (( Liberté du critique a, La Presse, Montréal, 28 janvier 1984, p. A3.
COSSETTE, Gilles et al. « Un cas de censure? D, Letfres québécoise, no34, 1984, p.111.
. LAURENDEAU, Marc. « Un procès de la critique à tenir selon l'équité D, La Presse, Montréal,
27 février 1984, p. A6.
LEMIEUX, LouisGuy. (( Haro sur le critique ou sur l'intolérance? », Le Soleil, Québec,
20 févner 1984, p.A8.
LÉVESQUE, Robert. (( Visite libre, au Quat'sous : Le crime de monsieur Faure B, Le Devoir,
Montréal, 16 septembre 1983, p.5.
CINQUIEME CHAPITRE
ANALYSE DES CINQ PIÈCES CRITIQUÉES
PAR LES QUATRE JOURNALISTES-VEDETTES
Dans les chapitres précédents, nous avons exploré les treize points pouvant
être présents dans une critique de théâtre.
Nous avons aussi analysé
statistiquement le contenu des critiques des quatre journaux et de leurs
journalistes-vedettes.
Cependant, le meilleur moyen de faire ressortir les
différences et les similarités entre tous ces articles consiste à confronter des
textes comparables. C'est pourquoi nous avons choisi d'approfondir les articles
portant sur les cinq pièces que les journalistes-vedettes ont wtiquées.
Nous
aborderons ainsi, à tour de rôle, George Dandin, Les Muses orphelines, Après
/a chute, Jeanne Dark et Don Juan.
5.1 George Dandin de Molière (Théâtre du Nouveau Monde)
De cette pièce, Carmen Montessuit n'aborde que cinq points : l'auteur, la fable,
la mise en scène, le jeu et les impressions générales, Au sujet de I'auteur, elle
affirme que Molière a d'abord écrit La jalousie du Barbouillé, pièce qu'il a
rallongée et qui est devenue George Dandin. En ce qui concerne la fable, elle
la décrit assez superficiellement en indiquant que Dandin épouse Angélique
pour grimper dans l'échelle sociale. Cette femme plus jeune que lui le cocufie
et, chaque fois qu'il tente de prouver ce fait, c'est sur lui que retombent les torts.
Montessuit déplore que le metteur en scène, Marcel Delvai, ait «gommé à peu
près tout l'humour »= de la pièce et qu'il ait choisi de situer l'action dans une
église. Fidèle à son habitude, elle trouve bons et excellents les comédiens. Elle
précise que Normand Chouinard aurait pu émouvoir les spectateurs si le
metteur en scène l'avait dirigé en ce sens. Finalement elle affirme ne pas aimer
la pièce. surtout à cause de la mise en scène, mais indique que le spectateur
qui partage la vision du metteur en scène l'appréciera sans doute. Carmen
Montessuit rédige donc une critique plutôt négative.
Pour sa part, Jean Beaunoyer fait une critique positive de cette production- II
traite huit des points de notre grille : !a fable, la qualité du texte, le contenu du
texte, le lieu théâtral, la mise en scène, la scénographie, le jeu et la mise en
relation. Dans sa description de la fable, Jean Beaunoyer va un peu plus loin
que la critique du Journal de Montréal.
II reprend à peu près les mêmes
éléments qu'elle, en dessinant quelques traits de caractères des personnages :
la famille d'Angélique semble obsédée par l'honneur, et l'intelligence
d'Angélique paraît supérieure à celfe de Dandin. II louange le texte et souligne
que Molière ne vieillira jamais puisque, trois cents ans plus tard, les spectateurs
savourent encore ses personnages. Jean Beaunoyer déclare qu'il s'agit d'un
drame moderne dans lequel Molière démasque les classes sociales et dévoile
les couples sous un jour peu favorable. On y traite d'ambition et d'hypocrisie.
Cette pièce a été peu jouée, car elle est demeurée longtemps incomprise. Jean
Beaunoyer ajoute un bon mot sur le lieu théâtral : << Et quel plaisir de goûter à
un tel spectacle dans un Théâtre du Nouveau Monde retrouvé. >pj7 Ce jugement
est moins une critique qu'une observation positive.
D'après Beaunoyer, le
metteur en scène a transformé cette comédie en drame troublant, alors qu'il
aurait été facile de sombrer dans le vaudeville ou dans la grossièreté.
Or
Dandin apparaît défait, fragile et émouvant. Pour la scénographie, le journaliste
souligne que le choix du décor et des éclairages aident à convertir la comédie
en drame. II qualifie le jeu de "retenu", dont celui de Normand Chouinard qui
évoque des sentiments rarement exprimés, comme la pitié. Enfin, Beaunoyer
met en relation le mariage de Molière et celui de Dandin. II démontre que,
comme toute comédie, l'histoire de Dandin repose sur une infinie tristesse. À
son avis, ce personnage comique essentiellement malheureux rejoint les Woody
Allen, Charlie Chaplin et Olivier Guimond. Beaunoyer a apprécié la vision du
metteur en scène, ce qui le démarque des trois autres journalistes-vedettes.
Le critique du Devoir, Robert Lévesque, n'a pas aimé cette production. II insiste
sur neuf points de notre grille : l'auteur, fa fable, la qualité du texte, le contenu
du texte, la troupe, la mise en scène, la scénographie, le jeu et la mise en
relation. Robert Lévesque soutient que Molière y va de sa plus grande charge
contre les femmes infidèles, au moment ou il vit la même chose avec Armande
Béjart. Au sujet de la fable, le critique décrit Dandin comme un pauvre homme,
un jouet, que sa femme a berné dans une liaison adultère. De plus, Dandin ne
réussit pas à convaincre ses beaux-parents de l'infidélité de leur fille. Du côté
de la qualité du texte, Lévesque considère cette pièce autobiographique à part
dans l'œuvre de Molière, car elle est construite différemment des autres. Son
aspect pathétique lui donne un ton moderne et grave. Elle contient d'ailleurs
peu d'éléments comiques.
Le critique trouve cruelle la façon dont Molière
dépeint les rapports humains.
Cette production témoigne d'un grand
professionnalisme, l'une des principales qualités du TNM, au dire du critique.
La mise en scène, mi-sévère et mi-cynique, maintient la pièce à un niveau
mineur. Selon Robert Lévesque, il aurait fallu aller plus loin dans le cauchemar.
Le journaliste reconnaît que le décor est magnifique dans la pénombre. Le jeu
cependant ne concourt pas au plaisir du spectateur. Ainsi Normand Chouinard,
à ses yeux, ne parvient pas à se renouveler.
Marie Tifo et Gilles Pelletier
reçoivent toutefois ses éloges. Enfin, Lévesque, en citant Tolstoï (le célèbre
auteur russe voulait attendre d'être au tombeau pour dire ce qu'il pensait
réellement des femmes et ensuite refermer rapidement le couvercle), prétend
que Molière devait partager le même point de vue sur les femmes.
Le
journaliste rappelle que plusieurs metteurs en scène ont eu cette vision de la
pièce, notamment Roger Planchon. Lévesque range cette pièce grave dans la
lignée des Don Juan et Le Misanthrope. Lévesque n'a pas détesté la mise en
scène comme sa collègue Carrnen Montessuit, mais il désapprouve plusieurs
autres éléments de la pièce, d'ou son article, somme toute, plutôt négatif.
Luc Boulanger, du journal culturel Voir, a lui aussi attribué une cote négative à
cette production du TNM. II passe en revue neuf points de la grille : l'auteur, la
fable, la qualité du texte, le contenu du texte, la troupe, la mise en scène, la
scénographie, le jeu et les impressions générales. Comme le fait le critique du
Devoir, Luc Boulanger précise que cette pièce reflète la vie de Molière avec son
épouse Amande Béjart. de vingt ans sa cadette. En quelques lignes, il rappeile
que Dandin veut prouver à sa belle-famille qu'il est cocufié. mais, chaque fois, la
situation se retourne contre lui.
Le critique déclare qu'il ne s'agit pas de la
meilleure pièce de Molière. Elle n'a pas l'étoffe des grands drames ni des
Parfois loufoque, la pièce multiplie les dialogues légers et ne
tragédies.
développe guère de quiproquos subtils. « Par moments. ça ressemble à du
Théâtre des Variétés qui aurait, par un prodigieux miracle, le panache d'un
classique!
D=
Luc Boulanger affirme que le personnage de Dandin pourrait
représenter un pauvre homme d'aujourd'hui qui aime péniblement et qui tente
de communiquer son mal à la société. Le critique soutient que la compagnie du
TNM s'est trompée en montant cette oeuvre puisque d'autres pièces s'avèrent
plus fiches et plus actuelles que George Dandin.
II déplore la lecture
dramatique imposée par le metteur en scène et constate que ni le côté comique
ni le côté dramatique de la pièce ne sont réussis.
En ce qui a trait à la
scénographie, Luc Boulanger fait ressortir la magnificence du décor, la
somptuosité des éclairages et l'aspect dramatique de la musique. Du côté du
jeu, le critique déclare que la distribution est solide, mais que la mise en scène
affiche maintes faiblesses. Enfin, il conclut que cette production s'avère plutôt
ennuyeuse.
Luc Boulanger n'a pas aimé cette pièce pour des raisons
différentes de celles de Robert Lévesque.
Ainsi, seul Jean Beaunoyer a écrit une critique positive sur
George Dandin. II a
particulièrement savouré la vision du metteur en scène, que Camen Montessuit
et Luc Boulanger n'ont pas prisée. Robert Lévesque n'a pas aimé la production,
même s'il était réceptif au travail du metteur en scène. À son avis, celui-ci n'est
pas allé assez loin dans la dramatisation.
5.2Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard (Théâtre d'Aujourd'hui)
Camen Montessuit a beaucoup aimé cette pièce. Elle la critique a l'aide de six
points : la fable, la qualité du texte, la mise en scène, le jeu,la réaction du public
et la mise en relation. Elle relate longuement la fable (28% de l'espace lui est
accordé) et en révèle plusieurs moments importants.
Elle insiste sur de
nombreux détails qui n'apparaissent pas généralement dans un résumé. Pour
la qualité du texte, elle se contente d'écrire qu'il est a très bon » avec
« quelques touches d'humour de temps en temps
Ensuite, Carrnen
Montessuit mentionne que la mise en scène de René-Richard Cyr laisse un
souvenir impérissable aux spectateurs et met nettement en valeur le texte. De
plus, grâce à la direction d'acteurs, des comédiennes ont la chance de jouer des
rôles inusités. En plus d'encenser le jeu de tous les comédiens, la journaliste
décrit chaque personnage et le situe dans la dynamique de la pièce. Elle relate
aussi l'ovation spontanée de plusieurs minutes que le public a réservée aux
acteurs. Puisqu'elle avait vu la première version de cette pièce, Montessuit
compare
émouvante
les deux productions et conclut que la plus récente est plus
et
touchante.
Carmen
Montessuit
rédige
une
critique
essentiellement positive de cette pièce.
Jean Beaunoyer a lui aussi très apprécié cette pièce. II aborde presque tous les
points, à l'exception de I'auteur et de la troupe. Son résumé de la fable est plus
succinct que celui de sa collègue, il décrit la situation de chaque personnage
avec précision sans en dévoiler les moments-clés. Concernant la qualité du
texte, Beaunoyer indique que I'auteur a réécrit plusieurs scènes de sa pièce,
l'une des plus belles de la dramaturgie québécoise. Selon le journaliste, Les
Muses orphelines deviendra une pièce de répertoire et sera montée à maintes
reprises dans les années à venir. II précise que le personnage d'Isabelle allège
le drame sans jamais le faire tomber dans la bouffonnerie. En ce qui a trait au
contenu du texte, Beaunoyer note que, sans être moraliste, I'auteur a écrit une
pièce que tout parent devrait voir.
Au-delà de l'anecdote, I'auteur règle le
compte des familles brisées, des générations sacrifiées.
Comme dans sa
critique sur George Dandin, Beaunoyer glisse quelques mots sur le lieu théatral.
II déplore en fait la largesse de la scène. À propos de la mise en scène, le
journaliste insiste sur le dépouillement du décor et le peu d'accessoires utilisés.
II ajoute que la scénographie se révèle la meilleure complice du metteur en
scène et que la musique est remarquable. À l'égard du jeu, le critique ne tarit
pas d'éloges: «le jeu des comédiens est admirable
N,
« la performance
exceptionnelle »,
i<
une belle rigueur >>, c< un plaisir manifeste B .
public est sorti enchanté le soir de la première.
Selon lui, le
II met en relation cette
production avec une autre qui a été montée il y a six ans. Le journaliste affirme
que la production actuelle, plus mature, constitue l'une des plus grandes
réussites de l'auteur. Même s'il réfère à la quasi-totalité des points de la grille,
Beaunoyer n'émet aucun commentaire négatif et recommande chaudement
cette pièce.
Robert Lévesque aborde les huit points suivants : la fable, la qualité du texte, le
contenu du texte, la mise en scène, le jeu, la mise en relation, les impressions
générales et la recommandation. Le critique du Devoir n'a pas l'habitude de
résumer la fable, or, dans cet article, il situe l'action jusqu'à en dévoiler presque
la fin. Pour améliorer la qualité du texte, selon le critique, I'auteur a réécrit et
resserré les répliques et l'histoire, de façon à proposer un nœud et une
conclusion signifiante. Au dire de Lévesque, la pièce sonne le glas du concept
traditionnel de famille et, en extrapolant, de celui du pays. Pour parler de la
mise en scène, le critique multiplie les qualificatifs. Ainsi la mise en scène est
sidérante, sublime, efficace; et la direction des acteurs, inventive, précise,
subtile. Le critique ajoute que le metteur en scène a su placer ses comédiens
dans un décor sobre et les entourer d'accessoires essentiels. En ce qui a trait
au jeu, le journaliste puise de nouveau dans son répertoire de termes élogieux :
a génie », << prodigieuse B, ic parfaite
»,
cc
sensible », « présence sourde m.
II
71
compare aussi
Les Muses orphelines avec les autres pièces de l'auteur. Le
journaliste affirme que cette production est nettement meilleure que l'ancienne.
Enfin, Robert Lévesque n'hésite pas à conseiller cette pièce a ses lecteurs.
Luc Boulanger louange à son tour la production du Théâtre d'Aujourd'hui. II
critique la fable, la qualité du texte, la mise en scène, la scénographie, le jeu, la
mise en relation et fait une recommandation. Boulanger propose d'abord un
court résumé des événements les plus importants. Le critique trouve l'écriture
de l'auteur, qui mêle humour et émotion, très habite.
Pourvue d'une solide
structure et d'une grande finesse dramatiques, la pièce réussit, aux yeux du
critique. à faire aimer ses personnages antipathiques et névrosés. Boulanger
soutient qu'il s'agit de la meilleure mise en scène de René-Richard Cyr.
La
direction d'acteurs lui paraît également remarquable. La musique, le décor et
les éclairages complètent admirablement le spectacle. Boulanger qualifie le jeu
de réussi, sensible et juste.
Cette production se démarque tellement de la
précédente que le journaliste croit assister à une première.
Tout comme
Lévesque et Beaunoyer, Boulanger invite ses lecteurs à se rendre au Théâtre
d'Aujourd'hui.
Bref, cette pièce rallie tous les critiques, qui la comparent à la production
précédente, mise en scène par André Brassard. Ils louangent la mise en scène
de René-Richard Cyr et soulignent le travail de réécrîture de Michel-Marc
Bouchard. La scénographie ainsi que le jeu ont aussi été très appréciés.
5.3 Après la chute d'Arthur Miller (Compagnie Jean-Duceppe)
C'est dans Après la chute que Camen Montessuit aborde le plus de points de
notre grille, soit huit : l'auteur. la fable, la qualité du texte, la mise en scène, la
scénographie, le jeu, la mise en relation et la recommandation. En introduction
à son texte, la journaliste indique que la pièce relate la vie de l'auteur, bien que
les noms ne soient pas les mêmes. Plutôt que de résumer l'histoire, Montessuit
énumère les personnages. et les comédiens qui les incarnent, et indique leur
rôle dans la vie du personnage principal. Concernant la qualité du texte, elle
déclare que la pièce, très intellectuelle, peut paraître longue.
Par la suite,
Montessuit insiste sur les principaux éléments de la mise en scène et en fait
ressortir quelques trouvailles. La journaliste reconnaît que la scénographie vaut
le coup d'œil. Elle émet une seule réserve pour le jeu d'un des comédiens, mais
cette remarque vise peut-être davantage le metteur en scène, qui a eu l'idée de
"dédoubler" le personnage principal. Carmen Montessuit fait peu de mises en
relation et se contente, habituellement. de références générales, partagées par
la majorité des gens.
Or, dans sa critique, elle compare la scénographie
d'Après la chute à celle du Rail de Carbone 14. Cette compagnie th&&trale, bien
que fort connue, ne possède pas la notoriété du Théâtre Jean-Duceppe ni du
TNM, que ses lecteurs doivent mieux connaître. Au point treize, malgré sa
réserve face à !a qualité du texte, Montessuit s'appuie sur la distribution pour
recommander la pièce. Cette critique se révèle somme toute positive même si
elle insiste plus sur le jeu que sur la mise en scene ou la qualité du texte.
La Presse se révèle aussi très favorable a la pièce. Bien qu'il traite de neuf
points, Beaunoyer met l'accent sur la fable et la mise en scène. II aborde aussi
la qualité du texte, la troupe, la scénographie, le jeu, la mise en relation, les
impressions et la recommandation.
Beaunoyer utilise en moyenne moins du
quart de ses articles pour narrer la fable. Dans cette critique, il lui accorde près
de la moitié de l'espace. II explique surtout les relations qui existent entre les
personnages et note les ressemblances avec les gens qui ont gravité autour de
Miller.
Le critique prétend que, en voulant camoufler les personnes réelles
derrière les personnages fictifs, l'auteur a réussi avec brio à les rendre encore
plus vraisemblables. Sans nommer la troupe ni la compagnie théâtrale comme
telle, Beaunoyer mentionne que ce groupe monte toujours, sans prétention, de
grandes pièces théâtrales. Dans ses autres articles, Beaunoyer attribue près de
10% d'espace à la mise en scène. Dans le cas d'Après la
quart de son texte à ce point.
chute, il consacre le
I! multiplie les louanges à l'égard d'Yves
Desgagnés pour l'originalité et l'efficacité de sa mise en scene. En contrepartie,
le journaliste n'emploie même pas une phrase complète pour signaler
l'excellence de la scénographie et des éclairages.
Bien qu'il reconnaisse la
qualité générale du jeu, il insiste sur la performance de Maude Guérin, qu'il
considère comme la révélation du spectade. Beaunoyer compare la pièce à
d'autres productions auxquelles ont participé Yves Desgagnées et Sophie
Lorrain. À la fin de son article, le journaliste formule une recommandation très
claire : « (.. .) un spectacle à voir pour du grand Desgagnés et du grand théâtre
toujours sans prétention.
Robert Lévesque, même s'il est le seul des quatre
à émettre de
véritables réserves face à cette production, n'en rédige pas pour autant une
critique négative, sa position est plutôt mitigée. II parle de l'auteur, de la qualité
du texte, du contenu du texte, de la mise en scène, de la scénographie, du jeu,
de la mise en relation et des impressions sur l'ensemble du spectacle. Robert
Lévesque démontre l'étendue de son savoir en rappelant l'accueil que cette
pièce a reçu lors de sa création et la façon dont Miller l'a vécu. À propos de la
qualité du texte, le journaliste considère que la traduction n'est pas très réussie,
mais que le texte, malgré sa lourdeur écrasante, possède tout de même une
construction raffinée.
II évoque les nombreux sujets abordés dans le texte,
notamment les camps nazis, la malhonnêteté, l'image de l'américain type et ses
convictions politiques. Un tiers de la critique porte sur la mise en scène et son
concepteur. Lévesque hésite à prononcer un verdict de réussite ou d'échec. En
dépit de la renommée d'Yves Desgagnés, le résultat final ne lui paraît pas
concluant.
L e journaliste admet cependant que la traduction, la lourdeur du
texte et la supeficialité du jeu n'ont pas facilité le travail du metteur en scène.
La scénographie occupe un peu plus de 10% de l'espace. Selon Lévesque, il
en découle des moments troublants et magnifiques.
Contrairement à
Beaunoyer, Lévesque trouve le jeu des comédiens mécanique, mal contrôlé,
superficiel, lourd et sec. II ne partage pas l'opinion de son confrère concernant
Maude Guérin. II compare cette production avec une mise en scène antérieure
de Desgagnés. Aux yeux de Lévesque, le spectacle demeure inachevé. Dans
cette cBtique, les références biographiques servent d'arguments à Lévesque
pour étayer ses opinions.
Le critique de Voir, Luc Boulanger, a bien apprécié cette pièce, même s'il
n'analyse que six points de notre grille: l'auteur, la qualité du texte, le contenu
du texte, la mise en scène, le jeu et la mise en relation. En quelques mots,
Boulanger rappelle que l'auteur, de nationalité juive, se demande pourquoi il a
survécu au génocide de son peuple. Le journaliste considère le texte comme
touffu, surtout au premier acte alors que les personnages sont peu développes.
Par contre, il préfère la deuxième partie, là où l'intrigue se resserre. Boulanger
reprend, durant presque la moitié de sa critique, les grands thèmes abordés
dans la pièce. À l'instar des trois autres critiques, Boulanger approuve les choix
du metteur en scène d'avoir situé la pièce dans un wagon et d'avoir "dédoublé"
le personnage principal. Cette pièce représentait un défi de taille que le metteur
en scène a su relever avec brio. Par contre, il émet des réserves à propos du
jeu de Michel Dumont, qualifie celui de Gilles Renaud et de Denis Bernard de
juste, et encense celui de Maude Guérin.
Très brièvement, le journaliste
rappelle la réception critique négative de cette pièce. Signant l'une de ses plus
longues critiques de notre corpus, Boulanger louange abondamment cette
production.
Trois critiques sur quatre ont donné une cote positive à cette production, et seul
Lévesque lui a attribué une cote mitigée. En général, les critiques ont trouvé le
texte lourd mais la scénographie réussie. Tous ne s'entendent pas sur le jeu et
la mise en scène. En fait, trois critiques ont signalé le jeu juste et convaincant
de Maude Guérin, tandis que Lévesque le considère comme lourd et superficiel,
à l'égal de l'ensemble de la distribution, sauf en ce qui a trait à Michel Dumont.
Si Montessuit ne comprend pas pourquoi Desgagnés, a "dédoublé" le rôle de
Quentin, Robert Lévesque et Jean Beaunoyer apprécient cette trouvaille, qui
rend la pièce moins narrative. Luc Boulanger, pour sa part, reproche au jeu de
Michel Dumont (Quentin) d'être trop narratif... Comme on le voit, cette pièce a
suscité plusieurs divergences d'opinion. D'ailleurs, selon Robert Lévesque, dès
sa première présentation en 1964: « [...] After the fa// fut reçue comme une
pièce prétentieuse et ratée, à laquelle la critique reprocha des longueurs et une
complaisance autobiographique. 8"
5.4 Jeanne Dark de Bertolt Brecht (Théatre du Nouveau Monde)
Dans une courte cri-tique négative, Carmen Montessuit touche sept points : la
fable, la qualité du texte, le contenu du texte, la mise en scène, la scénographie,
le jeu et les impressions sur l'ensemble. La journaliste effectue un très court
résumé de l'histoire, qui n'occupe que 16% de l'espace, alors qu'habituellement
elle consacre 42% d'espace à ce point. Montessuit trouve le texte ennuyant et
froid. Voilà pourquoi, selon elle, cette pièce est rarement montée ici comme à
l'étranger. La journaliste. même si elle se rapproche du résumé de la fable,
expose surtout les enjeux sociaux et politiques des personnages. Peu bavarde
sur la mise en scène, Montessuit souligne la rigueur et l'effet accrocheur du
chœur masculin. N'entrant pas dans les détails scénographiques, elle note que
le décor se révèle imposant et que la musique originale réserve de bons
moments, notamment grâce au chœur des ouvriers. A ses yeux, la majorité des
comédiens jouent d'une façon juste, à l'exception de la comédienne principale,
Catherine Sénart, qui, malgré d'impressionnants solos chantés, n'est guère
convaincante.
Contrairement à son ambivalence habituelle, la journaliste
termine son article en affirmant que le spectacle est très austère.
La piètre
qualité du texte l'amène à porter ce jugement. Même si la plupart des autres
éléments soulevés par C a n e n Montessuit sont positifs, elle n'en rédige pas
moins, dans l'ensemble, une critique négative.
Jean Beaunoyer, de son côté, aborde huit des treize points de la grille : la fable,
la qualité du texte, le contenu du texte, la troupe, la mise en scène, la
scénographie, le jeu et les impressions générales.
D'abord, il résume
simplement l'histoire du personnage principal. Ensuite, tout comme la critique
du Journal de Montréal, Beaunoyer trouve le texte écrasant. Cette lourdeur
provient, à ses yeux, de l'aspect didactique du texte, nettement trop appuyé
comme en témoignent les passages de propagande communiste. Le journaliste
considère que la compagnie a fait un mauvais choix de pièce, vu le contexte et
l'époque actuels. Bizarrement, le critique reproche à la mise en scène d'être
trop rigoureuse. En revanche, l'une des grandes forces du spectacle repose sur
la musique et les chants du chœur.
Divergeant d'opinion avec Montessuit,
Beaunoyer écrit que la performance de CatheBne Sénart est mémorable. De
plus, l'interprétation de la distribution entière semble lui avoir beaucoup plu.
Voilà pourquoi il considère le jeu comme l'autre point fort de la production.
Malgré tout, le résultat final laisse le journaliste sur son appétit. II rédige donc
une critique mitigée, sans mettre l'accent sur des problèmes particuliers, à
l'exception de la lourdeur du texte.
Lévesque est le seul critique à utiliser le titre original de cette pièce, Sainte-
Jeanne-des-Abattoirs, dans son article.
II traite de neuf points : l'auteur, la
qualité du texte, le contenu du texte, la troupe, la mise en scène, la
scénographie, le jeu, la mise en relation et les impressions. Sans insister sur
l'auteur. Lévesque indique que Jeanne Dark, l'une des plus vieilles pièces de
Brecht. ne véhicule pas de valeurs universelles, contrairement à d'autres textes
du même auteur. Lévesque juge la traduction banale et déplore que le texte ait
subi de si nombreuses coupures. Le journaliste explique que le propos de la
pièce porte sur la lutte des classes, le marxisme et le capitalisme. Or. dans
notre société. cette pièce ne rejoint personne et affiche ainsi son anachronisme.
Selon Lévesque. le TNM a commis une erreur en présentant cette pièce trop
éloignée de notre réalité contemporaine. Le journaliste respecte la vision des
metteurs en scène dans la mesure où ils la justifient.
La mise en scène de
Lorraine Pintal montre curieusement une Jeanne Dark étrangère aux
préoccupations politiques et sociales. La metteure en scène a ainsi
déshumanisé la pièce. au point d'en faire « un frigidaire théâtral
D
"
.
Lévesque
conclut sa critique avec ironie : il qualifie la mise en scène de totalitaire, ce qui
va à l'encontre même des idées de l'auteur.
Contrairement aux trois autres
critiques, Lévesque déclare que la musique n'apporte ni vitalité ni unicité à la
scénographie froide et impersonnelle.
Lévesque a tant détesté la mise en
scène que les autres points de la pièce lui paraissent insignifiants, dont le jeu
pseudo-robotisé et faible. Le journaliste compare cette pièce à celles du même
auteur qui véhiculent des valeurs universelles. De plus, il évalue la musique en
fonction de celle d'autres opéras. En somme, il estime que ce spectacle est
anti-brechtien. Lévesque se révèle le critique le plus intransigeant envers cette
production. Tout semble l'avoir agacé, en particulier le choix de la pièce et la
mise en scène.
Luc Boulanger ne réfère qu'à six éléments de notre grille : le contenu du texte,
la troupe, la mise en scène, la scénographie, le jeu et la mise en relation. II
constate a son tour que le texte, en raison de son idéologie marxiste, est
dépassé.
Le journaliste blâme aussi le TNM d'avoir choisi de présenter ce
spectacle. Le critique déplore que la forme de la production soit plus maîtrisée
que le contenu.
Pour une pièce qui véhicule un message politique, cela lui
paraît assez problématique. Néanmoins, il précise que ceux qui apprécient le
travail de Lorraine Pintal aimeront sans doute la pièce. Boulanger est le seul
critique à dénigrer le choix des costumes. il trouve les chorégraphies efficaces
et la musique excellente dans son ensemble, bien que les refrains ne soient pas
aussi marquants que ceux d'autres pièces de Brecht. Comme Beaunoyer, il a
aimé le jeu des comédiens, malgré la fébrilité de la comédienne principale. II
tisse un lien entre les derniers changements politiques et sociaux de notre
époque (la chute du Mur de Berlin, l'ère de la globalisation, etc.) et les idées
transmises dans la pièce. Dans i'ensemble, Boulanger n'a pas apprécié cette
production.
Tous les critiques affirment que le texte est lourd ou ennuyant et se
questionnent sur la pertinence de monter cette pièce.
L'appréciation du jeu
varie : Beaunoyer et Boulanger l'ont trouvé bon; Lévesque, mauvais et
Montessuit hésite. Beaunoyer prétend qu'il aurait aimé ce spectacle n'eût été
du texte.
Sa position paraît quelque peu mitigée.
Les autres critiques
s'entendent pour déprécier ce spectacle.
5.5Don Juan de Bertolt Brecht présentée par la Nouvelle Compagnie Théâtrale.
Malgré le titre de l'article qui laisse entendre le contraire (a Le Don Juan de
Brecht : détestable B), la critique de cette pièce s'avère incontestablement
positive. Montessuit passe sept points en revue : la fable, la qualité du texte, le
contenu du texte, la mise en scène, la scénographie, le jeu et la mise en
relation. Dans cette critique, la journaliste ne narre par réellement la fable, mais
elle rapporte quelques mises en situation. Elle note que le texte à été raccourci
d'une façon si efficace qu'on croirait entendre le texte original tellement il coule
de source. A propos du contenu, la journaliste mentionne uniquement que cette
pièce n'a aucune résonance politique.
Montessuit indique, de façon très
succincte, que la mise en scène rigoureuse permet de croire en la véracité des
personnages.
À ses yeux, le d&pouillement de la scène et les costumes
sombres accentuent le drame de la pièce. Elle justifie son appréciation du jeu
de Don Juan, Fabcice Pierre, par le fait qu'on le déteste au plus au point. Elle
ne tarit pas d'éloges à son égard : « Si je voulais exagérer, je dirais que c'est lui
qui a la pièce sur les épaules. »" Montessuit ne fait des mises en relation que
dans un article sur trois environ. Dans ce c a s a . elle compare le personnage
principal au Don Juan de Molière. Cette courte critique, qui ne contient que 316
mots. ne comporte aucune note négative et aborde tout de même brièvement
plusieurs points.
Jean Beaunoyer porte son intérêt sur six des treize points de notre grille : la
qualité du texte, le contenu du texte, la mise en scène, la scénographie, le jeu et
la mise en relation. Le journaliste déclare que la réécriture de cette histoire
connue nous donne une tout autre vision du personnage de Don Juan. Cette
pièce ne soulève pas de grands problèmes politiques ni sociaux, mais, selon le
critique. elle éclaire sous un nouveau jour le mythe de Don Juan. Don Juan y
apparaît vil, sans cœur, ni compassion, bref il incarne le type même du minable
dragueur. Grâce à la mise en scène alerte, cette pièce de deux heures file à
grande vitesse. Le metteur en scène, au dire du journaliste, a parfaitement
dirigé tous les comédiens qui parviennent à imposer leur personnage.
Contrairement à sa collègue du Journal de Montréal, Beaunoyer n'a pas aimé le
décor qu'il trouve trop dépouillé et d'une lamentable pauvreté, surtout que de
nombreux sténographes québécois savent faire des merveilles avec presque
rien. Jean Beaunoyer louange le jeu souple, intelligent et espiègle du comédien
de Sganarelle, Nino D'ltrona, l'un des meilleurs interprètes de ce rôle.
II
souligne aussi le jeu métallique de Don Juan. qui aurait probablement plu à
Brecht. Les rôles secondaires sont aussi bien campés, autant par les Français
que par les Québécois. À l'aide d'une très courte mise en relation. Beaunoyer
fait un rapprochement avec la pièce La Locandiera. Malgré une réticence du
côté du décor, Beaunoyer rédige un article très favorable à cette production de
Don Juan.
Dans une critique assez mitigée, Lévesque fait part de ses retenues en
abordant huit points : l'auteur, la qualité du texte, le contenu du texte, la mise en
scène. la scénographie, le jeu, la mise en relation et les impressions sur
l'ensemble du spectacle. Le journaliste décrit l'époque durant laquelle Brecht a
écrit cette pièce et qui est à la source de ses principes politiques et sociaux.
Lévesque évoque aussi un peu la vie privée de l'auteur, reconnu pour être, tout
comme Don Juan, un homme à femmes. concernant la qualité du texte, le
critique note que Brecht a su rendre l'esprit du jeu, le comique des situations, le
clownesque de Sganarelle et l'enjeu principal du texte de Molière. II ajoute
cependant que la sévérité du texte alourdit le spectacle. Lévesque fait ressortir
les idées humanistes de Brecht, notamment lorsque Don Juan est puni pour
avoir mené une vie de parasite et de débauché. Le journaliste trouve brillante
l'idée du metteur en scène de monter cette pièce, dont la morale est
communiste, dans les ruines d'un cirque. II ajoute que la clarté de la mise en
scène donne un spectacle à la fois festif et sévère, ce qui correspond au
mélange des genres de l'esprit brechtien.
II précise cependant que la
scénographie ne constitue pas le point fort de la pièce. Le critique déclare que
le jeu des comédiens campant Don Juan et Sganarelle est parfait : l'un dans la
bêtise et la faiblesse du goujat, l'autre dans le clownesque. En revanche, il n'a
pas apprécié le jeu lourd et sans rythme des comédiens québécois.
Le
journaliste compare Don Juan à Jeanne Dark du même auteur, pièce montée
par le TNM comme nous l'avons vu précédemment. Lévesque signale que le
décor de Jeanne Drak trahit la pensée de Brecht, tandis que celui de Don Juan
laisse entendre sa voix perspicace. Enfin, si le spectacle comporte des
lourdeurs, dans l'ensemble, le travail est intelligent. Positif par moments, négatif
en ce qui touche à la scénographie, au jeu des comédiens québécois et à la
sévérité du texte, Lévesque rédige une critique mitigée.
Boulanger compose une critique expéditrice de 286 mots, dans laquelle il
survole huit points : le contenu du texte, la troupe, la mise en scène, la
scénographie, le jeu, la mise en relation, les impressions et la recommandation.
II retient d'abord que le personnage de Don Juan est un parasite social, un
individualiste qui ne peut que finir dans la solitude. Le journaliste indique que
c'est grâce à l'excellente initiative de la directrice de la Nouvelle Compagnie
Théâtrale, qui a assisté à cette pièce en France, que nous pouvons la voir à
Montréal. Le critique qualifie la mise en scène de remarquable. Selon lui, le
décor donne un accent tragique à la pièce. Le journaliste reconnaît l'excellence
du jeu de tous les comédiens, mais il souligne le jeu magistral et magnifique des
comédiens principaux. Luc Boulanger note que le Don Juan de Molière et celui
de Brecht ne pouvaient qu'être rejetés par leur communauté. Le critique range
ce spectacle dans les productions de haut calibre.
lecteurs d'aller voir cette pièce, ne serait*
Il recommande à ses
que pour savourer le jeu des deux
comédiens principaux. Dans cette critique positive, Boulanger évoque plusieurs
points, sans vraiment les approfondir.
Au dire des quatre critiques, la mise en scène s'avère remarquable. Tous
s'entendent pour affirmer que ce spectacle est beaucoup mieux réussi que la
production de Jeanne Dark du même auteur. Le décor ne fait pas l'unanimité de
même que le jeu des comédiens (français, italiens et québécois) puisque
Montessuit, Beaunoyer et Boulanger trouvent le jeu juste et convaincant, tandis
que Lévesque qualifie le jeu des comédiens québécois de lourd et mal rythmé.
Les journalistes-vedettes ont aimé Les Muses orphelines, Don Juan et Après ia
chute, si l'on fait exception des quelques réserves de Lévesque concernant les
deux derniers spectacles.
Les quatre critiques ont détesté Jeanne Dark et
George Dandin, sauf Jean Beaunoyer, qui nuance sa position pour la première
pièce et qui a aimé la seconde. Les critiques se rejoignent donc dans leurs
jugements la plupart du temps, bien que certains accordent plus d'importance
ou d'espace à certains points de la grille.
Ainsi, une certaine homogénéité
semble ressortir de leurs articles. Comme il se doit, le lecteur peut développer
plus d'affinités avec un critique qu'avec un autre, même s'ils amvent à des
conclusions seinblables.
36-MONTESSUIT, Carmen. « George Dandin au TNM : un Molière rendu sévère », Le Joumal
de Montréal, 14 octobre 1994, p. 42.
37-BEAUNOYER, Jean. « George Dandin : un drame fort troublant », La Presse, Montréal,
14 octobre 1994, p. A-1 S.
38-BOULANGER, Luc- « George Dandin : le ciel peut attendre », Voir, Montréal, 20 octobre
1994.
39-MONTESSUIT, Carmen. (C Les Muses orphelines au Théâtre d'Aujourd'hui : un souvenir
impérissable », Le Journal de Montréal, 20 octobre 1995, p. 55.
40-BEAUNOYER, Jean. « Après la chute :Du grand Desgagnés u, La Prese, Montréal,
31 octobre 1994, p. A-1 3.
41-LEVESQUE, Robert. « Tentative de sauvetage d'une pièce mal-aimée u, Le Devoir,
1er novembre 1994, p.68.
42-LEVESQUE, Robert. (c: Un Brecht à l'esthétique totalitaire », Le Devoir, 22 novembre 1994.
p. B8.
43-MONTESSUIT, Carmen. « Le Don Juan de Brecht : détestable », Le Joumal de Montréal,
30 novembre 1994, p. 55.
CONCLUSION
Ce mémoire visait à analyser le contenu des critiques montrealaises de théâtre et à
vérifier le lien possible entre le journal d'appartenance et la critique. Pour y parvenir,
nous avons utilisé une grille d'analyse mise au point par Hervé Dupuis, professeur et
auteur de théâtre, qui regroupe treize points. Nous avons appliqué cette grille à un
corpus d'une centaine d'articles provenant du Journal de Montréal, de La Presse, du
Devoir et de Voir lors de la saison automnale 1994.
Nous avons établi une méthode de calcul qui tenait compte de trois facteurs : la
fréquence d'apparition (nombre de fois que chaque point est traité par un critique dans
l'ensemble de ses articles), I'espace global (I'espace qu'occupe un point dans la
production entière d'un critique) et I'espace ciblé (I'espace octroyé à un point dans les
textes ou il est abordé). Ainsi, le jeu, la qualité du texte, les impressions générales et la
mise en scène reçoivent le plus de mentions, tandis que la réaction du public et le lieu
théâtral occupent les derniers rangs. Les sept autres points se rangent entre ces deux
pôles.
Les critiques théâtrales au Journal de Montréal, qui, rappelons-le, vise un très large
public, font référence à des éléments peu spécialisés.
Nous avons observé que
Carmen Montessuit, la journaliste attitrée au théâtre. accorde beaucoup de place à la
fable et au jeu, et très peu à la mise en relation. Tout au plus fait-elle allusion à des
pièces dont elle à déjà traité dans des critiques antérieures ou à des œuvres
passablement connues.
De son côté, La Presse. qui touche à tous les secteurs d'information au Québec. publie
des critiques qui démontrent une tendance généraliste.
Les articles de Jean
Beaunoyer et de ses collègues abordent plusieurs points et se distinguent peu par
rapport aux autres journaux.
Reconnu comme un acteur social important, Le Devoir s'adresse à un public lettré et
instruit. Ses critiques théâtrales misent à fond sur la culture et la curiosité intellectuelle
de son lectorat et privilégient les mises en relations. Celles-ci ne se contentent pas
seulement de sujets généraux. mais présentent des œuvres, des artistes. des
personnalités et des événements qui ont marqué l'histoire théâtrale.
Voir. l'hebdomadaire culturel, insiste sur le contenu du texte et sa qualité. et critique de
nombreuses pièces dont les autres journaux ne font même pas mention. À l'exception
de La Presse. nous constatons que les journaux tiennent des discours différents sur les
pièces en conformité avec leurs orientations éditoriales.
Nous avons aussi confirmé que le journaliste-vedette colore nettement le journal pour
lequel il travaille. Oublions le cas de Montessuit, l'unique journaliste à publier des
critiques théâtrales pour Le Journal de Montréal. Beaunoyer, par l'homogénéité de ses
textes, reflète bien les résultats obtenus par La Presse.
De son côté, Lévesque
multiplie les mises en relation autant. sinon plus. que l'ensemble de ses confrères du
Devoir. Finalement, Boulanger, de l'hebdomadaire Voir, présente les éléments qui l'ont
le plus frappé, en accordant une place de choix au texte et à l'aspect culturel d'un
spectacle.
Enfin, en comparant les cinq pièces que les journalistes-vedettes ont critiquées, nous
avons dégagé malgré tout un certain consensus dans les opinions des uns et des
autres.
Si tous les critiques insistent, dans des proportions variées, sur différents
points de la grille, chacun développe son propre style et ses sujets favoris.
Nous n'avons pas pour autant épuise la question de la critique théâtrale. Par exemple,
une recherche pourrait déterminer pourquoi un lecteur préfère lire un journaliste plutôt
qu'un autre. Est-ce par affinité d'esprit? Pour le plaisir du style et du ton employés? II
faudrait aussi établir si la façon dont écrivent les critiques, les sujets qu'ils abordent et
les pièces auxquelles ils assistent relèvent de leur choix ou de celui de leur journal
respectif.
La présence d'un plus grand nombre de points de notre grille dans un article ne rend
pas forcément une critique plus compléte qu'une autre. Si dix sujets sont effleurés, le
texte paraîtra épars et peu développé. Par contre, si quatre points sont abordés en
profondeur (avec exemptes et citations), l'article semblera touffu.
Pourtant, il nous
amènera à nous questionner sur l'absence des autres points. En fait, le meilleur article
doit chercher la nuance et l'équilibre.
II incitera le lecteur ou le spectateur à se
questionner et à se forger son opinion, et indiquera au praticien ce qu'il doit améliorer.
De plus, une "bonne critique" n'est pas celle qui louange sans retenue, mais plutôt
celle qui développe un point de vue constructif. Le critique peut. et doit. susciter un
questionnement et une réflexion sur un spectacle ou une pièce. S'il ne détient pas la
vérité absolue. ses connaissances et ses compétences peuvent éclairer sous un
nouveau jour certains éléments d'une représentation. Le critique a aussi pour mission
de répertorier le travail des artisans de la scène et de conserver vivante, dans la
mémoire collective, la culture théâtrale d'hier et d'aujourd'hui.
ANNEXE
GRILLE D'ANALYSE D'HERVÉDUPUIS
ARTICLE ANALYSÉ
Cette grille d'analyse a été conçue par Hervé Dupuis et remise aux étudiants inscrits à
son cours de critique de théâtre donné à l'hiver 1996 (FRR 109) à l'Université de
Sherbrooke. Elle divise en treize points les sujets susceptibles d'être évaluée par un
critique et fournit l'espace nécessaire pour préciser les noms des artisans (1) et des
personnages (IP) ou pour ajouter des citations (IC). Dans "Autres I", le chercheur peut
indiquer les noms qui n'entrent dans aucune autre catégorie. Pour les besoins de ce
mémoire. j'ai ajouté, à la scénographie (point 8), les lignes "Générale" et "Son".
C r i tique
Nom de l'indexeur(e):
,
Journal :
.-
date:
,
19 /
/
Titre de 1a pièce-
la critique:
Titre
De la page-- d la page -
Auteur de l a c r i tique:
2- LA FABLE
1-
3- LA QUAUTE DU TEXTE
4- LE CONTENU DU TEXTE
TROUPE
MISE EN SCENE
SCÉNOGRAPHI E
Masques
Eciairages
Décor
O
Costumes
I:
Musique
1 O- LA
Mise
REACTION DU PUBL 1 C
en relation entre.--:
12- IMPRESSIONS
du spectacle
1-[
13- RECOMMANDATION
Autres éléments:
IP:
IC:
C r i t i q u e : posl t i v e
,
negJtive
mitigée
FI
Nom da l'indexew(e):
Jcurnal
:
J
Titre d e la pièce:
P
f& *.L
T i t r e de la c r i t i q u
Auteur d e la critique:
2- LA FABLE
II/3-
CI
5
4
-
LA
à la page
De la page-
OUALITE OU TEXTE
4- LE CONTENU DU TEXTE
TROUPE
M 1 SE EN SCENE
SCENOGRAPHIE
r
M a q u i i l ages
Masques
Eclairages
I l
1:
u
Accessoires
1:
Décor
U
r:
costumes
U
Mi~Slaue
9- LE JEU
riiSE en
,2- I
relation entre ...:
M
~ SW- I'enserrible
~
~
du spectacle
~
~
I
~
~
1 3- RECOMMANDATION
Autres éléments:
C r i t i m 10-
00s 1 t ive
neqative
I l
mitiaée
n
IL c.c.;*h
[l
~
=
El
BIBLIOGRAPHIE
1- Articles sur la critique de théâtre
ANONYME. <c La critique à l'épreuve du rire : Ha ha! ... au T.N.M. » Cahiers de
théâtre Jeu, no55, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1990, p. 126-134.
ANONYME.
Le Théâtre de Quat'sous et Le Devoir: Buissonneau explique
son boycott », Le Devoir, Montréal, 3 février 1984, p. 3.
ANONYME. « Un blâme à l'endroit des artisans de théâtre », Le Devoir,
Montréal, 18 février 1984, p. 5.
ANONYME. « Les droits du critique », Le Devoir, Montréal, 18 mai 1984, p. 3.
ANDRÈS, Bernard. c De la critique en action : témoignage d'un transfuge »,
Cahiers de théâtre Jeu, no 52, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc.,1989,
p. 168-174.
BISSONNETTE, Lise. « Pétition contre Le Devoir, » Le Devoir, Montréal,
24 janvier 1984, p. 7.
BISSONNETTE, Lise. « Le Devoir et le théâtre », Le Devoir, Montréal,
27 janvier 1984, p. 12.
BURGOYNE, Lynda. « Lettre d'une sorcière à un "critique de théâtre" »,
Cahiers de théâtre Jeu, no66, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1993,
p. 38-40.
CAMERLAIN, Lorraine. « Échos d'une enquête actuelle », Cahiers de théâtre
Jeu, no25, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1982, p. 72-74.
CAMERLAIN, Lorraine et FRÉCHETTE, Carole. G Vinci : L'arte è veicolo :
entretien avec Robert Lepage », Cahiers de théatre Jeu, no 42, Montréal, Les
Cahiers de théâtre Jeu inc.,1987, p. 124-125.
CORMIER, Guy. a Liberté du critique », La Presse, Montréal, 28 janvier 1984,
p. A3.
COSSETTE, Gilles et al. « Un cas de censure? », Lettres québécoises, no 34,
Montréal, Éditions Jumonville, 1984, p. 11.
DASSYLVA, Martial. Une critique en eflervescence, Collection
Montréal, Éditions La Presse, 1975, 283 p.
Échanges B,
DAVID, Gilbert. « Une critique en effervescence? N, Cahiers de théâtre Jeu,
no2, Montréal. Les Cahiers de théâtre Jeu inc.. 1976, p. 110-1 12.
DAVID, Gilbert et NOËL, Francine. cc Entretien », Cahiers de théâtre Jeu,
no 13, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1979, p. 74-76.
DAVID, Gilbert. « Jeu : après quatre ans N , Cahiers de théâtre Jeu, no 13,
Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1979, p. 143-145.
DAVID, Gilbert. cc À l'occasion des adieux (nostalgiques) d'un chroniqueur de
théâtre », Cahiers de théâtre Jeu, no 29, Montréal. Les Cahiers de théâtre Jeu
inc., 1983, p. 11-1 5.
LAVOIE, Pierre. K Aimer se faire haïr ou haïr se faire aimer D, Cahiers de
théâtre Jeu, no31, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1984, p. 5-13.
LAVOIE, Pierre et al. Cahiers de théâtre Jeu, no40, Montréal, Les Cahiers de
théâtre Jeu inc-, 1986, 296 p.
LAVOIE, Pierre. G Un festival hanté par l'absence » Cahiers de théâtre Jeu,
no78, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1996, p. 132-144.
cc Danse, p'tite désobéissance : les anges dans nos
LEFEBVRE, Paul.
campagnes >> Cahiers de théâtre Jeu, no 27, Montréal, Les Cahiers de théâtre
Jeu inc., 1983, p. 145-146.
LEMIEUX, Louis-Guy. <( Haro sur le critique ou sur l'intolérance? D, Le Soleil,
Québec, 20 février 1984, p. A-8.
LEPAGE, Gilbert et LAVOIE, Pierre. « Courrier D, Cahiers de théâtre Jeu,
no32, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1984, p. 176-177.
LESAGE, Marie-Christine. << Échos de la relève dans la presse écrite D, Cahiers
de théâtre Jeu, no77, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1995,
p. 105-115.
LÉVESQUE, Robert. « Visite libre au Quatlsous : Le crime de monsieur
Faure n, Le Devoir, Montréal, 16 septembre 1984, p. 5.
LÉVESQUE, Solange.
a Trois questions pour la critique : Congres de
l'Association internationale des critiques de théâtre à Helsinki D, Cahiers de
théâtre Jeu, no80, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1996, p.146-149.
MACDUFF, Pierre et LAVOIE, Pierre. « Coumer », Cahiers de théâtre Jeu,
no32, Montréal. Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1984, p.17û-180.
MAILHOT, Laurent. « Jean-Claude Germain, critique », Cahiem de théâtre Jeu,
no13, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1979, p. 92-100.
RICHARD, Michel. a Tribune libre B.,Cahiers de théâtre Jeu, no 29, Montréal,
Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1983, p.?6-17.
ROBITAILLE, Laurence. « Pourquoi le théâtre? D, Cahiers de théâtre Jeu,
no76, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1995, p. 136-138.
VAIS, Michel. a De qui se moque Le Devoit? B, Cahiers de théâtre Jeu, no 45.
Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1987, p. 7-9.
VAIS, Michel. « Jeu entre Ottawa et Québec BB,Cahiers de théâtre Jeu, no 47,
Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1988, p. 232.
VAIS, Michel. « Code d'éthique et de déontologie à l'usage des membres de
l'Association québécoise des critiques de théâtre (A.Q.C.T.)», Cahiers de
théâtre Jeu, no47, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1988, p. 236-237.
VAIS, Michel. « Les abus de la liberté d'expression : l'encadrement juridique du
rôle du critique D, Cahiers de théâtre Jeu, no 67, Montréal, Les Cahiers de
théâtre Jeu inc., 1993, p. 188-190.
VAiS, Michel. a Le critique et les marges du théâtre D, Cahiers de théâtre Jeu,
no 73, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1994, p. 13-1 18.
VIGEANT, Louise. << Les médias : un rôle de soutien? B, Cahiers de théâtre
Jeu, no77, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1995, p. 100-104.
VILLEMAIRE, Yolande. (< Jeu de cartes (fragments) D, Cahiers de théâtre Jeu,
no4, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc, 1977, p. 14-15.
WICKHAM, Philip. << Séminaire pour jeunes critiques à Grenoble B. Cahiers de
théâtre Jeu, no 76, Montréal, Les Cahiers de théâtre Jeu inc., 1995, p. 173-180.
2- Critiwes tirées du Journal de Montréal
MONTESSUIT, Carmen. G Havel sous le manteau : Une pièce "interdite" »,
12 septembre 1994, p. 47.
MONTESSUIT, Carmen. « Claude ou les désamois amoureux : Un nouvel
auteur plein de talent servi par de bons comédiens a, 14 septembre 1994, p. 56.
MONTESSUIT, Carrnen. cc Prise de sang : Du théâtre violent B. 15 septembre
1994, p. 52.
MONTESSUIT. Carmen. cc Joualez-moi d'amour : On s'amuse bien.. . »,
25 septembre 1994, p. 80.
MONTESSUIT, Carmen. « Equus : Une mise en scène rigoureuse »,
26 septembre 1994. p. 52.
MONTESSUIT, Carmen. a La Mouette : Spirituel, grave et tragique », 6 octobre
1994, p. 47.
MONTESSUIT, Carrnen. « La dernière bande : Une performance de Gabriel
Gascon I cc Pas moi : Le grand art de Danièle Panneton D, 7 octobre 1994,
p. 36.
MONTESSUIT, Carmen. « George Dandin au TNM : Un Molière rendu sévère »,
14 octobre 1994, p. 42.
MONTESSUIT, Carmen. « Les Muses orphelines au Théâtre d'Aujourd'hui : Un
souvenir impérissable 3,20 octobre 1994, p. 55.
MONTESSUIT, Carmen. c Eddy de Jean-Marc Dalpé : Une histoire de boxeurs
ennuyeuse pour une femme D, 21 octobre 1994, p. 43.
MONTESSUIT, Carmen. « Une pièce de Michel Tremblay : Théatre-midi
avec Carloffa et Johnny », 28 octobre 1994, p. 46.
MONTESSUIT, Carmen. « La jeune fille et la mort ... : Violée sur un air de
Schubert », 31 octobre 1994, p. 45.
MONTESSUIT, Carmen. c Après la chute : des trouvailles et de grands
comédiens pour Arthur Miller B, 5 novembre 1994, p. WE 8.
MONTESSUIT, Carmen. a Les mûres de Pierre : Un conte rural attachant »,
5 novembre 1994, p. WE 9.
MONTESSUIT, Carmen. « La espera : Un portrait émouvant de la vie de
réfugiés politiques D, 12 novembre 1994, p. WE 7.
MONTESSUIT, Cannen. « Tout va pour le mieux ... au Rideau Vert »,
14 novembre 1994, p. 46.
MONTESSUIT, Carmen. « Arlequin, serviteur de deux maîtres : Étourdissant! »,
18 novembre 1994, p. 49.
MONTESSUIT, Carmen. cc Jeanne Dark : Un spectacle très austère n,
23 novembre 1994, p. 66.
MONTESSUIT, Carmen. n Le Don Juan de Brecht : détestable B, 30 novembre
1994, p. 55.
MONTESSUIT, Carmen.
p. 46.
cc
Salvador: Un texte superbe », 5 décembre 1994,
MONTESSUIT, Carmen. « Cabaret neiges noires : Des thèmes sociaux sur fond
tragique », 8 décembre 1994, p. 52.
MONTESSUIT, Carmen.
cc
Le Père Noël est une ordure... B, 12 décembre 1994,
p. 50.
3- Critiques tirées du journal La Presse
BEAUNOYER, Jean.
1994, p. A l 5.
George Dandin : U n drame fort troublant », 14 octobre
BEAUNOYER, Jean. c Les Muses orphelines : Une des belles pièces de la
dramaturgie québécoise N, 21 octobre 1994, p. A1 0.
BEAUNOYER, Jean. « Après fa
1994, p. A1 3.
chute : Du grand Desgagnés D,
31 octobre
BEAUNOYER, Jean. « La jeune fille et fa moit : une excellente piéce montée
trop sagement D, 3 novembre 1994, p. 013.
BEAUNOYER, Jean. La espera : À la prochaine pièce de Retamal »,
9 novembre 1994, p. B5.
BEAUNOYER, Jean. Johnny, Carlotfa et Kiki: U n Tremblay qui se digère fort
bien B, 12 novembre 1994, p. €5.
BEAUNOYER, Jean. K Tout va pour /emieux au Rideau Vert : La surprise de la
saison D , 12 novembre 1994, p. E l 5.
BEAUNOYER, Jean. cc Une Jeanne Dark inspirée, mais un spectacle un peu
trop écrasant », 22 novembre 1994, p. A15.
BEAUNOYER, Jean. « Martine Chagnon : Clémence plus jeune », 26 novembre
1994, p. E4.
BEAUNOYER, Jean. K Tant pis pour le mythe. tant mieux pour les acteurs! »,
27 novembre 1994, p. B8.
BEAUNOYER, Jean. « Le showculte des jeunes : Cabaret neiges noires met
en scène le monde étouffé de la No Generation D, 3 décembre 1994, p. D i 3.
BEAUNOYER, Jean. n Corps à corps : On est bien loin d'Échec et mat »,
20 décembre 1994, p- 84.
KHAN, Jooned. « Pluralisme », 8 décembre 1994, p. 04.
LEPAGE, Jocelyne. a Le grand hôtel des étrangers : U n voyage virtuel et un
exploit visuel », 1" décembre 1994, p. D8.
Claude ou les désanois amoureux : Le drame d'une
RICHARD, Manon.
famille bien ordinaire P, 11 septembre 1994, p. 88.
SARFATI, Sonia. « Le Pays parallèle : Pour la bonne humeur et la sincérité u,
29 décembre 1994, p. Ç7.
THÉRIAULT, Yves. « Havel ... sous la manteau : Le vrai visage de la
dissidence D, 19 septembre 1994, p. E9.
THÉRIAULT, Yves. « Prise de sang : Collision frontale sur fond de racisme »,
19 septembre 1994, p. B7.
THÉRIAULT, Yves. a Des chevaux et des hommes », 24 septembre 1994,
p. ES.
THÉRIAULT, Yves. « Pascale Montpetit donne le ton à La Moueffe au Rideau
Vert B, 1'' octobre 1994, p. E4.
THÉRIAULT, Yves. « Beckett au Quat'sous : Une minuscule tache rouge dans
un océan noir D, 9 octobre 1994, p. B9.
4- Critiques tirées du journal Le Devoir
BÉLAIR, Michel. << Un étonnant appendice n, 6 décembre 1994, p. 88.
CHAREST, Rémi. a En pièces détachées : Jeanne et les anges est un
assemblage incohérent de cartes postales n, 30 septembre 1994, p. B8.
CHAREST, Rémi. « La brigade du rire contre-attaque : Pour comprendre
pourquoi les règles de l'art sont œ qu'elles sont », 4 octobre 1994, p. 87.
CHAREST, Rémi. ii Un Goglu court mais touchant », 24 octobre 1994, p. B I0.
CHAREST, Rémi. << Comédie avec facultés affaiblies », 22 novembre 1994,
p. B7.
CRON, Marie-Michèle. E< Grand hôtel des étrangers de Michel Lemieux et Victor
Pilon : L'exploration systématique des états seconds wl 6 décembre 1994. p. 88.
LARUE-LANGLOIS, Jacques. « Quand le comique occulte le policier >>,
28 décembre 1994, p. B8.
LÉVESQUE,Robert. << Jouer Havel ouvertement », 15 septembre 1994, p. 88.
LÉVESQUE,Robert. « La politique de la page 17 >>, 13 septembre 1994, p. 610.
LEVESQUE,Robert. c Un Zone des années néonazies », 19 septembre 1994.
p. B8.
LEVESQUE, Robert. c Une durée si proche de celle du rêve », 26 septembre
1994, p. 88.
LÉVESQUE, Robert. K Le temps des mouettes : Retour décevant d'André
Brassard à la mise en scène D, 4 octobre 1994, p. 88.
LEVESQUE,Robert. << Un Courteline de Moscou >>,6 octobre 1994, p. B8.
LÉVESQUE, Robert. « Le magistral Krapp de Gabriel Gascon », 7 octobre
1994, p. B I 1.
LÉVESQUE, Robert. « Le cocu pathétique : Un Dandin noir et décevant au
TNM D, 14 octobre 1994, p. B i 1.
LÉVESQUE,Robert. « Dans les sentiers battus B, 18 octobre 1994, p. B8.
LÉVESQUE,Robert. << La résurrection d'une pièce », 20 octobre 1994, p. 68.
LÉVESQUE,Robert. E< L'inavouable et l'impardonnable », 28 octobre 1994,
p. B l î .
LÉVESQUE.Robert. cc Tentative de sauvetage d'une pièce mal-aimée u,
1 novembre 1994, p. B8.
LÉVESQUE, Robert. « Un no way nommé désir », 12 novembre 1994, p. C7.
LÉVESQUE. Robert. « Où est passée la "vanité" de Genet? D, 14 novembre
1994, p. 68LÉVESQUE,Robert. K Le père se meurt n, 15 novembre 1994, p. 88.
LÉVESQUE, Robert. n Un Brecht à l'esthétique totalitaire M. 22 novembre 1994,
p. B8.
LÉVESQUE, Robert. « Le pur plaisir de jouer la comédie », 25 novembre 1994,
p. B10.
LEVESQUE, Robert. « Don Juan sans t'étoffe du héros >pl 29 novembre 1994,
p. B8.
RIOUX, Christian.
K Les nuages du multiculturalisme : Le jeune auteur
québécois Daniel Danis présente une pièce déroutante sur les ChampsElysées », 11 octobre 1994. p. B8.
5- Critiques tirées du iournal Voir
(L'indication des pages n'apparaît pas, ces articles ayant été consultés sur
f nternet.)
BOULANGER, Luc. cc Prise de sang : Pas de veine », 15 septembre 1994.
BOULANGER, Luc. fi Joualez-moi d'amour », 22 septembre 1994.
BOULANGER, Luc. K Parcours scénographigue : Chemin de traverse »,
22 septembre 1994.
BOULANGER, Luc. « Claude : Avec le temps », 22 septembre 1994.
BOULANGER, Luc. « Equus : Cheval de bois
P, 29
septembre 1994.
BOULANGER, Luc. a La Mouette : Ciel variable », 6 octobre 1994.
BOULANGER, Luc. « La Dernière Bande : Les grands explorateurs ».
13 octobre 1994.
BOULANGER, Luc. u George Dandin : Le ciel peut attendre )),20 octobre 1994.
BOULANGER. Luc. « Les Muses orphelines : Les bonnes grâces », 27 octobre
1994.
BOULANGER, Luc. <C Après la chute : Le procès
D, 3
novembre 1994.
BOULANGER, Luc- c Les Mûres de Pierre », 10 novembre 1994.
BOULANGER, Luc. « Jeanne Dark : Le rouge et le noir m. 24 novembre 1994.
BOULANGER, Luc. « Don Juan : La vie a du charme D, l
BOULANGER, Luc. « Grand hôtel des étrangers
N,
décembre 1994.
le'
décembre 1994.
BOUtANGER, Luc. << Salvador : Soleil trompeur », 8 décembre 1994.
LABRECQUE, Marie. (( Havel ... sous le manteau u, 15 septembre 1994LABRECQUE, Marie. (( Johnny, Carlotta et Kiki M, 27 octobre 1994.
LABRECQUE, Marie. a Teible and her Derman
D, 3
novembre 1994-
LABRECQUE, Marie. K La jeune fille et la mort », 3 novembre 1994.
LABRECQUE, Marie. K Caps : La famille stone », 17 novembre 1994.
LABRECQUE, Marie. « Le pére Noël est une ordure : Barbe à papa »,
15 décembre 1994.
MANDALIAN, Isabelle.« Contes du temps qui passe n, 13 octobre 1994.
MANDALIAN, Isabelle. (t Conte pour l'œil avide
N,
20 octobre 7994.
MANDALIAN, Isabelie. << Eddy : Coup de cœur », 10 octobre 1994.
MANDALIAN, Isabelle. << Haché menu comme chair a pâté », 27 octobre 1994.
MANDALIAN, Isabelle.
Gaspashow », 17 novembre 1994.
MANDALIAN, Isabelle. a La Espera
D,
1 7 novembre 1994.
MANDALIAN, Isabelle. « Marche de nuit
D,
17 novembre 1994.
MANDALIAN, Isabelle. a Arlequin, sewteur de deux martres
1994.
MANDALIAN, Isabelle.
D,
24 novembre
Ils volent quand ils dorment », 1 décembre 1994.
MANDALIAN, Isabelle. c Le Nez », 8 décembre 1994.
MANDALIAN, Isabelle. « Les Muses mutines », i5 décembre 1994.
Table analytique des matières
Page
Liste des figures
Introduction
Premier chapitre
Méthodologie et corpus
Deuxième chapitre
Analyse globale du contenu des critiques
Troisième chapitre
Analyse des critiques de chaque journal
Quatrième chapitre
Analyse des critiques des journalistes-vedettes
Cinquième chapitre
Analyse des cinq pièces critiquées par les journalistes-vedettes
5.1 George Dandin de Molière
(Théâtre du Nouveau Monde)
5.2 Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard
(Théâtre d'Aujourd'hui)
5.3Après fa chute d'Arthur Miller
(Compagnie Jean-Duceppe)
5.4 Jeanne Dark de Bertolt Brecht
(Théâtre du Nouveau Monde)
5.5 Don Juan de Bertolt Brecht
(Nouvelle Compagnie Théâtrale)
Page
Conclusion
Annexe
A. 1 Grille d'anaiyse d'Hervé Dupuis
A.2 Article analyse
Bibliographie
88