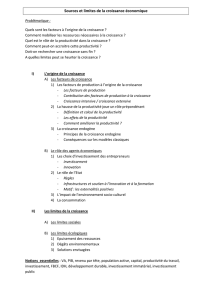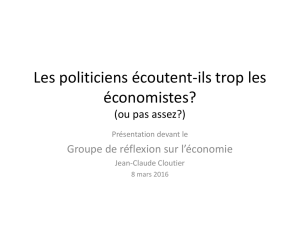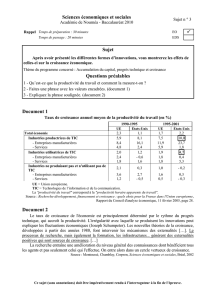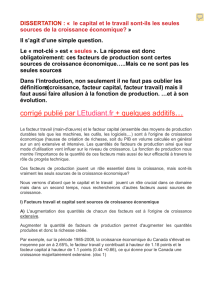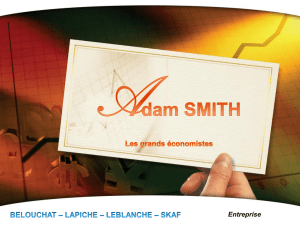Chapitre 2 - Sen

Cours Économie de l’Éducation 4e année
Chapitre 2 :
Analyse d’ensemble de la contribution de
l’éducation à la croissance économique.
Ce chapitre sera divisé en deux sections. Dans une première section, nous
ferons une revue de la littérature traitant du lien entre éducation et croissance
économique et dans une deuxième section, nous allons estimer la contribution de
l’éducation à la croissance économique par la Méthode des M.C.O.
SECTION 1 : Les fondements théoriques de la
relation éducation-croissance économique
La littérature sur la relation éducation-croissance est très fournie. La
théorie du capital humain en est la théorie centrale. L’une de ses prédictions
majeures est que l’éducation entraîne la croissance économique d’un pays. Cette
prédiction acquiert le rang de postulat dès l’instant qu’elle a su résister aux
attaques dont elle a été l’objet. Sur cette base, le problème qui se pose à la théorie
économique est comment l’éducation contribue-t-elle à la croissance économique ?
Cette théorie du capital humain postule que c’est par le biais de l’amélioration
de la productivité des travailleurs que l’éducation contribue à la croissance
économique. Cette contribution peut aussi se faire de manière indirecte par les
externalités positives engendrées par l’éducation et par d’autres types de
ressources humaines comme la santé, la pauvreté, la nutrition, la fécondité, etc. via
l’éducation.
I/ Les relations éducation-développement
La prise en compte de l’éducation en tant que facteur important de la
croissance dans les questions de développement, ne date pas d’aujourd’hui. L’histoire
de la pensée économique montre que Adam SMITH, fut l’un des premiers auteurs de
son époque à s’interroger sur la valeur intrinsèque de l’homme. Adam SMITH (1779)
dans « La richesse des nations… » écrivait sur la première page que la cause
principale du bien-être des individus réside dans l’intelligence, l’habileté et le
discernement (ability, dexterity and judgment) avec lequel tout travail est
effectué.

Cours Économie de l’Éducation 4e année
Mais le débat fut véritablement lancé dans les années 1960 où les
économistes ont commencé à s’interroger sur l’intérêt économique (pour la société)
de l’éducation.
Quelles peuvent être les implications économiques de l’éducation pour les
individus qui la reçoivent et les nations qui le mettent en œuvre ? C’est à cette
question que des efforts de réponse, sous la forme « d’une théorisation
systématique » (Logossah, 1994), vont voir le jour et donner naissance à la théorie
du capital humain.
II/ Le concept de capital humain et ses implications économiques
L’on a constaté que certaines activités économiques ont un impact immédiat
sur le bien-être de l’homme, alors que d’autres produisent des effets différés. En
exemple, si assister à un concert public ou aller à la plage peuvent procurer des
satisfactions immédiates à leurs bénéficiaires, aller à l’école ou apprendre un métier
exercent quant à eux des effets plus retardés et différés sur le bien-être des
individus qui le reçoivent. Car dans ce dernier cas, il faut du temps pour voir les
fruits de ces activités généralement des mois, des années voire même des
décennies.
C’est sous cet angle que, investir des efforts, sous toutes ses formes, en
faveur de l’éducation, a été considéré par Pierre Gravot (1993) comme un capital (au
sens économique du terme) capable d’améliorer la productivité des travailleurs.
Mais il faut dire que la notion du capital humain, dans sa conception
développementaliste, a bien évolué. A l’origine, le capital humain n’était appréhendé
que pour ces effets individuels, mais non collectifs (Saks, 994). Autrement dit,
l’éducation ne profite qu’à l’individu qui la reçoit. Ce qui a conduit un certain nombre
d’auteurs à soutenir que la société n’a pas intérêt à investir dans la formation des
individus. L’homme investit en lui-même pour des motifs personnels de profit et non
pour accroître la richesse de la nation ou l’entreprise (A. Marshall). Ce n’est que
bien après que l’idée que l’éducation contribue effectivement à la croissance
économique fut admise.
Mais là n’est as le problème essentiel. Si l’éducation contribue réellement à la
croissance économique, la question que l’on est en droit de se poser est de savoir
quels sont les canaux par lesquels se joue cette contribution.
L’impact de l’éducation sur la croissance économique et le développement
n’est plus à démontrer. Plusieurs études théoriques et empiriques (que nus
présenteront plus tard) consacrées à cette question inondent la littérature

Cours Économie de l’Éducation 4e année
économique de ces dernières années. Ce que Bowman a qualifié de « révolution dans
la pensée économique de l’investissement dans l’homme »
Selon la théorie traditionnelle du capital humain, c’est par le biais de
l’amélioration de la productivité des travailleurs que l’éducation contribue à la
croissance économique. Cette relation selon Beker (1964), résulte de ce que la
formation, qu’elle soit générale ou spécifique à une tâche, affecte positivement la
productivité des individus en améliorant leurs compétences et connaissance
générales, en leur procurant des qualifications directement ou potentiellement
applicables au processus de production.
En améliorant la qualification et la dextérité des travailleurs, l’éducation
crée un ensemble de facteurs au processus de production. Elle permet notamment à
l’économie, selon Gravot (1993), de disposer de main d’œuvre qualifiée surtout dans
le domaine scientifique et technique.
L’Etat, par ses investissements éducatifs doit pouvoir en tirer les avantages
à moins au moyen terme du fait de la capacité productive des citoyens qui s’en
trouve ainsi renforcée. Il augmente de cette manière toutes ses possibilités de
retrouver le chemin d’une croissance soutenue, condition nécessaire au
développement. Les expériences dans ce domaine ne manquent pas. L’histoire de la
pensée économique a montré que ce sont les pays qui ont le plus investi dans le
capital humain qui ont connu le degré de développement économique le plus élevé.
Lorsqu’on regarde les faits et les chiffres, on constate que le Japon, la
Corée, la Suisse… doivent leur extraordinaire développement à la qualité de leurs
ressources humaines. Les nouveaux pays industrialisés ont investi au moins 10 % de
leur PNB dans la recherche et développement. Les études consacrées aux « tigres »
de l’Asie du Sud-Est sont unanimes pour reconnaître que ce sont les énormes
investissements consentis dans le domaine de l’éducation, à la fin des années 1950
et au cours des années 1960, qui sont à la base de la croissance rapide enregistrée
par ces pays ces dernières années.
Il ressort de ces quelques observations empiriques, que l’éducation est un
facteur moteur et déterminant de la croissance économique et qu’à ce titre, son
implication dans les politiques de développement ne doit souffrir d’aucune légèreté.
Selon Augustine Oyowe (Le courrier septembre, octobre 1996) « tout ce dont un
pays a besoin pour réussir sur la plan économique est une main d’œuvre relativement
qualifiée et une certaine quantité de capital physique ou de ressources naturelles.
Or, l’Afrique subsaharienne dispose de ressources naturelles suffisantes. C’est
l’autre élément de l’équation, à savoir une main d’œuvre relativement formée qui lui
fait cruellement défaut ».
On voit que, l’éducation est un facteur d’efficacité qui élève la productivité
des travailleurs et contribue de cette manière à augmenter la production.
L’éducation est ainsi associée aux autres facteurs traditionnels (capital et travail)

Cours Économie de l’Éducation 4e année
pour expliquer les performances et les contres performances. Pour attester de la
validité de tous ces développements théoriques, diverses études ont essayé de
tester et de quantifier l’impact de l’éducation sur la croissance économique.
III/ L’impact global de l’éducation sur la croissance économique :
Analyses empiriques
Les premières tentatives de vérifications empiriques de l’effet de l’éducation
sur la croissance économique datent des années 1960 avec les travaux pionniers de
Sehultz (1961) et Denison (1962).
Ces études ont suscité un regain d’intérêt de la théorie de la croissance,
alors qu’on croyait déjà achevées ces recherches avec les travaux de Solow. E,
effet, selon la théorie traditionnelle de la croissance à la Slow, la croissance
économique est le résultat de la combinaison des facteurs capital et travail. Or les
tentatives de désagréger la croissance de la production en parts imputable au
capital et au travail, ont laissé apparaître l’existence d’un résidu inexpliqué
(Psacharopoulos et Woodhall, 1988). C’est en recherchant ce que cachait ce résidu
que les chercheurs ont pu se rendre compte qu’il est imputable aux effets
bénéfiques de l’éducation.
Par deux méthodes d’évaluation différentes mais équivalentes, Denison
(1961) et Schultz (1962) ont abouti à des résultats bien similaires. Denison calcule
que 23 % de la croissance des Etats-Unis entre 1930 et 1960, était imputable à
l’accroissement de l’éducation de la force du travail. Schultz (1963), par sa méthode
du taux de rendement, est arrivé lui aussi à la même conclusion que l’éducation
contribue pour une bonne part à la croissance américaine.
A la suite de ces deux auteurs, d’autres études vont être menées et
appliquées à d’autres pays pour des périodes différentes. Les résultats, même s’ils
sont assez disparates, attestent cependant de l’effet réel de l’éducation sur
l’activité économique. Une liaison que l’on qualifie de significativement positive.
Tableau 1.3 : Estimation de la contribution de l’éducation à la croissance économique des pays
développés.
Pays développés
Parts de l’éducation en %
Auteurs
Etats-Unis
Canada
R.F.A
Grande-Bretagne
Belgique
Japon
France
23
25
2
12
14
3,3
10
Denison
--
--
--
--
Psacharopoulos
Carré et al.

Cours Économie de l’Éducation 4e année
Source : A partir de Logossah, in économie et prévision, n° 116-1994-5
Tableau: Estimation de la contribution de l’éducation à la croissance économique des pays sous-
développés
Pays en développement
Parts de l’éducation en %
Auteurs
Argentine
Mexique
Brésil
Ghana
Nigeria
16
0,8
3,3
23,2
16
Nadiri (1972)
--
--
Psacharopoulos Carré et al. (1988)
---
Source : A partir de Logossah, in économie et prévision, n° 116-1994-5
L’observation qu’il convient de faire l’examen de ces tableaux, c’est qu’il y a
des différences relativement notables dans les taux de croissance entre les pays
développés (P.D) et les pays sous développés (P.V.D). Ces différences ne détruisent
en rien les prédictions de la théorie du capital humain. Elles traduisent plutôt une
réalité : la faible couverture scolaire et la baisse du rendement interne et externe
de l’éducation. Si lest Etats-Unis tirent 23 % de leur croissance de l’éducation, cela
est la conséquence des investissements réalisés dans ce domaine.
Le niveau de développement d’un pays est étroitement lié à son niveau
d’instruction au point même d’en dépendre. Plus le niveau d’éducation d’un peuple est
élevé, plus il y a de chance que ce pays soit développé. La question que l’on peut se
poser est de savoir quel est le niveau d’études à partir duquel on peut
raisonnablement parler d’un impact de l’éducation sur la croissance ? Il n’est pas
évident de répondre à une telle question, car la réponse varie d’un secteur d’activité
à un autre. Toutefois, des études empiriques ont montré que quatre années
d’enseignement élémentaire font progresser la productivité d’un agriculteur dans les
P.V.D de 8,7 % en moyenne.
Horowitz et Sherman (1980) en étudiant les performance des techniciens
des chantiers navales aux Etats-Unis, ont pu montrer que les équipes de travail
ayant un niveau d’éducation moyen plus élevé améliorant plus leur productivité que
celles dont le niveau de formation moyen est moindre.
IV/ Les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique
Les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique s’articulent
autour de deux points essentiels, d’une part ils se manifestent par les externalités
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%