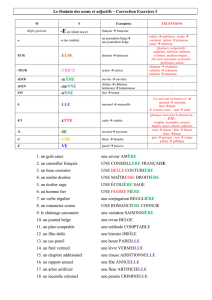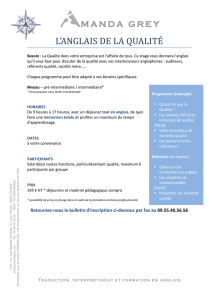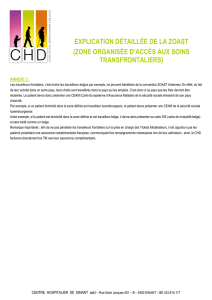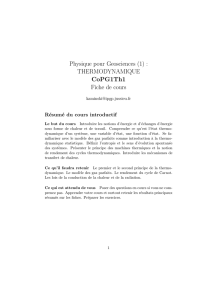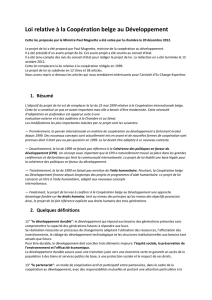fragments d`histoire - retouralaccueil Érudit
publicité

ili.
£
¿ u f 6 -
/7
^
( A jv v u u ^
PAUL HYMANS
FRAGMENTS D’HISTOIRE
IMPRESSIONS ET SOUVENIRS
P r é f a c e de
JULES BORDET
e lle n s js
.
1940
E D I T I O N S DE LA C O N N A I S S A N C E S.A. BRUXELLES
FRAGMENTS
IMPRESSIONS
D’ H I S T O I R E
ET S O U V E N I R S
PAUL HYMANS
FRAGMENTS D’HISTOIRE
IMPRESSIONS ET SOUVENIRS
P r é f a c e de
JULES BORDET
Co
949.303.3
HYMA
1940
E D I T I O N S DE LA C O N N A I S S A N C E S.A. BRUXELLES
DU MÊME A UTEU R:
F r è r e - O r b a n , tome 1 : 1812-1857 ; tom e II : La Belgique et le Second Empire.
J. Lebègue & Cle, Bruxelles.
P o r t r a i t s , E s s a is e t D is c o u r s . Henri Lamertin, Bruxelles 1914 .
P a g e s l i b é r a l e s . Les Editions du Flambeau, Bruxelles, 1936.
Copyricht 1939
by Editions de la Connaissance, s. a., Bruxelles
PRINTED IN DELCIUM
TABLE DES M A T I È R E S
P R É F A C E .......................................................................IX
LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME .
3
LA BELGIQUE
Les F o n d a t e u r s ..............................................23
Quelques leçons de l’H i s t o i r e ....................41
La vie politique pendant un demi-siècle (1888-1938)
La vie intellectuelle de 1830 à 1930 . . . .
54
58
1914-1919
Lord Grey de F a llo d o n .................................79
Une conversation avec Guillaume II . . .
113
L’Ultimatum — La Nuit du 2 au 3 août 1914 . . 117
Une mission belge aux E ta ts-U n is........................ 121
Tableau de G u e r r e .................................................. 146
La Fête de l’Indépendance à Londres, les 21 juillet
1916 et 1 9 1 7 ........................................................ 149
Un diplomate américain, W. H. Page . . . 153
Les Réparations — La priorité Belge et la libéra­
tion des dettes de g u e r r e .......................................161
LA PREM IÈRE ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DES
N A T I O N S ............................................................................. 169
VARIA
Réminiscences : Versailles — Waxweiler et Paul
L i p p e n s .......................................................................187
Emile V e rh a e re n ..........................................................190
Les vieux a r b r e s ..........................................................193
P R É F A CE
Un groupe d’amis de Paul Fïymans, dont j'a i le privilège
de jaire partie, s'est jormé en vue de lui offrir, à Voccasion de son
75ème anniversaire, en témoignage d'affectueuse admiration, ce
Recueil comprenant quelques-uns de ses écrits. Le jait que dans
ce groupe je suis l'un des plus proches de Paul Hymans par l'âge,
explique qu'on m'a chargé de lui exprimer, en quelques mots
de dédicace, les sentiments que tous au même degré nous éprou­
vons à son égard, et que nous ont inspirés la noblesse de son
caractère,l'éclat de son talent,le charme de sa personnalité. D'autres
eussent été jnieux qualifiés pour ce rôle d'interprète. Hélas, celui
qui sûrement eût été désigné ne se trouve plus parmi nous. Il était
pour Paul Hymans le confident le plus intime, le compagnon fidèle
avec lequel on se concerte, et que le même esprit anime. Et il
était pour moi, qu'on me permette d'évoquer ce souvenir, un cama­
rade d'enjance d'il y a 60 ans, un ami qu'on ne peut oublier.
C'est lui qui aurait dû parler en notre nom à Paul Hymans.
Aucun accent n'aurait pu le toucher plus profondément. Mais
cette noble voix s'est tue : Adolphe Max n'est plus.
Rendre hommage à Paul Hymans, c'est glorifier l'idéal qui
l'a guidé et qu'il poursuit encore de son énergie toujours jeune.
Sa carrière est un hymne à la liberté. C'est dans l'amour de la
liberté qu'il puise le zèle qu'il met à la déjendre, l'ardeur de son
éloquence, l'enthousiasme qui soutient son activité parlementaire,
toute de sincérité et de droiture, et qui est un exemple par l'élévation
des mobiles et la constance de l'effort. Comme il le disait lui-même
IX
de Jules Bara, la passion de la liberté et du droit ennoblit s o j i
existence.
Sans doute peut-on considérer comme définitives les grandes
conquêtes de la liberté, celle des Droits de l'homme notamment,
dont notre ami a fait récemment le sujet d'une belle conférence.
Pourtant, les hautes créations de la civilisation ont été parfois
anéanties, et il n'est pas exclu qu'un passé d'oppression puisse
revivre. Assurément, les hommes de la génération de Paul Hymans,
qui ont été élevés dans le souvenir encore vibrant des grandes
libérations, se refusent à penser que l'attachement à la liberté
pourrait devenir moins fervent. En ce pays, la servitude dont
certains peuples s accommodent n'inspirera jamais qu'une invin­
cible répulsion. Mais il ne suffit pas de protéger la liberté indivi­
duelle contre les entreprises de la force, il faut la défendre contre
les sophismes d une propagande qui cherche à en rapetisser les
bienfaits, ou même à la représenter comme contraire à l'intérêt
supérieur de la collectivité. Il est facile de prétendre, sans le moindre
soupçon de preuve, que telle doctrine est pernicieuse et menace dans
sa santé morale l ensemble de la Nation. C'est ainsi que dans
d autres pays on traque impitoyablement des croyances profon­
dément respectables. Il est facile d'affirmer, sans argument valable,
que telle réforme, en opposition manifeste avec le principe de
liberté, est nécessaire au bien de tous, et qu'il faut l'adopter en
immolant les droits de l'individu sur l'autel de la communauté.
C'est ainsi qu'ici même on s'oppose au libre choix de la langue,
en décrétant que même dans des régions qui depuis très long­
temps sont bilingues, les minorités linguistiques seront étouffées
pour la raison que les groupements dits culturels doivent disposer
intégralement du territoire qui leur est assigné, et préserver ja ­
lousement leur homogénéité et leur autonomie en empêchant toute
autre langue de servir de véhicule à Venseignement. Rappelons à ce
propos les mots de Paul Hymans : « Organe de la collectivité,
l'Etat n'a pas le pouvoir de façonner l'individu à son gré : la
raison d'Etat n'a que trop souvent servi aux audacieuses entreprises
de la Force contre le Droit ».
X
En divers poijits du monde, un nationalisme farouche or­
ganise sa tyrannie, contrecarrant révolution naturelle des idées
et des modes d'expression, rejoulant les aspirations qui haussent
les esprits vers une humanité solidaire. Tandis que le progrès
humain exige les contacts jéconds et les collaborations plus étroites,
on construit des barrières, on s'isole dans un ombrageux amourpropre de race. Contre de telles tendances, déjendons-nous en
défendant la liberté. A l'exemple de Paul Hymans, gardons une
foi profonde dans l'essor de la civilisation par le respect delà per­
sonnalité humaine et de sa dignité.
A l'Université, la liberté de la méditation et des recherches
s'appelle le libre-examen. Nous lui devons la pratique d'une
analyse libérée des parti-pris et des mots d'ordre, l'habitude d'une
critique impartiale et mesurée, attentive seulement à dégager le
vrai, ignorant les préférences irraisonnées, et n'accordant pas
d'indulgence spéciale aux conceptions qui ont à leur actif les
obscures prédilections instinctives. C'est lui qui nous apprend
à subir de bon gré le contrôle du Doute, ce censeur scrupuleux
dont l'ombre se profile sur les philosophies et qui, connaissant
nos faiblesses autant que la complexité des problèmes, enseigne
la sévérité pour soi-même et l'indulgence pour autrui. Pourvu
que la pensée résiste aux contraintes dogmatiques qui pourraient
l'étouffer, le libre-examen ne réprime aucun de ses élans et ne
réprouve aucune de ses méthodes. S'il autorise l'erivol des hypo­
thèses audacieuses qui prétendent aborder les problèmes éternels
dont l'homme est obsédé, il permet également la réserve prudente
de l'agnosticisme désabusé qui n'affronte pas l'inconnaissable.
Depuis un siècle, dans ce pays où l'on n'admettait guère que
c'est surtout dans le domaine des opinions qu'il faut traiter autrui
comme on désire être traité soi-même, de nombreuses générations
se sont formées sous son égide, dans une tradition de fière indé­
pendance, mais aussi d'égal respect pour les convictions du pro­
chain. Ce souci de juste réciprocité a désarmé sinon conquis cer­
tains milieux de prime abord hostiles, lesquels devaient finalement
reconnaître que la tolérance est la vertu sociale par excellence.
XI
En vérité, l'intolérance n'est légitime qu'envers l'intolérance. En
face de celle-ci, et seulement alors, l'adhésion au libre-examen est
une attitude de combat. Ceux qui le considèrent comme le principe
directeur ne pourront jamais se courber sous la contrainte intel­
lectuelle que font peser les dictatures, et c'est pourquoi notre Uni­
versité, dont il est le fondement et qui est un temple pour le Savoir,
est aussi, pour les libertés des citoyens et du pays, un rempart.
Comme l'a dit Paul Hymans, la tolérance n'est pas une abdication.
De notre Maison très aimée, Paul Ilymans est l'éloquent
porte-parole. Il lui fu t toujours profondément attaché, il collabore
quotidiennement à son fonctionnement depuis qu'il a pu délaisser
les responsabilités ministérielles dont il avait longtemps accepté
le fardeau, ayant été quinze ans membre du Gouvernement, et dix
ans, en des moments décisifs de notre histoire, et l'on sait avec quel
éclat, Ministre des Affaires étrangères. Pouvant consacrer désor­
mais plus de temps à l'Université, il prend une part plus directe
à sa vie intérieure et lui témoigne un dévouement qui est pour
lui-même une source de satisfactions, car la cause de l'enseignement
l'a toujours passionné. Nul n'a souligné avec plus d'insistance
la nécessité d'élever le niveau de la culture et de veiller à l'éducation
morale de nos populations. « Il ne suffit pas, disait-il, de proclamer
la liberté ; elle suppose une capacité et une organisation. Il n'y
aura de progrès social que parallèlement au progrès intellectuel.
Pour que la société s'améliore, l'homme lui-même doit devenir
meilleur ; aussi le progrès apparaît-il essentiellement comme
une œuvre d'éducation. L'importance des problèmes économiques
est vitale, mais on ne saurait les dissocier des problèmes moraux ;
l'émancipation intellectuelle du peuple et son émancipation maté­
rielle sont œuvres jumelles qu'il faut poursuivre simultanément ».
C'est dans cet esprit qu'il prit avec tant d'ardeur combative la
défense de l'école officielle en butte à de furieux assauts et qui,
ouverte à tous, ne pouvant être l'instrument d'un parti, se rapproche
de notre Université par son principe de stricte impartialité et
d'irréprochable tolérance. C'était d'ailleurs pourquoi elle était si
violemment attaquée. A u premier rang de ceux pour qui « le
X II
devoir de VEtat est de n'adopter et de ne proscrire aucune doctrine,
de rester à l'abri des disputes des sectes, de jaire ses écoles à son
image de façon à ce qu'elles puissent accueillir les enfants de
toutes les familles », il prononça, pour protéger l'enseignement
officiel contre des projets destructeurs, des discours dont le re­
tentissement fu t énorme et qui comptent parmi ses plus émouvants.
Mais il ne saurait être question aujourd'hui de chercher à
dépeindre, dans ces courtes lignes, une carrière qui n'a d'ailleurs
aucun besoin, pour s'imposer à l'unanime gratitude, que nous
en évoquions toutes les péripéties. Personne n'ignore que Paul
Hymans, par le rôle éminent qu'il assuma au Parlement et au
Gouvernement, par ses écrits qui touchent à tant de problèmes
sociaux et politiques ou qui retracent îiotre histoire parlementaire,
par son éloquence dont l'intensité de vie et l'émotion communi­
quent l'enthousiasme, par le respect accru que son talent valut
à la Belgique dont il était le mandataire dans les grandes assem­
blées internationales, par son constant souci de promouvoir les
œuvres d'enseignement, figure au premier rang de ceux qui con­
tribuèrent avec autorité à l'ascension intellectuelle et au prestige
de notre démocratie.
Aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire qui compte
des années dont le nombre est devenu imposant mais dont le poids
est resté bien léger tant il est vaillamment et allègrement supporté,
c'est à l'ami que nous nous adressons pour le féliciter de tout
cœur et pour lui exprimer, avec l'assurance de notre grande af­
fection, le vœu que nous formons de le voir longtemps encore présider
aux destinées de notre Université.
Bruxelles, le 23 mars 1940.
JU L E S BORDET
X III
LA
RATION DES
R O ITS DE
LA DÉCLA
DÉCLARATION
DES D
DROITS
DE
LL ’HOMME
' HOMME
LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME
Conférence à V Université Libre de Bruxelles sous
les auspices du Cercle «Le Libre Examen » et de
rU nion des Anciens Étudiants, le 5 jan vier 1940.
Je suis heureux d’être appelé à parler ce soir devant
une vaste assemblée universitaire où se confondent tous les
âges. Heureux et un peu confus. Car les anciens et les jeunes
ne s’accordent pas toujours. Chaque âge a sa façon de sentir,
de comprendre, de s’exprimer.
Les jeunes, par une poussée naturelle et qu’il ne faut pas
regretter pensent plus hardiment et plus vite. Au seuil de la
vie, ils voient devant eux d’immenses horizons. Ils sont prêts
aux lointaines explorations. Ils referont le monde. E t le monde
en a bien besoin !
Les vétérans se méfient de l’audace des débutants. Il y a
entre eux une différence d’humeur qui parfois les éloigne et
les oppose.
Mais à certains moments, dans certaines crises qui remuent
le fond de l’âme, une même pensée de salut, un même idéal
suprême rassemblent tous les esprits d’une même race intel­
lectuelle.
Nous traversons l’une de ces périodes critiques. Nous sen­
tons le besoin de nous rapprocher pour affirmer notre atta­
chement à certaines grandes vérités essentielles sur qui repose
notre conception de l’être humain, du progrès, de la civilisation.
La première, la plus noble, la plus vivifiante, c’est la liberté.
Je vais parler d’un grand fait historique, d’un acte mémo­
rable qui annonça le règne de la liberté, la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen.
Elle remonte à 1789. Dans l’année qui vient de finir, on
célébra solennellement son 150e anniversaire. Il n’est pas trop
tard pour que nous le célébrions a notre tour.
Les événements qui se déroulent autour de nous donnent
à ce grand souvenir une émouvante actualité.
3
Il semble, disait récemment M. Edouard Herriot, que
l’humanité soit arrivée à un tournant décisif de son histoire.
Tout ce qui fait l’honneur, le prix, la raison de la vie humaine
est mis en cause.
Il fut un temps, non éloigné de nous, où la liberté semblait
le climat de toute société évoluée. Nous la respirions comme
l’atmosphère naturelle de nos pays et de notre époque. Là où
elle supportait des limitations et des entraves, il semblait
qu’elle fût l’idéal vers lequel tendaient les peuples qui n’avaient
pas franchi jusque là les étapes nécessaires et atteint la majorité
politique. On la tenait pour la forme supérieure de la civili­
sation. Les peuples qui l’avaient n’en parlaient plus, tant ils
en étaient pénétrés, tant ils en avaient l’habitude. La liberté
pour eux, était une condition normale et en quelque sorte
vulgaire de l’existence.
Aujourd’hui, on frissonne, on s’exalte au spectacle de la
liberté en danger.
On sent, en voyant se dresser la menace, le prix de l’indi­
vidualité humaine, de ses forces, des biens qu’on en retire ; on
mesure la valeur morale des grandes libertés civiles et publiques
qui sont les instruments de la vie commune et les conditions
des progrès de la science, de l’art, de toute l’œuvre de l’esprit.
E t voici que remonte à la mémoire le grand Acte qui mit
fin il y a 150 ans, à l’absolutisme royal et aux privilèges du
régime féodal, qui fixa les droits de l’homme et du citoyen,
qui proclama la liberté et l’égalité.
La Déclaration sera le préambule de la Constitution de
1791. Elle condense en quelques formules sculpturales les
règles qui inaugurent un monde nouveau.
Je me borne, en ce moment, à en montrer quelques unes,
les dominantes, celles qui ont le plus de relief:
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Les droits imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la
propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression.
N ul ne peut être inquiété pour ses opinions. Tout citoyen
peut parler, écrire, imprimer librement.
La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être
la même pour tous.
Nul ne peut être accusé, arrêté, détenu que dans les cas et
suivant les formes déterminées par la loi.
Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes
ou leurs représentants la nécessité de la contribution publique et
de la consentir librement.
La Déclaration des Droits n’est pas une œuvre improvisée
dans la chaleur de discussions parlementaires ; ce n’est pas
non plus un catéchisme idéologique élaboré par un comité
de philosophes, le fruit d’un pur travail académique.
Elle est le résultat d’une profonde évolution des mœurs
et d’une longue opération intellectuelle ; elle n’est pas exclusi­
vement nationale et française, car elle a des racines en Amérique
et en Angleterre. Elle a été préparée par les abus et la désagré­
gation d’un régime, les souffrances du peuple et la crise finan­
cière où une administration incapable avait précipité la France.
La liberté n’est pas une fleur qui jaillit dans un jardin,
en quelques heures de soleil. Elle germe et pousse lentement.
Elle doit se conquérir et se mériter.
La Déclaration des Droits est le fronton de la Révolution
française, mouvement immense de délivrance et d’émanci­
pation et qui marque, comme la Renaissance, comme la Ré­
forme au XVIe siècle, une des grandes étapes de l’humanité.
Ah ! sans doute, la Révolution Française n’est pas un
bloc, contrairement à ce que dit un jour Clémenceau quand il
n’était encore qu’un ardent polémiste, bien avant les deux an­
nées de gloire pendant lesquelles il fit la guerre et la gagna.
Elle eut des aspects sinistres : la Terreur, la guillotine,
le Comité de Salut Public, les massacres de L’Abbaye, le mas­
que hideux de Marat, le froid et cruel doctrinarisme de Ro­
bespierre.
E t d’autre part si l’on embrasse toute la période révolu­
tionnaire de Louis XVI à Napoléon, quel prodigieux spectacle !
Ce sont d’abord les grandes journées de 1789, la réunion
des Etats Généraux dans tout l’appareil de la Cour, le Serment
du Jeu de Paume, la nuit du 4 août où s’effondrent les privi­
lèges féodaux, c’est la Déclaration des Droits.
Puis la Convention, le fanatisme jacobin, un gouvernement
féroce qui fait tomber les têtes, bouleverse la France et qui en
5
même temps lève une armée et repousse l’invasion ; une archi­
duchesse d’Autriche, reine de France, mourant sur l’échafaud,
et quelques années après une autre archiduchesse d’Autriche,
sa parente, m ontant sur le même trône orné de l’aigle impérial,
où l’appelle son mariage avec un sous-lieutenant de la Républi­
que couronné Empereur, Bonaparte devenu Napoléon !
Voilà, dit Le Bon dans sa Psychologie des Révolutions,
une tragédie unique dans les annales du genre humain !
Mais nous n’entreprenons pas ici de faire l’histoire de la
Révolution française et de la juger dans toutes ses manifesta­
tions, ses grandeurs et ses faiblesses, son héroisme et ses crimes.
C’est la Déclaration des Droits de l’Homme que nous cé­
lébrons. Elle transforme les bases de la vie civile et politique
d’un peuple qui, à la fin du X V IIIe siècle, par la pensée, la
culture de l’esprit, l’éclat de son passé de puissance et de
gloire, brille au sommet de la civilisation européenne.
La Déclaration est l’aboutissement d’un siècle de progrès
scientifique et d’un renouveau de l’esprit.
Les sciences physiques et naturelles se sont étendues et af­
fermies. Newton a construit un système du monde. Laplace
explique le mouvement des planètes et le mécanisme céleste.
Lavoisier décompose l’air, découvre l’oxygène et enseigne la théo­
rie de la respiration. Buffon écrit l’histoire du globe.
On se passionne pour l’observation de la nature, et paral­
lèlement les écrivains, dans le domaine moral et philosophique,
se détachent de la théologie, des traditions pour étudier l’homme,
pour discuter les institutions, les lois, les moeurs. L’esprit criti­
que s’éveille. La religion et l’E tat, la loi et la coutume sont sou­
mis à l’analyse et à la discussion.
La littérature réflète ces tendances nouvelles et leur donne
le prestige et le charme du style.
Voltaire inaugure le règne de l’opinion publique. Ses contes,
ses satyres, ses pamphlets, lui créent une extraordinaire popu­
larité. Il fait, par d’admirables plaidoyers, reviser le jugement
qui a condamné le calviniste Calas à la peine affreuse de la roue,
sous l’accusation d’avoir tué son fils, afin d’empêcher qu’il ne se
convertisse à la réligion catholique. Voltaire, selon le mot de
Brunetière, résume toutes les forces éparses de la libre pensée.
Jean Jacques Rousseau publie son Contrat social, qui crée
6
un type imaginaire de souveraineté populaire, de gouvernement
direct du peuple par le peuple, et son Emile, manuel d’éducation
inspiré de l’idée de la bonté originelle de l’homme. Ses livres
enflamment l’imagination.
Montesquieu, dans ses Lettres persanes, décrit ironiquement
les ridicules, les préjugés, les friperies du régime. Dans son grand
ouvrage, L'Esprit des lois, dont 22 éditions parurent en moins de
deux ans, il étudie les formes de l’E tat, les organes et les moeurs
politiques, vante la tolérance et s’oriente vers la monarchie
constitutionnelle selon le modèle de la monarchie anglaise.
Les Encyclopédistes Diderot, d’Alembert, Condillac, forment
toute une armée philosophique qui affirme les droits de la rai­
son, combat les croyances et les institutions du passé, et montre
dans le progrès des sciences, les sources de l’amélioration du
sort de l’humanité.
La pensée française se pénètre et s’enrichit des exemples
qui lui viennent d’Amérique et d’Angleterre.
On remonte à la Magna Charta (la Grande Charte) de 1215,
et à la loi d'Habeas Copus qui ont protégé l’individu contre l’ar­
restation et la détention arbitraires. Voltaire et Montesquieu
ont lu les ouvrages de Locke, défenseur de la liberté religieuse
et politique. Ils ont séjourné en Angleterre et se sont imprég­
nés de sa mentalité.
Mais d’Amérique vient la leçon récente et directe.
Les colonies britanniques de l’Amérique du Nord se sont
révoltées. La France les a assistées, leur a envoyé des soldats
et un capitaine, La Fayette. Les colonies ont conquis l’autono­
mie et fondé une République.
La Virginie, la première, s’est déclarée indépendante et
s’est donné, en 1776, une constitution qui énumère tous les prin­
cipes que l’on retrouve dans la Déclaration française de 1789 :
La nature a fait tous les hommes libres ; les hommes ont droit
au libre exercice de leur religion ; on ne peut priver les hommes
des droits qui se rapportent à la vie, à la liberté, à la propriété ;
aucun office public ne peut être héréditaire ; les pouvoirs exécu­
tif et législatif doivent être séparés et distincts du pouvoir judicaire.
Ces idées s’infiltrent dans les classes éclairées, dans la bour­
geoisie et dans la noblesse.
7
La bourgeoisie, — ce Tiers E tat qui, selon le mot de Sieyès,
est tout, n’est rien dans l’ordre politique et demande à devenir
quelque chose — s’est enrichie dans le commerce et l’industrie.
Elle est énergique, intelligente, ambitieuse. Elle s’irrite des
privilèges de l’aristocratie. Elle veut sa part d’honneurs et de
pouvoir.
La noblesse, qui a joué dans l’histoire de la monarchie fran­
çaise un rôle si éclatant, est désoeuvrée et frondeuse. Elle tirait
toute sa force et sa fortune de la terre. E t Louis XIV l’avait
déracinée en l’appelant à la Cour de Versailles où elle paradait
et se ruinait. Les seigneurs ont quitté leurs domaines et leurs
intendants pressurent les vassaux. La noblesse est cultivée.
Elle brille dans les conversations de salon. L’esprit du siècle
l’atteint. Il se forme des groupes de gentilhommes démocrates
et libéraux. On lit, on commente Voltaire, Rousseau, Montes­
quieu. On va au théâtre applaudir Beaumarchais.
Le commandement de l’armée faiblit. Les charges d’of­
ficier ne se donnent qu’aux nobles. Des loges maçonniques mili­
taires se forment. On en comptait 25 en 1789.
La Maçonnerie devient un centre de discussion et de propa­
gande. Beaucoup de grands seigneurs s’y rencontrent et y fra­
ternisent avec des officiers, et même certains membres du haut
clergé.
Le mouvement qui se dessine et s’amplifie n’est pas di­
rigé contre la Monarchie, qui a conservé aux yeux du peuple et
de l’élite le caractère presque sacré de la légitimité.
Mais l’administration est dans le désordre. L’arbitraire
sévit partout. On veut une Constitution, la disparition des privi­
lèges féodaux. On aspire à l’ordre, à la justice, à la liberté.
E t la vieille société, qui va disparaître, s’affaiblit. Les
murs qui la soutiennent fléchissent. Des pierres se détachent.
Dans le clergé la division apparaît. En haut, quelques
nobles prélats dont les diocèses rapportent des centaines de mil­
le livres. Il est des prélats de salon dont les plaisirs se con­
fondent avec ceux de la noblesse frivole et des gentilshommes
libéraux. Mais le petit clergé est misérable. On évalue la fortune
immobilière de l’Eglise à plus de 3 milliards. Elle possède d’im­
menses domaines. Elle prélève sur les fidèles l’impot de la dîme,
qui épuise les petits et soulève les colères.
8
En dessous des classes privilégiées le peuple, les paysans
accablés de taxes injustement réparties, de redevances seigneuria­
les, réduit à une sorte de servage, reste de la féodalité. Le paysan
traivaille, achète de la terre, et aspire à l’égalité de l’impôt.
La plèbe rurale est prête à s’insurger contre les privilèges. Le
petit peuple des villes se débat dans la misère.
Le bas clergé, dit Taine, est hostile aux prélats, les gentils­
hommes de province à la noblesse de Cour, le vassal au seigneur,
le paysan au citadin. L’anarchie contamine l’armée.
Le gouvernement se désorganise. Le Roi, demeuré populaire,
est mal conseillé et de médiocre intelligence. La Cour de Versail­
les se gaspille en fêtes et en prodigalités. Le Trésor se vide.
Necker lance de grands emprunts qui ne comblent pas le
déficit.
Enfin, en 1787, une crise agricole ajoute au mécontentement
les souffrances de la disette. L’heure vient où le Roi, impuis­
sant devant les événements et les esprits, décide, sur l’avis de
Necker, de consulter la Nation.
Le 1er janvier 1789 la France apprend que le Roi vient, par
décret, de convoquer les Etats Généraux.
Leur dernière assemblée remontait à 175 ans.
Un frisson secoua le pays.
Tous ceux qui se sentaient opprimés entrevirent la déli­
vrance.
On réformerait une administration boiteuse et vieillie. On or­
ganiserait l’E tat. On donnerait une Constitution au Royaume.
On ne songeait ni à la République, ni au régime parlementaire.
On voulait des garanties contre l’absolutisme, la suppres­
sion des impôts iniques et dévalisateurs, l’abolition des privi­
lèges, l’égalité devant la loi.
Les trois ordres éliront leurs députés, la noblesse, le clergé,
le Tiers E tat. Dans toute la France se réunissent leurs assem­
blées, qui formulent leurs vœux et les inscrivent dans des mil­
liers de cahiers.
Cet élan universel aurait pu conduire à la réforme si des
hommes d’E tat, à l’œil sûr et de claire volonté avaient compris
et conduit le mouvement. L’incapacité royale et gouvernemen­
tale le mena à la Révolution.
En mai les élus se réunissent à Versailles. E t tout de suite
9
apparaît la rivalité qui dresse le Tiers E tat contre les deux ordres
privilégiés, la noblesse et le clergé.
Le Tiers les appelle à lui pour se confondre et ne faire qu’une
assemblée. La discorde éclate. La Cour résiste. Le Tiers s’in­
surge.
Dans la noblesse quelques jeunes seigneurs, à l’esprit géné­
reux, se déclarent prêts à l’union. Le clergé cède le premier.
A la sortie de la séance, six évêques fusionnistes sont por­
tés en triomphe par la foule qui dans la rue, acclame et pleure
de joie.
E t le 20 juin, dans la salle du Jeu de Paume, se déroule la
scène historique où les députés se pressant autour de Bailly,
jurent «qu’ils ne se sépareront pas avant que la Constitution soit
établie et affermie sur des fondements solides.»
Dans les jours qui suivent la noblesse et le clergé arrivent
par groupes à l’Assemblée qui devient ainsi la représentation
de la grande communauté française. C’est l’Assemblée Nationale
qui deviendra bientôt l’Assemblée Constitutante.
Mais tout à coup la rue va parler. Une misère intense règne
dans Paris. Les récoltes ont été mauvaises. On a faim dans les
campagnes. Des bandes de brigands les ravagent. En ville on
dévalise les boutiques. Une agitation générale remplit la cité.
Les bruits les plus extraordinaires circulent. Des agitateurs af­
folent les bourgeois. On raconte que la Cour prépare un coup
d’E tat. Camille Desmoulins harangue les patriotes dans le jar­
din du Palais Royal.
Le 14 juillet la foule surexcitée se jette sur la Bastille,
y pénètre de force ; on assassine le gouverneur et les défenseurs
de la forteresse et l’on promène leurs têtes au bout de piques.
Ce fut un carnage affreux.
E t chose extraordinaire, la date - 14 juillet - de cet exploit
sanguinaire et stupide en somme d’une.foule en délire, est devenue
la date symbolique de la Révolution française.
C’est que la Bastille où l’on enfermait les gentilshommes
frappés d’une lettre de cachet, emprisonnés par ordre royal, sans
procès et sans défense, représente l’image de l’absolutisme, et
que sa destruction apparaît, au début de la grande tragédie,
comme le signal de l’émancipation.
Cependant, le mouvement populaire jette l’inquiétude dans
10
l’âme de ceux qui ont assumé la direction de la réforme consti­
tutionnelle.
On a peur des violences populaires, autant que des résis­
tances de la Cour.
Il faut se hâter, accomplir des actes décisifs qui apaiseront
les passions.
E t c’est alors la nuit du 4 août, où l’Assemblée, dans une
sorte d’émulation fiévreuse des nobles et des prêtres, abolit
tous les privilèges féodaux.
La féodalité disparaît. Déjà des voix annoncent que les
biens ecclésiastiques appartiennent à la nation.
Quelques mois plus tard, et tandis que la crise financière
arrache à Mirabeau cette apostrophe célèbre : La hideuse
banaueroute est là... et vous délibérez ! le clergé vient renon­
cer aux biens de l’Eglise dont les revenus se partagaient entre
quelques centaines de prélats et d’abbés de Cour. Ils deviennent
ceux de la nation et la dîme est abolie.
Ainsi le vieux régime est à terre. Un chapitre monumental
de l’histoire de France se termine.
On va reconstruire sur d’autres bases, dans un autre style.
Le 14 juillet, le jour même de la prise de la Bastille, l’As­
semblée nationale nomma un Comité chargé de rédiger un projet
de constitution.
L’idée surgit immédiatement d’inscrire en tête de la Consti­
tution une déclaration de principes. L’exemple donné par les Amé­
ricains inspira cette initiative. Cependant des hésitations se mani­
festèrent. De jeunes nobles enthousiastes, le Comte de Mont­
morency, le Comte de Castellane entraînèrent l’Assemblée.
Fallait-il proclamer les droits du peuple au moment où la mul­
titude se livrait à des excès ? Castellane répondit : Le vrai
moyen d’arrêter la licence est de proclamer la liberté.
Plusieurs projets furent rédigés. Mirabeau présenta un
rapport. L’accord ne se fit pas. On renvoya le tout aux bureaux.
Enfin, le 20 août, la discussion s’ouvrit. Le 26 août la Décla­
ration fut votée.
Aulard met en relief ce phénomène presque invraisembla­
ble : 1200 députés incapables d’aboutir à une expression con­
cise et lumineuse quand ils travaillaient soit isolément soit
par petits groupes, trouvèrent les vrais formules courtes et no­
il
bles dans le tumulte d’une discussion publique et c’est à coups
d’amendements improvisés que se construisit en une semaine
l’édifice de la Déclaration des Droits.
La Déclaration fonde la société sur la conception de l’hom­
me libre.
L’ordre ancien, a dit Goethe, reposait sur le dogme de l’auto­
rité. Il fait place à un ordre nouveau dont la liberté est la base.
Sans relire les X V II articles de la Déclaration, je vais tout
droit à trois phrases qui, à mon sens, renferment l’essence de la
conception de l’homme nouveau, de l’homme moderne :
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même reli­
gieuses.
La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'homme.
Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement.
C’est l’affirmation primordiale de la liberté d’expression
de la pensée, de la pensée libre par nature, attachée à la vie
même, attribut de l'intelligence, et dont aucune puissance ne
peut tarir la source intérieure.
L’homme est un être pensant.
La doctrine cartésienne est au fond de la règle politique
inscrite dans la Déclaration.
La pensée libre a le droit et le besoin de se manifester
par la discussion, la critique, le raisonnement, la persuasion.
Ainsi se révèle et s’affermit la personnalité humaine ; ainsi
se forment la conscience et le caractère, ainsi monte la valeur
morale d’un peuple.
Telle est la conception nouvelle de l’homme.
Voyons la conception de la société politique, de l’E tat.
La Déclaration établit le principe qui domine la consti­
tution de l’E tat : la souveraineté réside dans la nation. Nul
corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en
émane expressément. Les pouvoirs seront séparés. Les impôts
seront consentis par les représentants de la Nation.
Le but de l’association politique est la conservation des
droits naturels de l’homme.
Les hommes naissent libres et égaux en droits. Les dis­
tinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité pu­
blique.
12
L’égalité est consacrée et garantie. La loi doit être la même
pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Tous les citoyens sont admissibles aux emplois publics
selon leurs capacités, leurs vertus et leurs talents.
Nul ne peut être privé de sa propriété, que pour cause d’u ti­
lité publique, moyennant juste et préalable indemnité.
Enfin, à côté de l’idée de liberté, apparaît l’idée de soli­
darité.
L’E tat peut défendre les actions nuisibles à la société.
L’exercice des droits naturels de chaque homme a pour
borne les droits d’autrui. L’E tat peut limiter les droits indivi­
duels dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des droits
individuels de tous.
Deux Décrets émanés de la Déclaration des Droits en sont
la magnifique illustration. Ils redressent les injustices engendrées
par le dogme et l’intolérance.
Louis XIV par la révocation de l’Edit de Nantes, qui autori­
sait l’exercice du culte calviniste, avait frappé des milliers de
familles et chassé de France une élite qui s’était refugiée en
Allemagne et en Hollande. Un décret du 21 décembre 1789 rendu
en vertu de la Déclaration des Droits donna aux Protestants
l’égalité civique.
Par un decret du 27 septembre 1791, l’Assemblée, qui
allait se dissoudre, accorda les droits civiques aux Israélites.
Ainsi, avant de se séparer, elle restaurait et consacrait la li­
berté de conscience.
La Constitution de 1791 dont l’élaboration suivit la Décla­
ration des Droits de l’Homme, en confirma, en appliqua les
principes et régla le mécanisme de l’E tat.
Mais elle ne poussa pas l’égalité civile jusqu’à l’égalité
politique. Elle n’attribua pas à tous le droit électoral. Elle
organisa le suffrage à deux degrés. Il y aurait des assemblées
primaires composées de tous les citoyens âgés de 25 ans, domi­
ciliés depuis un an et payant une contribution directe égale à
la valeur de trois journées de travail. Ces assemblées nomme­
raient des assemblées électorales, composées de citoyens pro­
priétaires ou locataires de biens rapportant un revenu équi­
valent à la valeur de 150 à 200 journées de travail. Les assem­
blées électorales nommeraient les députés.
13
Ce régime repose sur l’idée que le droit de suffrage n’est
pas un droit naturel de l’homme, mais une fonction politique,
dont l’exercice exige certaines conditions d’indépendance et de
stabilité.
Cette idée, admise par le Constituant belge de 1831, expli­
que notre régime électoral censitaire qui subsista en Belgique
jusqu’à la révision constitutionnelle de 1893.
La Déclaration des Droits conserve à 150 ans de distance,
un magnifique rayonnement. On trouve en elle l’esprit de
l’Amérique nouvelle, l’esprit libéral de la vieille Angleterre,
où les institutions parlementaires poussent des racines pro­
fondes, l’esprit génial d’une France soudain affranchie, redressée,
dont la parole remuera l’Europe.
Les auteurs de la Déclaration ont voulu, disent-ils euxmêmes, parler pour tous les hommes, pour tous les temps.
La Déclaration n’est pas un formulaire philosophique, ni
un manifeste révolutionnaire.
C’est le programme de la vie sociale et politique des peuples
civilisés, arrivés, après une longue évolution, au niveau de culture
politique et morale nécessaire pour se gouverner eux-mêmes, ca­
pables d’une liberté intelligente, tolérante et disciplinée, qui
suscite l’effort et la concurrence, proscrit le privilège et l’arbi­
traire, et féconde le travail de la pensée, l’art et la technique.
La Déclaration contient tout l’esprit de la Révolution
française, qui, ainsi que le dit Pirenne, achève une évolution
historique et en inaugure une autre.
Elle fonde l’E tat sur la souveraineté de la nation, sur
la liberté du citoyen et sur l’égalité civile.
Ces idées, au milieu des bouleversements politiques, se
maintiendront et pénétreront la mentalité du peuple et des
classes gouvernantes.
Après l’Empire, en France, on en voit le reflet dans la Charte
de la Restauration.
Elles imprégneront en Belgique, après l’union à la Hollande
et la Loi Fondamentale, tout le mouvement qui tend à l’éta­
blissement d’un régime constitutionnel et libéral et qui aboutira
à la Révolution de 1830.
Notre Constitution belge en apparaît comme l’expression
la plus complète et la plus précise.
14
Pirenne l’a appelée avec raison le type le plus pur
d’une Constitution parlementaire et libérale. Nulle part, ditil, on n’a dispensé aussi largement la liberté et abandonné
aussi entièrement le gouvernement de la nation à la nation
même.
La Constitution votée par le Congrès National, en février
1831, après quelques semaines de discussion, formule ces règles,
qui découlent directement de la Déclaration de 1789.
Souveraineté de la nation dont tous les pouvoirs émanent,
et séparation des pouvoirs.
Il n’y a dans l’E tat, aucune distinction d’ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi.
La liberté individuelle est garantie.
La liberté des cultes, la liberté de manifester ses opinions
en toute matière, sont garanties.
La presse est libre.
Les Belges ont le droit de s’assembler et de s’associer.
Les Chambres représentent la nation, votent les lois et les
impôts.
Cependant, à aucun moment, dans les travaux prépara­
toires de la Constitution, dans les rapports, dans les débats
du Congrès, on ne découvre une mention, un rappel de la
Déclaration des Droits.
Les principes sont entrés dans les cerveaux, dans les
consciences. On ne les discute plus. Ils sont devenus une sorte
de loi morale commune et unanimement acceptée.
Mais un jour dans notre Parlement, la Révolution française,
et à vrai dire, sous le nom de Révolution française, la Décla­
ration des Droits fut mise en cause.
C’était en 1848, dans la discussion d’une question relative
à l’administration de la bienfaisance publique. Frère-Orban
soutenant la thèse de la laïcité de la bienfaisance, l’avait ra t­
tachée aux principes de 1789.
Cette évocation suscita les protestations de M. de Decker,
chef de la droite catholique, qui demanda si l’éloge de la Révo­
lution française était bien placé dans la bouche d’un ministre
du Roi. Il semblait aux réactionnaires de l’époque que cette
date retentissante ne fît surgir d’autre vision que celle des
échafauds de la Terreur.
15
Frère-Orban répondit par cet hommage éclatant :
« Je le crois, j ’ai dit que la révolution de 1789 était une
grande et magnifique révolution ; je n’ai pas parlé des excès
de 1792 et de 1793. J ’ai prononcé le mot de 89 qui rappelle
l’abolition des jurandes et des maîtrises, l’abolition des privi­
lèges de la noblesse et du clergé, qui rappelle l’avènement des
hommes du tiers état. C’est à cette révolution que nous devons
ce que nous sommes et comme nous avons reçu de père en fils,
avec le sang, le souvenir des ignominies qu’on fit peser sur le
tiers état pendant des siècles, nous pouvons aussi aujourd’hui
glorifier cette magnifique révolution de 89, et nous devons
plaindre ces insensés, ces ingrats, qui renient cette mère glorieuse
qui les a mis au monde à la vie publique, qui, de parias qu’ils
étaient, les a fait citoyens et, pour tout dire en un mot, qui
a proclamé de nouveau cette loi du Christ, la grande et sainte
égalité. » (*)
Nous venons de relire une page d’histoire.
A l’époque où Frère-Orban glorifiait la Révolution fran­
çaise, on n’en était encore éloigné que d’un peu plus d’un demisiècle.
La rumeur héroïque dont elle avait rempli le monde n’était
pas encore éteinte.
Le souvenir de l’ancien régime, omnipotence royale, droits
de la noblesse et du clergé, règlements corporatifs, entraves à
la liberté du commerce et du travail, hantait encore les esprits.
La liberté individuelle, le droit de l’homme forment la
substance de la doctrine professée par l’école libérale du milieu
du siècle dernier. Us expliquent la politique du free trade, du
libre échange, et la formule du laisser-faire. On attend de
l’initiative individuelle, du libre effort, de la concurrence,
l’amélioration matérielle et morale de la vie et toutes les formes
du progrès.
Mais une révolution industrielle va changer l’aspect de
l’Europe. Les découvertes scientifiques, les inventions, les
perfectionnements techniques engendrent les grandes entre­
prises qui concentrent les capitaux et agglomèrent la maind’œuvre. La population ouvrière prend conscience de ses
intérêts, s’organise et fait entendre des revendications.
(1) 22 janvier 1848
16
A côté des besoins individuels apparaissent les besoins
collectifs.
Les relations de la vie économique se compliquent. Les
intérêts s’enchevêtrent et s’affrontent.
La fonction de l’E tat s’élargit. On a jusqu’ici considéré
l’E tat comme le gardien des institutions et des libertés poli­
tiques et civiles. La fonction de l’E tat libéral, comme le dit
Marlio, devient double : la garantie des libertés, l’arbitrage des
intérêts.
L’arbitrage oblige à réglementer, donc à limiter l’action
des individus et des groupes sociaux. Il faut protéger le faible
contre le plus fort, coordonner les forces de la production, du
commerce, de l’agriculture, faciliter l’accord des ouvriers et
des patrons, organiser l’enseignement, encourager les travaux
de la science et de l’esprit, dégager des intérêts particuliers
l’intérêt général et le faire prévaloir, instituer et surveiller les
services publics qu’exige le développement de la vie commune.
La transformation des conditions économiques se répercute
dans le domaine des idées.
La notion de l’individu faiblit devant la notion de la
collectivité.
E t dans la notion de collectivité se dessine la notion de
classe.
On voit se propager et s’étendre une doctrine de classe qui
tend, par la lutte des classes, à la conquête de la suprématie.
Le problème est de concilier le droit de l’individu et l’inté­
rêt de la collectivité, de chercher à réaliser, dans un esprit de
justice et de coopération, et en tenant compte des mœurs,
des réalités, des possibilités pratiques, l’équilibre, condition
de la santé morale et sociale.
La tâche est difficile dans la Cité libre, comme l’appelle
Lippmann, bruissante d’appétits et d’ambitions, et que tra­
versent tant de courants économiques et de mouvements
d’idées.
E t combien plus difficile encore dans l’atmosphère où se
meut cette puissance anonyme et compacte, la masse.
La masse est un élément nouveau et redoutable de la vie
politique contemporaine. Elle absorbe l’individu, l’entraîne,
l’asservit. Elle est sensible et naïve, généreuse ou sauvage ;
17
elle cède facilement aux habiletés et aux frénésies de la parole
et de la propagande, qui dispose d’une prodigieuse instrumen­
tation technique.
La masse peut dans les grandes crises, conduire à la domi­
nation d’une classe, ou d’un parti, ou d’un homme, à la tyrannie,
à la dictature.
Si l’équilibre social se rompt, si le peuple, dans les heures
difficiles, perd confiance dans les institutions et les hommes
qui les dirigent, la recherche du neuf, l’attraction d’une formule,
l’appel sonore d’un aventurier peuvent le précipiter dans
l’inconnu.
L’œuvre de la liberté, un siècle et demi après la Déclaration
des Droits de l’Homme n’est pas achevée et demeure menacée.
Car la liberté est une récompense. Il ne suffit pas de la
proclamer pour qu’elle soit. Il faut la mériter par l’ordre, les
mœurs, la tolérance, le sens de la mesure et de l’équilibre.
André Maurois écrivait récemment ces lignes profondément
vraies :
« Pour fonder la liberté véritable, qui est un grand bien,
il faut non seulement des institutions libres, mais une éducation
morale. C’est dans la mesure où chacun de nous aura appris à
respecter le chef légal, à supporter l’existence d’une opposition,
à écouter les arguments de l’adversaire, et surtout à mettre
l’intérêt du pays au dessus des passions partisanes et des in­
térêts privés, que nous serons dignes d’être un peuple libre. »
Maurois termine en reniant une maxime de la Déclaration
de 1789.
La liberté, dit-il, n’est pas un droit imprescriptible de
l’homme.
Mais il conclut par ces mots justes :
« La liberté est une conquête souhaitable, mais difficile
et qu’il faut refaire chaque jour. »
Si sous la protection des lois, la liberté de parler, d’écrire,
de s’associer engendraient le désordre, l’anarchie, le déchaî­
nement des discordes civiles, l’habitude de l’insulte et de la
diffamation, la communauté sociale se décomposerait et le
premier coup de vent abattrait la liberté comme une plante
pourrie.
Les peuples qui ont réalisé la liberté ne l’ont pas décou-
18
verte par une sorte d’inspiration géniale. Ils se sont préparés
à la pratiquer par une séculaire éducation, par un long appren­
tissage. Ce sont les peuples évolués, ceux de l’Europe Occi­
dentale, l’Angleterre, mère du Parlement, la France qui pro­
clama les Droits de l’Homme, la Hollande, la Belgique, dont le
passé magnifique est rempli de luttes pour les franchises com­
munales et pour la conquête de l’indépendance.
La liberté vivra partout où l’homme gardera le sens de la
dignité et de la responsabilité, le goût et le besoin de l’initia­
tive, la capacité de se diriger selon sa conscience et ses facultés,
l’ambition de s’élever par sa valeur et son travail, partout où
la science et l’art conserveront un culte et du prestige.
Aujourd’hui, dans les démocraties libérales, la guerre,
la mobilisation des armées ont interrompu le fonctionnement
régulier des institutions. Les Parlements ont donné aux gou­
vernements des pouvoirs spéciaux qui suspendent le plein
exercice de la liberté. Toutes les énergies sont concentrées dans
la lutte contre l’adversaire ou dans la préparation de la défense
contre le péril d’une agression.
L’Europe entre dans une phase terrible de son histoire.
Nous avonsvu avec émotion des Etats faibles succomber
sous de plus forts. Au milieu des anxiétés qui nous obsèdent,
une lueur brilleau loin et nous réconforte. C’est le miracle
finlandais. C’est le spectacle d’un petit peuple libre et fier
qui défend héroïquement contre un Empire son existence et
son autonomie. La Finlande incarne aux yeux du monde la
cause de la civilisation.
La civilisation européenne fut un long effort des peuples
vers la liberté.
Sans doute il y eut des interruptions, des réactions, des
périodes d’attente et d’occultation.
La Terreur suivit la Déclaration des Droits de l’Homme et
les journées anarchiques de 1848 préparèrent le Second Empire.
Mais l’idée veillait et devait rallumer le flambeau.
L’exemple de la Belgique illustre la cause de la liberté.
La Belgique indépendante naquit il y a plus d’un siècle
au milieu d’une Europe hostile et méfiante. Elle a grandi et
traversé les crises les plus meurtrières, grâce à sa constitution
libérale, à la sagesse de ses Rois et d’une élite d’hommes d’E tat,
19
grâce à la pratique raisonnable de la liberté, à ses mœurs, à
son bon sens.
Dans la dernière guerre les démocraties libérales déplo­
yèrent une force de résistance supérieure à celles des Empires
autoritaires.
Mais m aintenant où allons-nous ?
Parfois, dans les heures de solitude et de méditation, on
se demande dans quelle condition morale l’humanité sortira
de l’effroyable épreuve où elle se débat.
Verrons-nous les idées de liberté, qui ont animé notre
jeunesse, céder devant les doctrines d’étatisme ou d’autarcie ?
Seront-elles écrasées par les doctrines totalitaires qui nient
les Droits de l’Homme, enferment la jeunesse dans un rigide
conformisme, font du citoyen le rouage automatique d’une
immense machinerie d’E tat et livrent l’individu à l’arbitraire
d’un pouvoir sans contrôle et sans frein ?
Comment un peuple habitué à la liberté pourrait-il revêtir
le corset de fer d’un régime policier et bureaucratique ? Com­
ment l’intelligence pourrait-elle subir la loi du silence ?
Nos âmes aspirent à un règne de moralité et de justice
qui assurera, dans la paix et dans l’ordre international, le plein
développement de la personne humaine.
Le génie est le fruit superbe de la pensée libre. La vie n’a
d’aisance et de sécurité, de charme et de noblesse que si les
relations entre les hommes sont dominées par le respect de la
dignité et de la conscience de l’individu.
Pour le salut de la morale et du Droit, la liberté doit vivre,
et elle vivra !
J ’ai été élevé dans le culte de la liberté. Je l’ai servie autant
que je l’ai pu. Je continue de l’aimer.
La liberté est nécessaire pour faire un peuple vigoureux,
des âmes fières, une jeunesse entreprenante, pour éveiller les
vocations et les initiatives. Elle est nécessaire pour l’épanouis­
sement de la pensée et de tout ce qui fait la beauté de la vie.
J ’ai foi dans la liberté.
Je crois aux forces éternelles de la conscience humaine.
20
LA BELGIQUE
BELGIQUE
LA
1830 - LES FONDATEURS
Conférence à VUniversité des A n ­
nales, à Bruxelles, le 27 mars 1914.
1830, quelques aspects de l’époque, un profil en raccour­
ci des événements, quelques figures qui y furent mêlées, en
somme un peu d’histoire avec des illustrations verbales, telle
sera la substance de cette causerie que je voudrais familière,
sans apprêts d’éloquence, et je l’espère sans pédantisme.
1830, combien c’est à la fois près et loin de nous.
Très près chronologiquement.
Il n’y a pas un siècle écoulé depuis. Nos grands-pères étaient
de ce temps là. E t beaucoup ici — et j ’en suis — se souvien­
nent d’avoir dans leur jeunesse rencontré dans nos rues quelquesuns des grands acteurs de cet âge héroïque.
Je me rappelle, adolescent, en 1880, lors de la célébration
de l’anniversaire de l’indépendance nationale, avoir vu arriver
à la grande fête patriotique, sur la plaine du Cinquantenaire
— il n’y avait point de parc encore — Charles Rogier et le
chanoine de Haerne, devant qui toutes les têtes se découvraient
et tous les bras se levaient, dans un geste de fébrile émotion.
Ce fut l’apothéose. Puis vint l’indifférence. Les derniers
survivants de la grande époque disparurent. On se détourna
de leur mémoire. Une lassitude se fit autour de leur gloire.
On avait trop parlé d’eux. Une Belgique nouvelle s’élaborait,
évoluait, se cherchait, s’orientait vers des destinées élargies
et modernisées ; il semblait qu’elle se sentît gênée et comme
à l’étroit dans la défroque de 1830. Elle dédaignait, raillait
la Belgique ancienne, la Belgique des commencements ; elle la
repoussait avec une sorte d’agacement, comme on repousse
une tradition bourgeoise usée et défraichie, un genre poncif,
et qu’avaient en effet banalisé l’emphase des cantates et l’abus
des hommages officiels.
23
Maintenant trente ans de plus ont fui. E t la période dan­
gereuse, la période du « démodage », comme disait ingénieuse­
ment l’autre jour Maurice Donnay, à propos d’un grand poète
qui fut un peu délaissé et auquel on revient, cette période
critique est écoulée.
1830, c’est désormais et vraiment de l’Histoire, du passé
classé et classique. On n’a plus peur en s’en rapprochant de p a­
raître soi-même d’un autre âge. On se retourne pour y regarder,
pour y rechercher ses origines. On se reprend de curiosité pour
cette brève époque, fiévreuse et tourmentée ; on puise à la sour­
ce d’où sont sorties nos institutions, nos richesses, notre per­
sonnalité morale et politique. On y va chercher des leçons, et l’on
y découvre tant de contrastes avec aujourd’hui et de si frappants
que de cette époque, encore voisine après tout, on se sent toutà-coup prodigieusement éloigné !
On parlait alors, on écrivait dans un autre style. On s’habil­
lait, on se coiffait autrement ; on vivait différemment, avec
modestie, avec simplicité et à meilleur marché ! Les journaux
étaient peu nombreux et ne comptaient pas beaucoup de lecteurs.
On ne connaissait ni reportage, ni réclame. Mais dans le petit
monde qui s’occupait de la chose publique, il y avait du zèle,
des convictions, de la passion réfléchie et résolue.
La Belgique souffrait. Elle avait été jointe à la Hollande en
1815 et sans qu’on l’eût consultée, à titre « d’accroissement de
territoire. » Et ce mot seul l’avait cruellement humiliée. Elle
avait vécu pendant quinze ans sous un régime qui la froissait
dans ses mœurs, son instinct de liberté, ses traditions religieu­
ses, sa langue, sa culture. Bruxelles était une petite cité de
province. Les pouvoirs publics siégeaient ailleurs. Sans fau­
bourgs, elle était enserrée dans la ceinture des boulevards,
au delà desquels s’ouvrait la campagne. Elle avait ses beautés :
au cœur de la vieille ville, les fiers édifices municipaux et la
massive collégiale, et, dans la ville haute, sur le plateau, le
quartier élégant et symétrique dessiné par Guimard, où se
dressaient les bâtiments officiels, les palais royaux, les hôtels
des nouveaux riches, et où le Parc m ettait la grâce de ses feuil­
lages.
On y menait une existence aisée et paisible, malgré tant
d’orages traversés, la Révolution Brabançonne, et l’invasion
24
française et le retour des Autrichiens, l’annexion à l’Empire,
enfin Waterloo ! Il n’y avait ni luxe, ni apparat, mais une
certaine élégance tout de même, et le lustre que donnaient
une antique noblesse et une bourgeoisie patricienne vieillie
dans les offices publics.
Et voici qu’une tempête militaire et politique, une petite
guerre de rues suivie d’une campagne courte et meurtrière
entreprise sans préparation, presque sans armée, bouleverse
cette atmosphère quiète, et va transformer ce petit chef-lieu
de province en capitale, et ce petit peuple qui ne s’est jamais
complètement appartenu en nation, et va faire surgir en Europe
une question belge, d’où sortira peut-être une guerre générale.
E t voici que finalement, au bout d’un an de négociations et
de labeurs, soutenus avec une admirable fermeté et continuité
de propos, cette question belge, débattue à Londres par les
représentants des puissances, réunis en Conférence, se résout
par l’admission dans la société politique continentale d’un
E tat indépendant et neutre, qui vivra et se développera,
et qui, après trois quarts de siècle, sera devenu l’un des organes,
l’un des facteurs de l’économie et de la culture européennes.
Voyons comment les événements s’enchaînent. C’est un
tableau chronologique que je vais mettre sous vos yeux, et
qui, par la succession et la rapidité des faits, résume avec une
sobre éloquence l’œuvre accomplie.
Le 24 septembre 1830 un petit groupe d’hommes jeunes
et entreprenants imagine de discipliner, d’organiser la Révo­
lution, et crée à l’Hôtel de Ville une commission administrative.
Ils n’ont qu’une installation de fortune : une table de bois
blanc empruntée au corps de garde, deux bouteilles où sont
plantées des chandelles, et un capital de dix florins 35 cents
trouvés dans la caisse municipale. Le 28 septembre la com­
mission administrative se transforme en gouvernement provi­
soire. E t celui-ci exerce le pouvoir jusqu’au 24 février 1831,
jusqu’à ce que la Belgique, à la recherche d’un Roi, se donne
un régent. Le Gouvernement provisoire aussitôt institue des
comités, des collèges ministériels, entre lesquels il répartit les
affaires. Il arrête que les provinces belges constitueront un
E tat indépendant. Il convoque une assemblée qui représentera
leurs intérêts. Il charge une commission de préparer un projet
25
de constitution qu’examinera cette assemblée. Il donne aux
Belges, par décrets, les droits essentiels qu’ils réclament. Tout
cela se fait en moins d’un mois.
L’ordre règne et c’est dans le calme que se déroule la
campagne électorale.
Le 3 novembre, une poignée de citoyens, 30.000 belges,
élisent, au nom d’une nation de 4 millions d’âmes, 200 députés,
et le 10 novembre, tandis que sonnent toutes les cloches des
églises et que des salves d’artillerie retentissent, le Congrès
National se réunit dans le grand hémicycle du Palais où siègent
encore nos Chambres législatives.
C’est l’assemblée des Fondateurs. C’est notre premier,
notre plus grand Parlement. Il fera la Belgique, obtiendra pour
elle droit de cité en Europe, organisera la vie intérieure, et
scellera dans le sol des institutions qui n’ont ni bougé, ni fléchi,
si solides qu’elles suffisent encore aujourd’hui à porter le
poids d’une société où tout a changé, à l’exception des principes,
des idées essentielles qu’il a dès sa naissance injectés dans ses
veines et incorporés à sa substance.
De quels éléments cette assemblée se compose-t-elle ?
Plusieurs générations s’y rencontrent. Des anciens, des vieil­
lards, des hommes du X V IIIe siècle. E t d’abord le doyen
du Congrès, le vieux Gendebien, père d’Alexandre dont la mé­
diocre statue se dresse sur la Place du Palais de Justice.
Cet ancêtre avait été mêlé en 1790 à la Révolution Brabançonne,
première tentative avortée d’émancipation nationale.
A côté de lui, le Baron Beyts qui avait servi le Consulat
et l’Empire, qui avait siégé à Paris au Conseil des Cinq-Cents
et avait été préfet de Napoléon dans le département de Loiret-Cher.
Puis la génération moyenne des hommes mûrs déjà, et
dont plusieurs ont fait leur apprentissage sous le régime hollan­
dais. Au premier rang de Gerlache qui avait représenté aux
Etats généraux de La Haye l’opinion catholique et y avait
réclamé avec force et éloquence la liberté d’enseignement, de
Gerlache qui fut le deuxième président du Congrès, et plus tard
premier président de la Cour de Cassation ; le baron de Stassart,
homme politique et homme de lettres, fabuliste non dépourvu
26
de grâce et d’esprit, et qui avait été lui aussi préfet de l’Empire ;
et Surlet de Chokier, qui fut Régent de Belgique et dont je vous
reparlerai, et de Muelenaere, et Charles de Brouckère, le père
d’un Bruxellois que bien d’entre nous ont connu et aimé, le père
d’Alfred de Brouckère qui fut mon ami et dont je garde le souve­
nir fidèle et charmant. Cadet d’artillerie en 1815, Charles de
Brouckère devint successivement sous le nouveau régime ministre
des finances et ministre de la guerre ; il organisera nos premiers
budgets et notre première armée, avec d’étonnantes qualités
de chef et d’administrateur. Puis il se dégoûte de la politique,
il la quitte, entre dans l’industrie, dirige les usines de la Vieille
Montagne, enseigne à l’Université les mathématiques supérieures
et l’économie politique, enfin entre au Conseil Communal de
Bruxelles et ceint l’écharpe de bourgmestre.
Curieuse nature, d’une activité débordante et multiforme,
caractère brusque, ombrageux, difficile, cœur excellent d’ail­
leurs, et prompt aux mouvements généreux. En 1852 les proscrits
du second Empire qui vinrent chercher un refuge à Bruxelles
trouvèrent en lui un protecteur chevaleresque du droit d’asile.
C’est lui qui épargna à Victor Hugo un arrêté d’expulsion.
Léopold 1er qui avait éprouvé ses qualités et ses défauts l’a jugé
d’un mot spirituel : « C’est un homme avec lequel et sans lequel
il n’y a rien à faire. »
A ces deux générations se mêlent des hommes nouveaux
qui surgissent brusquement à l’appel des événements : Rogier,
van de Weyer, le comte Félix de Mérode, qui font partie du
gouvernement provisoire ; Lebeau et Paul Devaux — Nothomb
et Leclercq — Vilain X IIII et de Theux — Seron et de Robaulx,
combien d’autres encore. — Je ne cite que les plus fameux,
ceux dont on retrouvera les noms et les œuvres dans les grands
débats du Congrès, puis dans notre histoire parlementaire et
qui exercèrent sur notre vie politique une action sensible et
profonde.
Parmi eux beaucoup sont de vrais débutants et tout
jeunes. Rogier a trente ans — Van de Weyer qui ira à Londres
affronter Palmerston et Talleyrand n’a pas vingt huit ans —
Devaux qui fut l’un des conseillers écoutés de Léopold 1er
et dont les hautes inspirations se reflètent dans toute l’œuvre
constitutionnelle, a vingt neuf ans — Henri de Brouckère a
27
vingt huit ans — Nothomb enfin, le benjamin de la pleïade
n’a que vingt cinq ans. E t quelques mois suffisent pour le
consacrer orateur, écrivain, diplomate.
D’où viennent tous ces hommes nouveaux ? Quelles sont
leurs origines ?
Ce sont des jeunes gens de bourgeoisie cultivée, haute
ou moyenne, quelques uns de naissance noble ou patricienne.
Ils sont avocats, archivistes, bibliothécaires, journalistes, sou­
vent avocats et journalistes, éloignés de la vie officielle par
un régime qu’ils détestent et qui les redoute.
La Révolution les tire de l’obscurité et les appelle à l’action.
Sans la secousse des événements, peut-être leurs vertus, appli­
quées à des besognes ordinaires, seraient-elles restées ignorées
et s’ignorant elles-mêmes. Combien n’est-il pas dans le monde
de talents qui n’existent qu’en puissance et en virtualité, qui
sommeillent et n’éclatent qu’au choc des épreuves, des grandes
émotions qui mobilisent les volontés et font se révéler les âmes !
Le drame de 1830, l’angoisse du lendemain, l’attente,
l’espoir de grandes choses à accomplir retentissent comme une
sonnerie de bataille. Les énergies, les talents se dressent, s’offrent, se déploient. Et ces jeunes gens vont s’improviser hommes
d’E tat, constituants, légistes, diplomates, hommes d’adminis­
tration, de finance ou de guerre. E t ils vont travailler pour
l’histoire et faire de l’histoire — une histoire révolutionnaire,
mais que ne salira ni haine, ni anarchie, ni persécution, et
qui ne laissera ni honte ni remords, mais seulement de la vie,
de la vie libre, féconde, laborieuse, et par conséquent de la
gloire.
Voyons l’œuvre maintenant, et résumons-la en quelques
faits, marqués de dates.
Le 10 novembre 1830, le Congrès se réunit. Le 18, il pro­
clame l’indépendance du peuple Belge. Le 22, il arrête la forme
du gouvernement et se prononce pour la monarchie consti­
tutionnelle représentative. Le 24, il exclut de tout pouvoir
la Maison d’Orange-Nassau. Le 25, il examine en sections le
projet de constitution. Fin décembre, il en aborde la discus­
sion publique. Le 6 février 1831, il l’achève. En un jour, il
revise le style. Le 7, la Constitution est adoptée sans scrutin.
Le 11, elle est promulguée et rendue exécutoire.
28
En moins de deux mois tout est fini. Quelle leçon pour
les parlements modernes !
En deux mois on a, dans un magnifique esprit d’émulation
et de concorde, discuté, fixé, voté la plus grande, la plus durable
de nos lois, la loi capitale, celle qui domine toutes les autres,
et si parfaite qu’on a pu dire d’elle qu’elle est immuable comme
la vérité !
Mais il reste un blanc dans le texte. La Constitution dit
en son article 60 que les pouvoirs du Roi sont héréditaires
dans la descendance directe, naturelle et légitime de... Elle
s’arrête là !
Il faut remplir le blanc, y inscrire un nom. Lequel ? E t
voilà le Congrès en quête d’un Roi ! Sera-ce un indigène ou un
étranger ? E t si c’est un indigène, sera-ce un Mérode ou un
Ligne ?
Parmi les étrangers on hésite. On pense au Duc de Ne­
mours, fils de Louis Philippe, au Duc de Leuchtenberg, fils du
prince Eugène de Beauharnais. On nomme le Duc de Nemours.
Une députation se rend à Paris afin de notifier au Roi des
Français le choix du Congrès. Louis-Philippe la reçoit solen­
nellement et refuse, car l’Angleterre qu’inquiète la perspective
d’une annexion dissimulée, a interjeté son veto. E t alors, dans
l’incertitude et l’attente, on se contente d’un Roi provisoire,
on élit un Régent. E t ce sera le président du Congrès, le baron
Surlet de Chokier.
Mais on continue à chercher cependant et l’attention se
fixe enfin sur le Duc Léopold de Saxe-Cobourg, prince allemand,
veuf d’une princesse anglaise, destinée si elle avait vécu à
monter sur le trône de Grande-Bretagne, et qui vient lui-même
de refuser une couronne, la couronne de Grèce, de la nouvelle
Grèce, enfin délivrée du Turc et toute resplendissante du lustre
des Orientales.
Léopold hésite, veut le consentement de l’Europe et le
règlement, d’accord avec les puissances, de la position inter­
nationale du pays.
La Conférence de Londres déchire les traités de 1815 et
par le traité des X V III articles détermine les bases de la sépa­
ration de la Hollande et de la Belgique, et accorde à celle-ci,
29
avec l’indépendance, la garantie de la neutralité et de l’inté­
grité de son territoire.
Le Congrès élit Léopold Roi des Belges et ratifie les X V III
articles.
Le 21 juillet 1831, le nouveau Souverain entre à Bruxelles
et sous le péristyle de l’église St-Jacques, prête serment et
monte au trône.
La Belgique moderne est née, viable et saine. Elle a une
constitution, une dynastie. Elle est inscrite à l’état civil de
l’Europe. Le Congrès national a rempli sa tâche, il est dissous.
La période de fondation, la période héroïque est close.
La plupart des hommes de ce temps, et qui y ont joué un
rôle, ne faisaient que commencer une carrière qui s’est pour­
suivie plus tard dans nos Chambres, au gouvernement, dans
la diplomatie.
L’un d’eux appartient exclusivement à l’époque. Il rentre
dans l’ombre dès qu’elle est écoulée. C’est Surlet de Chokier,
Régent de Belgique.
Porté à la présidence du Congrès d’abord, puis au sommet
de l’E tat, il remplit sa tâche sans reproche. Il connut tous les
honneurs, et goûta, ou put goûter toutes les ivresses de la
popularité. E t cependant il est presque oublié. On ne le connait
plus guère que par un boulevard et une place publique : le
Boulevard du Régent — la Place Surlet de Chokier. C’est trop
peu pour faire vivre une mémoire.
Quel homme était-ce donc ? E t comment fut-il désigné
pour remplir une si grande mission ?
C’était un gentilhomme campagnard, de vieille souche.
Son père était originaire de Gingelom, en pays de Liège. Luimême affectionna toujours le village natal, il en fut maire sous
l’Empire et dans ses dernières années, bourgmestre. Il y faisait
de l’agriculture et de l’élevage. Il élevait des moutons mérinos
et vendait leur laine. C’était sa spécialité ; il en tirait une con­
fortable aisance.
En 1830, il avait soixante ans et tout un passé militaire et
politique. Il était sous-lieutenant au moment de la Révolution
brabançonne. Sous le Directoire il devient administrateur du
département de la Meuse et reçoit de superbes certificats de
30
civisme, attestant que le citoyen Surlet Chokier (la particule
a disparu) est « l’ennemi des tyrans et des injustes privilèges ».
Vers la fin de l’Empire il est élu membre du Corps législatif et
va, pour remplir son m andat, s’établir à Paris. Sous le régime
hollandais, il siège aux Etats généraux et reçoit du Roi Guillaume
le titre de baron. Il défend à La Haye les griefs des provinces
belges.
Dès les premières séances du Congrès, les regards se tour­
nent vers Surlet et quand le scrutin s’ouvre pour la désignation
du président, c’est sur lui, après ballottage qui le met en con­
cours avec de Gerlache ,et de Stassart, que se porte la majorité
des suffrages.
Pourquoi ? En raison sans doute de son âge et de son expé­
rience, et aussi parce qu’il représente ce qu’on appelle « l’unionisme » et qu’il est donc l’homme du juste milieu, et enfin parce
qu’il est tout de suite et naturellement sympathique.
Et ce qui le rend sympathique c’est qu’il ne porte ombrage
à personne, et qu’il ne se distingue point par des talents exces­
sifs, et qu’il est simple, familier, jovial, bonhomme, oserai-je
dire bon garçon, et que vous le savez, en Belgique, ces mérites,
aux yeux de beaucoup, dépassent tous les autres.
Physiquement, d’après un contemporain, il est de haute
stature et d’aspect vénérable, avec un nez en bec d’aigle, des
yeux gris pleins de feu, de longs cheveux flottant sur les épaules,
une tournure sans façon, un sourire railleur.
Oratoirement, il ne cherche pas l’éloquence. Ses discours,
aux Etats généraux de La Haye, étaient, paraît-il, plutôt des
causeries. Il n’est pas sans lettres ; il multiplie, suivant la mode
d’alors, les citations d’Horace et de Virgile ; il entremêle le tout
de mots flamands, qu’il prononce avec l’accent français, pour
faire rire. Au Congrès, du haut bureau présidentiel, il laisse
tomber des plaisanteries faciles qui dérident la docte assem­
blée.
Il vit le plus simplement du monde. Il habite un appar­
tement au deuxième étage d’une maison de la rue des Carrières
— c’est le nom que la municipalité française avait donné à la
Cantersteen. C’est là qu’il reçut en février 1831 la députation
chargée par le Congrès National de lui annoncer son avènement
à la Régence.
31
Il fallut bien alors qu’il sacrifiât à la dignité du rang.
On lui offrit un des palais nationaux ; il refusa et menaça,
si on le contraignait, de prendre incontinent la diligence de
St-Trond et de retourner à Gingelom. Il s’installa rue Latérale
— actuellement rue Lambermont — dans un hôtel qu’avait
habité un certain M. Repelaer, directeur de la Société Générale,
situé au coin de la rue Eucale et dont le jardin s’étendait
jusqu’au boulevard.
C’est le 25 février qu’il fut installé et prêta serment. Ce
jour là une grande foule se porta vers le Congrès.
Quand le Régent quitta l’assemblée et monta en voiture
— il avait loué un carrosse au mois — de jeunes patriotes
entreprirent de dételer les chevaux et de lui faire un cortège
triomphal. Il sauta aussitôt à terre et rentra précipitamment
chez lui par le Parc, suivi de la troupe des manifestants, au
nez desquels il ferma brusquement la porte de son hôtel. Le
soir la Grande Harmonie vint lui donner une sérénade.
A en croire un article de M. Alphonse Royer, que publia
en 1835 la Revue des Deux Mondes — peu bienveillant d’ailleurs
pour notre pays et ses hommes d’E tat — et qui fut réédité à
Bruxelles, sous forme de brochure, le Régent continua rue
Latérale sa vie bourgeoise, en compagnie de sa gouvernante,
Mlle Joséphine, qui, dans les réunions d’amis, ne se gênait
point pour dire son mot sur les affaires de l’E tat. Il recevait
tous les matins en robe de chambre les députations de la garde
civique et les solliciteurs recommandés, puis présidait le conseil
des ministres, signait les documents officiels et après dîner se
rendait souvent à Laeken dans une petite maison de campagne
qui avait appartenu au Roi Guillaume et où il respirait l’air
des champs.
Une fois par mois il y avait audience ouverte. E t il dis­
tribuait à tous les malheureux qui venaient implorer des secours
des pièces de cent sous empilées sur son bureau. Ces aumônes
patriotiques et quelques dîners officiels absorbaient sa liste
civile qui était de 10.000 florins par mois.
Ce souverain provisoire, vertueux et débonnaire, régna
cinq mois, forma deux ministères où il eut l’art d’appeler les
meilleurs, les plus éminents, et qu’il soutint avec tact et loyauté.
Il garda, par sa probité personnelle et politique l’estime du
32
pays et de l’étranger. C’est sous son consulat que la Belgique
acheva de s’organiser, de réaliser son indépendance, et la fit
reconnaître par l’Europe. E t, vous en conviendrez, tout cela
en somme n’est pas si ridicule.
Dès qu’il descendit du pouvoir qu’il n’avait pas sollicité,
il s’empressa de retourner à ses moutons mérinos. Il se réinstalla
à Gingelom et ayant été presque roi, il accepta de devenir
bourgmestre de son village. Peut-être que pour cet esprit
pratique et simpliste, il n’y avait après tout pas tant de dif­
férence entre ces deux magistratures.
Il ne survécut guère à ses grandeurs. Mais dans sa retraite,
on ne le dédaigna pas. Le Congrès, avant de se séparer, avait
décrété qu’il avait bien mérité de la patrie, et fait frapper une
médaille commémorative à son effigie. Le Roi Léopold lui
témoigna maintes fois sa sympathie. Le Roi Louis-Philippe et
la Reine Marie-Amélie, auprès de qui il avait conduit la dépu­
tation du Congrès après l’élection du Duc de Nemours au
trône de Belgique, avaient gardé de ce vieillard cordial et digne
un souvenir affectueux, et lui écrivaient en termes charmants.
Enfin ses paysans l’adoraient et avaient fait de lui l’ar­
bitre de leurs intérêts et de leurs querelles.
Il mourut en 1839, satisfait de la vie qui lui avait donné
beaucoup plus qu’il ne lui avait demandé, et qui ne lui avait
infligé, à titre de revanche, ni regrets ni souffrances d’aucune
sorte.
E t c’est dans l’ensemble une figure curieuse, originale,
non dépourvue d’une certaine grandeur civique et patriarcale,
très belge d’ailleurs, et qui mérite d’échapper à l’oubli.
Je ne puis songer dans cette brève causerie à faire défiler
devant vous toutes les célébrités du temps. E t d’autre part je
serais amené à les suivre à travers leur longue carrière jusqu’à
une époque si proche de la nôtre qu’elle se confond presque
avec elle.
Il est deux personnages cependant devant lesquels je
m ’arrête, parce qu’ils se distinguent des autres en ce qu’ils
ne sont pas seulement comme eux des hommes politiques,
et plus que des hommes politiques, des hommes d’E tat, mais
aussi et plus spécialement des diplomates et les plus grands
33
diplomates qu’ait produits la Belgique. Je veux parler de
Van de Weyer et de Nothomb.
Nothomb, avocat et rédacteur au Courrier des Pays-Bas,
où il collaborait avec Lebeau, Devaux et Rogier, était accouru
à Bruxelles dès les premiers événements, du fond du Luxem­
bourg dont il était originaire. C’était le cadet des hommes de
1830. Il devint membre du comité de Constitution, puis du
comité diplomatique. Lorsqu’après l’élection du Roi Léopold,
il fallut aller à Londres s’entendre avec lui et les puissances
sur les bases du traité qui fixerait la situation internationale
de la Belgique — et ce fut le traité des X V III articles, — on
désigna Nothomb pour cette mission, conjointement avec Paul
Devaux. Il fut question de leur adjoindre d’autres collègues.
Mais ceux-ci se dérobèrent. E t Surlet de Chokier s’étonna de
voir Nothomb, si jeune, accepter dans ces conditions une tâche
si redoutable.
—
« Je vous trouve bien présomptueux », lui dit Surlet,
et Nothomb de riposter : « Pourquoi donc ? On voit tant de
choses de nos jours. Vous, par exemple, Monsieur le Baron,
vous êtes Régent de Belgique ». Il avait vingt six ans. Il partit
et fit merveille. Il rentra à Bruxelles le traité en poche.
Quelques mois plus tard tout était à recommencer, dans
des circonstances beaucoup plus difficiles. Dans l’intervalle en
effet, la Hollande avait repris les hostilités et battu les troupes
belges à peine organisées. La Conférence de Londres remit son
ouvrage sur le métier et le traité des X V III articles devint
le traité des XXIV articles qui infligeait à la Belgique de dures
conditions et notamment la perte du Luxembourg et d’une
partie du Limbourg. Nothomb se multiplie pour épargner au
pays cette diminution qui l’atteint doublement lui-même, comme
Belge et comme Luxembourgeois ; mais bientôt convaincu
de la stérilité de la résistance, il s’emploie à faire accepter,
par la Chambre des Représentants — notre première Chambre
— les sacrifices indispensables. Il dépense dans le débat autant
de courage que de talent.
Après son discours, un de ses collègues M. de Muelenaere,
encore sous l’impression de son langage, lui dit ce mot saisissant :
« Vous grandissiez en parlant à tel point qu’il n’y avait plus
que vous dans la salle ».
34
Nothomb et Lebeau furent les deux premiers orateurs du
Congrès, et dans les discussions fréquentes et orageuses que
souleva la question extérieure, ils rivalisèrent d’éloquence.
C’est Lebeau qui, ministre des affaires étrangères, avait
eu la charge de défendre le premier traité, au milieu d’un
ouragan d’impopularité.
On l’accusait d’avoir trahi la Belgique. On criait : Lebeau
à la lanterne !
Quand il prit la parole au Congrès, il eut peine à do­
miner les clameurs des tribunes.
Mais dès les premiers mots sa mâle énergie eut raison de
la foule exaspérée.
« L’homme, s’écria-t-il, qui n’a tremblé ni devant les
menaces de pillage, ni devant les menaces anonymes, celui-là
n’est pas un lâche ».
E t ses accents eurent tant de puissance qu’ils boulever­
sèrent l’assemblée.
« Les tribunes, dit White, un des meilleurs historiens de
la Révolution, étaient comme fascinées ». La péroraison fut
saluée par d’extraordinaires effusions : « Les hommes pous­
saient des acclamations, les femmes agitaient leurs mouchoirs
et les députés, même les plus violents adversaires du ministre,
s’élançaient au pied de la tribune pour le féliciter. Plusieurs
versaient des larmes ».
La seconde phase de la vie de Nothomb s’écoula hors de
Belgique, mais à son service. Il représenta le pays auprès de
la Confédération Germanique, puis de la Prusse, puis de l’Em ­
pire. Il occupa à Berlin une position considérable, dûe à ses
mérites plus encore qu’à sa fonction ; il fut mêlé à toutes les
grandes affaires. On le recherchait, on le consultait. Il se lia
au début avec Metternich, qu’il concilia à la cause belge, et
devint plus tard l’ami de Bismarck. Il racontait avec fierté
qu’après la guerre de 1870 et le retour du chancelier à Berlin,
les deux premières visites de Bismarck avaient été pour lui
et pour Richard Wagner.
Ce que Nothomb fut pour nous en Allemagne, Van de
Weyer le fut à Londres.
Lui aussi, très jeune, s’affirma négociateur et parlemen­
taire. Ses débuts sont curieux. A vingt ans il est nommé biblio­
35
thécaire de la Ville et — rare phénomène — sait se faire aimer
de tous ceux qui fréquentent la bibliothèque. Un journal de
1825 disait que depuis sa nomination, tout avait changé dans
cet établissement : « l’ordre, les soins, les prévenances ont fait
disparaître les abus qui en éloignaient les amis des sciences et
des arts ». Ce bibliothécaire écrit et publie. On cite de lui un
petit traité de morale politique, dont le titre à lui seul formule
un conseil d’une sagesse bien précoce : Il faut savoir dire non.
Il se passionne, dès les premiers jours, pour la cause natio­
nale. Il est du gouvernement provisoire. Bientôt on le charge
d’aller à Londres faire comprendre au monde politique anglais
la véritable situation des affaires belges, qui y était ignorée ou
méconnue.
Avec une admirable souplesse il s’introduit partout, est
reçu et bien reçu par les hommes d’E tat, les savants, les poètes,
cause avec Palmerston, Tennyson, Hume, Bentham, et revient
au Congrès rendre compte de son voyage dans un discours qui
ravit l’assemblée.
« On ne saurait imaginer, écrit un auditeur, rien de plus
élégant, de plus exquis dans la forme, de plus émouvant dans
l’exposé. Pendant cette charmante causerie on aurait entendu
voler une mouche. J ’ai rarement été témoin d’un pareil succès ».
A l’étranger on applaudit comme à Bruxelles « ce jeune diplo­
mate, représentant d’une révolution, délégué par un gouver­
nement issu des barricades » et qui n’a pas craint de négocier
avec les représentants de la Sainte Alliance. « Ecoutez, dit un
journal français, le National, le langage plein de force et de
candeur de ce jeune Van de Weyer, diplomate achevé à vingt
huit ans, sans s’être jamais demandé ce que c’est que la diplo­
matie. Il est sincère, il est net et courageux ; il n’a rien dit
dans le cabinet de Wellington qu’il n’ait pu dire avec le monde
entier pour témoin ».
Van de Weyer, devenu plus tard notre ministre à Londres
et qui le demeura jusqu’en 1867, fut le constant et précieux
auxiliaire des intérêts belges dans ce grand centre politique,
où il fréquentait l’élite du Parlement, des lettres et du monde.
On l’y traitait presque comme un compatriote. Il épousa une
Anglaise et la Reine Victoria voulut être marraine de son
premier-né.
36
Il a été l’un des artisans de l’œuvre de l’affranchissement
de l’Escaut. E t dans toutes les crises européennes, dans les
péripéties de la question d’Orient en 1840, en 1856, enfin dans
la question du Luxembourg, il eut l’art de tout savoir, de ren­
seigner sur tout, et aida à conserver à la Belgique l’amitié
fidèle, attentive et protectrice de l’Angleterre.
Enfin il est une figure expressive et pittoresque que je
dois croquer au passage, celle du comte Félix de Mérode, frère
du comte Frédéric qui fut mortellement blessé dans le combat
de Berchem.
Ce grand seigneur était peuple par certains aspects —
de tempérament spontané et brusque, plein de sève, abon­
dant en saillies, franc jusqu’à la rudesse. C’était un homme
d’action, brave, généreux, emporté, à qui son nom, son patrio­
tisme, la simplicité de ses mœurs valurent une extraordinaire
popularité. Membre du gouvernement provisoire, H u t élu
au Congrès par trois arrondissements. Il aurait été régent
s’il l’avait voulu, et quand il fut question de l’élection à la
régence, Surlet de Chokier et lui déployèrent une rare émula­
tion de courtoisie et d’abnégation.
Ils signèrent et remirent à Van de Weyer le billet suivant :
« Faites ce que vous trouvez bon — nous sommes d’accord ».
Puis Félix de Mérode se désintéressa de l’affaire et Surlet fut élu.
Bien qu’il ne prît point fréquemment la parole au Congrès,
son influence et son prestige y étaient grands. Il remplaça
Charles de Brouckère au département de la guerre et continua
son œuvre de réorganisation militaire.
Il siégea longtemps à la Chambre sans que jamais ses
boutades ou ses accès d’humeur lui fissent un ennemi. Quand
il se mêlait à de grands débats politiques ou religieux, il écrivait
ses discours. Mais sa vraie nature éclatait dans de rapides et
fougueuses improvisations, de forme négligée, mais reluisantes
de bon sens et d’esprit. Il parlait alors sous la pression de
l’idée, qui jaillissait originale et vive, sans préoccupation d élo­
quence.
Je veux citer de lui deux traits qui le caractérisent.
Un jour la questure de la Chambre eut l’idée de doter
les représentants d’un insigne — dont on garde encore un
exemplaire sous verre au Palais de la Nation. C’était une plaque
37
faite pour être fixée sur l’habit et qui ressemblait à une déco­
ration. Félix de Mérode, furieux, saisit l’insigne, le jeta à terre
et le piétina devant toute la Chambre.
Un autre jour, en 1835, le président lui donnant la parole,
le désigna par son titre. — Il protesta. — « On me donne sans
cesse, dit-il, le titre de comte. Je ne repousse pas ce titre en
dehors de cette Chambre, sans lui donner aucune valeur. Mais
il me semble que dans la Chambre on ne doit pas donner de
titres. Dans la Chambre des députés de France, on ne donne
jamais de titres. Je crois que cet usage doit être suivi ici ».
E t cette motion du comte Félix de Mérode créa l’usage
en Belgique. On ne donne jamais de titres à la Chambre. On
laisse ce lustre au Sénat. Il est assez curieux tout de même de
noter que l’initiative vint d’un comte de Mérode qui n’avait
pas besoin d’afficher son titre pour faire connaître sa noblesse.
Après un salut à ce galant homme qui servit son pays
avec éclat, j ’arrête notre promenade dans la galerie des ancêtres.
D’autant que je voudrais, avant de finir, fixer votre attention
sur l’un des débats les plus intéressants du Congrès National.
C’est la discussion qui, tout au commencement des travaux
du Congrès — et c’en fut vraiment la préface — s’engagea
sur la forme du gouvernement.
La Belgique serait-elle République ou Monarchie ? Pro­
blème capital.
Le débat dura trois séances. E t tout y a de la grandeur
— le sujet lui-même — la dignité du langage — le sens politique,
la vive pénétration de l’avenir dont témoignèrent les discours
essentiels, ceux qui dominèrent l’assemblée et déterminèrent
son vote.
Sans doute la majorité était monarchiste et avait été
élue comme telle. Mais la discussion donna à l’instinct dont
le Congrès était inspiré une expression réfléchie et raisonnée,
basée sur des considérations de science et de sagesse politique.
Tout d’abord on tenait que la forme républicaine inquié­
terait l’Europe et froisserait nos voisins. Nothomb disait :
« Monarchie, vous serez une puissance. République, vous serez
un épouvantail ».
Mais il restait des irréductibles : d’un côté, l’abbé de
38
Haerne, qui redoutait qu’à l’imitation du Roi Guillaume, un
nouveau gouvernement monarchique ne tentât de régenter
l’Eglise, et, de l’autre, des radicaux, notamment Seron et de
Robaulx, qui soutinrent la théorie républicaine avec une
emphase rappelant la phraséologie de la Convention et avec
cette obstination sereine et bornée que donne la pratique de
la pure idéologie.
Il y a de nos jours un certain plaisir intellectuel à relire
leurs formules philosophiques et leurs maximes solennelles,
où éclatait une si majestueuse puissance d’illusion. Notez
d’ailleurs que c’était de très braves gens — tout bourrés de
mots et de principes, et d’une merveilleuse sincérité.
Seron tient la république pour la meilleure réalisation
d’une société parfaite. Il rêve un état de choses où « la liberté
ne soit confiée qu’à des mains pures, à des hommes probes
et vertueux ». un gouvernement « qui tende au bonheur des
hommes, qui protège les bons contre les méchants ».
Et
ce serait la république.
De Robaulx ne veut pas de la monarchie, parce qu’il
redoute que les représentants du peuple viennent « respirer
l’air contagieux des antichambres et de la cour », parce que
sous la monarchie « la justice n’est souvent qu’un mensonge ».
La république, ce serait « le triomphe des capacités et de la
vertu».
Le Congrès ne se laissa pas convertir à cette singulière
superstition. E t Devaux, Lebeau, Nothomb, Leclercq oppo­
sèrent à ce déploiement de rhétorique une justification solide
et positive, historique et politique de la monarchie constitu­
tionnelle représentative, de la royauté moderne, tempérée par
les institutions parlementaires, par la responsabilité minis­
térielle, par la séparation des pouvoirs, par les plus larges
libertés privées et publiques, de la monarchie que Nothomb et
et Vilain X IIII se complaisent à appeler une « monarchie
républicaine ».
Nothomb y voyait une garantie d’équilibre, par la jux­
taposition d’un principe de durée : l’hérédité, et d’un principe
de mobilité : la souveraineté populaire. Devaux y trouvait la
liberté de la république avec un peu d’égalité en moins dans
les formes, mais avec une immense garantie d’ordre et de
39
stabilité, et plus de liberté par conséquent dans les résultats.
E t enfin Leclercq, dans un discours de jurisconsulte et
d’homme d’E tat, d’une classique ordonnance et où perçait un
sens aigu de la psychologie politique, décrivait le péril des
élections périodiques du chef de l’E tat.
« Prenez garde, disait-il, à l’ambition qui agite le cœur
de l’homme et qui ne connaît pas de bornes dès qu’elle convoite
le rang suprême. Le moyen sera l’intrigue ; le résultat sera le
déchaînement des passions. Le chef élu cherche ensuite à
assurer sa réélection. Il s’entoure de ses partisans ; il distribue
des places à sa clientèle. E t devant lui se dressent tous ceux
qui aspirent à le renverser. »
Ce qui donnait à l’argumentation monarchiste une au­
torité particulière, c’est d’abord qu’elle n’était pas dynastique.
Il n’y avait ni roi, ni dynastie, ni cour. Nul ne cherchait à
plaire. Nul n’était suspect de courtisanerie ou de servilité.
Puis, elle est vierge de préjugé sentimental. Les hommes du
Congrès sont monarchistes par raison politique et par raison
de patriotisme. Tous veulent la liberté. Tous cherchent la
meilleure organisation possible de la liberté, celle qui, avec la
liberté, assurera l’ordre et le durée.
Au vote la monarchie a 174 voix, la république en a 13.
Dans cette question comme en beaucoup d’autres, le
Congrès fit sagement les choses.
E t nous n’avons vraiment rien à regretter.
Me voici au bout de ma tâche. J ’ai voulu vous donner
l’impression que nous avons d’illustres origines ; jai voulu
vous montrer que l’époque dont nous venons est une grande
époque, grande par les événements et les problèmes, grande
par les hommes qui affrontèrent les uns et surent résoudre les
autres.
Rien n’incite plus à vivre et à bien vivre que la contem­
plation d’un noble passé.
40
QUELQUES LEÇONS DE L’HISTOIRE
Discours prononcé le 5 mai 1937
à VAcadémie Royale de Belgique.
Il y aura tantôt sept ans, en l’an 1930, l’Académie me
confia la tâche de résumer dans une assemblée solennelle,
devant le Roi et la Reine, l’histoire du mouvement intellectuel
pendant le siècle écoulé 1).
Je n’oserais songer aujourd’hui, profitant de l’honneur et
du privilège de la présidence, à compléter le tableau en l’aug­
m entant d’un volet consacré au mouvement politique.
Mais les soucis de l’époque et du lendemain, le trouble
qui énerve beaucoup d’esprits, les incertitudes et les impa­
tiences de la jeunesse, les inquiétudes qu’inspirent les perspec­
tives de l’avenir aux survivants des générations anciennes,
m ’ont incité à me retourner vers le passé si proche encore
auquel se rattache directement le présent, d’où les hommes
d’aujourd’hui sont immédiatement issus, auquel même certains
appartiennent presque par les souvenirs et l’empreinte reçue.
J ’y fus conduit par le désir d’y chercher des leçons, d’y
découvrir des secrets de l’hérédité, d’y trouver peut-être des
raisons d’espérance.
E t je fus aidé par la lecture renouvelée d’un beau livre
de notre illustre et regretté confrère Henri Pirenne, le septième
et dernier volume de sa monumentale Histoire de Belgique.
Le grand historien s’est arrêté devant le fossé profond
que la guerre de 1914 a creusé dans la route où marchait le
peuple belge, riche, satisfait et insouciant. Au delà, il a vu
se dessiner un tournant brusque, un nouveau point de départ
vers des horizons indistincts. Il a cru devoir à cette limite ter­
miner son ouvrage.
E t il est certain qu’une Belgique différente est sortie de
1) Voir p. 58 et suiv. de ce volume.
41
la longue et formidable tourmente qui épuisa le sang et l’or,
menaça la nationalité et infligea à tout l’organisme physique
et moral de si terribles secousses.
Dans la jeunesse qu’elle a produite, qui monte et où bril­
lent tan t de promesses, on aperçoit souvent des réactions
instinctives contre le passé, l’envie de s’en dégager, le mépris
d’une société qui n’a pu préserver l’Europe d’un boulever­
sement monstrueux et qui, peut-être, par aveuglement, égoïsme
ou faiblesse, l’aurait préparée et rendue inévitable.
D’audacieux réformateurs croient vivre dans un monde
nouveau, qui serait né avec eux et qu’ils s’imaginent pouvoir
façonner à leur gré. Parmi les anciens, on rencontre des pessi­
mistes, dont on retrouve des exemples en tous les temps, après
les grandes crises, et surtout au début du X IX e siècle, et pour
qui le mouvement des idées, les modifications des conditions
sociales, toute l’évolution de la vie semblent annoncer des
catastrophes. Le monde change. Tout est donc perdu ! Où
nous conduit-on ?
L’histoire qui montre comment le passé s’unit au présent
permet de raccorder le présent au futur.
E t l’on ne saurait augurer les destinées d’un peuple sans
déterminer, par l’étude de ses mœurs et de ses œuvres, les
facultés qui lui sont propres et que les accidents peuvent af­
faiblir, mais qui demeurent comme les traits permanents de la
physionomie nationale.
On a dit qu’un homme qui n’a pas de souvenirs s’ignore.
Il en est des peuples comme des individus.
Sans doute ce n’est pas vers le passé que pousse le mou­
vement naturel de l’âme, mais vers l’avenir. La technique de
l’existence se complique et se perfectionne. Des besoins s’éveil­
lent. Des chemins s’ouvrent à la pensée. Si le fond de l’homme
varie peu, les manières changent, le ton et le comportement,
la structure des formes sociales et politiques, les relations entre
individus et des individus avec l’É tat, et il est normal de se
demander où l’on va. Mais il est bon de savoir d où 1 on vient
et comment on est arrivé au point d’où l’on veut repartir.
La Belgique, après l’invasion et l’occupation étrangère,
après tous les labeurs, les angoisses, les déceptions, la fièvre
et les élans de la résurrection, aura-t-elle les forces qu’exigent
42
les expériences et les réformes futures, les ressources humaines
et matérielles nécessaires, assez de volonté et de persévérance,
une capacité suffisante d’adaptation et de rajeunissement ?
Comment répondre sans regarder derrière soi, sans évoquer
les ancêtres, sans interroger l’histoire, qu’on a appelée la con­
science de l’humanité ?
Ecoutons sa réponse :
Trois forces fondamentales ont, pendant un siècle, soutenu
l’édifice :
La Constitution, la Dynastie, le Parlement.
La Constitution établit les pouvoirs, fixe les droits de
l’individu et leurs garanties.
La Monarchie assure l’unité et la stabilité, impose la
modération, conseille, inspire, stimule et contient.
Le Parlement exprime la volonté du pays, reflète l’opinion,
fait les lois, vote les impôts, contrôle le pouvoir exécutif.
La formation de la Belgique indépendante, son prodigieux
développement en l’espace de cent ans sont dus à ses institutions
et aux hommes appelés à en manier les leviers.
La Belgique eut de grands Rois. E t ses Rois trouvèrent
pour les assiter des pléiades d’hommes d’E tat, de finance et
d’administration.
Pour tous la Constitution demeura la charte sacrée des
droits et des devoirs.
La liberté s’épanouit dans l’ordre et la paix. La paix, dit
Pirenne, au lieu d’engourdir le peuple exalta sa force de travail.
Il n’avait jamais joui d’une sécurité aussi longue. Jam ais non
plus il ne déploya une vitalité plus intense.
Cependant de redoutables épreuves, des périls mortels,
des commotions internes et les luttes des partis secouèrent la
jeune nation.
L’attachement à la Constitution, le prestige de la monar­
chie, la clairvoyance des hommes d’E tat, la souplesse du régime
parlementaire et les qualités qui caractérisent la mentalité belge
nous préservèrent des catastrophes. On côtoya des précipices. On
sortit des fossés. On gravit les pentes. La Belgique vécut, se
renouvela, grandit, devint l’une des fortes unités de l’Europe.
Le souvenir des dernières années d’avant la guerre efface
souvent celui des dangers et des crises d’autrefois.
43
On se représente la Belgique telle qu’elle était à la veille
du désastre, s’avançant vers le Destin, dans l’aisance et dans
l’orgueil de la fortune et la sécurité.
Mais qu’on regarde plus loin : la période de la fondation,
depuis le tumulte révolutionnaire de 1830 jusqu’au traité de
1839, et après, la crise de 1848, où la misère semblait appeler
la révolution ; les menaces et les ambitions du Second Empire ;
l’agitation de 1886 qui annonça l’éveil de la conscience ouvrière ;
l’ascension de la démocratie qui imposa la réforme du régime
électoral et fit passer au peuple le pouvoir que la bourgeoisie
avait jusque-là gardé pour elle.
Que d’ébranlements, d’émotions ! Que de responsabilités
en haut ! Que d’agitation en bas !
Cependant, le cours de la vie ne fut pas interrompu. Aux
heures les plus confuses, les plus sombres, la mesure dans
l’action sinon dans les paroles, une sorte d’optimisme réaliste
jusque dans l’infortune, la volonté de l’union jusqu’au milieu
des discordes, la confiance en soi, l’attachem ent aux institutions
qui s’adaptent étroitement aux mœurs et au tempérament
sauvèrent le pays, qui chaque fois se releva avec des forces
fraîches.
La proclamation de l’indépendance fut en 1830 un défi
à l’Europe. On brisait les traités de 1815. E t les Puissances
alarmées ne recoururent à la diplomatie pour régler l’affaire
belge que par crainte d’une guerre générale. La Conférence de
Londres fut le résultat d’une politique de non-intervention.
En moins d’un an, la Belgique indépendante se donna,
par l’organe d’une assemblée qu’élirent 30,000 citoyens, une
Constitution et un Roi.
La Constitution est demeurée intacte. Car l’article 47,
qui fut deux fois révisé, n’avait point la vertu d’un principe.
E t tous les principes ont conservé leur substance et leur vigueur.
Elle a été citée partout comme un modèle. Elle reste la
suprême garantie contre le désordre, l’anarchie ou la dictature.
Le Roi, choisi dans l’Internationale princière de l’ancien
régime, se méfia sans doute à l’origine d’une constitution qui
ne donnait à la monarchie qu’une action publique limitée et
conditionnée. Mais il en comprit l’esprit. Il avait vu de près
fonctionner le parlementarisme anglais et en avait subi l’in­
44
fluence. Il joignait à l’énergie la loyauté. Il prisait et pratiquait
le tact et la modération. « Tout humble qu’elle est, écrivit-il
un jour à sa nièce, la Reine Victoria, elle a souvent valu des
succès là où le talent et le génie ont échoué. Le tact dans les
grandes affaires de ce monde fait merveille. La sécurité en
dépend fréquemment ». On l’avait appelé en Angleterre le
Marquis Peu-à-Peu et M. Tout-Doucement (1).
Il plut par la noblesse du visage et de l’allure. Il sut manier
les hommes. Il tint compte de l’opinion. Il agit par l’exemple,
le conseil, la conversation, par l’influence morale que donne,
unie au pouvoir, une conscience droite et éclairée. Il avait le
sens et l’amour de la politique et fut un lien vivant de la Belgique
avec l’Europe. Il correspondait avec la Reine Victoria et le
Roi Louis-Philippe, avec Thiers et Metternich. Il réalisa la plus
parfaite incarnation de la monarchie constitutionnelle.
Pendant ces années fébriles de 1830 à 1839, qu’ensanglanta
une guerre malheureuse, une cohorte magnifique de jeunes
hommes, orateurs, juristes, diplomates, administrateurs, dirigea
les affaires : Lebeau et Rogier, Devaux et de Theux, de Gerlache et de Brouckère, Nothomb et van de Weyer. Ils négocient
avec l’Europe et conduisent les Chambres, qui posent les bases
de notre organisation communale et provinciale.
Avec le Roi, qu’entourent quelques conseillers intimes,
parmi lesquels Jules Van Praet, fidèle, habile et perspicace,
ils créent la Belgique moderne.
Il est difficile d’imaginer en un temps plus court une œuvre
plus durable et plus solide, accomplie avec autant de courage
et de sagesse, dans une atmosphère plus ardente et plus troublée.
Franchissons maintenant un court espace. E t voici 1848.
On a fondé un E tat et une Dynastie. Tout à coup du dedans
et du dehors jaillissent d’épaisses fumées et des flammes, qui
semblent annoncer une éruption, où tout risque de s’effondrer.
Depuis 1840, l’industrie, qui s’était relevée, faiblit. Les salaires
baissent. Une enquête révèle dans les classes ouvrières une
profonde misère. L’enfance est asservie aux plus durs travaux.
La vieille industrie linière des Flandres succombe devant
l’invasion de la machine. La maladie des pommes de terre, la
1) Louis d e L ic h te r v e ld e , Léopold I er.
45
rouille du seigle font monter le prix du pain. Le typhus ajoute
ses ravages à ceux de la disette.
Dans les sphères intellectuelles, des rêves exaltent l’ima­
gination avide de justice et d’un renouveau. Les doctrines de
Saint-Simon entraînent des esprits ardents vers un idéal égalitaire. Saint-Simon est adoré comme un Messie. On écoute
les missionnaires de Fourier et l’on aspire aux joies du pha­
lanstère. Une mystique sociale envahit les cervaux.
Tout à coup, en France, la vague populaire déferle et
emporte le trône. La République s’installe, proclame le suffrage
universel, ouvre les ateliers nationaux, et dans les rues l’émeute
se déchaîne. Le raz de marée atteint Berlin et Vienne.
La Belgique, au milieu de ce déluge, demeure debout,
intacte, comme un îlot de liberté.
Dans de petits cercles politiques on voit poindre une
agitation républicaine. Il y a à Bruxelles un milieu d’exilés
politiques. C’est ici que Marx prépare son manifeste commu­
niste.
Mais le peuple belge garde son sang-froid, massé étroite­
ment autour du Roi et de la Constitution. L’amour de la liberté,
l’union nationale sauvent le pays. E t au milieu de la tempête
qui secoue l’Europe, le Gouvernement et le Parlement entre­
prennent la réforme de l’Etat.
On élargit le corps électoral. On exclut les fonctionnaires
des Chambres. On lève deux emprunts forcés. On crée la Ban­
que Nationale. L’œuvre constructive se poursuit après la
crise. On abolit les octrois, on institue la Caisse d’Epargne.
On accuedle l’idée du libre-échange venue d’Angleterre ; on
négocie des traités qui ouvrent à nos exportations de larges
débouchés ; on rachète les péages de l’Escaut et l’on affranchit
la voie qui nous conduit à la mer. On fonde la fortune de la
Belgique.
Il n’y a pas dans l’histoire de notre X IX e siècle de page
plus émouvante et plus noble.
1848, dit Pirenne, est une date essentielle.
La Belgique s’impose tout ensemble à l’admiration des
souverains aux abois et des peuples en révolte. Sa Constitution
paraît un miracle de sagesse.
Le Tsar, qui, jusque-là, boudait la monarchie de 1830,
46
accrédite auprès d’elle un représentant diplomatique. Metternich, l’âme du régime de 1815, écrit à Léopold 1er qu’il vient
chercher un refuge en Belgique, « le pays le plus tranquille
du monde ».
A l’extérieur d’autres périls vont surgir. En France le
désordre et l’incertitude conduisent à l’Empire, la peur de
l’anarchie à l’absolutisme.
La restauration napoléonienne n’aura-t-elle point des
visées de guerre et de conquête ? Comment le régime bonapar­
tiste tolérera-t-il le langage de la presse libre du petit pays
voisin, qui devient l’asile des proscrits du Deux-Décembre,
écrivains, orateurs, conférenciers ?
L’exil leur donne une puissance d’attraction et de réso­
nance qui retentit au delà des frontières. A la Conférence de
1856 à Paris, Walewski met en accusation le régime belge ;
notre Parlement lui répond par une fière affirmation de la
volonté unanime de maintenir la Constitution.
Il faut en même temps pourvoir à la sécurité. On construit
la place fortifiée d’Anvers. E t la diplomatie est en éveil. Après
la guerre de 1866 et Sadowa, le Second Empire recourt à l’occulte
politique des compensations : en 1869 une tentative d’acca­
parement d’une partie de notre réseau de chemins de fer par
une compagnie française provoque une énergique réaction du
Gouvernement belge.
Toute cette période est imprégnée du patriotisme le plus
vigilant et le plus éclairé. La Dynastie, les ministres, les Cham­
bres, la Constitution forment tous ensemble le rem part que
rien n’entame. La Belgique demeure unie et forte, laborieuse
et libre.
De 1870 jusqu’aux premières années du X X e siècle, la
paix règne en Europe et la vie intérieure fructifie à l’abri de
toute contrainte.
Deux péripéties, comme des arêtes saillantes, marquent
l’époque.
Le mouvement démocratique brise les barrières de la
doctrine individualiste. La classe ouvrière prend conscience
de sa dignité et de ses intérêts. La législation sociale s’élève par
degrés, offrant au monde du travail une protection et une
assistance qui lui assurent plus de droits et plus d’aisance.
47
L’axe du pouvoir politique se déplace. Au régime censitaire
succède le suffrage populaire.
E t pendant que sous l’impulsion de Léopold II, la Belgique
atteint les plateaux supérieurs de la productivité et de l’ex­
pansion commerciale, le génie investigateur du Souverain
découvre au cœur de l’Afrique d’immenses territoires, où il
bâtit une colonie belge, qu’il donne à son pays.
C’est en 1886 qu’un accès de colère précipita la classe
ouvrière dans une grève qui prit l’allure d’une révolte et qui
alluma des incendies et fit couler le sang.
L’ordre fut rétabli par l’armée et la garde civique. Mais
le Gouvernement et les Chambres comprirent leur devoir.
On nomma une Commission d’enquête. E t les premières lois
sociales furent votées. L’ère s’ouvre de l’intervention légale
dans l’organisation du travail.
L’évolution démocratique se manifeste à la fois dans les
couches éclairées du monde ouvrier et dans une région de la
bourgeoisie.
Le peuple ignorant jusque-là était resté inerte. Mais peu
à peu l’influence de l’école, la liberté de la propagande par la
presse, la parole et les assemblées, l’instruction et l’épargne
suscitent des initiatives et font naître l’esprit de classe. Un
parti se forme qui en sera l’expression et l’instrument. En 1880
on fonde le Vooruit à Gand, la Maison du Peuple à Jolimont.
En même temps les jeunes radicaux de la bourgeoisie
dénoncent le privilège du vote censitaire et réclament l’accès
du peuple aux urnes électorales.
L’opinion modérée, qu’effraie une revision de la Consti­
tution, résiste. Le conflit s’aggrave. Mais l’élan de la jeunesse,
l’appétit de la réforme qui ferait circuler un sang plus vif,
l’idéal de l’égalité politique finissent par triompher. Après
de longues péripéties parlementaires et des troubles de la rue,
les Chambres, en 1893, adoptent le suffrage universel tempéré
par la pluralité du vote.
Le corps électoral est décuplé. La masse ouvrière, qui
s’organise sur la base de groupements professionnels et écono­
miques, est désormais directement représentée au Parlement
et y fait entendre ses revendications par la voix de députés qui,
élus au début dans un esprit de guerre, s’adaptent progressi­
48
vement au régime jusqu’au point de collaborer un jour à sa
direction.
Parallèlement la compréhension grandit, dans la bour­
geoisie, des besoins et des devoirs de la solidarité.
Cette bourgeoisie qui jusque-là avait régné sans partage
était profondément imbue de l’idée individualiste. Elle ajoutait
au culte de la liberté politique celui de la liberté économique.
Liberté de pensée, liberté des échanges, liberté du travail,
tout ne formait qu’un bloc. Du libre développement de l’indi­
vidu, par l’instruction et l’épargne, du jeu naturel des forces
concurrentes, on attendait l’épanouissement du bien-être et de
la civilisation. La règlementation du travail apparaissait comme
une atteinte au droit de disposer de soi-même, au droit de
l’homme. Ce serait, dit un jour un grand orateur, « une forme
de la servitude ».
Un souffle nouveau, venu des profondeurs, élargit les
conceptions, pousse aux réformes qui garantiront la santé de
l’ouvrier, le protégeront contre l’abus de sa faiblesse et de
son isolement et l’aideront à hausser le niveau de sa vie morale
et matérielle.
La Belgique devient une démocratie. Sa physionomie se
transforme. C’est une évolution, non une révolution. Elle se
continue jusqu’à la guerre ; interrompue par l’énorme tension
d’énergie qu’impose la défense contre l’invasion, elle reprendra
son cours au delà sans qu’à aucun moment les principes du
régime constitutionnel, monarchique et parlementaire cèdent
ou s’affaiblissent. Les vagues passent, élargissent le lit du
fleuve, mais les rochers du fond demeurent enfoncés dans le
sol.
La bourgeoisie belge a admirablement rempli sa tâche.
Sortie du peuple ou de la petite classe moyenne, elle avait
de puissantes facultés d’initiative, qu’elle déploya dans l’équi­
pement des grandes affaires, la formation des capitaux, la
multiplication des machines et des usines.
Dès 1834, quatre ans après sa fondation, la Belgique avait
créé le premier chemin de fer du continent, instrument de
sa renaissance économique. A la fin du siècle, elle s’élève
aux premiers rangs des nations productrices et commerçantes
de l’Europe.
49
Cette bourgeoisie fut aussi une grande bourgeoisie poli­
tique, dominée par le respect du Roi et de la Constitution,
douée du sens du devoir civique et de l’intérêt national. Le
Parlement, où elle envoya des élites d’hommes d’E tat et
d’orateurs, fut un organe à la fois souple et vigoureux d’action
et de résistance. Il reflétait l’opinion et tout à la fois la subis­
sait et la dirigeait.
La fin du X IX e siècle et les débuts du X X e furent remplis
par une géniale initiative qui modifia la position de la Belgique
dans le monde et par le problème de la sécurité, que rendit
plus pressant et plus angoissant l’état général de l’Europe.
Jamais l’intervention de la Couronne ne fut plus directe
et plus efficiente. Elle rencontra de l’indifférence, des résis­
tances, parfois de l’hostilité. Mais elle était dirigée par un
regard pénétrant fixé sur l’avenir, soutenue par une tenace
persévérance, par un souci constant des périls du dehors et
du développement des forces intérieures.
Léopold II, timide dans les débuts du règne, entreprend,
dès qu’il se sent mûr pour l’action, une immense opération de
conquête et de création. Il réalise le rêve de sa jeunesse. Il
veut pour son pays des débouchés, sa part de la mer, un do­
maine que jusqu’ici ni la civilisation ni la politique européenne
n’ont touché ; la Belgique y exercera les forces jeunes d’un
peuple stimulé par l’appétit de la gloire et de la fortune.
Il se fait proclamer et reconnaître Souverain de l’E tat
Indépendant du Congo. Il envoie là-bas des officiers qui, à la
tête de troupes indigènes, repoussent les Arabes esclavagistes ;
des hommes d’affaires, des ingénieurs qui creusent des ports,
ouvrent des mines, posent des chemins de fer, construisent des
villes.
L’opinion d’abord reste sceptique. E t des anciens, vieillis
dans l’expérience, s’effraient de l’aventure. Mais peu à peu
l’idée pénètre et entraîne. La jeunesse intellectuelle, et je m’en
souviens, s’échauffe à la vision d’un avenir neuf et grandiose.
Le Roi trouve les hommes qu’il lui faut dans la diplo­
matie et l’administration du Royaume, Lambermont et Banning, Van Eetvelde et van Neuss ; son armée lui donne Thys
Chaltin, Le Marinel, Van Gèle, Francqui, Lothaire et combien
de héros qui offrent leur sang.
50
Il négocie, fait la guerre et le commerce. Il a de l’imagina­
tion et de la volonté. Il est autoritaire et persuasif. Il sait l’art
de la conversation et du discours. Il cherche à convaincre.
Son ironie, parfois dure, intimide. Par le port, la parole, le
geste, le regard, il est totalement Roi.
Il méprise la popularité. Il a l’instinct et le besoin de la
grandeur. Il la veut pour son peuple et pour lui-même, qu’il
associe.
Après trente ans d’efforts il cède à la Belgique une colonie
admirablement outillée, organisée, en plein rendement.
Sans doute l’histoire de cette extraordinaire entreprise,
qui a des aspects d’épopée, est mouvementée et coupée d’inci­
dents inévitables dans un pays de libre discussion, où les partis
se contrôlent et s’affrontent.
Dans certains milieux on s’offusqua de la tendance au
pouvoir personnel ; il y eut des moments où l’on redouta l’hos­
tilité de l’Angleterre, les responsabilités et les sacrifices trop
lourds. Les méthodes d’exploitation du domaine suscitèrent des
critiques sévères en Belgique comme à l’étranger. Une fraction
de l’opposition dans les Chambres discuta en termes souvent
passionnés le principe même de la politique coloniale.
Cependant, le Parlement répondit finalement à chaque
appel que lui fit le Roi par l’organe constitutionnel de ses
ministres. Il n’y eut de dissentiment que sur la Fondation de
la Couronne, dont la Chambre refusa le maintien au moment de
la reprise du Congo.
Il serait donc injuste autant qu’inutile, pour hausser le
piédestal du Souverain, de rabaisser la nation. C’est dans la na­
tion que Léopold II puisa l’appui et les hommes indispensables.
Il imprima le sceau royal à son époque. Ce fut un temps
de fébrile activité. On lui a donné son nom. La période léopoldienne offre le spectacle d’un superbe sursaut de l’esprit d’en­
treprise. On regarde au loin. On envoie en Orient comme en
Afrique des prospecteurs et des capitaux. Nos industries à
l’étranger font reluire le nom belge. Dans ce petit pays en­
combré se dresse un grand peuple. Au centre rayonne Bruxelles,
qui s’orne et s’agrandit. Le Roi perce des avenues, plante des
parcs, érige des monuments et des palais. Il lui faut une capi­
tale à sa mesure.
51
Aux complications qui se déroulèrent autour de la question
coloniale se mêle, enchevêtrée, la question militaire. Pour assurer
la défense du territoire, la nécessité apparut de fortifier la ligne
de la Meuse, de moderniser l’enceinte d’Anvers, d’élargir le
recrutement de 1 armée. Mais elle ne fut reconnue qu’après de
longs débats. La neutralité garantie endormait la vigilance. On
se fiait aux traités. E t pourquoi, dans l’hypothèse d’une guerre
nouvelle, ne verrait-on pas se reproduire le miracle de 1870 ?
La préoccupation de la sécurité du pays obséda Léopold II,
qui, à maintes reprises, fit retentir d’impressionnantes adju­
rations. Les solutions furent atteintes parfois tardivement. E t
le Roi eut la suprême satisfaction de signer, quelques heures avant
de mourir, la loi établissant le service personnel obligatoire.
Le troisième règne commence dans une aurore resplen­
dissante. L’avènement du Roi Albert fait passer sur le pays
un souffle de jeunesse. Mais bientôt les querelles de partis
s’exacerbent. Des discussions orageuses s’engagent au Parle­
ment, d’où sortent deux réformes capitales : le service mili­
taire général et l’instruction obligatoire.
Tout à coup, du ciel européen qui s’est assombri, la foudre
jaillit.
C’est la guerre et l’invasion.
Pendant quatre ans, le peuple belge, en qui l’agression
a réveillé le vieil esprit d’union nationale, déploie, sous la
conduite de son Roi, une résistance héroïque.
Enfin la victoire libère le territoire.
La vie publique reprend son cours.
Ici s’ouvre le présent, dans lequel s’incorporent les vingtcinq dernières années.
E t, comme Henri Pirenne qui fut mon guide, je m’arrête.
J ’ai tenté d’esquisser les principaux épisodes de notre
histoire de nation indépendante, pendant près d’un siècle.
J ’ai voulu en dessiner le relief, les sommets où l’on monta,
les pentes où l’on faillit glisser vers l’abîme, toutes les sinuo­
sités, tous les obstacles rencontrés sur le chemin.
Il n’était pas possible de retracer les péripéties de la lutte
des partis. Les partis en Belgique n’ont jamais été des clans
ou des coteries servant des ambitions personnelles ou des
intérêts particuliers et temporaires. Ils ont groupé des ten­
52
dances, des aspirations communes à de vastes catégories d’es­
prits. Ils ont eu un programme, une discipline, des chefs. Ils
furent les organes nécessaires de la vie d’un peuple libre. La
position de l’Eglise et l’influence des doctrines religieuses dans
les affaires temporelles, l’indépendance et la laïcité du pouvoir
civil, la question scolaire, le libre-échange et le protection­
nisme, les charges militaires et l’organisation de la défense,
l’impôt, le système électoral, l’intervention de la loi dans le
régime du travail engendrèrent des divisions d’ordre spirituel,
économique et social, des entraînements et des réactions, qui
aboutirent à des chocs, à des alternatives de victoire et de défaite.
Il est juste de dire, si l’on regarde de haut et de loin, qu’au
milieu des remous et du tumulte des partis la Belgique fut bien
gouvernée et que le Parlement remplit avec conscience et
probité, souvent avec éclat, sa mission législative et de con­
trôle. Il fut l’interprète fidèle de la volonté nationale. Ses
Annales renferment de belles pages.
Des figures éminentes illustrèrent nos Chambres. Ne citons
que quelques noms : Lebeau et Nothomb, Rogier et de Theux,
Frère-Orban et Malou, Beernaert et Jacobs, Woeste et Paul
Janson.
Frère-Orban et Beernaert sont avec nos Rois les grands
constructeurs de la Belgique contemporaine.
La Constitution a gardé son prestige et son autorité.
Pirenne l’a appelée « le seul régime digne d’un peuple libre et
la plus haute raison d’être de l’indépendance nationale ».
Enfin la Dynastie a été le centre de gravité de l’E tat,
un symbole, une lumière, une source de sagesse, une garantie
de stabilité et de durée.
Mais la Monarchie, le Parlement, les institutions ne seraient
que de fragiles décors s’ils ne reposaient sur des assises perm a­
nentes : l’amour et l’habitude de la liberté, l’esprit d’initiative,
le sens de la mesure, l’instinct des réalités, la faculté d’adap­
tation du peuple belge.
Tous ces éléments de santé, d’équilibre et de grandeur,
la Belgique les possède. Pirenne les a décrits dans le livre magis­
tral qui inspira ce discours.
Je le termine par un suprême hommage au célèbre his­
torien et par une profession de foi dans les destinées du pays.
53
LA VIE POLITIQUE PENDANT UN DEMI-SIÈCLE
(1888-1938)
En novembre 1938.
Pour juger l’étendue et l’ampleur de l’évolution politique
du pays pendant le dernier demi-siècle (1888-1938), il suffit
de se reporter à l’année initiale.
Qu’était la Belgique de 1888 ?
130.000 citoyens payant le cens électoral (42 Fr. 32 d’im­
pôts à l’Etat) élisaient les Chambres. Ils constituaient le « pays
légal ».
On comptait dans la population environ 30 p.c. d’illettrés.
Il n’y avait pas d’obligation scolaire.
L’armée se recrutait chez les pauvres, par le tirage au
sort. Les familles aisées se payaient des remplaçants.
Au lendemain des émeutes de 1886, le Parlement vote des
lois sociales qui apportent des soulagements aux conditions de
la vie ouvrière.
La politique coloniale s’esquisse et son avenir semble
incertain. Le Roi, après la Conférence de Berlin, a obtenu
des Chambres en 1885, l’autorisation d’exercer la souveraineté
de l’E tat Indépendant du Congo.
Le parti catholique, vainqueur aux élections de 1884,
fin du dernier cabinet libéral de Frère-Orban, gouverne sous
la direction de Beernaert.
La classe ouvrière s’éveille et s’organise. C’est le début.
Anseele, en 1880, a fondé à Gand la première coopérative, le
Vooruit.
Les problèmes de l’intérieur, la réforme des institutions
absorbent l’opinion. Au dehors on regarde peu. L’Europe est
calme. La Belgique est neutre. Cinq grandes Puissances ont
garanti sa neutralité. On n’éprouve aucune sensation de péril.
De loin ce moment de notre histoire semble celui de la
félicité. Il le fut si l’on songe aux épreuves terribles qui de­
vaient vingt six ans après, bouleverser le pays.
54
Mais la vie politique était ardente, les luttes de parti
pleines d’aigreur et de colère. Le mouvement démocratique
qui commençait et s’accentuait suscitait des passions et des
anxiétés.
Maintenant, rapidement, d’un coup d’œil, embrassons toute
la période qui s étend jusqu’à 1914, jusqu’à la guerre.
En 1893, on revise la Constitution et les Chambres donnent
le pouvoir électoral a 2 millions de citoyens, avec le correctif
du vote plural.
Le parti socialiste pénètre dans les Chambres. E t son
apparition, son langage effrayent la bourgeoisie.
La représentation proportionnelle en 1900 corrige les
premiers effets massifs du suffrage universel.
La Belgique est devenue une démocratie.
Un souffle nouveau pousse aux réformes qui protégeront
l’ouvrier et l’aideront à hausser son niveau d’existence.
Léon X III, en 1891, a lancé l’Encyclique Rerum Novarum.
Un groupe de démocrates-chrétiens se forme au sein du parti
catholique.
Trois problèmes deviennent le centre des polémiques et
m ettent les partis aux prises, l’organisation de l’armée, la
question scolaire, le régime électoral.
Pendant qu’elles agitent le Parlement, Léopold II poursuit
son œuvre coloniale, avec une magnifique puissance de réali­
sation. Il crée un empire belge au centre de l’Afrique et en
transm et le gouvernement à la Belgique.
Il meurt après avoir signé la loi qui abolit le remplacement
et institue le service militaire personnel et obligatoire.
Il laisse à son successeur une Belgique prospère, qui s’est
prodigieusement développée et figure au premier rang dans
le monde économique.
Un nouveau règne s’ouvre. D’unanimes démonstrations
d’espoir et de confiance saluent le Roi Albert et la jeune Sou­
veraine.
Cinq ans vont s’écouler dans la paix. Cependant les divi­
sions politiques s’exacerbent. De longs efforts aboutissent à
deux grandes réformes, l’instruction obligatoire et le service
militaire général.
E t puis c’est la guerre et l’invasion.
55
Ici s’ouvre une tranchée profonde dans le chemin de notre
évolution politique.
Après quatre années de souffrances, d’héroïsme et de
gloire, la Belgique se retrouve unie autour du Roi.
Mais la restauration exige l’apaisement des querelles de
parti, des oppositions de conscience et de classe. La collabo­
ration de toutes les forces est nécessaire.
Le Roi Albert forme un ministère d’union nationale. E t
les Chambres, s’affranchissant des formalités constitutionnelles,
adoptent à l’unanimité le suffrage universel pur et simple à
21 ans. On ne veut pas exclure de l’électorat les jeunes soldats
qui ont risqué leur vie sur les champs de bataille et les jeunes
ouvriers qui ont affronté la déportation.
Puis le Parlement vote la loi des 8 heures.
E t ces deux actes capitaux caractérisent le régime qui
s’ouvre.
Le suffrage universel pur et simple à 21 ans transforme
la composition des Chambres. Il augmente la représentation
des éléments populaires, socialistes et démo-chrétiens. Il réduit
la droite conservatrice et la gauche libérale. Aucun parti désor­
mais ne trouve au Parlement la majorité absolue.
Des ministères de coalition se succéderont, recrutés dans
les deux ou trois grands partis, et dans certaines circonstances
graves et pressantes, qui exigent une action énergique et rapide,
ils obtiendront des Chambres le pouvoir de régler des problèmes
de finance et d’administration par des arrêtés royaux ayant
force de loi.
Les soucis des gouvernements et de l’opinion se partagent
entre les besognes lourdes et coûteuses de la reconstitution
économique du pays et les dangers, les crises qui secouent
l’Europe profondément ébranlée par une guerre générale de
quatre années.
Il faut pourvoir à la sécurité du pays et organiser le relè­
vement de son commerce et de son industrie.
Quand on regarde de haut cette période de travail intense
et de préoccupations fiévreuses, on ne saurait sans injustice
contester que la Belgique, sortie ruinée de la guerre, s’est
magnifiquement relevée. Les épreuves financières qu elle a
traversées avec courage en 1926 et en 1935, n’avaient pas pour
56
origine ses propres faiblesses. C’étaient les répercussions iné­
vitables du désordre dont souffrait l’Europe. Parfois même
notre sort fut heureux, si l’on veut établir quelque compa­
raison avec celui d’autres peuples voisins, même les plus grands.
Enfin, depuis la victoire de 1918, aucune convulsion sociale
n’a troublé la paix civile.
Cette vision d’ensemble d’une longue étape, la plus péril­
leuse de notre histoire, ne doit pas nous illusionner sur les
difficultés du présent.
La vie publique a changé d’aspect. Les masses dominent.
Le prestige du Parlement a fléchi. Les intérêts de classe et de
métier se heurtent. En même temps on réclame pour eux la
protection de l’E tat et l’on repousse avec horreur son action
envahissante. Les charges publiques s’alourdissent et la haine
de l’impôt s’exalte.
On sent, au dehors, l’odeur de la guerre ; on entend des
appels à la force ; on assiste à d’impitoyables persécutions.
On voit se déployer des régimes totalitaires où disparaissent
l’individu et la liberté.
A l’intérieur la question linguistique prend un caractère
racique ; une bande de nationalistes flamands prêche le sépa­
ratisme et la destruction de l’E tat belge.
Il importe de veiller et d’agir, de corriger et réformer.
La liberté, la démocratie, les institutions parlementaires
veulent une discipline, des mœurs, de la mesure et de l’ordre.
Les charges budgétaires doivent être proportionnées aux
ressources de la nation.
Les discordes civiles autant que le désordre financier
entraîneraient l’anarchie, la décadence, l’incertitude du len­
demain. De là sortent les aventures.
La Belgique pour remplir son rôle, a besoin d’une solide
unité morale.
Ses dons d’adaptation, le bon sens, le patriotisme la lui
donneront sous l’égide de son jeune Roi, héritier de traditions
illustres.
57
LA VIE INTELLECTUELLE DE 1830 A 1930
Discours prononcé à la séance publique de VAcadé­
mie Royale de Belgique du 14 ju in 1930 à l'occasion
du Centenaire de VIndépendance Nationale, en p ré ­
sence de Leurs Majestés, le Roi et la Reine.
La Belgique, en commémorant les grands actes politiques
qui, il y a cent ans, consacrèrent sa nationalité et firent d’elle
un E tat indépendant, ne se borne pas à célébrer un souvenir
éclatant de son passé. Elle glorifie l’œuvre d’un siècle, ses
développements, ses lois et ses Rois, ses richesses, tout ce
qu’elle a acquis et créé, tout ce qu’elle a sauvé, tout ce qu’elle
espère.
Ailleurs et en maintes occasions on a dessiné la courbe
ascendante de ses forces productrices et de son expansion
commerciale ; on a décrit les phases de son évolution politique
et sociale et reconnu, sous les remous des agitations de parti,
la stabilité fondamentale des institutions. Il n’est pas en Europe
de pays dont l’histoire pendant les cent dernières années montre
une plus durable continuité, un élan plus soutenu et régulier.
Une catastrophe, vers la fin, faillit tout emporter. Mais quand
le flot déchaîné eut passé, la Belgique reparut, pleine de suc
vital ; le sentiment national s’était, dans l’épreuve, nourri
aux sources profondes du sacrifice. Le goût du travail et de
l’action, le muscle et l’intelligence, l’initiative et cette aptitude
à s’accommoder des faits, à les arranger, à les agencer de manière
à en tirer le meilleur profit, qui est un des traits du caractère
belge, la sagesse enfin qui évita les déchirements et maintint
l’unité, refirent une Belgique aisée, adaptée aux temps nou­
veaux et digne du rang que les événements lui avaient assigné
et où elle figura glorieusement.
Toutes ces raisons de fierté ont été ou seront magnifiées
dans les cérémonies publiques.
L’Académie royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts, dans cette séance plénière de ses trois Classes, a voulu
58
honorer aujourd’hui la vie intellectuelle pendant le siècle
écoulé, la pensée, la science et l’art qui sont l’ornement de
toute civilisation. Un peuple riche qui les dédaignerait som­
brerait dans la vulgarité. Les mœurs en seraient dégradées et
la jeunesse découronnée. Toutes les ardeurs se dépenseraient
en luttes brutales pour l’assouvissement des appétits.
Nos Souverains sont pénétrés de ces sentiments. Ils le
prouvent en participant avec une attention émue et éclairée à
tous les mouvements de l’activité artistique et scientifique. Un
mot viril du Roi, un sourire de la Reine sont un stimulant et
une récompense.
La croissance de la vie intellectuelle en Belgique a suivi
le développement économique et politique du pays. Les forces
spirituelles ne se dégagent pas immédiatement d’une société
en formation. Elles exigent une atmosphère, des conditions
sociales, une certaine sérénité morale, venant d’une impression
d’aisance et de sûreté, d’une confiance en soi et dans l’avenir,
qui libèrent l’imagination des contingences de la vie positive.
La Belgique indépendante surgit en 1830 dans une Europe
effervescente. La Sainte Alliance qui avait abattu l’Empire se
dissout. En France, la royauté légitime s’écroule et une dynastie
s’inaugure. Le libéralisme triomphe en Angleterre et ouvre une
ère de réformes. La Grèce s’affranchit du joug ottoman. La
Pologne se révolte et le Tsar l’écrase dans le sang. Les Italiens
s’agitent et inquiètent la domination autrichienne. Des troubles
éclatent en Allemagne. Dans l’Europe qui fermente se dessinent
les linéaments d’un ordre nouveau.
Le pouvoir des classes moyennes s’affirme et s’installe.
La grande industrie et le machinisme transforment les mœurs
économiques. Avec l’ancienne société les Arts et les Lettres
créés à son image s’étiolent. Le romantisme fait entendre des
chants de triomphe et donne ses fleurs de printemps. Le sen­
tim ent de la nature et l’imagination secouent les règles du
néo-classicime. Le mouvement et l’expression, le goût du
pittoresque et de l’exotisme brisent le moule de l’art académique.
Dans les sciences expérimentales et les sciences historiques,
des méthodes modernes s’esquissent ; l’esprit critique et l’idée
d’évolution suscitent des disciplines nouvelles. Au milieu de
cette rapide évolution les âmes hésitent entre la crainte des
59
bouleversements et l’espérance du renouveau. Victor Hugo,
dans le Prélude des Chants du Crépuscule s’écrie :
De quel nom te nommer heure trouble où nous sommes ?...
Seigneur ! Est-ce vraiment Vaube qu’on voit éclore ?...
N ’y voit-on déjà plus, n’y voit-on pas encore ?
Est-ce la fin , Seigneur ? ou le commencement ?
En Belgique, au début, toutes les énergies se consument
dans la lutte pour l’indépendance, dans la construction de
l’ordre civil, dans les périlleuses négociations avec une Europe
inquiète et méfiante, dans l’érection des deux piliers de la vie
nationale : la Constitution et la Dynastie.
Une superbe génération de jeunes hommes apparaît. Mais
c’est le combat pour l’affranchissement qui absorbe leur enthou­
siasme. Ils s’improvisent législateurs et diplomates. Ils s’adon­
nent à une œuvre qui les illustrera : la création d’un Etat.
Mais à peine les bases scellées au sol il faut, avec l’aide
de la France, refouler une invasion de l’armée hollandaise ;
puis élaborer des lois organiques pour assurer le fonctionnement
des pouvoirs.
Enfin une initiative audacieuse bouscule les préjugés et
forge l’outil des développements futurs : Rogier décrète l’éta­
blissement du premier chemin de fer du continent.
En même temps, les idées se tournent vers l’enseignement.
En 1835, on réorganise les Universités de l’E tat et deux Uni­
versités libres surgissent, dues l’une aux catholiques qui bien­
tôt l’installent dans les antiques auditoires de Louvain ; l’autre,
libérale à Bruxelles, qui débute dans de modestes locaux muni­
cipaux. On met en mouvement les organes indispensables de
la vie intellectuelle.
Jusque-là elle est demeurée terne, sans flamme et sans
originalité.
Le gouvernement hollandais sans doute avait fondé les
Universités de Liège et de Gand et accompli un effort louable
dans le domaine de l’instruction primaire et moyenne. Mais le
haut enseignement était, dans une atmosphère d’indifférence
et d’hostilité au pouvoir, demeuré sans rayonnement.
La presse, dans la première période du régime de 1815,
60
était lourde et sans feu. Depuis 1825 le mouvement national
l’avait échauffée. Des feuilles nouvelles : le Courrier des PaysBas, le Mathieu Laensberg, puis le Politique avaient excité
l’opinion bourgeoise. Les jeunes patriotes qui devaient faire
1830 s’y étaient exercés à la polémique.
Mais l’art et les lettres semblaient muets. A vrai dire y
avait-il un mouvement de l’esprit, un public apte ou disposé à
le suivre et l’entretenir ?
La Belgique entière et Bruxelles vivaient d’une vie pro­
vinciale, étroite et casanière. La capitale n’était qu’une minime
agglomération. Le Parc et les hôtels patriciens de la ville haute
couronnaient les quartiers commerçants et populaires. L’en­
semble, non dépourvu de pittoresque, était médiocre. La préoc­
cupation du bien-être et du confort, les conversations banales
des salons, en haut, les causeries de café, en bas, formaient la
tram e de l’existence ordinaire.
Point de littérature ou de musique. Des fables de Stassart,
un Salon de Peinture sont les seules manifestations de pensée
littéraire ou artistique que l’on puisse noter dans ce paysage
sommeillant.
La révolution, comme un frisson, remue cette société
endormie ; une passion l’exalte. Le sentiment national, lon­
guement mûri, éclate et redresse tout un peuple. Il y a désor­
mais un E tat, un pouvoir autonome, une communauté sociale
qui prend conscience d’elle-même. On ressent une joie de
vivre, d’être ce qu’on est et de le montrer, de faire mieux, de
se grandir, afin de mériter l’estime chez soi et au dehors.
Une vie intellectuelle va progressivement s’élaborer. Mais
les débuts sont lents et difficiles.
On ne saurait ici songer à rédiger un catalogue, à établir
une liste de personnages, à procéder à une revue critique des
hommes et des travaux d’un siècle. Beaucoup de livres, d’ar­
ticles et de discours ont été consacrés et le seront encore à la
description des formes diverses de l’activité littéraire, artistique
et scientifique des cent années révolues.
Il est permis de dire avec orgueil que dans tous les do­
maines de la production de l’esprit, on peut énumérer de grands
noms et de belles œuvres, dont le lustre ennoblit notre histoire.
61
Nous nous bornerons à marquer quelques phénomènes de la
vie intellectuelle, à montrer l’étonnant et magnifique contraste
qu’offrent l’indigence des commencements et l’épanouissement
de l’époque contemporaine.
C’est dans les Universités que s’allument les premiers
foyers, et tout de suite quelques hommes suscitent un milieu
propice, groupent autour d’eux des disciples en qui ils éveillent
une vocation et dont ils animent la pensée. C’est à Gand, notam ­
ment, dans le premier quart du siècle d’indépendance, Moke et
Huet, l’historien et le philosophe, qui recevaient dans l’intimité
leurs meilleurs élèves, discutaient familièrement avec eux toutes
les questions du jour, et qui formèrent une école de libres
esprits. Emile de Laveleye, qui devint une des brillantes figures
de notre X IX e siècle, était de cette phalange.
En 1833, un livre paraît que le public s’arrache. C’est
VEssai historique et politique sur la Révolution belge, de JeanBaptiste Nothomb. Acteur et témoin des événements de 1830,
Nothomb, à 25 ans, avait joué un rôle influent dans la rédaction
de la Constitution ; il avait négocié à Londres avec Talleyrand
et Palmerston. De tels antécédents donnèrent à ces deux gros
volumes une autorité qui dépassa nos frontières. En deux ans,
trois éditions s’épuisèrent. E t sans doute l’ouvrage répondait
aux préoccupations du moment. Mais il est d’un style ferme
et d’une composition solidement ordonnée. On y reconnaît à
la fois l’écrivain et l’historien.
Avec la période révolutionnaire coïncide le réveil de notre
école de peinture. Elle a été stérile pendant le X V IIIe siècle.
Au début du X IX e l’influence néo-classique de David marque
l’œuvre de Navez, dont le tempérament se révèle dans le por­
trait. Mais en 1830 un vent se lève qui renouvelle l’inspiration.
1830 n’est pas seulement en Belgique comme en France un
changement de régime. C’est, selon le mot d’un livre récent, une
émeute d’idées. Le romantisme entraîne l’art pictural belge,
qui d’un coup d’aile cherche à rejoindre Rubens et d’un autre
se jette dans les orages politiques. Au Salon de 1830, la foule
s’attroupe devant une grande toile dramatique du jeune Wappers. Nos peintres amplifieront les scènes pathétiques et les
incidents pittoresques de l’histoire ; à leurs dons innés de colo­
ristes s’allie le sentiment civique, stimulé par les événements.
62
L’école belge renaît. Après les premiers romantiques, Leys
et Gallait l’illustreront. Mais on se lassera bientôt des grandes
images historiques, dont l’emphase atténuera l’accent. E t vers
le milieu du siècle, les tendances réalistes venues de France
tourneront nos artistes vers l’observation plus assidue de la
figure humaine et des aspects de la terre.
Des ateliers de Navez, de Wappers, de Leys, de Portaels,
sortira une légion de beaux peintres dont les tableaux illu­
mineront leur temps. Ce n’est pas la cérébralité, ni l’attraction
du mystère, le rêve ou l’allégorie, qui caractériseront leur œuvre.
Dès l’origine se révèlent en eux le respect passionné de la nature,
l’instinct de la nuance, le sens pénétrant et délicat des har­
monies de la lumière, des splendeurs de la chair, de l’étoffe
et de la verdure, l’amour du mouvement et de la vie. Ainsi
les liens avec le passé sont renoués et la lignée des ancêtres se
continue. On a dit parfois que nos artistes sont nos grands
ambassadeurs ; chef de notre diplomatie, j ’accepte ce jugement,
qui ne la diminue pas. La peinture belge est la plus haute
expression de notre génie. C’est notre gloire. A la contempler
nous nous sentons plus grands.
La première période de l’E tat belge, la période de fondation,
offre un spectacle de multiple et féconde activité. A l’origine,
c’est le vide, la plaine rase, l’aventure. Il faut planter, bâtir,
tracer les chemins. E t le rythme de la vie intellectuelle suit
celui de la vie administrative et politique.
On institue l’Observatoire, le Conservatoire de Musique,
la Bibliothèque, les Musées. Immédiatement des hommes se
trouvent pour conduire et innover. Plusieurs affirmeront une
forte personnalité, qui sera reconnue et appréciée à l’étranger ;
ils appartiendront à la fois à leur pays et à l’Europe.
Fétis, le premier directeur du Conservatoire, est tenu
pour le musicographe le plus érudit de son temps. E t sa Bio­
graphie universelle des Musiciens devient un ouvrage fondamen­
tal que l’on consulte partout.
A l’Observatoire règne Quetelet, astronome et mathéma­
ticien, sociologue et physicien. C’est un esprit universel, qui
devance son temps. Il a beaucoup voyagé, s’est lié avec des
personnalités illustres, a passé huit jours chez Goethe à Weimar.
Il publie la Physique sociale et crée une science, la statistique
63
morale, qui poursuit la recherche de lois fixes se dégageant des
grands nombres et auxquelles sont soumis les phénomènes
démographiques et sociaux. Il forme un élève qui, s’orientant
vers les travaux de physique expérimentale, sera l’un des
héros de la science belge : Plateau, devenu aveugle pour avoir,
pendant ving-cinq secondes, observé le soleil à l’œil nu. Un
de nos contemporains éminents a dit de lui qu’il avait le génie
de l’expérience. Sa renommée était générale et certaines de
ses études sur la lumière et les impressions visuelles en font
en quelque sorte un précurseur du cinéma.
Cependant la Belgique s’affermit et s’organise. Elle traverse
une crise agricole douloureuse, une inquiétante tourmente
financière. La Révolution de 1848 qui flambe à ses frontières
ne mord point sur ses jeunes institutions, qui, intactes, tien­
nent debout. La vie s’élargit et les fenêtres s’entrouvrent.
Les événements de France, en 1851 et 1852, vont donner
une impulsion au mouvement intellectuel. Le coup d’E tat et
l’Empire chassent vers la Belgique hospitalière des savants,
des poètes, des historiens qui cherchent chez nous un refuge
loin des tribunaux sévères et d’une police inquisitoriale :
Hugo, qui ne reste guère ; Edgar Quinet, Bancel, Emile Deschanel, qui s’installent ; Raspail, Madier de Montjau, l’éditeur
Hetzel. Cette colonie de proscrits, avides de parler et d’écrire
librement, apporte avec elle des relents de fièvre politique. En
applaudissant leur talent, on honore leur infortune. On offre
à Bancel une chaire à l’Université. Deschanel et Madier dis­
sertent dans les cercles de la capitale et de la province. Ils
m ettent à la mode un genre littéraire, la conférence, style
oratoire, méthode d’éducation et distraction mondaine. Ils
ont leurs centres de réunion, leurs hôtes assidus, une clientèle ;
et leur influence sur la jeunesse hâte dans les milieux libéraux
l’éclosion des idées radicales.
A partir du milieu du siècle dernier une période s’ouvre
qui se prolonge jusqu’à la grande guerre de 1914 ; car le X IX e
siècle déborde en vérité sur le X X e et la classification des faits
ne correspond pas à une chronologie mathématique.
La nation évolue et sa destinée se déroule sans accidents.
Elle se possède. Son patrimoine se consolide. Ses traits s’ac­
64
cusent et lui composent la physionomie où se fixe son carac­
tère. En 1880, elle étale avec faste, dans les cérémonies du
Cinquantenaire, la fierté de ses libres institutions, la joie d’une
saine existence, apte à de nouveaux enfantements. Elle réalise,
sans se déchirer, la transition nécessaire du régime bourgeois
à la démocratie. Son second Roi la pousse vers les espaces
lointains, dont les horizons incertains déconcertent d’abord ce
qu’elle a de préjugés tradionnels et casaniers, mais excitent
bientôt ce qu’elle a d’esprit entreprenant et audacieux. Léopold II
se taille en Afrique un Empire qu’il lui lègue, et projette au
dehors l’initiative de nos hommes d’affaires et de nos ingénieurs.
Avec un étroit territoire, dont pas un pouce ne demeure en
jachère, et une immense colonie, avec un bout de côte maritime
et l’un des grands ports du continent, la Belgique devient l’une
des puissances commerciales du monde.
Lorsque, parmi les acclamations et les sourires, un troi­
sième couple royal rajeunit la dynastie, la vie est intense ;
la capitale est un centre sonore ; les mœurs sont élégantes et
cossues ; les arts, les lettres, les sciences haussent le niveau
moral d’une société dont l’éducation et le goût se sont affinés et
dont les besoins matériels sont satisfaits. C’est l’épanouis­
sement.
De riches prémices annoncent cette saison splendide qui
fleurit vers la fin du X IX e siècle et au début du X X e.
Des maîtres éminents donnent à l’enseignement univer­
sitaire, que des Ecoles spéciales ont outillé et renforcé, une
valeur scientifique et morale qui accentue le mouvement de
l’esprit. Une élite se forme. La vie intellectuelle s’amplifie.
Mais comment, dans une si rapide esquisse, dire tout ce
qu’il faudrait, classer les hommes et les œuvres ? Résignonsnous à ne montrer que quelques fronts qui dominent, quelques
renommées qui éclairent leur époque.
Voici Emile de Laveleye, intelligence prompte et hardie
qu’attiraient tous les aspects nouveaux du monde international,
de la démocratie, de l’économie politique, de la philosophie.
Il s’intéressait à tous les élans généreux. Professeur, essayiste
fertile, au style rapide et chaleureux, il écrivit beaucoup pour
la Belgique et pour l’étranger sur la propriété, sur les formes
du gouvernement, sur la religion, sur les problèmes de la poli­
65
tique européenne. Il fut l’un des collaborateurs assidus de la
Revue des Deux Mondes.
E t voici François Laurent, grand jurisconsulte, penseur
passionné, infatigable producteur. Il entreprit une sorte d’im­
mense enquête en dix-huit volumes sur l’Histoire de l’Hum a­
nité. Il bâtit, en trente-trois volumes, les Principes du Droit
civil. Il enseigna, batailla pour les idées, créa des œuvres sociales
qui servirent de modèle. Ce fut un chef reconnu, cité m ainte­
nant encore et admiré au delà de chez nous.
Parmi ceux qui suivent apparaît l’un des agents discrets
et clairvoyants de notre diplomatie, bel écrivain et haut esprit :
Emile Banning, qui fut le collaborateur de Rogier, de FrèreOrban, de Léopold II. Ses études politiques abondent en vifs
aperçus sur les conditions et les destinées de la Belgique. Ce
serviteur modeste de l’E tat, que la nature avait frappé d’une
disgrâce physique et qui fuyait le monde, laissa un livre de
réflexions intimes, où se révèlent une âme stoïque et de nobles
aspirations.
Comment oublier, plus près de nous, Adolphe Prins et
Waxweiler ? Prins renouvela la science pénale, fut l’initiateur
de réformes humanitaires et ouvrit l’esprit de la jeunesse aux
effluves des temps nouveaux. Waxweiler créa une sociologie
fondée sur l’expérience, sur l’observation de l’individu et de
son milieu. Il mourut pendant la guerre, après avoir, dans un
livre éclatant de vérité, La Belgique neutre et loyale, détruit
de meurtrières légendes.
La science pure eut ses héros : le chimiste Stas, élève de
J.-B. Dumas ; ses recherches sur les atomes, certaines méthodes
qu’il institua, lui valurent la célébrité. Tous les corps savants
le couvrirent d’honneurs. Ed. Van Beneden, le biologiste,
étendit par ses découvertes le champ de l’embryologie et donna
des bases aux lois de l’hérédité. Gramme, l’illustre constructeur
de la première dynamo, créa l’instrument destiné à transfor­
mer la force motrice et à la transporter à distance. Il ouvrit
ainsi la voie à toutes les applications de l’énergie électrique
et prépara une extraordinaire évolution de l’industrie et de
la vie économique.
L’histoire fut toujours cultivée en Belgique. Après 1830,
on débute par l’érudition et le récit. Les analyses de l’archi­
66
viste Gachard, les ouvrages narratifs de Juste, de Kervyn, de
Wauters, de Louis Hymans préparent le terrain. Poullet et
Thonissen étudient les institutions. Puis l’histoire s’élargit et
s’approfondit. Yanderkindere écrit le Siècle des Artevelde. Fredericq raconte les luttes religieuses aux Pays-Bas. Henri
Hymans et Max Rooses se vouent à l’histoire de l’Art. Godefroid K urth vient à son tour. Avec ses dons d’imagination et
d’éloquence, il ressuscite, dans ses Origines de la Civilisation
moderne, de longues périodes qu’il éclaire de vues philosophiques.
Un pas de plus nous conduit aux grandes œuvres de Pirenne,
qui reconstitue la vie sociale et économique de nos cités et
construit une synthèse imposante. Il trace les grandes lignes
d’une histoire commune, met à jour les racines de la nationalité
belge et montre sa croissance logique et continue. Il devient
aux yeux du monde le grand historien de la Belgique.
L’histoire religieuse ne fut pas négligée par les catholiques.
Fondée par des Belges au X V IIe siècle, l’œuvre des Bollandistes
a été reprise à partir de 1837 et continue avec succès. Aujourd’hui
notre confrère dom Ursmer Berlière poursuit ses savants tra­
vaux sur la vie monastique aux siècles passés.
L’évocation de l’idée religieuse suscite aussitôt à nos
yeux l’effigie majestueuse du Cardinal Mercier. Si intimement
associé aux épreuves dont le souvenir fait encore frémir nos
cœurs, il appartint à la Science, et à l’Eglise. C est la
Science qui le conduisit au siège archiépiscopal de Malines.
Il fut chef d’école à l’Université de Louvain. Il incarnait à
l’Institut supérieur de philosophie la doctrine néo-thomiste,
qui imprègne la jeunesse croyante. Devant l’invasion, il se
dressa l’Evangile à la main. Ses lettres pastorales, où résonnait
l’âme de tout un peuple, soulevèrent la conscience universelle.
Il servit la justice, la foi, la patrie. Sa figure sereine se profile
sur l’histoire morale du pays.
Tandis que le X IX e siècle s’avançait vers sa fin, dans
une atmosphère où soufflait un vent de réforme, eclot une
soudaine et fraîche floraison littéraire.
La jeunesse impatiente lève la tête. Les discussions esthé­
tiques se mêlent aux débats des partis qu’agitent les signes de
la démocratie et les premières rumeurs du monde ouvrier. La
67
presse nombreuse et active donne plus de place et d’importance
aux préoccupations intellectuelles. Elle compte des écrivains
et des polémistes dont la plume a de la verve et du trait ; Verspeyen au Bien Public de Gand, de Haulleville au Journal de
Bruxelles, Louis Hymans à YOffice de Publicité, Charles Tardieu
à Y Indépendance, et Gustave Frederix, dont les feuilletons de
critique sont lus et prisés à Paris, comme dans les milieux
lettrés de Belgique.
Les luttes de la tribune ont de l’écho dans l’opinion. Nous
avons une légion de grands orateurs et l’éloquence n’est pas
seulement une action, mais un art, puisqu’elle exprime direc­
tement par le mot, la voix, le geste, le regard toutes les nuances
de la pensée et de l’émotion, les élans du cœur et de la raison.
On se presse au Palais de Justice et au Parlement pour entendre
les accents charmeurs de Jules Le Jeune, la phrase nerveuse et
châtiée de Charles Graux, le style académique d’Auguste
Beernaert, la parole souple et acérée de Victor Jacobs, les
périodes altières de Frère-Orban, le verbe puissant de Paul
Janson, les improvisations fougueuses et multiformes d’Edmond
Picard, infatigable remueur d’idées, iconoclaste et prophète,
abatteur et bâtisseur de préjugés, et qu’on pouvait ne point
aimer, mais qui fut un extraordinaire animateur.
De ce ciel nuageux et variable qui annonce un changement
de saison, tout à coup descendra, neuve et inattendue, la jeune
Poésie.
L’école littéraire, dont Max Waller, page impertinent et
spirituel, claironne l’avènement, se donne un mot d’ordre :
« l’Art pour l’Art ! » et une revue : La Jeune Belgique, après
laquelle naîtront la Wallonie, YArt Moderne, Durandal. Elle
reconnaît un précurseur : De Coster, et un chef : Camille Lemonnier. La légende héroïque, joyeuse et glorieuse d’’JJlenspiegel et de Lamme Goedzak perpétue le nom de Charles De
Coster. C’est la première grande œuvre originale éclose en
Belgique. On y sent battre le cœur de la Flandre en des épi­
sodes burlesques ou tragiques, que rehausse une langue ar­
chaïque, opulente et pittoresque. Les romans de Camille Lemonnier, inspirés d’abord de l’esthétique naturaliste, sont riches
d’images et d’expressions fortes. La recherche du mot, l’exu­
bérance descriptive, des éclats de lyrisme enluminent et échauf­
68
fent sa prose bruissante et touffue, parfois violente jusqu’à
l’outrance. Eeckhoudt et Demolder suivent Lemonnier avec
des nuances diverses. On pourrait presque dire qu’ils sont tous
peintres autant qu’écrivains. Ils ont l’amour et le sens de la
couleur, des formes plastiques, de la nature. Ce sont de robustes
tempéraments d’artistes.
Maintenant gravissons les sommets. C’est dans les alti­
tudes que respirent les poètes.
Figure mélancolique et délicate, Georges Rodenbach chante
le règne du silence. Il a trouvé dans les rues solitaires, les bé­
guinages et les eaux dormantes des vieilles villes flamandes
l’atmosphère et comme le climat de sa sensibilité : « Moi,
dit-il, moi dont la vie aussi n’est qu’un grand canal mort ! ».
Van Lerberghe module en vers libres d’une grâce fluide
la Chanson d'Eve, qui s’épanouit dans un paysage de rêve,
dans un «jardin bleu ». C’est le symbole et la confession d’une
âme tendre, toujours émerveillée.
La nature harmonieuse et fière d’Albert Giraud s’insurge
devant les trivialités de la vie moderne. Le poète s’enferme
dans un hautain Parnasse où il sculpte de pures strophes,
tels des médaillons à l’image des dieux antiques. Il s’absorbe
dans la contemplation des temps héroïques de la Grèce, mère
de toute beauté. Il tressaille au bruit de la guerre. E t les dou­
leurs de la patrie lui arrachent de brûlantes satires.
Montons un degré. Yerhaeren et Maeterlinck se coudoient.
Ce sont les deux écrivains qui, tout imprégnés du suc de la race,
ont porté le plus loin notre gloire littéraire. Dans les âmes,
à travers le monde, ils ont créé une émotion, fait passer un
frisson.
Yerhaeren, mort depuis quinze ans, demeure associé à
notre existence. Certains de ses vers hantent nos mémoires.
On les cite, on les déclame. Ils sonnent parfois comme des
coups de marteau et des chocs abrupts brisent leur cadence.
Avec quelle puissance farouche et pénétrante, héroïque ou
sereine, ils traduisent les clartés et les ombres de nos cieux,
de nos terres et de nos eaux, les fureurs du vent et de la mer,
les tumultes de la cité, le travail de l’usine et des champs, et
la colère sacrée du droit violé, la passion tenace du sol natal !
Dans son œuvre aux multiples splendeurs, poème d’un
69
peuple et d’une époque, l’amour et la mort, la force et la volupté
soufflent, vibrent, flamboient et se déchaînent comme dans
une immense symphonie. Verhaeren restera pour nous, selon
le titre d’un de ses recueils, le poète des Rythmes Souverains.
Maeterlinck, lui, vit, écrit, poursuit son périple magni­
fique. Après ses premiers vers et ses drames mystiques, il a
subi l’étrange attraction des mystères de la vie. La science
et la philosophie ont entraîné son imagination vers de graves
problèmes qu’il a illuminés de poésie. Dans des livres célèbres
il a décrit le génie ailé de la ruche, la sinistre sociologie des
Termites, la féerie du firmament. Sa phrase ample, nombreuse,
musicale, miroitante d’images, toute la beauté qui enveloppe
ses exposés scientifiques l’ont mis au premier rang des prosateurs
de notre temps. Nous saluons sa gloire. Elle enrichit le patri­
moine moral de la Belgique.
La poésie flamande à son tour s’est parée de lauriers.
L’œuvre de Guido Gezelle, dont la statue vient d’être inaugurée
à Bruges, est toute baignée d’un sentiment profond de l’har­
monie simple des choses et du plus tendre idéalisme chrétien.
Ce prêtre modeste, ce poète par la grâce de Dieu s’inspirait
aux sources claires de la nature familière qui fut le cadre et
la joie de son humble existence. Dans une langue souple et
vivante il interpréta lyriquement les nuances délicates, les
arômes des campagnes de Westflandre, avec leurs toits rouges,
leurs troupeaux et leurs blés. C’était une âme pure d’artiste
et de chrétien.
La littérature flamande, anémiée en 1830, s’était lente­
ment redressée. Henri Conscience, le premier, avait atteint le
peuple et lui avait réappris sa langue. Une longue germination
aboutit à la formation d’une école de poètes et de conteurs où
après Gezelle, brillent Hugo Verriest, Styn Streuvels, enfin
Cyriel Buysse, dont les romans maintes fois traduits dépeignent
avec un réalisme pittoresque et touchant les mœurs des petites
villes de son pays.
Enfin le Vlaamsche Volkstooneel a ressuscité l’art dra­
matique flamand.
Ainsi, que nous regardions d’un côté ou de l’autre, nous
embrassons le spectacle d’un mouvement littéraire tardif sans
doute, mais qui n’a cessé de grandir. L’arbre est plein de sève.
70
Il porte des fruits savoureux. A son ombre l’herbe verdit et
les fleurs foisonnent.
L’événement réalise la pensée qu’exprimait le 11 mars
1856 Léopold II, alors duc de Brabant. Il disait au Sénat :
« Une sage politique nous enseigne qu’un peuple jaloux de
son existence indépendante doit tenir à posséder une pensée à
lui, à la revêtir d’une forme qui lui soit propre, et qu’en un mot,
la gloire littéraire est le couronnement de tout édifice national ».
L’histoire rapide de notre évolution littéraire nous mène
aux journées radieuses qui précèdent la catastrophe de 1914.
La vie intellectuelle est organisée et le pouls de la nation
bat d’un rythme heureux. Il y a désormais dans cette commu­
nauté industrieuse et utilitaire un public instruit, policé, lettré,
friand de lecture autant que passionné pour les concerts et les
tableaux.
La musique, qui s’était tue dans les environs de 1830,
reprit vite et d’un soubresaut son magique pouvoir d’attraction.
Les conservatoires, les écoles réveillèrent des facultés latentes.
Des virtuoses en sortirent que toute l’Europe, après la
Belgique, acclama, les Yieuxtemps, les Servais, dont Ysaye et
De Greef continuent l’illustre lignée.
Gevaert, au Conservatoire de Bruxelles, entretint un foyer
d’art où, pénétré de la pensée des maîtres, il la communiquait
à ses auditoires dont il cultivait la sensibilité et le goût.
Ainsi se forme une sorte d’opinion musicale fervente et
compréhensive. Initiée aux nobles émotions du style classique,
elle prête une oreille accueillante aux rythmes et aux sono­
rités des écoles nouvelles. En même temps que les chefs-d’œuvre
du passé et les œuvres modernes du dehors, elle applaudit les
œuvres nationales des compositeurs belges, de Peter Benoit,
de Tinel, de Lekeu. Elle s’enorgueillit de César Franck, qui
vécut à Paris, mais naquit à Liège. Il rajeunit la musique
orchestrale par d’originales inflexions mélodiques, des harmonies
enveloppantes et souples, des accents humains ou mystiques
qui bercent l’imagination ou l’exaltent, et qui vont jusqu’à
l’âme.
Tandis que ces sources de spiritualité rafraîchissent et
tonifient l’air, un courant majestueux continue à dérouler
71
ses eaux qui traversent le siècle d’un bout à l’autre. C’est le
grand fleuve d’art jailli des profondeurs du passé, c’est la
Peinture.
Elle évolue avec le temps, sa mentalité, ses modes de
sensibilité, sans cesser jamais de demeurer près de nous, du
peuple, de la nation, parce qu’elle traduit son tempérament
et répond à ses aspirations et à ses instincts. A deux ou trois
reprises un soubresaut la redresse, un élan de modernité l’éloigne
de procédés ou de genres devenus conventionnels et dont l’œil
s’est fatigué. Mais toujours l’effort tend à se rapprocher de la
nature pour en révéler un aspect nouveau, pour en rajeunir et
en accentuer l’expression. Car l’école belge se marque par sa
fidélité à la nature saine et frémissante, humaine, champêtre
ou sylvestre. Sans volonté ni préoccupation de matérialisme,
nos artistes aiment la matière pour ses lignes et ses couleurs,
pour sa grandeur ou sa grâce, pour la lumière qui la fait vi­
brer et lui donne une âme. Nos paysages, les bois et les fleurs,
les étangs et les prés, les bêtes qui pâturent, les feuillages de
l’automne ou de l’été, la mer, ses horizons et ses plages, les
ciels d’hiver ou de printemps, ont leurs peintres attendris ou
véhéments. La figure humaine, avec le trait et le geste du rang
ou du métier, le rayonnement intime de la pensée, le costume
rude ou moelleux qui drape le torse musclé ou la taille élégante,
dans le décor de la campagne ou de l’usine, de la chaumière ou
du salon, a ses interprètes éloquents, délicats et subtils qui
savent observer, deviner, comprendre et sentir.
Un de nos grands peintres, Ensor, définissait récemment
son art en ces mots : «Voir de tous ses yeux ; voir c’est peindre,
c’est aimer la nature et la femme et les enfants et la terre ».
On retrouve dans l’école belge du siècle révolu des affi­
nités qui la relient aux grands et aux petits maîtres d’autrefois,
l’opulence des tons, la gradation des nuances, la notation
précise du détail pittoresque, et, joints au culte du vrai, le
souci de la probe exécution, l’orgueil du beau métier. Notre
école est humaine et sincère et par là s’affirme vraiment nationale.
Il serait vain, après tant d’articles de journaux et de
revues et tant de livres savants et documentés, tels ceux de
notre distingué confrère M. Yan Zype, de faire défiler en ce
discours des noms illustres. Il vaut mieux aller contempler à
72
quelques pas d’ici, au Palais des Beaux-Arts et au Musée,
l’œuvre resplendissante de nos peintres et de nos sculpteurs,
de Leys à Boulenger, de Charles de Groux à Stevens, de Yerwée
à de Braekeleer et à de ’W inne, de Dillens et de Yinçotte à
Constantin Meunier.
En sortant de ce spectacle on se sent comme touché de
la grâce.
On y voit se déployer les fruits d’un magnifique labeur
d’évocation et de création. On y entend chanter toutes les
beautés, toutes les joies, toutes les douleurs de la nature et
de la vie.
On y reconnaît, noble, souriant, familier, le visage de la
patrie.
La Belgique goûtait avec plénitude une insouciante et
brillante prospérité, quand la tempête fondit sur elle et l’en­
traîna vers les abîmes. Une nuit de quatre années, traversée
d’éclairs, s’appesantit sur la nation. Puis le ciel blanchit, une
aurore nouvelle lança ses premiers feux. C’était la paix. L’ordre
ressuscita. Mais au milieu de quels débris et de quelles anxiétés !
Il fallait tout refaire et tout recommencer. L’entreprise était
formidable. E t son achèvement aujourd’hui réalisé étonne le
monde. Mais notre peuple a d’infinies ressources d’énergie et
une sagesse foncière qui aggloméra les forces et imposa silence
aux discordes civiles.
Cependant un péril grave restait menaçant. Sans doute
réussirait-on à reconstituer les capitaux, à rajuster les machines,
à rebâtir les maisons. Mais la guerre avait tari des sources
d’idéalisme et détourné des travaux de la pensée. L’existence
devint âpre et coûteuse ; elle poussa aux métiers lucratifs,
aux gains rapides. La restauration ne serait-elle donc que
l’industrialisation, la mécanisation d’une société condamnée
aux besognes pratiques ? La victoire sur la matière serait
facile. Mais comment assurer la nourriture morale et remédier
à la misère de l’esprit ?
Aujourd’hui le mal est conjuré. D’amples donations ont
sauvé nos Universités, dont chacune a reçu vingt millions de
francs, reliquat des épargnes de la Commission de Ravitail­
lement et qui toutes bénéficient de la personnalité civile. La
73
munificence de la Fondation Rockfeller a doté l’Université
de Bruxelles d’une nouvelle Ecole de Médecine. La Biblio­
thèque de l’Université de Louvain, installée dans un édifice
monumental, a regarni de livres tous ses rayons. La Fondation
Universitaire, à laquelle s’attachent les noms de M. Hoover et
de M. Francqui, accorde des prêts d’études et des bourses de
voyage aux étudiants et des subventions aux associations et
publications scientifiques.
Une grande entreprise a surgi à l’appel du Roi. « Il faut,
dit le Souverain, le 26 Novembre 1927, que, débarrassés des
soucis matériels, les hommes de science soient en mesure de
concentrer sur la recherche tout l’effort de leur pensée. Il faut
que tout soit mis en œuvre pour susciter, encourager, soutenir
les vocations scientifiques. » En quelques mois, le Fonds Na­
tional de Recherche fut constitué au moyen de souscriptions
qui dépassèrent cent millions. Il assiste les travailleurs dans
les instituts belges et étrangers, assure des dotations aux savants
éminents, effectue des prêts d’instruments, facilite les expé­
ditions scientifiques favorise le développement des laboratoires.
Notre Académie Royale, fidèle à ses traditions historiques,
est demeurée un foyer de culture désintéressée et participe au
progrès des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts par ses
publications, ses concours et les prix qu’elle décerne. A côté
d’elle ont pris place les Académies de langue et de littérature
françaises, de langue et de littérature flamandes.
Nos musées ont été réorganisés et enrichis. Des instituts
universitaires, des écoles supérieures fortifient et spécialisent
le haut enseignement.
Un désir ardent de relèvement, un besoin de création et
d’expansion ont suscité de nombreuses initiatives, telle la
Fondation Egyptologique qui porte le nom de la Reine. Lne
association privée soutenue par l’E tat, et dont M. Henri Le
Bœuf est l’animateur, a érigé un vaste Palais des Beaux-Arts
dont notre réputé confrère M. Horta a dessiné les plans et qui
est rapidement devenu un centre d’action. De multiples phé­
nomènes de la même qualité révèlent une tendance à stimuler
l’essort des idées.
Les esprits sont plus indépendants, plus audacieux qu au­
trefois.
74
La Belgique, dont le rôle international était restreint et
comprimé, a acquis dans le monde le rang d’une grande per­
sonnalité morale. Sa vision, ses intérêts portent plus loin.
Toutes les fenêtres sont ouvertes. Dans la maison mieux aérée,
les courants intellectuels circulent librement. Le public est
curieux, avide de savoir et de sensations d’art. Tous les jours,
à Bruxelles, devenu grande capitale bruissante d’animation
et de luxe, des concerts, des conférences groupent des auditoires
empressés et attentifs. On compte plus de cinquante salles
d’exposition et combien de théâtres ! E t quel pullulement de
revues et de livres !
Il y a moins de disputes politiques et plus de discussions
d’économie sociale et de questions extérieures, plus de contro­
verses d’art et de littérature. Des formules nouvelles qui agitent
leur crinière et montrent leurs crocs soulèvent les passions. On
a vu, un soir, et c’est un trait significatif des mœurs d’aujourd’hui,
une assemblée de deux mille citoyens débattre des problèmes
d’esthétique, avec des cris de colère et des clameurs d’enthou­
siasme.
Sans doute, aucune discipline ne s’impose qui imprime au
mouvement des idées l’unité d’un système ou d’un style. Les
doctrines s’entrechoquent et toutes les valeurs d’hier sont
soumises à une impitoyable révision.
Mais du bourgeonnement, de la fermentation des âmes,
une récolte naîtra d’œuvres et de talents qui feront la parure
de la Belgique de demain.
Arrêtons-nous, en nous excusant d’avoir dû négliger cer­
tains aspects de la vie intellectuelle du pays, de n’avoir pas
rendu justice comme nous l’eussions voulu à tous ceux qui
ont collaboré à sa grandeur, ou même cité avec l’hommage
nécessaire, des noms du passé, honorés à l’étranger comme
en Belgique, tels que ceux du Général Brialmont, d’Ernest
Solvay, l’inventeur et le sociologue, et du Dr Depage.
Mais nous avons dit assez pour attester la vitalité de l’in­
telligence belge, la renaissance de l’esprit, l’éveil de forces
morales qui, faisant contrepoids aux forces matérielles, assurent
l’équilibre et la santé d’un peuple éprouvé et resté jeune, et
qui, allègre et vigoureux, poursuit sa marche vers l’avenir.
75
1914-1919
1914-1919
1
LORD GREY DE FALLODON
Discours prononcé à VAcadémie
Royale de Belgique, le 5 mai 1926.
L’histoire mêle au cours tourmenté des événements des
figures dont les proportions, la valeur, l’influence sur le monde
extérieur et sur l’évolution des faits ne peuvent se mesurer qu’à
distance. Des hommes surgissent qui dominent une période,
en qui s’expriment les aspirations d’un peuple, et dont les
gestes acquièrent un sens symbolique. Ce sont des anticipateurs
qui annoncent la vérité du lendemain, ou des fondateurs, de
puissants réalisateurs que le destin suscite pour extraire d’une
époque, d’un état social ou politique, la substance ou l’idée en
germe dans les masses. Tels Cavour qui créa l’unité italienne,
Bismarck, le rude forgeron de l’unité allemande, ou, beaucoup
plus loin, Napoléon, Cromwell ou Richelieu.
Au sortir d’une des plus effroyables crises qu’ait traversées
le monde, il est difficile de dénombrer, sans parti pris et avec
quelque chance de ne verser ni dans la prévention ni dans la
faveur, ceux qui, très rares en tout cas, entraînèrent les peuples,
leur assignèrent un idéal, précipitèrent et réglèrent l’action
des foules et la modelèrent sur un plan conçu par leur cerveau
et imposé par leur volonté.
Grey, qui vit encore et qui n’a pas atteint la vieillesse, Sir
Edward Grey, qui porte, depuis son ascension à la pairie, le
nom de vicomte Grey de Fallodon, n’apparaît pas au rang des
créateurs, des dominateurs, des grands conducteurs d’hommes
en qui se résume la synthèse d’un système ou d’un mouvement.
Mais son rôle fut en des temps difficiles et dans les épisodes
tragiques auxquels ils menèrent, considérable et parfois décisif.
Il y montra des talents et des vertus qui font ressortir sa phy­
sionomie en relief sur le décor mouvant des événements.
Il a dirigé la politique extérieure de la Grande-Bretagne
pendant les neuf années qui ont précédé la grande crise de
1914. Il a donné le coup de barre qui jeta son pays dans la
79
tourmente, au secours de la France et de la Belgique, et il a
gardé le gouvernail pendant la première phase de la lutte.
Il a souhaité et cherché pour l’heure finale de l’apaisement
et de la victoire, dont il ne douta jamais, un régime qui m ettrait
le monde à l’abri des entreprises barbares et destructrices et
qui substituerait le droit à la violence.
Dès que le péril se révéla imminent, il songea à la Belgique,
et, jusqu’à l’heure où il quitta la dunette du commandement,
il fixa le regard sur ce point de l’horizon.
On trouve en lui une image singulièrement représentative
de l’esprit le plus élevé de sa race et de son pays, le type du
politique anglais qui associe à une conception réaliste de l’in­
térêt de l’Empire la sensibilité d’une conscience éprise de
liberté et de justice.
Enfin, sous l’homme d’E tat apparaît un homme vraiment
humain, simple et droit, qui, sans faste et sans phrases, conduit
de grandes affaires publiques avec la même honnêteté que
m ettrait un gentleman à gérer loyalement d’ordinaires aftaires
privées, un cœur en qui le devoir ne tarit pas les sources d’émo­
tion et que fait frémir, à l’instant des décisions les plus graves,
le dilemme où il ne sombre pas, mais dont il sort meutri : 1 ir­
réductible effort qu’exige une juste cause, et l’angoisse des
souffrances infligées, du sang qui coule, du désordre où le monde
est impitoyablement précipité.
Lord Grey vient, il y a quelques mois, de publier ses mé­
moires, qui résument une carrière de vingt-cinq ans (!). C’est
un document historique, un témoignage et une confession. La
lecture en est attrayante et facile, car l’ouvrage n’est surchargé
ni de dates, ni de notes, ni alourdi par les citations et les détails
minutieux que le recul du temps dépouillé de tout intérêt.
Lord Grey raconte et se raconte. Le récit coule, sans se
heurter à des récifs, d’un flot continu. Lord Grey ne cherche
pas à se grandir, et non même à glorifier son pays. Il dit ce
qu’il a fait, sans en tirer vanité. Il ne se met pas en scène, mais
il s’explique et l’on sent qu’il n’a rien à cacher. Dans sa poli­
tique on ne découvre pas de calculs souterrains. Il a fait ce
qu’il devait et ce qu’il pouvait. Il sourit de l’ingéniosité des
(1) Twenty five years (1892-1916), 2 vol. Londres, Hodder and Stoughton, 1925.
80
exégètes et de la fantaisie des foules qui se plaisent à orner les
incidents les plus simples d’une parure théâtrale et à expliquer
des gestes logiques ou spontanés par des concepts mystérieux.
Un diplomate allemand, avec qui il causait librement avant
la guerre, lui attribue ce mot : « Il n’est pas très difficile de dire
la vérité. La difficulté est de faire qu’on y croie ». E t lui même
ajoute, de sa plume, ce commentaire ironique : « Le moyen le
plus sûr en diplomatie de tromper l’opinion est de lui dire la
vérité, car elle n’y croit jamais ».
Ses mémoires disent, en langage familier et sincère, sans
viser à l’effet, la vérité telle que Grey la comprit et la vit. Il
ne les a pas écrits pour défendre une thèse ou étaler son rôle ;
l’un de ses mobiles, en les composant, fut de fournir des m até­
riaux à la méditation des générations futures, dont la guerre
de 1914 hantera longtemps la conscience et l’imagination, et
de poser devant elles le problème de l’avenir. Des questions
nouvelles ont surgi depuis la fin du conflit. Peut-être nous
semblent-elles plus étranges et plus complexes, à nous, qui,
par tant d’attaches, appartenons au passé, qu’à des esprits
jeunes et frais, qui, dès leur printemps, les abordent, les cotoient, se développent dans leur atmosphère et n’y voient que
les phénomènes naturels de la vie contemporaine.
A peu près en même temps que les mémoires de Lord
Grey ont paru deux autres ouvrages où la figure de l’homme
d’E tat anglais apparaît décrite et interprétée par des personna­
lités qui ont été à maintes reprises associées à ses préoccupa­
tions et qui ont pu impartialement juger l’être, son caractère
et ses inclinations.
La Vie et les Lettres de Walter Page, ambassadeur des EtatsUnis à Londres, de 1913 à 1918, et les Papiers intimes du colonel
House, le conseiller et confident du président Wilson, que vient
de publier M. Charles Seymour, professeur à l’Université de Yale,
éclairent certains aspects de la diplomatie et font pénétrer dans
l’intimité de Grey, de ses procédés politiques et de ses états
d’âme au moment troublant et pathétique du conflit européen (1).
Entre Page et Grey, comme entre House et lui, on discerne
des affinités qui les firent se comprendre aisément et qui auraient
(1) Ces deux ouvrages n’ont pas été traduits jusqu’ici.
81
probablement eu des effets sensibles et heureux si Grey, à la fin
de la guerre, avait encore occupé le pouvoir et s’il avait été
appelé à collaborer avec le colonel House dans les délibérations
de la paix.
Sur la vie privée et les débuts de Lord Grey, ses mémoires
sont discrets.
Cet homme de mœurs unies et réservées demeure simple
dans ses écrits comme dans ses manières.
Rien dans sa jeunesse n’annonce les hautes destinées qui
l’attendent.
Il naquit le 25 mai 1862. Son père, le capitaine George
Grey, qui appartint à la maison du prince de Galles, s’était battu
en Crimée, dans l’armée britannique, côte à côte avec les Fran­
çais. A l’âge de quatorze ans Edward Grey le perdit, et sa pre­
mière éducation se poursuivit sous la direction de son aïeul,
qui avait joué un rôle actif dans la politique libérale et avait
occupé des fonctions ministérielles dans les gouvernements de
Lord Melbourne, de Russel et de Palmerston. Ainsi s’implantent
dans ce jeune cerveau, sans qu’il en sente la pénétration, les
tendances qui guideront sa vie. Ce n’est guère qu’a vingt-deux
ans, d’après son propre aveu, que s’éveille en lui la curiosité des
choses de l’esprit et de la politique.
Jusque-là il s’adonne aux joies de la vie à la campagne, à
Fallodon, dans le parc riant et touffu qui enveloppe la maison
des ancêtres.
Les bois, l’eau courante, les animaux qu’abrite la futaie, les
oiseaux qui l’animent de leur vol et de leurs chants sont les
témoins et les amis de ses premières années. Il ne les oubliera
jamais. Le parfum des arbres et des prairies pendant son long
servage ministériel le hante à Londres dans son cabinet et sa
maison de ville. Et c’est dans le cadre familier de son enfance
que s’écoule maintenant sa retraite paisible et studieuse.
Habile aux sports, comme tout jeune Anglais bien né, il fut
proclamé vainqueur d’une joute de tennis dans l’année qui suivit
son avènement à la direction du Foreign Office, et c est de la
pêche à la ligne que traite le seul livre qu’il publia, avant d’avoir
rédigé ses mémoires.
L’un des chagrins dont il se souvient fut de devoir se
priver d’aller saluer, un dimanche de printemps, le reverdisse­
82
ment des hêtres, parce qu’il attendait la réponse tardive du
Sultan à un ultim atum du Gouvernement britannique. E t rien
n’est plus charmant que le récit d’une visite que lui fit en
mai 1910 le président Roosevelt, récemment descendu du pou­
voir et qui, revenant d’un tour européen, passait par l’Angle­
terre.
Le robuste homme d’E tat américain aimait, comme Grey, les
oiseaux et se plaisait à étudier leurs mœurs et leurs vocalises.
Ils passèrent ensemble une après-midi dans les bois, écoutant les
oiseaux chanteurs et distinguant leur langage. Ils réussirent,
parait-il, à discerner plus de cinquante thèmes qui se croisaient
et s’entrelaçaient dans la symphonie dont l’immense orchestre
ailé îaisait retentir le dôme de la forêt.
Ces traits marquent la physionomie et dénotent les penchants
intimes. On les découvre dès l’enfance, on les retrouve à l’âge
des grandeurs.
Quand la vie intellectuelle de Grey, qui fit ses études au col­
lège de Winchester, puis à Oxford, s’ouvrit vers 1884, elle
s’épanouit avec intensité. Il lit tout, littérature, politique, éco­
nomie, prose et vers. Les affaires publiques l’attirent. Un inci­
dent décide de son avenir.
Les libéraux de son district organisent une réunion de protes­
tation contre le rejet par la Chambre des Lords d’un projet de
loi qui élargit l’électorat. Ils lui demandent de la présider. Son
nom, la popularité dont sa famille jouit dans la contrée le
désignent. Il accepte. E t le voici officiellement libéral, comme
l’avaient été son grand-père et tous les siens. L’année suivante
il est élu membre de la Chambre des Communes. Il a vingt-trois
ans. L’atavisme, les traditions, plus qu’un choix volontaire et
réfléchi, déterminent le plus souvent l’orientation politique et le
classement des opinions. Le raisonnement intervient plus tard
et consacre généralement le mouvement presque inconscient de
l’âme où se reflètent la race et le passé. Grey se sent, se recon­
naît vraiment libéral quand Gladstone, en 1886, donne pour
programme au libéralisme le Home Rule, l’autonomie de
l’Irlande. Une scission coupe le vieux parti whig en deux
fractions.
Le prestige de l’illustre chef libéral, que le jeune député
s’enorgueillisait, étant enfant, d’avoir vu converser amicalement
83
avec son grand-père, la critique émouvante par John Morley du
système de la coercition en Irlande, le portent vers la gauche,
où il se fixe.
En 1892 les libéraux triomphent. Gladstone reprend le pou­
voir et donne les affaires étrangères à lord Roseberry, qui
s’attache Grey en qualité de sous-secrétaire parlementaire.
Comment cette désignation pour une charge importante et
lourde s’explique-t-elle? Grey n’avait, durant six années de
m andat législatif, prononcé qu’un discours, qu’il mentionne avec
modestie. Mais les vétérans affectionnent parfois les débutants
modestes qui savent attendre. Grey appartenait à la caste où
l’Angleterre était accoutumée de recruter son personnel poli­
tique. Son visage, ses façons, son langage dégageaient une
impression de sincérité et de dévouement, annonçaient l’homme
de caractère et de réflexion, en un mot l’honnête homme. On ne
voyait rien en lui de l’arriviste, de l’intrigant, du faiseur, que
l’Anglais a en horreur. Il s’exprimait sobrement, avec précision
et fermeté.
Le choix était hardi. Grey ne savait rien du métier auquel on
le destinait. Sa fonction, dont il n’existe pas d’équivalence en
Belgique ou en France, était de donner à la Chambre des Com­
munes toutes informations demandées sur les affaires étrangères,
d’exposer et de défendre la politique extérieure du gouverne­
ment, devant une assemblée attentive au contrôle et où l’oppo­
sition groupait des critiques habiles et redoutables. Mais la
spécialisation n’est pas une condition d’aptitude à l’office gou­
vernemental. Dans le régime parlementaire, observe justem ent
Lord Grey, la direction ne revient pas aux experts, aux techni­
ciens, mais aux hommes doués d’une capacité générale, qui ont
le sens des intérêts du pays : leur mission est de consulter les
experts et de statuer, après les avoir entendus. Le jeune secré­
taire parlementaire s’initia rapidement à ses devoirs et les
remplit pendant trois ans avec tact et sûreté.
Le Cabinet libéral tomba en 1895 et le régime unioniste qui
lui succéda dura dix années. Grey s’effaça pendant cette longue
période. Il suivit de loin les événements et parla rarement. Ce
fut, avoue-t-il, un temps d’heureux détachement. Il le passa
dans son domaine, alla peu à Londres, et consacra une part de
ses travaux à l’administration d’une importante compagnie de
84
chemins de fer. Mais l’instinct politique se raviva en lui lorsque
Chamberlain lança le mouvement protectionniste. Il reprit alors
contact avec son parti et s’associa à la grande campagne d’opinion
que les libéraux organisèrent pour défendre le Free Trade, le
libre-échange.
Lorsqu’en décembre 1905 les Unionistes vaincus quittèrent
le Gouvernement, Grey était de l’état-major du libéralisme
victorieux, aux côtés d’Asquith, de Haldane, de Morley. Le
chef du Cabinet nouveau, Campbell Bannerman, lui conféra
la gestion du Foreign Office. Il resta secrétaire d’E tat jusqu’à
ce qu’en 1916, en pleine guerre, M. Lloyd George brisa le
ministère de coalition nationale que dirigeait M. Asquith, pour
se rendre maître du pouvoir.
Quand Grey prit la direction des Affaires étrangères, il les
trouva dans un état très dissemblable de celui où il les avait
laissées à son départ dix ans auparavant. L’axe de la politique
britannique s’était déplacé.
De 1892 à 1895, le Cabinet libéral avait suivi la ligne tracée
par Lord Salisbury. C’était l’amitié pour la triple Alliance, sans
engagement d’ailleurs, ni promesse, au point qu’un jour un
membre du cabinet précédent avait défini la position de l’Angle­
terre par le mot fameux de «splendide isolement». Il n’était
pas alors question d’équilibre ou de «balance du pouvoir». L’An­
gleterre ne cherchait pas à opposer au bloc de la Triplice un
bloc qui lui ferait contrepoids. Elle se rangeait du côté de ceux
avec qui il semblait qu’elle dût avoir la moindre possibilité de
conflit. Elle avait besoin de l’appui de l’Allemagne en Egypte.
Elle appréhendait des difficultés avec la France en Afrique et
avec la Russie en Orient. Elle se conformait à ses intérêts
immédiats et à son désir de paix, sans élaborer de plans pour
de futures et incertaines éventualités. C’était, dit Grey, le trait
caractéristique de la politique pratiquée jusque-là par la plupart
des ministres des Affaires étrangères. «Leurs meilleures qualités
étaient négatives ». Ainsi échappe-t-on le plus sûrement,
observe-t-il, aux déceptions qu’entraine l’erreur ou la chute d’un
grand bâtisseur de combinaisons qui entreprend de construire
l’avenir.
Cependant l’isolement n’avait ni vraie splendeur ni même
85
une forte réalité. Car l’Allemagne, dans les affaires de Turquie,
blessa l’amour-propre et les intérêts britanniques. De brusques
contacts avec la France amenèrent des frictions irritantes. E t
pendant les dix années que Grey passa, presque silencieux,
dans l’opposition, des événements s’accomplirent qui changèrent
la physionomie de l’Europe.
L’Angleterre, d’abord, sous l’impulsion de Chamberlain, le
père de l’actuel Secrétaire d’E tat, esquisse une tentative de
rapprochement vers l’Allemagne. La prise de possession de
Port-Arthur par la Russie, l’incident de Fashoda, où le vaillant
capitaine Marchand s’était rencontré face à face avec les officiers
de Kitchener, ont creusé dans l’opinion des sillons où poussent
les ressentiments et les inquiétudes. En 1899, Chamberlain,
dans un discours retentissant, préconise un accord entre l’Em ­
pire teutonique et les deux nations de race anglo-saxonne. Ce
fut un moment critique et redoutable. L’Allemagne demeura
inattentive et laissa passer l’occasion. Elle ne devait plus se
représenter.
Puis éclate la guerre du Transvaal, et l’on soupçonne que le
président Kruger a reçu des encouragements de Berlin.
Enfin l’Allemagne, en 1900, adopte une politique navale qui
menace de bouleverser l’équilibre des forces maritimes.
Pour se protéger contre la Russie, dont elle craint les enva­
hissements en Asie, l’Angleterre conclut une alliance avec le
Japon ; en Europe, elle se porte du côté de la France. Elle par­
vient à échapper au danger de se trouver entrainée dans la
guerre russo-japonaise qui éclate en 1903, et, en 1904, Lord
Lansdowne et M. Delcassé, entre qui M. Paul Cambon sert
de trait d’union, règlent, par un accord équitable et amical, les
deux questions qui envenimaient les relations de leurs pays : la
position de l’Angleterre en Egypte et de la France au Maroc,
et se prom ettent réciproquement un appui diplomatique. Ils
posent les bases de l’Entente cordiale. Je ne sais, dit Grey, s’ils
avaient dès lors prévu les développements qu’elle prendrait dans
l’avenir, et si quelque conception à lointaine portée avait inspiré
cet arrangement pratique dans un domaine nettement cirsonscrit. Quant à lui-même, explique-t-il, sans regarder si
avant ou si profondément, il se contenta d’éprouver la vive
satisfaction de voir s’effacer la perspective d’énervantes dis-
86
eussions avec le gouvernement français et disparaître les diffi­
cultés de la question d’Egypte et de la question marocaine, sans
que d’ailleurs cet apaisement pût empêcher l’Angleterre d’en­
tretenir avec l’Allemagne des relations amicales (1).
Mais ce contentement optimiste fut bientôt ébranlé par
une alerte, la première des secousses qui annoncent à près de
dix ans de distance la grande commotion de 1914. L’empereur
Guillaume débarque à Tanger. Sa visite tapageuse est une
démonstration. Il entend que l’Allemagne ait sa part dans
l’examen des réformes marocaines. La France accepte la con­
vocation d’une conférence internationale qui se réunira à
Algésiras, et M. Delcassé, qui avait négocié l’arrangement avec
l’Angleterre, est contraint de se retirer. L’Allemagne étale
lourdement sa vanité et ses appétits. Elle croit avoir, de ce
rude coup, brisé l’entente franco-anglaise.
C’est dans ces conjonctures difficiles que Grey, en décembre
1905, prend les rênes de la politique extérieure.
Où les événements vont en neuf ans le conduire, il ne
peut alors s’en douter. C’est un homme de conciliation et de
paix, un Anglais de son île, hostile aux entraînements mili­
taristes, jaloux de conserver à son pays sa liberté de mouve­
ment, peu disposé à l’engager dans d’étroites alliances conti­
nentales. Mais il a la fierté de la parole donnée et ne la donne
que s’il se sent capable de la tenir. Il a un sens élevé de l’hon­
neur personnel et de l’honneur de l’Empire. Il s’efforcera sans
relâche d’éviter la guerre, en gardant ses amitiés. Les événe­
ments seront les plus forts, et la course à la guerre commence,
lentement d’abord, puis plus vite et par bonds répétés.
La conférence d’Algésiras, après avoir suscité de vives
inquiétudes, se termina par un accord satisfaisant. E t l’année
suivante l’Angleterre mit fin aux ennuis et aux préoccupations
que lui donnait l’action russe en Perse et sur les frontières du
Thibet et de l’Afghanistan, par un arrangement du 31 août 1907,
qui établit avec la Russie des relations de confiance et de
cordialité.
C’est un nouveau contrefort de la paix.
Mais l’atmosphère européenne va très vite se brouiller et
(1) Grey prit la parole aux Communes, dans la discussion de l’arraniement avec la France
(T. II, appendice).
87
L affaire d Agadir remit en lumière, cinq ans plus tard,
1 opportunité d’une entente plus étroite. Les conversations
militaires^ se firent plus actives, embrassèrent un champ plus
vaste. L opinion en Angleterre, dont les mouvements sont
massifs et puissants, était en éveil, et M. Lloyd George, dont
la sensibilité excelle à deviner ses impulsions, prit l’initiative
de donner à l’Allemagne un avertissement sonore. Après avoir
rapidement prévenu Sir Edward Grey, qui ne le retint pas, il
alla dans la Cité prononcer un discours enflammé dans lequel
il proclama que la Grande-Bretagne ne tolérerait aucune atteinte
a 1 honneur et à l’intérêt de la nation et que la paix était à
ce prix. L’effet fut immense dans le pays et au dehors. E t ces
quelques phrases de tribun firent plus que beaucoup de
dépêches diplomatiques pour conjurer la guerre.
Les circonstances devenaient propices au renouvellement
des propositions que la France avaient formulées en 1906.
En novembre 1912, Sir Edward Grey et M. Paul Cambon
éc angèrent des lettres dans lesquelles les deux Gouvernements
se promirent que, dans le cas d’un danger d’agression non
provoquée ou d’événements qui troubleraient la paix générale,
ils examineraient la question d’une action commune et les
mesures à prendre de concert. Le cas échéant, les plans établis
par les etats-majors seraient mis en vigueur.
Ce n était pas une alliance, «une obligation ferme d’assis­
tance réciproque », comme le dit M. Poincaré, mais une garantie
d amitié qui procura à la France « plus d’aisance et d’auto­
rité » Q.
En dehors des raisons politiques supérieures qui l’inspi­
rèrent, les rapports personnels, la sympathie confiante qui
s’étaient créés entre le Ministre anglais et l’Ambassadeur de
France contribuèrent beaucoup à cet heureux accord.
Les deux hommes différaient par la stature et la physio­
nomie. L’Anglais, grand, aux larges épaules, au masque imberbe,
au profil de médaille, avec des yeux clairs et profonds, un men­
ton de ferme contour, une bouche sinueuse, dont le pli tra­
hissait une secrète sensibilité, et dans toute sa personne quelque
chose de sérieux et d’ouvert qui commandait le respect et la
(1) Les Origines de la Guerre, pp, 80 et 81.
89
des décharges électriques font prévoir l’orage qui se prépare.
En 1908, une étincelle jaillit à Casablanca. Presque en même
temps un foyer s’allume dans les Balkans. Après la révolution
à Constantinople et l’avènement des Jeunes-Turcs, l’Autriche,
sans se soucier du traité de Berlin, annexe la Bosnie et l’Herzégovine et occupe militairement Novi-Bazar. La Serbie frémit
et la Russie laisse faire, impuissante, mais se sent atteinte au
cœur. Enfin, en 1911, l’arrivée du Panther à Agadir fait tres­
saillir les chancelleries. Après de longs efforts diplomatiques,
la France et l’Allemagne arrêtent les termes d’une transaction.
La tempête passe, mais la houle continue. E t le ciel reste lourd
de fumées.
Au cours de ces crises successives, le danger resserra les
liens assez détendus qu’avaient noués entre l’Angleterre et la
France les conversations de 1904. A la Conférence d’Algésiras,
l’appui diplomatique promis à la France fut loyal et ferme.
Mais la France inquiète tenta d’obtenir davantage, et M. Paul
Cambon demanda à Sir Edward Grey si, dans l’éventualité
d’une agression allemande, la Grande Bretagne serait disposée
à prêter à son pays une assistance militaire. Sir Edward Grey
estima ne pouvoir s’engager aussi loin. Il croyait que si la
France était attaquée par l’Allemagne, l’opinion publique
anglaise se prononcerait énergiquement en faveur de la pre­
mière de ces puissances. Il ne négligea pas de le faire savoir à
Berlin et de laisser comprendre qu’il serait difficile au Gouver­
nement britannique de garder la neutralité (*).
Quant à lui-même, son instinct plus encore que sa raison
lui soufflait que le devoir de l’Angleterre serait d’aller au se­
cours de la France. Mais il ne voulait pas se lier d’avance par
des engagements absolus. Car tout dépendrait des circonstances
et des causes de la rupture, et jamais le Cabinet ni le Parlement
ne ratifieraient des promesses prématurées (2).
Mais les entretiens et la correspondance de 1906 eurent
un résultat positif. On autorisa officiellement les conversations
qui s’étaient engagées de fait depuis un an entre les autorités
navales et militaires des deux pays, sans d’ailleurs que ce contact
pût impliquer aucune obligation politique de part ni d’autre.
(1) Lettre du 9 janvier 1906 à Sir Henry Campbell Bannerman.
(2) G r e y , t. I, p. 77.
88
u
II' '
i
confiance. Le Français, de taille menue, au fin visage couronné
de cheveux blancs, barbe en pointe et moustache argentée,
au regard pénétrant, qu’égayait parfois un éclair de malice.
Il avait la voix douce et contenue, un débit lent, précis et
nuancé, dont une main nerveuse et distinguée scandait le
rythme.
Ils s’entendaient fort bien, quoique dans leurs colloques
chacun employât la langue de son pays. M. Paul Cambon
comprenait l’anglais, mais préférait ne s’en point servir. Lord
Grey comprend parfaitement le français, mais le prononce
avec quelque difficulté. Il fut un jour contraint dans un conseil
interallié, pendant la guerre, de s’expliquer devant les ministres
français, dont aucun ne savait l’anglais, tandis que M. Asquith
et M. Lloyd George, de leur côté, se trouvaient incapables de
s’exprimer en langue française. Lord Grey s’en tira heureuse­
ment et non sans peine. Après la séance, M. Lloyd George, en
manière de compliment, lui dit : « Votre français est le seul
que j ’aie compris ». Mais depuis, dans les nombreuses confé­
rences internationales qui ont suivi la guerre, M. Lloyd George
a sans doute fait des progrès.
Lord Grey, dans ses mémoires, rend un touchant témoignage
au loyal et sûr caractère de M. Paul Cambon. Nous n’étions
pas, dit-il, intimement liés, mais nous avions l’un en l’autre
une foi absolue. Leurs entretiens avaient plutôt un tour diplo­
matique et officiel. Une seule fois un mot, jailli du cœur, brisa
leur enveloppe conventionnelle et domina. C’était lors de la
retraite des Alliés, au début de la campagne, avant la bataille
de la Marne. Paris était en danger. E t Sir Edward cherchait à
trouver des raisons d’espoir et d’encouragement. Il disait ce
qu’il pouvait. Cambon l’écoutait silencieux, et tout à coup, se
redressant dans son fauteuil et tout vibrant, il dit : « Il y a
aussi la Justice ». Il n’y eut rien de théâtral dans le ton ni le
geste, mais le mot fut prononcé avec un tel accent d’indignation
et de foi que, rapporte Grey, il donna tout à coup l’impression
d’une puissance plus haute et plus forte que celle des armées.
A cet hommage du ministre anglais, un hommage belge
doit être associé. Pendant que j ’occupai le poste de ministre
de Belgique à Londres, que de fois n’eus-je le privilège de
consulter le doyen éminent de la diplomatie française, d’écouter
90
ses avis clairvoyants, de m’instruire à l’audition de ses sou­
venirs, qu il contait avec autant d’esprit que de grâce et qui
etaient riches d’expérience et de sagacité ! Il admirait la Bel­
gique, le rôle qu elle avait assumé dans la guerre et croyait en
son avenir. « Il faudra, nous dit-il un jour, que la Belgique
devienne un grand pays ».
&^
Dans les conversations militaires anglo-françaises de 1912,
iî “ Utra^
fut 1,une des préoccupations des états-majors!
JJeja en 1906,^ au moment où approchait la réunion de la eonerence d Algésiras, Grey avait signalé au Premier Ministre la
nécessité pour le War Office d’examiner ce qu’il conviendrait
dei are pour la protéger dans l’hypothèse d’un conflit avec
I Allemagne.
Après Agadir on envisagea la coopération des forces britan­
niques en vue de s’opposer au passage éventuel des troupes
allemandes à travers le territoire belge (*). Ces études ame­
nèrent les attachés militaires anglais à Bruxelles à s’entretenir
avec les chefs de l’état-major belge des mesures techniques
qu il conviendrait de mettre en œuvre en cas d’atteinte à
notre neutralité. Ces échanges de vues, auxquels notre Gou­
vernement resta d’ailleurs étranger et qu’expliquaient les
préparatifs de l’Allemagne et la crainte d’une brusque offensive,
eurent lieu d’abord entre le lieutenant-colonel Barnardiston et
le général Ducarne, puis en 1912 entre le lieutenant-colonel
Bridges et le général Jungbluth. Ils furent travestis pendant
la guerre par le gouvernement allemand, qui s’efforça d’y
montrer la preuve d’un complot dirigé contre l’Allemagne et
de la violation par la Belgique de ses devoirs de neutre.
Le baron Beyens, alors Ministre des affaires étrangères,
ht justice par une note de mars 1917 de cette audacieuse manœu­
vre, dont l’histoire ne retiendra rien. E t M. Poincaré, dans
son livre si solidement construit et documenté : Le Lendemain
d Agadir, a donné sur ces incidents des détails intéressants et
précis qui m ettent fin à une légende créée pour les besoins de
la propagande germanique (2).
Agadir laissa l’Europe émue et anxieuse. Grey respirait
partout un air de suspicion et d’insécurité. La politique alle(1) G r ey , t. I, pp. 118 et 95 (note).
(2) Pages 223 et suiv.
91
mande procédait par jets et par surprises et cherchait par
des coups de boutoir à ébranler l’accord franco-anglais.
Grey, fidèle à ses accords avec la France, ne les tenait
pas cependant comme en contradiction avec une attitude
cordiale à l’égard de l’Empire central. Ainsi espérait-il par
un sage équilibre et des amitiés parallèles préserver la paix.
Des elforts furent tentés pour dissiper les inquiétudes que
suscitait en Angleterre le programme d’accroissement continu
de la flotte allemande. Il y eut des visites de souverains ; un
grand financier, Sir Ernest Cassel, qui avait des accointances
dans le monde berlinois, fut chargé de se mettre en contact
avec les hautes personnalités de l’Empire. Un membre du
cabinet, Lord Haldane, alla en mission officieuse causer avec
le gouvernement allemand. Le but était de convenir d’un
arrêt, d’une suspension dans la construction des navires de
guerre, ce que l’on appela une vacance ou une trêve navale.
On échoua. Berlin demanda que l’Angleterre s’engageât à
rester neutre dans une guerre continentale contre l’Allemagne.
Grey ne voulut pas réduire la pleine liberté d’action du Gou­
vernement britannique ni, d’autre part, risquer de briser ses
liens avec la France et la Russie (*).
E t la course aux armements continua, s’intensifia, se préci­
pita sur mer et sur terre, jusqu’à la collision finale.
Le prologue de la tragédie de 1914 se termina par un
épisode mouvementé. C’est la guerre balkanique de 1912.
Cependant, une fois encore, le péril d’un embrasement général
fut écarté. Une conférence diplomatique, dont le siège tut
fixé à Londres, parvint, après de longues délibérations qui se
prolongèrent jusqu’en l’été de 1913, à régler les conditions
d’un arrangement. Sir Edward Grey la présida. Il y dépensa
beaucoup de patience et de fermeté ; les ambassadeurs qui
l’entouraient et connaissaient son tour d’esprit équitable et
généreux l’aidèrent sincèrement et utilement ; M. Paul Cambon,
d’abord ; l’Autrichien, comte Mensdorff, grand seigneur allié
à la famille royale d’Angleterre et qui, aujourd’hui, représente
la République d’Autriche à la Société des Nations, avec une
discrète dignité ; le Russe, comte de Benckendorff, et l’Allemand,
(1) Voir The World Crisis, «La Crise mondiale», de M. W in s to n C h u r c h ill, édition ang­
laise, t. I, pp. 94 et suiv. — Voir aussi G re y , t. I, pp. 249 et suiv.
92
prince Lichnowsky, lui-même ardent ennemi de la guerre,
et dont le Gouvernement, à ce moment, était décidé à ne pas
rompre la paix.
La Conférence de Londres donna de si efficaces résultats
et créa une si bienfaisante atmosphère que Grey, comme
M. Poincaré, exprime l’amer regret qu’elle n’ait pu s’instituer
permanente, se prolonger ou renaître en 1914. C’était une
petite Société des Grandes Nations. Pendant les huit jours
qui suivirent l’ultimatum à la Serbie, peut-être aurait-elle
sauvé le monde.
Quand la Conférence se sépara, il sembla que l’on voguait
sur une mer aplanie. On leva les ancres. Mais des courants
mystérieux remuaient les eaux et entraînaient le navire dans
les cataractes de la guerre.
Bien que vers la fin de l’automne, l’empereur Guillaume
eût donné un sinistre avertissement au Roi des Belges, l’année
1914 s’ouvrit sous un ciel calme. E t les premiers mois furent
une période de détente. Au printemps, les Souverains anglais
firent à Paris une visite de grand apparat. Grey les accompagna.
Il ne perçut en France aucun symptôme de dispositions
belliqueuses ; en Russie, nul signe inquiétant ne se découvrait.
Sur la demande de M. Poincaré, il autorisa des conversations
navales entre les autorités anglaises et russes, d’après le modèle
des conversations militaires avec l’état-major français, con­
venues en mars 1912. Mais il ne fit aucune promesse et conserva
son entière indépendance politique. Deux ans auparavant, il
avait expliqué à M. Sazonolf, sans réticences, les intentions de
l’Angleterre. Elle ne favoriserait aucune guerre de revanche.
Elle chercherait à apaiser toute contestation entre la France et
l’Allemagne. Mais si l’Empire allemand tentait d’écraser la
France, il serait difficile d’imaginer qu’elle pût assister les
bras croisés à cette entreprise de destruction (1).
Dans l’ensemble, au début de l’été de 1914, la situation
paraissait favorable. L’horizon s’éclairait. Grey communiqua ses
impressions optimistes au prince Lichnowsky, lui affirma la
volonté pacifique de l’Angleterre et lui décrivit l’état rassurant
des esprits en France et en Russie (2).
(1) G r e y , t. I, p. 298.
(2) Lettre de Sir Edward Grey à Sir E. Goschen. (G re y , t. I, p. 303.)
93
C’était le 24 juin.
Le 28, l’archiduc François-Ferdinand tombait à Sarajevo
sous les balles d’un assassin.
Le 23 juillet, l’ultimatum autrichien est signifié à la Serbie.
Un grand frisson traverse l’Europe.
Où va le monde ? E t que fera Grey ?
Comment pense-t-il et sent-il pendant la semaine qui pré­
cède l’explosion ? Il va nous le dire, afin que nous comprenions
ses actes. E t le récit est émouvant. Car un drame intérieur se joue
dans cette âme très haute et pure et profondément imbue de ses
responsabilités, tandis que se prépare le drame européen.
Une angoisse l’étreint. Si la guerre éclate, le devoir serait
de soutenir la France. Mais est-ce que le Cabinet, le Parlement,
l’opinion le comprendraient ? E t Grey envisage sa démission.
Mais qu’est-ce qu’une démission de ministre au seuil d’une
catastrophe ?
Puis un scrupule s’éveille. Il ne peut prendre aucun en­
gagement qu’il ne soit certain de tenir et de faire tenir par
son pays. Car il faut éviter que la France et la Russie se laissent
entraîner dans la guerre par l’espoir de l’appui britannique et
que, celui-ci faisant défaut, elles n’aillent à un désastre !
Donc il faut, sans perdre un instant, tout imaginer, tout
essayer pour empêcher la guerre. E t comme l’Autriche dépend
de l’Allemagne, c’est à l’Allemagne qu’il faudra parler, elle
qu’il faudra convaincre, sur elle qu’il faudra peser.
La première idée qui s’imposa à l’esprit de Sir Edward Grey
fut de provoquer des explications entre les gouvernements inté­
ressés et les puissances étrangères au conflit, et de centraliser
les conversations dans une conférence en laquelle revivrait la con­
férence balkanique. Déjà des entretiens qu’il avait eus avec le
colonel House avaient fait surgir la conception d’une coopéra­
tion internationale. Le discret messager du président Wilson,
dont le règne venait de commencer, était venu en Europe dans
l’été de 1913, avait rencontré Grey et s’était immédiatement
senti attiré vers cette nature d’élite qu’il décrit ainsi: «un homme
d’E tat mêlé d’un philosophe, insouciant des honneurs conventionels, dépourvu du sens apparent de sa position personnelle, con­
duit par le sentiment du devoir et n’en tirant aucune vanité » (1).
(1) Papiers intimes, t. I, p. 200.
94
House était hanté déjà par de vagnes projets d’entente inter­
nationale en vue de réduire les armements et de rapprocher les
puissances rivales de la vieille Europe ; il avait trouvé en Grey
un écho sympathique.
Les propositions de conférence cependant se heurtèrent à
l’indifférence et au parti pris. La chancellerie allemande feignait
d’avoir ignoré l’initiative autrichienne et même de critiquer les
termes de l’ultimatum. Grey soupçonna bientôt que l’Allemagne
obéissait à d’autres forces qu’à celles de son gouvernement
politique, que le chancelier n’était pas maitre de la situation,
que l’Empereur n’était qu’un personnage d’apparat, avide de
bruit et de gloriole et qu’une occulte puissance militariste pous­
sait à la guerre.
Le colonel House l’avait averti quelques semaines aupara­
vant. Il avait fait une rapide enquête à Berlin et à Paris ; il avait
vu Guillaume II, Tirpitz, Falkenhayn, Zimmerman. Il était
revenu profondément alarmé et en avait fait part au président
Wilson et à Sir Edward Grey ; en France, pas d’esprit de guerre
ou de revanche ; en Allemagne, une formidable machine militaire
sous pression, une énorme accumulation de fluide électrique qui
pouvait éclater d’un instant à l’autre.
Grey cherche à gagner du temps, à retenir les forces en mou­
vement. D’un côté, il fait observer que l’Angleterre, n’ayant pas
d’intérêts directs dans le conflit qui s’engage, garde les mains
libres, et, de l’autre, il avertit qu’on se ferait illusion en croyant
qu’en toute hypothèse elle s’abstiendrait d’intervenir (‘).
Mais il se sent impuissant à arrêter les courants qui vont se
heurter. Les hommes de Berlin, avec qui il négocie, ne sont
que des fonctionnaires sans autorité. Derrière eux se dissimulent
les chefs d’armée, qui commandent.
La guerre paraît inévitable. Il faut se décider, arrêter un plan
d’action, le temps presse. Grey vit des jours fiévreux. Il sent la
pointe aiguë des responsabilités, tandis qu’il vaque à un labeur
épuisant : la lecture des dépêches et les réponses, les délibéra­
tions ministérielles, les entretiens avec les ambassadeurs, du
matin jusqu’avant dans la nuit. Il paraît dix ans plus vieux, dit
Page, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, qui dîne avec lui
(1) Lettres à Sir F. Bertie et à Sir E. Goschen, 29 juillet (Livre bleu, n03 87 et 89).
95
chez Lord Glenconner, et le décrit sombre, silencieux, laissant
échapper une parole banale et retom bant dans la mutité.
Comment le problème se précise-t-il dans la conscience de
Grey ?
Il
y a la France d’abord, l’amitié, les ententes de 1904 et de
1912 ; l’arrangement en vertu duquel la flotte française occupe
les eaux de la Méditerranée, tandis que les escadres britanniques
veillent dans l’Atlantique et la Manche ! Ah ! sans doute, aucun
engagement n’a été conclu, et si la France est précipitée dans la
guerre, c’est que son alliance avec la Russie l’y entraîne. Sans
doute l’Angleterre a les mains libres. Mais que conseillent
l’honneur et l’intérêt ? Peut-on laisser devant soi succomber la
France ?
C’est une autocratie militaire qui veut la guerre et ambitionne
de dominer l’Europe. Que deviendront la liberté et la démo­
cratie sous la suprématie d’un militarisme insolent et brutal?
C’est le sort des grandes civilisations libérales qui va se jouer.
E t puis qu’adviendrait-il de la Belgique ? L’indépendance de
ce petit pays est une des bases historiques de la politique
anglaise. Elle est nécessaire à la Grande-Bretagne. E t la
Grande-Bretagne s’est liée vis-à-vis de la Belgique par un
traité solennel qui l’oblige à protéger sa neutralité. E t si la
Grande-Bretagne abandonne la Belgique, quelle figure fera-t-elle
dans le monde? Quelle confiance inspirera-t-elle désormais? E t
après la Belgique, la Hollande et le Danemark peut-être seront
dévorés à leur tour !
Voilà des raisons puissantes d’agir, de se jeter en avant
contre l’agresseur, de dire les mots définitifs qui annonceront le
geste imminent.
Mais un ministre, un homme peut-il les prononcer de sa
propre inspiration, s’il n’est pas certain que sa parole sera rati­
fiée par ceux avec lesquels il partage la charge du gouverne­
ment, et par le Parlement et la Nation ? Car, s’il est désavoué,
il aura donné à ses amis du dehors de fausses espérances qui
peuvent les mener à une catastrophe, et, au dedans, il provo­
quera une crise politique qui laissera le pays sans gouverne­
ment et désamparé dans les conjonctures les plus graves.
Or, Grey sait le cabinet indécis, et même divisé. A ses affir­
mations sur ce point s’ajoutent les témoignages de M. Winston
96
Churchill, son collègue, et de l’ambassadeur Page. Les radicaux
sont en principe hostiles à toute immixtion dans une guerre
continentale. Churchill rapporte que les trois quarts des mem­
bres du cabinet étaient adversaires de l’intervention. Lui-même,
comme M. Asquith et comme Grey, tenait pour un péril direct
l’écrasement de la France. E t cette vision l’obsédait. Il pensait
moins au début à la Belgique. Il la connaissait peu ; il croyait
que peut-être elle laisserait faire et passer, après une protesta­
tion et un simulacre de résistance. Quelques jours plus tard
il s’accrocha à la cause belge, et ses actes, pendant la guerre,
attestèrent la fidélité et la sincérité de son attachement (1).
Le cabinet était en somme l’image de l’opinion. Les puri­
tains, les dissidents parmi lesquels le parti libéral anglais a tou­
jours recruté le plus grand nombre de ses adhérents, étaient
pacifistes par doctrine. E t les centres industriels désiraient le
maintien d’une paix féconde en profits.
La minorité conservatrice de la Chambre penchait cependant
pour une politique d’intervention. M. Bonar Law, dans la
dernière semaine de juillet, le fit entendre à Sir Edward Grey,
mais il ne put lui assurer que son groupe serait unanime ou se
prononcerait à une très forte majorité, à moins toutefois que la
Belgique ne fût envahie. Presque en même temps un député
libéral était venu déclarer au Foreign Office qu’il serait absurde
de faire la guerre. A quoi l’on répondit : Même si l’Allemagne
violait la neutralité de la Belgique ? Il réfléchit un instant et
riposta avec assurance : Elle ne le fera pas!
Ainsi la question belge montait au premier plan. Grey se mit
à l’étudier, consulta les dossiers, retrouva les précédents. Il y
avait le traité de 1870 que l’Angleterre avait fait signer par
l’Allemagne, par la France et qui confirmait les traités de 1839 ;
il avait préservé la Belgique de la guerre déchainée sur ses fron­
tières.
Il y avait un discours de Lord Derby, prononcé en 1867 à
propos de la question du Grand-Duché de Luxembourg et qui
marquait le caractère individuel de la garantie donnée à la neutra­
lité, à l’intégrité et à l’indépendance de la Belgique. Il y avait un
discours de Gladstone et un discours de Lord Granville, qui, le
(1) The World Crisis, t. I, p. 202.
97
8 avril 1870, avait déclaré que, l’indifférence à l’égard du
maintien de la neutralité belge dût-elle être considérée comme
avantageuse ou commode, l’honneur et l’intérêt de la nation
ne perm ettraient pas que la Grande-Bretagne adoptât semblable
attitude.
L’opinion de Sir Edward Grey était désormais fixée. Une dé­
marche de l’Allemagne activa ses résolutions.
Le 30 juillet une dépêche lui parvint, annonçant que l’Alle­
magne prom ettait, si la Grande-Bretagne demeurait neutre, de
n’infliger à la France, en cas de victoire, aucune ampution
territoriale et de ne point toucher aux Pays-Bas. Quant à la
Belgique, l’action des armées allemandes dépendrait de celle des
armées françaises, mais après la guerre l’intégrité du pays serait
maintenue s’il ne prenait pas parti contre l’Allemagne.
Ce marchandage impudent indigna l’homme d’E tat anglais.
Je lus cette dépêche, écrit Grey, avec un sentiment de désespoir.
Accepter, c’eût été l’irrémédiable honte. Comment BethmannHollweg ne l’avait-il pas compris ? E t quel homme était-ce donc ?
Il fallait refuser sur l’heure. Plus encore, si l’honneur interdi­
sait de poursuivre un débat sur les conditions de la neutralité,
n’apparaissait-il pas avec évidence qu’il était impossible de
justifier la neutralité elle-même, pure et simple, et sans condition.
Grey tint les propositions du Chancelier pour une insulte. Il
les rejeta, et l’ambassadeur Page relate que, plus tard, maintes
fois pendant la guerre, il en évoqua le souvenir, avec des sur­
sauts de colère.
Maintenant les actes se succèdent avec logique et rapidement.
Le 31 juillet Sir Edward Grey demande à l’Allemagne et à la
France de s’engager à respecter la neutralité de la Belgique. La
France répond par de catégoriques assurances. L’Allemagne se
dérobe. Le 2 août, Grey déclare à M. Paul Cambon que la flotte
anglaise protégera les côtes occidentales de la France.
E t cependant il ne veut pas encore se lier définitivement. Le
Président de la République Française, M. Poincaré, lui avait
fait demander, le 30 juillet, par Sir Francis Bertie, d’annoncer
que l’Angleterre viendrait en aide à la France, dans le cas d’un
conflit entre elle et l’Allemagne, et le lendemain, M. Paul
Cambon avait insisté, m ontrant une dépêche de son frère,
M. Jules Cambon, qui représentait l’incertitude où l’on était à
98
Berlin au sujet de l’intervention de l’Angleterre, comme un
encouragement pour le gouvernement impérial. Grey n’avait
pas cede. 11 ne pouvait, répétait-il, «donner aucun gage à ce
m om ent» (). C’était sa thèse et sa conviction. E t combien il
? aiMPü i nde !eS maintenir devant les instances, les prières
ae M "aul Cambon, qui m ettait dans ces démarches ultimes
tout le frémissement d’une âme tourmentée ! En ce qui con­
cerne la Belgique, Grey se retient. Le 1er aoûtî le ince Lich_
lm demande si l’Angleterre resterait neutre au cas
ou Allemagne prom ettrait de respecter la neutralité belge. Il
retuse de formuler des conditions, tout en faisant ressortir
1 importance de la question belge pour l’opinion, qui en somme
dictera 1 attitude du Gouvernement (2).
Le 2 août les dernières illusions s’évanouissent. La guerre
est sur le seuil. Le sort de la Belgique est en jeu. Il importe que
le Labinet se prononce et que le Parlement statue. La Chambre
des Communes est convoquée pour le 3.
La garantie de la neutralité belge, dans le ministère, emporte
toute hésitation. Deux ministres cependant, de conviction
imperturbablement pacifiste, se retirent.
Grey dépeint en quelques lignes son état d’âme pendant
ces moments extrêmes. Le torrent l’emportait. Il trouvait à
peine le temps de la réflexion. Il savait où il allait ; il y devait
aller et ne pouvait aller ailleurs. La menace qui planait sur la
Belgique ralliait l’opinion et faisait s’évanouir tous les dis­
sentiments.
Pendant la matinée du lundi 3 août, il ne trouva pas un
instant pour jeter des notes sur le papier. Il lui fallut lire les
télégrammes, puis assister à une réunion du Cabinet. A 2 heures
il retourna au Foreign Office, courut ensuite chez lui pour
prendre quelque aliment, avant l’effort oratoire où il allait, à
3 heures, dépenser toute sa force persuasive. Il lui restait une
heure pour ranger ses idées et préparer mentalement un plan.
iI a,nt ^ rï n’entrât à la Chambre, l’ambassadeur d’Allemagne
affolé se présenta. Est-ce la guerre ? demanda le prince Lichnowsky. E t il supplia Grey de ne pas faire du respect de la
(1) Livre Bleu, n os 99 et 119.
le S b ïr t
C0rT rf ti0n avCC M' Ça“ bon, il se réserve encore, attendant que
ait dehljtre en vue de la reunion prochaine du Parlement. Livre Bleu, n°s 123 et 101.
99
neutralité belge une condition imposée à l’Allemagne. Il ne
savait rien, dit-il, des projets de l’état-m ajor allemand. Tout
au plus, peut-être, écornerait-on un morceau de la Belgique.
Lui-même avait en horreur la guerre et tout ce qui se préparait.
Grey ne répondit rien. Il allait parler publiquement.
Ce fut une inoubliable séance.
Mon but, écrit Grey, fut de convaincre la Chambre et le
pays que si l’Angleterre se résignait à la neutralité, elle serait
isolée, discréditée, haïe.
Le Secrétaire d’E tat débuta en annonçant que l’espoir de
maintenir la paix devait etre abandonne. E t il décrivit la posi­
tion de l’Angleterre telle que la conditionnaient les circon­
stances des dix dernières années et les incidents récents et
immédiats. Il arriva à la question belge et en fit le point capital
de sa démonstration. Il ignorait, au moment où il parlait, le
texte de l’utimatum notifié par l’Allemagne à la Belgique, et
notre réponse. Mais le Roi Albert avait télégraphié au Roi
George pour lui demander l’appui diplomatique de la GrandeBretagne, afin de préserver l’intégrité de son pays. E t le bruit
de l’ultimatum avait atteint le Foreign Office, sans détails
précis. Il rappela les déclarations des hommes d’E tat d’autrefois
et un mot saisissant de Gladstone : Si l’Angleterre désertait
l’obligation qu’elle a de défendre l’indépendance de la Belgique,
elle se rendrait complice d’un abominable crime. Que resterait-il
de l’honneur britannique si la Belgique et la France succom­
baient sous les coups d’une puissance qui, victorieuse, domi­
nerait le monde ? Il montra les responsabilités du Gouvernement,
le déclara prêt à faire face aux événements et exprima la con­
viction qu’il serait jusqu’au bout soutenu par le courage et
l’endurance de la nation entière.
On ne relit pas, sans émotion, ce discours qui dressa debout
la Chambre unanime dans un sursaut d’enthousiasme et qui
entraîna le pays.
Cependant, il n’a pas de beauté verbale. Il sort des formes
d’éloquence qu’ont coutume d’admirer les publics de culture
latine. Il ne brille ni par l’éclat des mots, ni par la sonorité des
périodes, ou la splendeur des images. Il est simple, net ; il
marche droit, d’une allure ferme et carree. Il n a ni exorde, ni
péroraison. C’est un récit, un appel aux consciences, une affir­
100
mation du droit et de la loyauté, un bloc de marbre uni que
semble éclairer une lumière intérieure.
L’impression, dit Grey, dans ses mémoires, eût été plus forte
si j ’avais pu lire à la Chambre l’ultimatum allemand et la
réponse du Gouvernement belge. Un incident avait retardé la
communication de ces documents. Notre ministre à Londres, le
comte de Lalaing, s’était, selon des renseignements qui ont été
publiés depuis (*), rendu dans l’après-midi au Foreign Office,
pour en remettre le résumé qui venait de lui être télégraphié de
Bruxelles. Mais Sir Edward Grey avait quitté son cabinet pour
se rendre au Parlement. Le comte de Lalaing garda le papier et
ne put le déposer dans les mains du Secrétaire d’E tat que dans
la soirée. Grey retourna au Palais de Westminster, et, dans
une séance de nuit, en donna lecture à la Chambre.
Le lendemain 4 août, l’action suivit les paroles. Le Gou­
vernement britannique fit sommation au Gouvernement alle­
mand de respecter la neutralité de la Belgique, à défaut de
quoi il aurait recours aux armes pour assurer l’observation des
traités qui liaient l’Allemagne au même titre que la GrandeBretagne (2).
L’Angleterre entrait dans la guerre. Elle y entrait d’un
cœur ardent, d’un élan unanime, avec cet esprit de robuste
opiniâtreté qui caractérise la race britannique.
Sir Edward Grey avait accompli son devoir, obéi à l’impé­
ratif de la conscience. Il mesurait l’immensité de la catastrophe
européenne, les douleurs, les pertes de sang et d’argent qu’en­
dureraient le pays et l’Europe et l’intensité de l’effort qui
tendrait toutes les énergies des peuples. C’était pour lui, mora­
lement, une accablante déception. A l’ambassadeur des EtatsUnis, il dit : « Toutes mes espérances se sont effondrées. Je
suis un homme qui a gaspillé sa vie ». E t dans la soirée du 3 août,
se penchant à sa fenêtre à l’heure où l’on allumait les réverbères,
(1) Times du 22 décembre 1920. — Conversation avec M. Paul Cambon, au moment où
l’ambassadeur de France prit sa retraite.
(2) Dans l’intervalle, l’ignorance où nous étions à Bruxelles de ce qui se passait à Londres
nous donna des inquiétudes. Le 3 août, dans la matinée, le ministre d’Angleterre, Sir Francis
Villiers, annonça à M. Davignon que l’Angleterre nous donnerait son plein appui. Quelques
heures plus tard, il nous fit savoir que cette communication devait être tenue pour nulle et
non avenue. Notre émotion fut vive. Ce n’est que dans la soirée que la nouvelle de l’ultimatum
nous parvint.
il laissa échapper tristem ent ces mots : « Les lampes s’éteignent
dans toute l’Europe. Nous ne les verrons plus luire notre vie
durant ».
L’ambassadeur Page a raconté dans un mémorandum son
entrevue avec le Secrétaire d’E tat, le 4 août (1). Sir Edward Grey
tenait à mettre le représentant des Etats-Unis au courant des
mobiles de la politique britannique. Ce fut un entretien dram a­
tique. Grey, assis, le menton reposant sur ses mains croisées,
exposa la situation d’un ton calme. L’Allemagne, dit-il, a
violé un traité qu’elle a signé. C’est sur la base de traités tels
que celui qui garantit la neutralité belge, que la civilisation
repose. Puis brusquement, il se leva et s’écria : « L’Angleterre
eût été à jamais méprisable si elle avait consenti à la violation
de ce pacte et laissé le militarisme allemand régenter le monde ».
Il s’exprimait, dit Page, avec une sincérité solennelle.
« Il était magnifiquement simple ».
L’ambassadeur, connaissant les difficultés que les divisions
du Cabinet avaient infligées à la politique de Grey, termine
son récit par cette conclusion : C’est un fait historique que
l’Angleterre n’aurait pas déclaré la guerre, tout au moins en
ce moment, si l’Allemagne n’avait pas envahi la Belgique. E t
le comte Mensdorff, ambassadeur d’Autriche, apporte un témoi­
gnage non moins significatif, que nous fournit une lettre résu­
m ant une conversation avec le Secrétaire d’E tat : « Celui-ci,
écrit il à son gouvernement, est plein d amertume et desespere
de n’avoir pu réussir à maintenir la paix. Il prévoit que la
guerre aura d’incalculables conséquences. C’est le plus grand
pas vers le socialisme qu’on ait jamais pu faire. Nous aurons
après ceci des gouvernements socialistes dans tous les pays ».
E t l’ambassadeur d’Autriche, de l’Empire allié de l’Allemagne,
formule ce jugement : « Je suis convaincu que l’attaque contre
la neutralité belge a fait tout crouler ici ».
Dans la suite et au milieu des préoccupations de la diplo­
matie de guerre, Grey longtemps soupesa ses responsabilités et
en quelque sorte ausculta son âme. Aurait-il pu, par une poli­
tique différente, éviter le conflit, ou agir plus tôt et par de
promptes déclarations arrêter la marche implacable des événe­
ments ? Il y pensait parfois dans le silence de la nuit. W alter
(1) Vie et lettres de W. H. Page, t. I, p. 312.
102
Page, dans une lettre du 23 août au Président Wilson, lui
mande qu’il a causé avec le Secrétaire d’E tat presque chaque
jour depuis trois semaines, qu’il l’a vu brisé par l’insomnie,
pleurant parfois et à d’autres moments dressé par l’indignation,
avec un air confiant et invincible. Quel eût été l’effet d’une
parole décisive quand M. Poincaré et M. Cambon, le 30 et le
31 juillet, avaient sollicité une promesse d’intervention ? Eûtelle fait tomber l’épée des mains de l’agresseur, détruit les
plans de l’état-major allemand, préservé l’Europe de l’embra­
sement ? Quel troublante interrogation ! Le passé conserve son
énigme. Nul ne saurait la déchiffrer.
Grey, dans ses mémoires, rend compte de son examen de
conscience. Il n’a jamais travaillé à l’encerclement de l’Alle­
magne et il conteste que jamais le Roi Edouard V II, dont il
trace un portrait coloré, ait tenté de réaliser cette opération
laborieuse et compliquée. Les nécessités le poussèrent à se
rapprocher de la France, sans qu’il eût négligé de demeurer
en relations d’amitié avec l’Empire. Mais l’Allemagne ne com­
prenait pas la mentalité anglaise et vivait dans de perpétuels
soupçons. Le militarisme allemand avait tout voulu, préparé,
consommé. Quand le conflit s’annonça, il était impossible à
Grey de donner des promesses à la France et à la Russie, car
elles eussent été sans valeur. Le Cabinet n’était pas disposé à
prendre des engagements, et n’était pas à même de le faire,
en raison de l’état des esprits dans le Parlement et le pays. Une
action prématurée aurait eu ce résultat que lorsque la viola­
tion de la Belgique fut perpétrée, on se serait trouvé devant
un Cabinet divisé, et peut-être en pleine crise ministérielle.
Au surplus, l’Allemagne était décidée à aller de l’avant. Elle
dédaignait la force militaire de la Grande-Bretagne.
En regardant attentivem ent derrière lui, Grey arrive à
cette conclusion que la ligne suivie fut celle qui conduisait le
plus sûrement à l’intervention britannique, avec l’appui total
de la nation, et que l’entrée immédiate dans la guerre de l’Angle­
terre unie fut la conséquence directe de l’invasion de la Belgique.
M. Winston Churchill confirme ces appréciations (1). Il
observa de près le trouble auquel était en proie son collègue
(1) The World Crisis, t. I, pp. 203 et suiv. — Voir aussi Vie el Lettres de W .-H. Page, t. III,
pp. 124 et 125.
103
des Affaires étrangères pendant ces jours fatidiques. Grey,
dit-il, était plongé dans un immense et douloureux problème :
empêcher la guerre et, d’autre part, ne pas déserter la France.
Comme Grey, Churchill et Asquith inclinaient à l’action, mais
tout geste hâtif eût rompu le Cabinet, et le Parlement l’eût
répudié. M. Lloyd George hésita jusqu’à la violation de la
neutralité belge, qui fit se fondre les incertitudes en une volonté
commune. Morley et Burns, isolés, se retirèrent.
Dès que les opérations de guerre se développèrent, les
regards de la Grande-Bretagne se tournèrent vers les EtatsUnis (1). Il y avait là-bas un grand peuple, de race principale­
m ent anglo-saxonne, de langue et de culture anglaises, épris
d’un idéal de liberté, pratiquant des institution démocratiques,
haïssant d’instinct l’orgueil et les bravades militaristes. Il
avait une position politique indépendante et solide et d’immenses
ressources industrielles.
Que pouvait-on espérer de lui ?
Le Président Wilson occupait le pouvoir depuis 1912 et
passait pour une forte personnalité. Le colonel House avait,
lors d’un récent voyage, laissé une agréable et sérieuse impres­
sion. Enfin, un nouvel ambassadeur, M. Page, ancien éditeur
de grands journaux et journaliste lui-même, représentait depuis
un an les Etats-Unis à Londres. Ce démocrate, qui a décrit
avec humour ses premières expériences à la Cour de Saint-James
et dans le grand monde, se révéla un ami ardent de l’Angleterre,
un serviteur passionné de la cause des Alliés, sous des dehors
modestes qui ne laissaient guère, pour un observateur non
averti, transparaître la ferveur de ses idées et la ténacité de son
action.
Une attraction spontanée l’attacha à Sir Edward Grey, dont
il écrit : « c’est le contraire d’un insolent. Il est franc, et le
mieux équilibré de tous », et, compliment suprême : « il suffirait
de le frotter avec du papier de verre pour en faire un vrai
Américain » (2).
(1) Le premier ministre belge, M. de Broqueville, songea aussi, dès le début, aux avantages
de l’amitié américaine. Il envoya à Washington, à la fin du mois d’août 1914, une mission
composée de MM. Carton de Wiart, Hymans, de Sadeleer et Vandervelde pour attirer l’atten­
tion du Président Wilson sur les atrocités commises par la soldatesque allemande. Voir p.p. 121
et suiv. de ce volume.
(2) Vie et Lettres de W. H . Page, t. I, p. 150.
104
Pendant les deux dernières années du ministère de Grey,
celui-ci eut à débattre avec Page les différends les plus com­
plexes. Il s agissait de la contrebande de guerre. Les EtatsUnis, dont le Président Wilson avait proclamé la neutralité,
prétendaient exporter en Europe tout ce que l’Europe, sans
distinction de pays, voulait acheter, et réclamaient la liberté
des mers. Les Alliés et l’Angleterre, parlant en leur nom dans
ces questions maritimes, ne pouvaient renoncer à contrôler, à
réglementer ce trafic et à empêcher l’ennemi de se ravitailler
en Amérique. De là des frictions et des discussions que les
instructions de Bryan, puis et surtout de Lansing, juriste
pointilleux, qui dirigèrent tour à tour la Secrétairerie d’E tat, à
Washington, rendirent souvent pénibles et dangereuses.
W alter Page, qui dès le début s’était d’instinct jeté du côté
des Alliés, qui voyait dans l’invasion de la Belgique une mons­
truosité, dans la guerre le choc des forces brutales du despo­
tisme militaire contre tout ce qui figurait à ses yeux la civilisa­
tion et les aspects nobles de l’humanité, se multiplia en efforts
pour aplanir les incidents qui surgirent. Il lui arriva de dicter
à Grey la réponse à faire à une note, qu’il jugeait trop vive,
de son gouvernement.
Avec beaucoup de patience et d’habile énergie, l’Angleterre
parvint a serrer de plus en plus le filet du blocus maritime,
qui lentement étouffa 1 Allemagne. En même temps qu’avec
1 Amérique, il fallut négocier avec les neutres d’Europe, d’où
les matières prohibées pouvaient s’écouler vers les territoires
ennemis. La contrebande fut fertile en stratagèmes. On apprit
un jour que de Suède le cuivre passait en Prusse, sous la forme
de multiples statues métalliques de Hindenburg.
Derrière les questions économiques et maritimes, un autre
problème de plus vaste envergure se dessinait. La nation améri­
caine demeurerait-elle emprisonnée dans une froide indifférence ?
Le Président Wilson maintiendrait-il le mot d’ordre de neutra­
lité ? Retiendrait-il son peuple, ou chercherait-il à l’entraîner ?
De quel poids ne serait pas son intervention ? Y songeait-il et
dans quel sens ?
W alter Page a donné tout son cœur aux Alliés, à l’Angleterre
surtout, parce qu’il ne connaît qu’elle en Europe et qu’il est
de souche britannique. Il entrevoit pour le Président un rôle
105
historique. Il lui écrit : « Votre heure viendra. Nous sommes
dans le monde l’unique grande puissance qui n ait pas d enga­
gements ». Un peu plus tard, il lui mande : « Il nous appar­
tiendra de préserver la civilisation. L’Europe tombe en mor­
ceaux ». E t encore : « Personne ne peut arrêter la guerre par
des bons offices ou la médiation. Nous seuls pouvons y mettre
fin rapidement, et nous ne le pouvons que par des actes et des
menaces ». Il fallait, selon lui, poser quelques principes fonda­
m entaux qui seraient la base d’un accord : la restauration de
la Belgique et le désarmement (*).
.
A mesure que la guerre fait rage, sans episodes décisifs, et
paraît devoir se prolonger jusqu’à l’épuisement, les lettres de
Page se font plus pressantes; elles deviennent pathétiques
après le torpillage de la Lusitania. Mais elles ne semblent pas
ébranler la rigidité doctrinaire du Président Wilson. Leur
publication récente (2) a causé aux Etats-Unis une vive sensa­
tion et donné lieu à des polémiques auxquelles des aliments
nouveaux viennent d’être apportés par les deux volumes qui
contiennent les Papiers intimes du colonel House.
Sir Edward Grey, qui avait connu le colonel House en LVLÔ
et l’avait revu en 1914, appréciait son caractère et son jugement.
Il le tenait pour un ami sûr, d’esprit sincère et de vision penetrante. Le colonel House, qui jouissait de la confiance du Fresident et qui, certes, inspira beaucoup de ses discours et de ses
actes, pouvait parler librement. Il n’avait aucune mission
officielle. Il fuyait la réclame et ne recherchait aucun profit
personnel d’influence ou d’ambition. C’était un intermédiaire
fidèle et un conseiller plein de tact et de pondération. Il revint
en Europe en 1915, animé d’une vague espérance de paix. If
retourna à Berlin et y éprouva de nouvelles désillusions.
Il n’était pas alors partisan de l’intervention des Etats-Unis.
Il ne pensait pas qu’il leur eût été possible d’entrer dans la lice
aux premiers temps du conflit. Il hésitait encore après 1 englou­
tissement de la Lusitania. Il croyait à un long affrontement
de forces équivalentes, sans victoire définitive d un cote ni
de l’autre. On aboutirait à une impasse. E t son reve était
qu’à l’heure opportune le Président des Etats-Unis s engeat
(1) Vie et Lettres de Walter H. Page, t. III, pp. 130, 132, 168, 174 et.175.
(2) Les volumes I et II ont paru en 1923. Un troisième a paru fin 1925.
106
en médiateur ou arbitre et pût dicter une paix équitable.
En avril 1915, il eut avec Grey de fréquents entretiens, où
s’ébaucha l’idée d’une Ligue des Nations (1).
Quand il rentra en Amérique, il poursuivit par correspon­
dance la discussion de cette conception vague encore, à laquelle
le ministre anglais adhérait de plein cœur. « Pour moi, écrit
Grey, la perle à découvrir ce serait une sorte de Ligue des
Nations donnant des sanctions au droit international et réglant
les différends entre peuples par l’arbitrage et la médiation. »
Pour éliminer le militarisme, écrit-il encore, il faudrait créer
des garanties de sécurité dans l’avenir contre une guerre d’agres­
sion et contre tout E tat qui violerait un traité (2).
Ce sont les germes du « Covenant », du Pacte de la Société
des Nations, du Protocole de Genève, des accords de Locarno.
En janvier 1916, le colonel House fit de nouveau la traversée,
apportant un projet.de médiation qui impliquait l’intervention
éventuelle des Etats-Unis dans la guerre (3). Il l’avait exposé
au Président Wilson, qui semblait enclin à sortir de l’immobilité
et à faire un geste. Il le développa à Londres, puis à Paris et
reprit ensuite l’affaire avec les Anglais, sans obtenir le concours
de son ambassadeur, qui repoussait toute politique médiatrice
et opinait résolument pour la manière forte, pour l’entrée
éclatante des Etats-Unis dans la mêlée, avec toutes leurs for­
midables ressources.
Les conversations de Londres aboutirent à la rédaction
d’un mémorandum, qui est resté inconnu jusqu’à sa publication
dans les mémoires de Lord Grey. Ce document, qui résume les
propositions du colonel House, est daté du 22 février 1916 (4).
On y lit que le Président Wilson se tient prêt, au moment que
la France et l’Angleterre déclareraient opportun, à proposer la
convocation d’une conférence pour mettre fin à la guerre. Si les
Alliés acceptaient la proposition et que l’Allemagne refusait, les
Etats-Unis prendraient « probablement » part à la guerre contre
l’Allemagne. Le « probablement », qui ne se trouvait pas dans
le texte élaboré à Londres, fut ultérieurement inséré par le
(1) Lettres de Grey à House et de House au Président. — Voir Papiers intimes, 1.1, pp. 428
et suiv.
(2) Papiers intimes, t. II, pp. 87 et 88.
(3) Ibid., t. II, p. 115.
(4) G r e y , t. II, p. 123. — Voir aussi Papiers intimes, t. II, p. 200.
107
Président. Si la Conférence n’aboutissait pas à un accord sur les
conditions de la paix, les Etats-Unis deviendraient puissance
belligérante aux côtés des Alliés. Les conditions de paix que le
Colonel House estimait équitables et que le Président approuvait,
étaient notamment la restauration de la Belgique et le transfert
de l’Alsace-Lorraine à la France.
La déclaration était importante, mais Grey jugea que dans
la phase que l’on traversait, on ne pouvait en faire usage et lui
donner une suite pratique. Il était, d’autre part, impossible de
paraître ignorer l’initiative américaine, tout autant d ailleurs
que de formuler un avis ou des propositions sans concert avec
les Alliés. Le colonel House ayant eu des conversations avec
M. Briand et M. Jules Cambon à Paris, il convenait de leur faire
part du langage tenu par lui à Londres et de se dire prêt à causer
de l’affaire avec le gouvernement français si celui-ci le desirait.
M. Briand fut donc averti par l’intermédiaire de l’ambassade
de France et sans commentaires.
Mais la guerre, qui traînait dans les tranchées, se rallume et
flambe. Les Allemands jettent sur Verdun, pendant des mois, des
vagues humaines et des rafales de mitraille. Les Français
indomptables repoussent ces assauts désespérés et maintiennent
leur drapeau sur le sol désormais sacré que le Kronprinz tente
en vain de leur arracher. Sur toutes les lignes 1 effort des armées
s’exaspère. E t les suggestions américaines demeurent stériles et
tom bent dans l’oubli.
Il n’en pouvait être autrement. Page avait raison en deman­
dant des actes, non des offres mediatrices. La brutalité de
l’agression, les horreurs de l’invasion avaient engendré une
volonté si passionnée de châtiment et de réparation, que des
transactions eussent paru fades, molles, débiles, inopérantes.
La fatalité déroulait ses anneaux qui tenaient le monde enchainé.
On irait jusqu’au bout. Quand de loin, dans les difficultés de la
paix, la raison s’exerce froidement, peut-être conduirait-elle à
penser que la sagesse et le calcul eussent c o m m a n d é de chercher
à abréger l’épreuve par de raisonnables accords. C était impos­
sible. Il fallait la victoire ! Quelle indissoluble amertume eût,
pendant des générations, empoisonné les peuples qui luttaient
pour la vie, si les douleurs et les sacrifices endurés ne leur
avaient donné, à l’heure finale, la joie suprême due à la conscience
108
humaine, l’exaltation de la justice ressuscitée et triomphante.
La restauration de la Belgique était la première des condi­
tions inscrites dans les propositions du colonel House, à qui
plus tard nous dûmes, pendant la Conférence de la Paix, l’ini­
tiative de l’attribution au Gouvernement belge d’une priorité
de deux milliards et demi de francs sur les paiements de répa­
ration imposés à l’Allemagne (*).
La pensée de Grey demeure, dès l’origine, attachée à cet
objectif essentiel. Dans la correspondance intime qu’il échangea
en 1914 et 1915 avec l’ancien Président Roosevelt, les deux
hommes d’E tat s’accordent pour considérer l’indépendance de
la Belgique comme une impérieuse nécessité d’ordre international
et d’équité.
Je fus à même de juger de la sincérité et la constance de
cette préoccupation, pendant que j ’eus l’honneur de représenter
à Londres le Gouvernement belge.
Quand j ’allai saluer Sir Edward Grey la première fois, en
mars 1915, il m’accueillit par cette phrase : « Je tiens à vous
dire que le minimum de paix que l’Angleterre puisse accepter,
en ce qui la concerne, c’est la restitution à la Belgique de sa
pleine indépendance et la réparation complète des dommages
qui lui ont été infligés. Elle exigerait cela, même si elle n’obte­
nait rien pour elle-même ».
Le 9 décembre 1916, j ’allai lui faire mes adieux, la veille de
sa retraite. Au moment où je prenais congé, il saisit ma main
dans les siennes, et d’un ton grave et pénétrant, il me dit, en
termes précis, nettement articulés : « Vous pouvez être certain
que, lorsque l’heure de la paix viendra, l’intérêt de l’Angleterre
et, autant que son intérêt, le souci de son honneur, feront que
sa préoccupation principale, avant toute autre considération,
coloniale par exemple, sera la complète restauration de votre
pays. Ce sera pour l’Angleterre la première des conditions de
la paix ».
A maintes reprises, nos conversations portèrent sur la
situation à laquelle l’occupation ennemie réduisait les Belges. Il
se montra pratique et conciliant dans nos négociations au sujet
du programme des importations en Belgique destinées au ravi­
taillement de nos populations, plein d’humaine émotion au récit
(1) Voir pp. 152 et suiv. de ce volume.
109
des déportations, attentif et bienveillant quand je lui exposais
les soucis que nous inspirait l’avenir. En juillet 1916, notre
Ministre des Affaires Etrangères, le baron Beyens, vint me
rejoindre à Londres, afin de développer devant le Secrétaire
d’E tat, avec l’autorité de sa fonction, nos vues sur le statut poli­
tique futur de la Belgique, nos aspirations et nos besoins.
C’est Lord Crewe, enfin, qui, en l’absence de Grey et en
son nom, me communiqua le projet, en décembre 1915, de
prier les Alliés de renouveler ensemble, publiquement et solen­
nellement, les engagements pris vis-à-vis de la Belgique au
début de la guerre, afin d’entretenir et de stimuler l’endurance,
le courage, la confiance du peuple belge ('). De là procéda la
déclaration de Sainte-Adresse, dont les termes furent discutés à
Londres entre Sir Edward Grey, M. Paul Cambon et moi.
Je trouvai chez Grey une amitié sans arrière-pensée, de
prudents et fermes conseils, une sollicitude anxieuse pour le
règlement et la garantie de nos destinées.
L’avènement de M. Balfour, qui lui succéda, et ne nous
témoigna pas moins de sympathie, ne suffit pas à nous consoler
de son départ.
La crise ministérielle de décembre 1916, qui entraîna la
retraite de Grey, fut provoquée par une crise de la guerre. Une
succession de revers militaires avait ébranlé la confiance de la
nation et entraîné des échecs diplomatiques. On reprochait au
Gouvernement l’entreprise des Dardanelles ; on s’alarmait des
défaites roumaines. On s’irritait du jeu de la Grèce. La guerre
sous-marine répandait de sourdes inquiétudes. On voulait une
direction plus énergique, qui imprimât à la nation et aux armées
un élan nouveau et plus vif. On la donna à M. Lloyd George.
Lord Grey, qui, promu à la pairie, siégeait depuis six mois
à la Chambre des Lords (2), quitta les affaires sans amertume.
Il ne se mêla guère aux débats de la Haute-Assemblée. « On
ne gagne pas de batailles, me dit-il un jour, par des discours. »
Il alla retrouver à Fallodon le décor familier de sa jeunesse ;
ses yeux étaient atteints d’un mal qui affaiblissait sa vue. Il
(1) C’est le 23 décembre 1915 que Lord Crewe me fit part des intentions du Gouvernement
britannique. Lord Crewe remplaçait momentanément au Foreign Office Sir Ed. Grey, que le
soin de sa santé avait contraint de prendre quelque repos.
(2) Il n’avait pas sollicité cet honneur et était sorti avec regret de la Chambre des Com­
munes, où il avait siégé et lutté pendant vingt ans.
110
était seul ; sa femme avait succombé, toute jeune, aux suites
d’un accident de voiture, en 1906. Il l’avait beaucoup aimée.
Elle était, dit-on, charmante. Il l’associait à ses réflexions. Elle
avait ce don propre à l’intelligence féminine, de regarder les
questions complexes d’un œil libre et neuf et d’y jeter des
lueurs fraîches qui en font apparaître des côtés inaperçus de
l’homme expert et raisonnable (1).
Lord Grey a, dans une page de jolie psychologie, dépeint
les impressions du minstre qui abandonne le gouvernement. Il y
cite une fine observation de l’historien Gibbon : « Il est rare
qu’un esprit absorbé par les affaires publiques ait pris l’habi­
tude de converser avec lui-même, et, dans la perte du pouvoir,
ce qu’il regrette toujours, c’est de se trouver privé d’occupation ».
Mais le mouvement des idées et le spectacle des hommes,
le culte de convictions demeurées chères, les livres, l’histoire
et la nature, qui, sans arrêt ni crise, fait chaque année reverdir
les arbres, suffisent à remplir et à faire aimer la vie.
Les conclusions du livre de Lord Grey n’ont ni prétention
prophétique, ni pessimisme, ni facile abandon à d’utopiques
espérances.
Elles sont d’un homme d’E tat qui a vu, observé et compris.
Examinant l’avenir, il redoute qu’on ne revienne au sys­
tème des armements. La guerre a montré qu’au lieu de créer
la sécurité, ils engendrent la peur, et qu’ils excitent des rivalités
qui finissent tôt ou tard par se heurter.
Il cherche la sécurité dans une politique d’entente et de
garantie mutuelle.
La guerre a tracé une coupure dans l’évolution du monde.
Nous sommes entrés dans une période nouvelle. Retombera-t-on
cependant dans les vieilles ornières ? L’Allemagne demeure, par
sa population et son organisation économique, le pays poten­
tiellement le plus fort. Si elle ne se consacre pas sincèrement
à l’œuvre de la paix, dit Lord Grey, l’Europe ne retrouvera pas
de tranquillité. E t les pays menacés : la Belgique, l’Angleterre,
la France, seront contraints de chercher un abri dans les combi­
naisons politiques et les alliances militaires. Ce serait une
désolante perspective.
(1) Lord Grey s’est remarié le 4 juin 1922. Il a épousé Lady Glenconner. Le premier époux
de Lady Glenconner était fils de Sir Charles Tennant, dont une des filles est la femme de
M. Asquith, aujourd’hui Lord Oxford and Asquith.
111
Il faut qu’un esprit nouveau anime les peuples et les décide
à s’en remettre, comme les individus, à des juges et à des lois,
pour le règlement de leurs différends. Ainsi naquit la Société
des Nations. Lord Grey l’avait, dès 1915, devinée, entrevue,
esquissée. E t nous le rencontrâmes au premier rang des specta­
teurs, quand le Conseil de la Société tint à Paris sa séance
inaugurale, en février 1920. Mais l’édifice réclame de solides
arcs-boutants. E t il ne trouvera de base compacte et durable
que dans l’opinion publique universelle.
Peut-on espérer que la nature humaine et les mœurs poli­
tiques s’adapteront à des formes et à des méthodes si différentes
des traditions du passé ? Les objections des pessimistes ne se
justifieraient que si l’homme était inapte à se réformer et
incapable de perfectionnement moral.
Si l’humanité n’a rien retenu de la guerre, si elle n’en a pas
compris les leçons, alors l’heure de la décadence a sonné. La
civilisation est en péril. E t Lord Grey prononce cet arrêt :
« Apprends ou meurs ! ».
Lord Grey vit en Angleterre dans le rayonnement d’un
prestige paisible et sans faste.
Il n’est ni un théoricien puissant ou un grand constructeur
politique, ni un artiste de la tribune ou un entraîneur de foules.
Mais la tâche que dans la grande crise il fut appelé à rem­
plir exigeait, plutôt que les dons du génie, des qualités de
courage, de sang-froid, de vision juste et de loyauté. Elles
habitaient son esprit et formaient la substance de son carac­
tère. Il lui suffit de les déployer, pour se montrer égal aux
événements.
Il n’a pas d’ennemis et son autorité morale s’impose à
tous, dans son pays.
Dans le nôtre, qu’il aida à sauver, il a droit à la gratitude
et au respect.
112
UNE CONVERSATION AVEC GUILLAUME II
«Le S o ir», 24 avril 1923.
Je retrouve, en remuant mes papiers et en classant mes
»Un 1r Empereur
v U feuilleVGuillaume
°" Je convàslgnai
la conversation
que dej ’eus
avec
Bruxelles,
en 1910 lors
la
visite qu il fit à nos Souverains, à l’occasion de l’Exposition.
Un n y découvrira aucun secret d’E tat. C’est une impres­
sion, un document psychologique. Pour le comprendre, il
taut qu en quelques mots, je situe l’entretien.
C était un an après le vote de la loi militaire de 1909 crui
abolit le remplacement et organisa le système du service d’un
A»
amî! et 3 du
j aiS’Sénat,
o aVeC meS
et regrettés
de lalParL
Chambre
MM. éminents
Louis HuysmSns
et amis
Sam
îener, mene pendant plusieurs années une vive campagne
pour 1 institution du service personnel.
1 art du X V IIe siecle6 en était le joyau.
Enfin, au moment du voyage de l’Empereur à Bruxelles,
des divulgations de la presse faisaient connaître les traits
principaux d un projet de revision de la Constitution de 1’Al­
sace-Lorraine. Un mouvement accentué d’opinion dans les
provinces arrachées par l’Allemagne à la France en 1870
demeurees irréductibles et soumises jusque-là à une sorte de
dictature, s était manifesté en faveur d’une administration
autonome. Berlin avait annoncé des concessions. Mais elles se
revelerent insuffisantes et frustratoires.
VEtoile Belge, dans une correspondance de Strasbourg
iW
-e * 1 : Lt»a°i
r?’ résumarecevrait
ainsi le outre
ProÍetune
du Chambre
gouvernement
imperial
Alsace-Lorraine
élue,
un ¡sénat qu elle ne demandait pas, et qui serait de tendance
fortement conservatrice. Le statthalter resterait l’agent direct
du ¡souverain. Le pays n’aurait pas voix délibérative au Conseil
l’art Y í f v T T e 0 - I
191?
fU t , U n
grand
Succès'
Le
Salo n
de
113
Ces brèves indications sont nécessaires pour comprendre
les paroles que me dit l’Empereur. C’est au cours d un spectacle
de gala au théâtre de la Monnaie, le 26 octobre, que je 1 approchai.
Yoici ma note rédigée le lendemain :
« Pendant le premier acte, le général Jungbluth vint me
trouver, aux fauteuils d’orchestre, pour me prier de monter a a
loge royale, au cours du second entr’acte, et m annonça que je
SCra1« ^n^prévint’ auTs^mon collègue, M Louis Huysmans
«A u moment convenu, je me
dans le couloir des
premières loges. Le général Jungbluth
tement. Je saluai le Roi qui me présenta aussitôt a l Impératrice.
Celle-ci me dit quelques paroles d’une agreable banalité.
« Puis elle s’écarta et le Roi lui présenta le prince Albert
de Ligne.
,
« Le Roi s’approcha alors de 1 Empereur.^
« Guillaume causait avec la Reine, accoude sur une console.
Le Roi lui dit quelques paroles à l’oreille, et j entendis ces
mots . service personnel... député libéral de Rruxelles.
r e n d i s
« L ’Empereur se redressa avec prestesse et un m ouvem ent
de tête qui sem blait dire : c’est cela, je sais de quoi il s agit.
dC T l Æ v a n ç a vers m oi d’un pas rapide, me tend^it la m ain
d’un geste ouvert et cordial et me parla aussitôt
du service
personnel et de l’effet heurenx pour la
£
cette réforme avait produit au dehors. Je dis que je m en
iouissais et que j ’avais aidé à l’adoption de eette mesure.
« Il me félicita et se mit à vanter les avantages du service
militaire. Dès ce moment il parla seul, avec abondance,facilite
et une extraordinaire variété de ton et d expression. Le débit
est si rapide que la pointe légère d’accent germamque s atténué
vite et s’efface. On ne la remarque plus.
a P r e m i e r thème : La discipline.
« E l l e e s t nécessaire dans les armées. Elle est nécessaire
dans la société, dans la famille. Mais le sens de ^
s’affaiblit, même au foyer, on a moms ,Ae
doit être
pour « Papa et Maman » (sic), et cependant la famiUe dm <e
la première école de la discipline. E t dans 1 art •L* 1 J
plus de discipline du tout. Le respect des grands maitres n es
plus que de l’admiration platonique, de 1 esthetisme. Mais
114
modernes dédaignent leurs leçons. Voyez les chefs-d’œuvre
des grands maîtres flamands exposés en ce moment au palais
du Cinquantenaire. On les regarde, on les loue, on ne s’en inspire
plus. L’anarchie règne dans l’art.
« Puis brusque changement de sujet et de ton. Deuxième
thème.
« — Je viens de donner une constitution à 1’AlsaceLorraine. Il y a longtemps qu’on me harcèle. Ils veulent un
Parlement. Ils l’auront. Il y aura une Chambre basse où l’on
discutera le budget. (Ironiquement) Qu’ils le discutent longue­
ment, le plus longuement possible, cela les occupera. Mais je
place au-dessus une Chambre haute, pour tempérer... Quant
au gouvernement, c’est autre chose ! C’est moi qui les gouver­
nerai. D’une voix énergique, en se frappant la poitrine, et en
redressant la tête — l’attitude, le geste, l’accent du chef qui
commande et a la conscience de son pouvoir.
« Nouveau changement de physionomie, et troisième
thème :
« — Il y a beaucoup de prêtres chez vous, n’est-ce-pas ?
E t qui font de la politique ? Chez nous aussi. Il n’y en a que
trop. Ce sont des gens difficiles à vivre. E t n’est-il pas curieux
de voir tant d’indiscipline au sein de cette Eglise, qui est cepen­
dant la plus solide hiérarchie qu’on puisse concevoir. Le petit
clergé n’en entend qu’à sa tête. Il ferait beaucoup mieux de
s’occuper plus des choses... des choses... l’Empereur cherche le
mot, je lui souffle : des choses du Ciel. C’est cela, des choses
du Ciel et de nous laisser arranger entre nous les choses de la
terre. Il en est ainsi en Belgique aussi, n’est-ce-pas ?...
« Tout ceci, sur le mode de la causerie enjouée, gaie,
familière.
« Puis quelques mots de congé et une nouvelle poignée
de main.
« Je me retire et M. Huysmans est présenté.
« Impression : un impulsif qui a de la souplesse, de la
hauteur, de la bonne humeur, le sens très vif de son rôle, de son
pouvoir. Mais un impulsif — l’extraordinaire variété des ex­
pressions qui se succèdent sur le visage, comme des masques
qu’on m ettrait et qu’on enlèverait aussitôt, l’atteste, et aussi
la rapidité, l’abondance de la gesticulation ».
115
Ici s’arrête le bref récit que je traçai cursivement le len­
demain.
Je me rappelle avoir été très naturellement sensible à
l’accueil aimable du Souverain qui s’efforçait à la simplicité et
au charme et, selon maints témoignages de l’époque, y réus­
sissait souvent.
Je ne devinai pas en lui l’ennemi futur qui devait d’une
main brutale, déchirer les traités et prendre à la gorge la loyale
Belgique. Mais je fus particulièrement frappé par le langage
qu’il me tint au sujet de l’Alsace-Lorraine.
Ce n’est que deux ou trois jours après que l’on apprit
par la presse les projets relatifs à la révision de la Constitution
des provinces annexées. La question était très peu connue en
Belgique. Il n’y avait aucune raison pour l’Empereur de m’en
parler et de me faire en quelque sorte la confidence de ses
arrière-pensées. Il ne me connaissait pas. Rien ne lui garan­
tissait ma discrétion. E t j ’eusse créé un beau tapage si j ’avais
le lendemain de notre conversation, publié ses propos. J ’eus
soin de les garder pour moi, par un élémentaire devoir de
convenance.
Mais c’est dans ce morceau de son discours — ce fut à
vrai dire un monologue — que s’accusaient le plus vivement
sa mobilité d’esprit, sa nervosité, sa légèreté qui le fit sans
m otif se découvrir un instant, et cette vanité, cette infatuation
du maître habitué d’être obéi — qui devaient peu après se
déployer dans la préparation et le déroulement d’événements
trop lourds pour ses épaules et jeter le monde en d’effroyables
convulsions.
116
L’ULTIMATUM
LA NUIT DU 2 AU 3 AOUT 1914
Emission radiophonique, le 4 août 1937.
Yoici le récit succinct de la première scène du grand drame
de 1914.
C’était le dimanche 2 août.
A la fin de l’après-midi, M. Ingenbleek, aujourd’hui Gouver­
neur de la Flandre Orientale, alors secrétaire du Roi, était
venu m’annoncer ma nomination de Ministre d’E tat. Nous nous
étions entretenus avec angoisse de la guerre qui nous menaçait,
mais sans que nous ayons perdu l’espoir de voir la Belgique
échapper à la tourmente. Les armées allemandes ne glisseraientelles pas le long de nos frontières, dans une marche rapide vers le
sol français.
Pendant le dîner je reçois un télégramme d’E tat qui me
convoque au Palais du Roi, le soir même à 10 heures. Je crus que,
les Chambres étant convoquées pour le 4 août, il s’agissait de
régler, d’accord entre le Gouvernement et l’opposition, les
mesures urgentes que commandait la situation.
J ’arrive au Palais. E t quand j ’entre dans le salon de récep­
tion, Schollaert, le président de la Chambre, s’avance vers moi,
le visage contracté et me dit : «l’Allemagne va nous envahir!»
On m’annonce l’ultim atum . Je reçois le choc en pleine poitrine.
Je me raidis et je regarde autour de moi. Woeste est là, livide ;
puis arrivent le Comte Greindl, notre ancien ministre à Berlin,
courbé sous le poids de la nouvelle, M. Vanden Heuvel, le vieux
M. de Landtsheere, appuyé sur le bras d’un huissier.
On nous introduit dans la salle voisine où le Conseil des
Ministres siège sous la présidence du Roi.
Le Roi est calme, impassible. Aucun trait du visage ne
bouge, aucun frémissement n’en altère l’expression.
Le Roi nous lit d’une voix ferme, la note allemande.
117
M. Davignon, ministre des Affaires étrangères, résume son en­
tretien avec le Ministre d’Allemagne.
L’Allemagne nous somme de laisser passer ses troupes.
En cas de refus, elle emploiera la force des armes.
Le Conseil des Ministres a délibéré avant l’arrivée des Minis­
tres d’E tat. C’est l’avis des Ministres d’E tat que l’on demande.
Woeste parle le premier. Il esquisse d’un ton résigné,
l’idée d’une sorte de simulacre de résistance.
Je m’élève contre cette politique. Je soutiens la thèse
de la résistance énergique et totale. L’honneur la commande.
E t la meilleure politique aujourd’hui est celle de l’honneur,
qui sera la sauvegarde, après la guerre, de l’existence du pays.
M. Vanden Heuvel, ancien Ministre de la Justice, esprit
lucide et juriste éminent, dont M. Davignon s’assurera le concours
au Ministère des Affaires étrangères, repousse l’ultim atum qu’il
déclare inacceptable.
M. De Sadeleer s’emporte et prononce un virulent réquisi­
toire contre le Kaiser.
Puis on interroge, sur l’état et la position de l’armée et sur
les résultats de la mobilisation, le Général de Selliers de Moranville, chef de l’Etat-M ajor et le Général de Rykel, sous-chef de
l’Etat-Major.
Il n’y eut pas, contrairement à ce que l’on a souvent ra­
conté, d’exposé ou de discussion du plan des opérations.
Le Roi demanda que chacun se prononçât sur l’ultim atum ,
par un vote personnel.
On procéda à l’appel nominal. A l’unanimité on se prononça
pour la résistance.
M. Van den Heuvel et moi-même, nous fûmes désignés pour
rédiger, avec M. Carton de W iart, Ministre de la Justice, la
réponse à l’Allemagne.
E t la séance fût levée, pour être reprise dans la nuit. Elle
s’était déroulée dans une atmosphère de dignité, de calme grave et
lourd. Le Roi, image du devoir, avait gardé l’immobilité du marbre.
Tout avait été court, simple, sans appareil.
Nous descendîmes silencieusement le grand escalier. Au
pied, un groupe d’officiers et de dames d’honneur attendait
dans l’anxiété, le résultat de notre délibération.
Yers minuit, les ministres chargés de la réponse à l’ulti­
118
matum, se retrouvèrent dans le Cabinet du Ministre des affaires
étrangères.
M. Carton de W iart occupa le fauteuil et prit la plume.
M. Van den Heuvel et moi, nous nous assîmes aux deux côtés
du bureau. M. Davignon et son secrétaire général, M. Van der
Elst, étaient présents. Le chef du Gouvernement, M. de Broqueville et M. Poullet vinrent nous rejoindre et assistèrent au travail
de rédaction sans y prendre part.
Nous commençâmes par lire un avant-projet rédigé par
M. de Gaiffier, directeur général de la politique et notre futur
ambassadeur à Paris. C’était un cadre bien construit, un exposé
schématique des points principaux à développer.
Nous nous mîmes ensuite à l’œuvre. Elle se fit dans une
pleine tranquillité. Chacun de nous suggérait une idée, une
formule, une expression. On la notait, la relisait, la corrigeait,
la m ettait au point.
Il y a trois phrases de la réponse que je cite, car elles en
sont l’âme :
L’une est de M. Yan den Heuvel :
«Aucun intérêt stratégique ne justifie la violation du droit.»
La seconde est de moi :
«Le Gouvernement belge en acceptant les propositions qui
lui sont notifiées, sacrifierait l’honneur de la nation en même
temps qu’il trahirait ses devoirs vis-à-vis de l’Europe.»
La troisième phrase est de M. Carton de W iart :
«Conscient du rôle que la Belgique joue depuis plus de
80 ans dans la civilisation du monde, il se refuse à croire que
l’indépendance de la Belgique ne puisse être conservée qu’au
prix de la violation de sa neutralité. »
Pendant que nous discutions et écrivions, on vint annoncer
que le Ministre d’Allemagne, M. de Below, demandait à voir
le Ministre des Affaires étrangères. Le Secrétaire général alla
le recevoir. M. de Below venait dénoncer le vol d’avions français
sur le territoire allemand. Il avait l’air troublé et le front mouillé
de sueur. Il partit déconcerté, étant venu sans doute pour humer
l’atmosphère et chercher à pressentir les décisions qui se pré­
paraient.
A 3 heures du matin, nous retournâmes au Palais et nous
119
lûmes au Roi et au Conseil de la Couronne, le texte que nous
avions rédigé.
Il fut adopté sans observations.
A sept heures du matin, M. de Gaiffier alla déposer la ré­
ponse belge entre les mains du Ministre d’Allemagne.
Tout était fini. E t tout allait commencer.
UNE MISSION BELGE AUX ÉTATS-UNIS (1914)
Conférence à V Université des A n ­
nales à Bruxelles, le 27 mars 1931.
J ’ai intitulé cette conférence : Souvenirs. J ’en possède une
riche collection, amassée au cours d’une assez longue vie
publique.
J ’ai pensé que la boîte secrète où, tout au fond de moimême, je garde précieusement tant de clichés fixant des impres­
sions diverses, des visions d’hommes et de choses, je pourrais
retirer quelques images et récits d’un passé proche encore et
dont les émotions ne sont pas éteintes.
Si vous le voulez bien, je ferai passer devant vous, comme
un film rapide, l’histoire d’une mission belge aux Etats-Unis,
dans les premiers mois de la guerre.
C’était en août 1914. L’ennemi venait d’occuper Bruxelles.
Je m’étais rendu à Anvers sur l’invitation de M. de Broqueville,
chef du gouvernement d’alors. Il avait appelé auprès de lui
les ministres d’E tat, afin de pouvoir, dans les moments graves
recourir à des consultations auxquelles participeraient des
représentants de toutes les opinions.
Vers la fin du mois, M. de Broqueville nous fit part d’une
idée hardie et opportune, d’une idée politique à longue portée
que le ministère des Affaires Etrangères trouva d’ailleurs peu
conforme aux règles de l’orthodoxie diplomatique.
La guerre serait longue et dure. E t, pour assurer le salut
final de la Belgique entraînée dans une si terrible tourmente, à
quelle aide suprême songerait-on, sinon à celle de la grande
nation américaine, fille de la race anglo-saxonne, maîtresse des
immenses ressources de tout un continent, magnifiquement
outillée pour la production, et en même temps idéaliste et
sentimentale, fière de cultiver les vertus démocratiques, apôtre
de la justice et de la morale ?
M. de Broqueville y pensa et conçut le projet d’envoyer
121
au Président Wilson une mission belge qui lui raconterait le
drame de la neutralité violée et les horreurs de l’invasion.
Les ministres de France et d’Angleterre, consultés, approu­
vèrent. La Belgique servirait à la fois sa cause et celle de tous
les Alliés. Il fut décidé que la commission serait composée de
trois ministres d’E tat appartenant aux divers partis, M. de
Sadeleer, M. Vandervelde et moi, et conduite par un membre
du gouvernement, M. Carton de W iart, ministre de la Justice.
Elle aurait pour secrétaire le propre secrétaire de M. de Broqueville, le jeune comte de Lichtervelde, qui depuis s’est fait
un nom’ dans notre littérature historique, par la publication de
deux beaux livres consacrés à nos premiers rois.
L’objet de la mission serait de remettre au Président les
procès-verbaux de la commission instituée pour rechercher et
prouver les atteintes au droit des gens commises par 1 armee
ennemie, et d’abord, en passant par Londres, de remercier de
son appui le gouvernement britannique.
, ,
Avant de me résoudre à partir, j ’allai trouver le général
Jungbluth, chef de la maison militaire du roi. Je craignais
l’enveloppement d’Anvers, qui, à mon retour en Europe, m em­
pêcherait de rejoindre le gouvernement et, pendant une penode
tragique, me séparerait de ma femme. Le général me rassura.
Il faudrait deux cent mille hommes pour encercler la position ;
les Allemands ne détacheraient pas une telle force pour immo­
biliser l’armée belge. Personne alors ne songeait à une attaque
puissante et brusque contre un secteur, par laquelle une trouee
serait percée qui entraînerait la chute de la place.
^
Nous nous embarquâmes à Anvers, le lundi 31 août, sur
une vieille malle du service Ostende-Douvres Le Rapide.
Nous emmenions avec nous un bébé, le petit-fils de M. de
Broqueville, aux bras de sa nourrice, et quelques employés
de la Banque Nationale qui convoyaient des sacs d’or et d ar­
gent à destination de la Banque d’Angleterre.
^
Un torpilleur anglais nous escorta de Flessingue a Douvres.
Devant nous filait le Breydel, portant la Reine et les princes,
que leur mère conduisait chez lord Curzon, pour revenir ellemême à Anvers aussitôt après.
A Douvres, un train spécial nous attendait. A Londres,
le comte de Lalaing et le personnel de la légation nous reçurent,
122
Nous n’y passâmes que deux jours, mais combien fiévreux et
remplis d’activité et d’émotions.
Nous allons le lendemain porter nos hommages au Roi
George, qui, le regard clair, jeune et bienveillant, nous tend
la main avec une cordiale simplicité et nous affirme que l’Angle­
terre soutiendra la Belgique (shall support Belgium).
Nous nous rendons ensuite au Foreign Office, où nous
saluons Sir Edward Grey. Un homme court et râblé, le monocle
à l’œil, la figure carrée que barre une forte moustache, nous
conduit à lui. C’est Sir William Tyrell, qui devint ambassadeur
d’Angleterre à Paris. Derrière Grey est assis un petit homme
voûté, à la physionomie distinguée et attentive, vers qui le
ministre se tourne souvent. C’est le sous-secrétaire d’E tat, Sir
Arthur Nicolson, le conservateur des grandes traditions de la
politique impériale. Grey lui-même nous impressionne par son
masque romain, au front haut et pur, aux lèvres longues et
sinueuses qui trahissent une intime sensibilité. Il nous stimule,
nous réconforte. L’Angleterre luttera jusqu’au bout (to the last).
La Belgique a conquis l’admiration du monde civilisé. Le
conflit est entre le césarisme prussien et les peuples aux institu­
tions libérales. L’Angleterre ne le terminera que par la victoire.
De là, nous allons à l’ambassade de France, chez M. Paul
Cambon. Quel contraste ! Un homme de petite stature, à barbe
argentée et pointue ; un regard spirituel, une voix douce et
contenue, un débit précis et mesuré, souligné par le geste d’une
main délicate et nerveuse. Il nous fait un tableau ironique de
la diplomatie allemande. La guerre sera rude, mais on vaincra.
Il faudra — ceci avec force — que la Belgique soit un grand
pays.
Enfin, visite à l’ambassadeur de Russie, le comte de Benckendorff, grand seigneur, qui nous reçoit avec une aristocratique
courtoisie.
Plus tard, pendant que je fus ministre de Belgique à Lon­
dres, après le comte de Lalaing, j’ai revu ces belles physionomies,
qui me devinrent familières. J ’eus avec ces hommes éminents
des contacts fréquents, des relations continues et intimes. J ’en
ai gardé un souvenir ému et fidèle.
Quand nos démarches officielles furent accomplies, nous
fûmes accaparés par les journalistes, qui nous accablèrent de
123
questions et de démonstrations d’amitié. Nous nous séparâmes,
pour prononcer des allocutions dans des salles de l’hôtel Cecil,
devant des auditoires qui nous acclamèrent.
Dans la soirée, l’Amirauté nous fit savoir que nous pour­
rions nous embarquer le lendemain. Il était très difficile de
nous loger sur les bateaux en partance pour les Etats-Unis.
Les Américains en vacances en Europe fuyaient devant la
guerre et se hâtaient de regagner les calmes régions d’outre­
océan. Ils se disputaient les cabines. Tout était plein. On nous
offrit une installation modeste mais convenable sur le Celtic,
de la White Star Line. Le 2 septembre nous nous embarquâmes
à Liverpool.
Nous fûmes reçus sur le quai de la gare par des officiers
de l’Amirauté. Sur le pont, la foule des passagers contemplait
l’arrivée des délégués belges.
On nous fit monter processionnellement sur le navire ;
puis, contraste piquant, à peine en haut, on nous fit descendre
tout au fond, dans des cabines de deuxième classe, où l’on nous
entassa deux par deux !
E t, par une silencieuse nuit d’été qu’éclairait une lune
apaisante, le navire nous emmena, tandis qu’à quelques cen­
taines de kilomètres la terre tremblait sous le canon.
Pendant la traversée, qui dura neuf jours, nous passâmes
par de multiples états d’âme simultanés et contradictoires.
Nous sortions de Londres, tout gonflés d’espoir, exaltés
par les louanges, les promesses d’appui, les affirmations de
victoire. E t, sur le bateau, les Américains nous pressaient de
témoignages affectueux et d’encouragements. Tous les soirs,
ils se levaient pour applaudir les hymnes nationaux des Alliés
que jouait l’orchestre du bord. Et cependant, dans ces moments
de confiance et de fierté, une voix sourde au fond de nous
sonnait l’alarme.
Nous nous éveillions le matin sous les rayons d’un chaud
soleil qui passaient par les hublots de nos cabines, et l’air salin,
le rythme de la mer, vivifiaient notre sang et calmaient nos
nerfs. Mais au dedans, tout à coup, une angoisse nous contractait.
Nous écoutions de près les compliments et, de loin, l’écho
de l’ouragan déchaîné sur la Belgique.
Nous regardions les longues vagues régulières de l’océan
124
et nous pensions à ceux que nous avions quittés là-bas. Où
les reverrions-nous ? E t quand ?
Nous allions dans l’inconnu, vers un pays opulent et
puissant, dont nous allions découvrir les richesses, les beautés,
l’âme et le visage. Qu’y trouverions-nous ?
Et que se passait-il dans l’Europe dont nous nous éloig­
nions ? Que se passait-il chez nous ? Des marconigrammes nous
arrivaient, qu’imprimait le journal du bord. Ils semblaient
annoncer un retour de fortune pour les Alliés : c’était la bataille
de la Marne qui se déroulait.
En arrivant à New-York, nous apprîmes la victoire de
Joifre et, sans que nous pussions comprendre l’influence qu’elle
devait avoir sur l’issue de la guerre, nos cœurs s’élargirent.
Le 11 septembre, nous saluons la statue de la Liberté et
nous débarquons.
Me voilà dans le Nouveau Monde, l’œil et l’esprit alertés
par la curiosité, par l’avidité de voir et de comprendre, par le
devoir de se faire connaître et comprendre d’une nation qui,
alors, nous ignorait, ou à peu près, d’hommes d’E tat et d’affaires,
de journalistes,de professeurs en qui nous devions éveiller la sensi­
bilité, la volonté de s’employer au service d’une cause humaine,
d’aider un peuple faible mais brave, victime d’une iniquité.
Tout de suite, les reporters nous entourent, nous leur dis­
tribuons des papiers, des déclarations écrites pendant la tra­
versée. Puis viennent quelques grands journalistes, initiés aux
affaires européennes, et notre première impression est revigo­
rante. L’arrivée des représentants de la Belgique, au moment
où les événements de Belgique secouent l’attention du monde,
au lendemain de la résistance de Liège, de la destruction de
Louvain et de son université séculaire est un événement. Voilà
les Belges ! Ce sont des Belges ! Nous allons savoir ! E t les
questions pleuvent. Nous répondons, nous expliquons, nous
décrivons.
Il y a ensuite des personnages à voir, à consulter. Nous
avons des lettres d’introduction. Il faut que nous arrêtions
notre plan de campagne et qu’à Washington le Président nous
donne audience.
Nous recevra-t-il ? Certains ont des doutes, car M. Wilson
125
a proclamé le dogme de la neutralité. De puissantes influences
germaniques manœuvrent aux Etats-Unis. L’ambassadeur im­
périal, le comte Bernstorff, les dirige. La population renferme
des éléments considérables d’origine allemande. On nous envoie
des cartes, des billets d’injures et des menaces. E t le Kaiser
nous a devancés : le 7 septembre, il a adressé au Président un
télégramme dans lequel il dénonce la barbarie des Français,
qui tirent des balles dum-dum, et les cruautés que la popu­
lation civile belge excitée par son gouvernement, que les
femmes et les prêtres exercent sur des soldats blessés, « telles
qu’il a fallu recourir aux mesures les plus énergiques pour
terroriser un peuple assoiffé de sang ».
La lecture de cette dépêche impudente nous fit bondir et
le jeune comte de Lichtervelde, oubliant les règles de discrétion
que nous imposait le caractère diplomatique de notre mission,
s’écria: «Le Kaiser est un menteur ! » devant des journalistes
qui s’empressèrent de publier ces mots en caractères énormes
dans des éditions sensationnelles.
Mais nous sommes bientôt rassurés. Le Président nous
recevra le 15. Nous passons trois jours à New-York, et, dans
les intervalles de nos visites et de nos conversations, nous
parcourons la cité et les environs, sous la conduite de notre
consul, M. Mali, qui était allié, par son mariage, à l’une des
familles les plus haut cotées de la vieille société américaine.
Nous sommes reçus à l’hôtel de ville. On nous invite à
déjeuner et à dîner dans les clubs. Le matin, au premier déjeuner,
nous goûtons la fraîcheur acide du grape-jruit.
Les impressions de foule, les profils gigantesques des gratteciel et, le soir, l’éblouissement des réclames lumineuses, le
contraste du colossal et du petit, certains aspects de nature
qui rappellent, dans les parcs et le long du fleuve Hudson, les
forces primitives encerclées par la rigide ordonnance du plus
moderne urbanisme, toutes ces images se fixent, accumulées
dans ma mémoire ; elles y sont demeurées mêlées, un peu
confuses, mais avec un étrange relief, une couleur qui ne s’est
pas effacée. Je n’étais pas à New-York pour étudier les formes
homogènes de la civilisation mécanique et quantitative ; et
j ’étais porté à l’admiration plus qu’à la critique, à la surprise
plutôt qu’à l’analyse.
126
Le 14, nous arrivâmes à Washington, où l’hospitalité nous
fut offerte par notre ministre, M. Havenith, et sa charmante
femme, qui avaient fait de la légation une demeure accueillante
et d’un beau décor. Dans le salon d’apparat, se déployait une
suite de magnifiques tapisseries.
M .,H avenith était entouré d’amitiés sûres et sincères et
entretenait depuis longtemps des relations d’intimité avec les
ambassadeurs de France et d’Angleterre, M. Jusserand et Sir
Cecil Springrice. Ceux-ci accoururent à la Légation.
M. Jusserand, que, dans les dernières années, j ’ai revu
régulièrement à Bruxelles, chez M. Herbette, Ambassadeur de
France — il y vient pour assister aux séances de l’Union Inter­
nationale des Académies, — nous conquit par le charme allègre
de sa conversation et cette précision rapide d’expression qui
est l’un des délices de la langue française.
Il connaissait à merveille la psychologie américaine autant
que la littérature anglaise, dont il a écrit l’histoire. Il nous parla
de la Belgique en termes qui nous émurent. Nous sommes
accoutumés aujourd’hui aux compliments et nous ne man­
quons pas de nous les adresser souvent à nous-mêmes, tout au
moins dans les cérémonies officielles ; nous rachetons ces élans
d’amour-propre national par l’habitude quotidienne des déni­
grements individuels. Mais alors, un mois après l’invasion, et
quand nous nous demandions fièvreusement quelles seraient
nos destinées, je vous assure que les hommages et les gestes
affectueux nous touchaient l’âme, et qu’au milieu des tour­
ments on sentait surgir en soi comme un feu d’espérance.
M. Jusserand nous dit que la résistance belge est un des
grands faits de l’Histoire, qu’un homme domine la première
phase de la guerre, c’est le Roi des Belges, par le caractère, la
fermeté et la mesure du langage, par le courage politique et
militaire. C’est un grand roi. La Belgique devient et doit être
un grand peuple.
Sir Cecil Springrice, bien différent d’aspect et de mentalité,
n’est pas moins prévenant et empressé. Il nous donne d’ex­
cellents conseils, corrige certains mots de notre discours au
Président et nous expose l’état de l’opinion. C’est sur la violation
de la neutralité qu’il faut insister auprès des Américains, parler
beaucoup du sort des petites nations et peu des grands alliés.
127
Sir Cecil Springrice est un vieux gentleman, à lunettes d or,
qui figure un professeur plutôt qu’un diplomate, au parler lent
et pénétrant, et dont les propos révèlent de l’érudition et une
remarquable connaissance des hommes et de la politique.
Le lendemain, 15 septembre, nous rendons visite au Secré­
taire d’E tat, M. Bryan, qui nous mènera chez le Président. Il a
une renommée d’orateur, un front superbe, un visage napo­
léonien. Sur cette noble physionomie, par un contraste décon­
certant qu’accentue la conversation, brille un regard naïf et
circule un sourire ingénu. M. Bryan nous parle de l’instruction
obligatoire et engage vivement la Belgique à signer sans tarder
un traité d’arbitrage, qu’il se propose de soumettre aux Etats
belligérants. C’est un visionnaire éloquent.
Nous partons pour la Maison Blanche. Un officier de haute
taille et de mâle prestance nous attend et nous introduit auprès
du Président.
M. Wilson est debout, en redingote, au milieu d’un vaste
salon semi-circulaire. Derrière lui, deux secrétaires en veston.
Il est bien bâti, plutôt grand, de teint coloré. Sa carrure, son
maintien, donnent l’impression de 1 équilibré. Tete pensive,
regard franc sous le pince-nez ; lèvres épaisses plutôt molles,
avec un pli de bonté. Un geste cordial nous accueille.
M. Carton de W iart lit le discours que nous avions préparé
avec tant de soin.
^
Le Président nous adresse une réponse écrite, qu’il détaille
en appuyant sur les mots.
« C’est avec un sincère plaisir, nous dit le Président, que
je vous reçois en votre qualité de représentants du Roi des Belges.
Le peuple des Etats-Unis ressent pour la Belgique une admi­
ration et une amitié profondes et, pour son Roi, un respect
sincère. Permettez-moi d’exprimer l’espoir que des occasions
nous seront données de gagner et de mériter leur considération.
Les Etats-Unis, vous le savez, aiment la justice, cherchent
comme vous le progrès et se préoccupent avec passion des
droits de l’humanité. J ’éprouve une fierté profonde de repré­
senter pendant ma présidence, un tel peuple et d’être son inter­
prète. Je regarde comme un honneur que votre Roi se soit
tourné vers moi en cette heure d’épreuve, dans le désir qu’au
nom du peuple américain je prenne en considération les titres
128
qu’une nation qui se juge gravement lésée peut avoir à la
sympathie de l’humanité. Je vous remercie d’avoir mis entre
mes mains le document qui contient le résultat des investi­
gations poursuivies par le comité judiciaire et dont l’exposé
est un des objets de votre mission. Je le lirai attentivem ent et
je lui accorderai la plus sérieuse réflexion. Vous n’attendez
pas, j ’en suis sûr, que j ’en dise davantage. Bientôt, je le de­
mande à Dieu, cette guerre finira. Alors, viendra le jour du
règlement des comptes.
« Les nations de l’Europe s’assembleront en vue d’examiner
les solutions à intervenir, de déterminer les torts, d’en tirer
les conséquences, de fixer les responsabilités. Grâce à Dieu,
les nations du monde ont, de commun accord, élaboré une
organisation qui permet de procéder à l’établissement et au
règlement d’un tel compte. Les points que cette organisation
pourrait laisser dans l’ombre seront tranchés par l’opinion,
arbitre universel en pareille matière. Il serait prématuré et
peu sage, pour une nation agissant isolément et alors qu’elle
est comme celle-ci en dehors des hostilités, il serait contraire
aux devoirs de la neutralité d’exprimer un jugement final.
Je n’ai pas besoin de vous assurer que cette conclusion est
formulée avec franchise, parce qu’elle l’est dans un sentiment
de chaleureuse amitié. Elle constitue le meilleur moyen d’établir
entre nous une entente parfaite, fondée sur le respect, l’admi­
ration et la cordialité mutuels.
« Soyez les bienvenus ! C’est un grand honneur pour nous
que vous nous ayez choisis comme les amis à qui vous soumettez
une question importante, vitale pour vous, certains que votre
démarche serait comprise et qu’il y serait répondu dans le
même esprit qui vous en avait fait concevoir la pensée ».
Le discours présidentiel nous parut dans l’ensemble excel­
lent. On nous en remit des copies après l’audience. Nous les
montrâmes à M. Jusserand et à Sir Cecil Springrice, qui s’en
dirent enchantés. « Nous n’aurions pas pu le faire mieux »,
s’écria l’un des deux ambassadeurs.
Mais une ombre voila notre joie quelques heures plus tard.
M. Wilson, après nous avoir reçus, avait aussitôt, par un
souci tenace de neutralité, télégraphié au Kaiser, en réponse à
son message du 7 septembre. E t la dépêche présidentielle
129
reproduisait à l’adresse de l’Empereur un passage textuel du
discours à la mission belge. C’était le morceau du milieu, où
le Président réservait son jugement final jusqu’au moment où
les nations pourraient examiner les solutions, déterminer les
torts et fixer les responsabilités.
Mais, tout de même, le discours aux Belges s’ouvrait et se
term inait par des mots caractéristiques qu’on ne retrouvait pas
dans le télégramme au Kaiser : l’admiration et l’amitié profonde
pour la nation, le respect pour le souverain. Quelques phrases,
quelques accents, traduisaient un mouvement, une inclination
vers la Belgique, le désir de lui donner, dans son épreuve, du
réconfort et de l’espoir.
D’ailleurs, nous n’avions jamais pensé que notre visite
pût brusquement détourner le Président du chemin qu’il s’était
tracé. Elle ne pouvait servir qu’à exposer notre cause, à émou­
voir l’opinion, à créer une atmosphère.
La préoccupation de Wilson d’éviter de marquer une
préférence était telle qu’il se montra — nous le sûmes peu
après, grâce à une indiscrétion — fort inquiet d’avoir laissé
trop apparaître, dans le langage qu’il nous avait tenu, ses
sympathies pour la Belgique.
Qu’il eût des sympathies pour la Belgique dès ce moment,
tout porte à le croire. On en trouve la trace dans les papiers
intimes du colonel House, son confident, qu il appela « un
second moi-même ». Le cynique chiffon de papier de BethmannHollweg l’indigna. Il se montra très affecté de la destruction de
Louvain et condamna les méthodes de guerre de l’Allemagne
et sa philosophie, laquelle lui paraissait égoïste et dénuée de
tout spiritualisme.
Mais ce n’étaient là que les sentiments humains d’un
témoin, non l’attitude d’un chef d’Etat.
Wilson avait prescrit à son peuple une stricte neutralité,
c’est-à-dire un véritable esprit d’impartialité, de justice et de
bienveillance à l’égard de tous. Au milieu du déchaînement de
la violence et des passions, il voulait donner au monde un
exemple d’idéalisme pacifique. E t il alla jusqu à dire de la
guerre : « Elle ne nous touche en aucune façon », et plus^ tard,
même après le torpillage de la Lusitania, que l’on crut être le
signal de l’entrée des Etats-Unis dans la lutte, jusqu’à pro­
130
noncer cette phrase hautaine qui indigna les Alliés : « On peut
parfois être trop fier pour faire la guerre ! ».
Mais, pour comprendre le geste et le langage, il faut péné­
trer l’individu. C’était un pur Américain, qui avait concentré
sur la vie intérieure, politique et économique des Etats-Unis,
toutes ses études, ses préoccupations, ses forces intellectuelles.
Il avait publié des ouvrages sur l’histoire américaine, sur les
institutions américaines. Il était, nous raconte House, très
indifférent à la situation européenne. Après son élection à la
présidence, en 1913, il s’était consacré à la réalisation de son
programme démocratique : une réforme libérale du tarif des
douanes et, pour en compenser la réduction, un impôt fédéral
léger et progressif sur le revenu ; une législation sur le contrôle
des trusts bancaires et la réglementation des rapports entre le
capital et le travail. Les questions diplomatiques l’intéressaient
peu.
Il convient, d’ailleurs, de reconnaître qu’au début le
« neutralisme » présidentiel répondait à l’opinion américaine.
On l’approuvait de toutes parts. Seul, un esprit éminent, le
président Elliot, de l’illustre Université de Harvard, avait,
dès les premiers jours, préconisé l’intervention immédiate aux
côtés des Alliés. Mais la masse, étourdie par le bruit de la guerre,
stupéfiée par les bouleversements du vieux monde, ignorant
leurs causes, se sentait très loin de la catastrophe et se com­
plaisait en somme dans son immunité.
Peu à peu, les événements la secouèrent. C’est à protéger
la liberté des mers, le commerce neutre des Etats-Unis qu’en­
travait le blocus maritime des empires centraux, solidement
assujetti par la flotte anglaise, que s’employa d’abord la di­
plomatie américaine. Il y eut entre Washington et le Foreign
Office des moments de tension sérieuse. Puis letorpillage de
la Lusitania et du Sussex, et la guerre sous-marine à outrance
irritèrent la sensibilité et l’orgueil américains. Le colonel House
que Wilson envoya en Europe, et Page, son ambassadeur à
Londres, l’instruisirent et le stimulèrent. Le flux guerrier
monta. Les impondérables agirent. Les forces morales traver­
sèrent l’océan ; la tragédie belge remua les consciences.
Quand, en 1917, Wilson eut été réélu président, réélu par
la raison précisément qu’il avait préservé les Etats-Unis de la
131
guerre, Wilson, dont Roosevelt disait brutalement alors qu’il
associait la métaphysique la plus haut perchée au plus grossier
pragmatisme gouvernemental, Wilson rompit avec l’Allemagne
et lança son peuple dans la mêlée.
Le peuple américain s’y jeta d’un magnifique élan. Des
centaines de milliers de jeunes gens furent en quelques mois
équipés, dressés, transportés en France. E t l’apport aux Alliés
de ces fraîches légions décida de la victoire finale.
Cependant, pour juger cette période de la vie de Wilson,
il reste un problème angoissant à résoudre. E t je n’oserais le
trancher. Pendant longtemps, Wilson rêva le rôle d’arbitre et
de médiateur. Il imaginait une paix blanche dont il dicterait
les termes.
N’aurait-il pu, un an plus tôt qu’il ne le fit, donner à la
nation américaine l’ordre de marche ? Ne l’aurait-elle pas suivi,
s’il avait hâté l’initiative ? Dans ses Mémoires, l’ambassadeur
Page répond affirmativement, et le colonel House pense comme
lui. Ah ! s’il l’avait fait, que de désastres il eût épargnés au
monde ! Car c’est dans la dernière année de la guerre que
l’Europe épuisa son sang et ses ressources, ses réserves d’or et
de jeunesse.
Mais le loisir et peut-être les preuves me manquent pour
juger cette redoutable question d’histoire et de psychologie
politique.
Notre séjour dans la capitale nous permit d’aller à MountYernon déposer des fleurs sur la tombe de Washington. Dans
la délicieuse résidence agreste du fondateur des Etats-Unis,
sur les rives boisées du Potomac, nous vîmes la clef de la Bastille
dont La Fayette avait fait don à son ami, et nous signâmes le
Livre d’Or, sur la page même où s’étaient inscrits, quelques
années auparavant, le prince Albert et le général Jungbluth.
Avant de regagner notre quartier général à New-York,
nous nous arrêtâmes à Philadelphie, où notre consul général,
M. Hagemans, nous avait préparé une entrevue avec les mem­
bres de la municipalité. Ils dinèrent avec nous et je me rappelle
le speech de l’un d’eux, M. Porter, un quaker ennemi par dogme
religieux de la guerre et qui célébra avec une fervente éloquence
la résistance de la Belgique envahie.
Rentrés à New-York, nous y trouvâmes de nouveaux
132
collaborateurs, décidés à nous aider et, outre beaucoup d’autres,
un journaliste de talent, M. Bullard, mort il y a un an à Genève ;
M. Marburg, ancien ministre des Etats-Unis à Bruxelles ;
M. Franklyn, directeur de YEvening Post, et M. Seton W atson’
oncle de M. Grant Watson, alors secrétaire de la légation bri­
tannique à Bruxelles et dont le nom avait de l’autorité. Mes
collègues et moi nous nous partageâmes la besogne. M. Vandervelde se mit en rapport avec M. Gompers, chef des syndicats
travaillistes, et harangua les foules ouvrières. J ’écrivis, pour
la revue The Outlook, un article intitulé : Pourquoi la Belgique
a tiré l Epée. E t tous ensemble, avec l’assistance aimable et
laborieuse du jeune comte de Lichtervelde, nous préparâmes
une brochure sur la cause de la Belgique (The Case oj Belgium),
qui fut tirée à des milliers d’exemplaires.
La seconde partie de notre voyage commence alors. Nous
devions remonter au nord, aller à Boston, pousser une pointe
dans le Canada, à Montréal, puis de là passer à Chicago et,
en revenant, saluer l’ancien président Roosevelt.
Il serait vraiment superflu de relater en détail nos con­
versations et nos démarches, qui, toutes, avaient le même but
et qu une même pensee orientait, et de citer les notabilités avec
lesquelles nous prîmes contact à Boston, et spécialement à
1 L niversité de Harvard, a Chicago, à Montréal. Mais certains
traits méritent d’être notés, certains aspects, où parfois le
plaisant se mêle au sévère. Dans les circonstances les plus
sérieuses, dans les temps les plus graves, tout à coup le comique
luit comme un éclair. E t la mémoire en retient le reflet.
Quand nous arrivâmes à Boston, le temps était superbe
et torride. Une vague de chaleur s’était abattue sur cette belle
et charmante Athènes d’Amérique. Notre consul, un consul
honoraire, d’origine anglaise, nous proposa aussitôt de nous
rafraîchir chez lui. Il nous offrit un thé glacé. Dans le salon
d un joli cottage, nous vîmes sur la table un bassin d’argent
où un bloc de glace baignait dans une liqueur dorée. Chacun
de nous remplit sa tasse. M. Yandervelde, approchant la sienne
de ses lèvres, poussa aussitôt une exclamation de dégoût.
Horreur ! Ce thé froid était un rhum authentique et puissant !
Le soir, nous fûmes invités à dîner au club. Le consul
avait ordonné un repas succulent. Il aimait la bonne chère et
133
l’éloquence. Après le potage, il vida une coupe de champagne
et porta la santé du Roi ; après le poisson, il but du champagne
toujours, à la Reine et aux enfants royaux ; puis, de service en
service, aux Souverains alliés. Au dessert, il se leva, une carafe
d’eau à la main, et dit d’un ton d’indicible mépris : And now,
gentlemen, one word more ! Cold water for the Kaiser ! (Et main­
tenant, messieurs, encore un mot, de l’eau froide pour le Kaiser!)
A Montréal, une réception prodigieuse nous attendait, et
dont le souvenir vibre encore en moi.
Là, nous étions en pays allié, dans un Dominion britannique.
Pendant le trajet de Boston à la frontière, un fonctionnaire
vient nous trouver dans notre wagon et nous annonce que,
par exception, le train s’arrêtera à une petite station, Saint-John,
sur la demande des autorités. Nous arrivons. Sur le quai, des
centaines de personnes nous font une ovation. On brandit devant
nous deux drapeaux belges. On nous invite à y inscrire nos
noms. Le maire nous harangue en français.
A Montréal, la surprise est plus vive et plus profonde.
Le maire et le recteur de l’Université nous font entrer
dans le hall de la gare. D’une foule énorme jaillissent des
clameurs d’enthousiasme. Les mouchoirs volent. La fièvre
allume les yeux et les visages. On promène au-dessus des têtes
les portraits du Roi et de la Reine. On agite des bannières trico­
lores. Des hommes, des femmes, se précipitent au-devant de nous :
« Vive la Belgique ! » E t au dehors, quand on nous fait monter
en voiture, les étudiants détellent les chevaux et nous traînent
en triomphe jusqu’à l’hôtel. Ce fut un épisode inoubliable.
La journée du lendemain fut remplie de témoignages ardents
et spontanés d’admiration et de solidarité. Nous passons en
auto devant le collège de Mont-Saint-Louis. Les élèves sont
rangés le long de la façade et leur orchestre joue La Bra­
bançonne. Le soir, dans la vaste salle du Monument national,
un avocat renommé de Montréal, M. Monpetit, exalte la Belgique
et ses soldats, la Belgique qui renaîtra dans la victoire, la
Belgique « pays du droit vengé, des libertés conquises, de la
parole gardée », dans un discours qui, par l’inspiration, la
forme, le choix et le ton de l’expression, me parut être un modèle
superbe de mâle et noble éloquence.
134
Depuis la guerre, M. Monpetit est venu plusieurs fois chez
nous. Pour sa maîtrise oratoire et le culte qu’il voue à la langue
française, il a été élu membre de notre Académie de littérature.
Son discours du 24 septembre et tout le récit de notre visite
à Montréal ont été publiés dans un volume que je conserve comme
une relique (*).
Au retour de notre court exode en terre canadienne, nous
gagnâmes Chicago et nous y reprîmes notre rôle de missionnaires.
Un banquet groupa autour de nous les sommités du monde des
affaires et nous y pûmes rééditer le grand thème national.
Il y avait une colonie belge, presque exclusivement flamande,
dont était l’âme un médecin, le docteurVermeer, qui, autrefois,
avait fait de la politique à Londerzeel (2). On fraternisa et,
de tout notre cœur nous chantâmes ensemble Le Lion de Flandre
(De Vlaamsche Leeuw) et La Brabançonne.
Nous ne manquâmes point le pèlerinage classique au « Tem­
ple de la Mort ». C’est le nom sinistre que donne M. Duhamel
au stockyards de la maison Armour, gigantesques abattoirs
qu’emplissent l’odeur du sang et le cri éperdu des bêtes qu’on
égorge. Nous assistâmes au sacrifice mécanique des porcs et à
toutes les opérations qui se succèdent depuis l’holocauste jusqu’à
la mise en boîtes de la viande à peine dépecée, aussitôt cuite, et
découpée par des jeunes filles en collerette et en manchettes
blanches, qui, de demi-heure en demi-heure, vont se faire soigner
les doigts par les manucures de l’établissement.
Pendant les quarante-huit heures qui suivirent notre descente
dans ce nouveau cercle de l’enfer, je devins végétarien.
En quittant Chicago, nous allâmes à la rencontre du
colonel Roosevelt. C’était, après Wilson, la plus grande figure
des Etats-Unis. Il avait été, pendant huit ans, président de la
République. Son caractère se reflétait dans le titre du volume
qui réunit ses principaux discours, La Vie Intense, où, il y a
vingt-cinq ans, l’Europe fatiguée trouva une leçon d’énergie
et un mot d’ordre.
Il avait l’intrépidité du soldat, jointe à l’autorité de l’homme
d’E tat. Dans la guerre contre l’Espagne, en 1898, il commandait
un régiment de cavalerie devenu célèbre, les « Rough Riders »
(1) L em o nt, La M ission Belge au Canada. Publié par la Chambre de Commerce du district
de Montréal, 1914.
(2) Localité rurale importante dans les environs de Bruxelles.
135
(les Rudes Cavaliers). Sorti d’office, il alla chasser le fauve en
Afrique. Orateur, il avait prononcé des paroles qui révélaient
à la fois le sens civique et le culte du devoir moral. «La jus­
tice, avait-il dit, devrait régner non seulement d’homme
à homme, mais de nation à nation. » Il avait dit encore :
« Quand un homme a perdu la faculté d’enthousiasme pour
la justice, il vaudrait mieux pour lui et pour son pays qu’il
abandonnât la vie publique ».
B attu aux élections présidentielles de 1909, par Wilson,
chef des démocrates, il s’était séparé des républicains et avait
fondé un parti nouveau, le progressive party (le parti pro­
gressiste).
En 1910, il avait passé par Bruxelles et y avait été acclamé.
Nos souverains lui avaient fait grand accueil. Tout nous inci­
tait à croire que ses inclinations l’éloigneraient des fadeurs de
la politique neutraliste et que nous ferions jaillir de cet esprit ro­
buste un cri de protestation, un appel à l’honneur et à l’entr’aide.
M. Roosevelt nous donna rendez-vous le 27 septembre,
dans la ville de Cleveland, à l’hôtel, et nous invita à prendre
avec lui le premier déjeuner, le breakjast, à sept heures et demie.
La veille au soir, nous partîmes de Chicago et arrivâmes
de grand m atin à Cleveland.
Après un bain tonifiant, nous nous fîmes annoncer chez
l’ancien Président, qui occupait une confortable suite d’appar­
tements. C’est la politique qui l’avait attiré dans cette moyenne
cité. Il était en tournée électorale. Il travaillait pour la canditature de son ami Garfield, qui briguait le poste de gouverneur.
Pour décrire notre entrevue,j’aime m ieux,plutôt que de con­
fectionner un morceau littéraire, me borner à reproduire ici les
notes que je rédigeai quelques jours après, de mémoire toute
fraîche et d’un style sommaire, et que j ’ai retrouvées dans mes
dossiers. Les petites photographies instantanées ont plus de
relief que des agrandissements. Voici mon papier :
Nous sommes reçus par un sécretaire, auquel vient se
joindre M. Garfield, type britannique distingué, regard aimable
et intelligent. Le colonel entre. Présentations.
On sert le breakjast anglais : café, toast, cantaloupe (petit
melon savoureux), œufs, bacon. Tout le monde y fait honneur,
nul plus vaillamment que le colonel.
136
Longue conversation. Roosevelt parle l’anglais, comprend
très bien le français, prononce en français quelques phrases
indiquant une connaissance parfaite de la langue.
Il est dans la force de l’âge. Il a l’œil gris clair et hardi,
le regard mobile, luisant, un front bas, le nez petit et recourbé,
la mâchoire forte, la denture très blanche et régulière ; il ouvre
largement la bouche en parlant ; il a un mouvement de
mâchoire de carnassier ; la moustache courte, en brosse, se
retrousse. Il se penche vers son interlocuteur. Il a l’air de le
menacer d’un coup de dents. Un homme d’entreprise, d’initia­
tive, d’attaque.
Ce qu’il dit, cependant, n’a rien de menaçant ni de belli­
queux, ni même de particulièrement original.
Il explique qu’il est dans une position difficile, qu’il est
exclu de la direction des affaires, que, s’il avait le pouvoir,
il en aurait fait un autre usage que ceux qui le détiennent ;
mais qu’il ne peut actuellement défendre une politique contraire
à celle du Président des Etats-Unis, qu’il doit observer une cer­
taine discipline.
Il tourne en dérision les traités d’arbitrage que négocie
le Secrétaire d’E tat Bryan, qui s’imagine ainsi pouvoir arrêter
les armées en marche ; ce sont des traités sans sanctions, sans
police internationale, sans contrainte. Il ne veut d’autres trai­
tés que ceux qu’on a la puissance de faire respecter. Il veut la
paix, mais non pas toute paix quelconque. Il ne veut pas la paix
pour la paix. Il veut, et il y insiste, une paix juste qui réta­
blira le droit.
Il raconte que les Allemands lui ont envoyé un émissaire.
Celui-ci s’est plaint d’un article qu’il a publié dans la revue
The Outlook, a essayé de le gagner à la cause de l’Allemagne,
lui a rappelé qu’il était l’ami du Kaiser.
—
Oui, a-t-il répondu, mais je suis aussi l’ami du Roi et de
la Reine des Belges.
Ici, la conversation dévie. M. Yandervelde l’entraîne sur
une voie divergente. Il parle socialisme. M. Yandervelde a un
incoercible esprit de prosélytisme. Il tient à expliquer sa doctrine,
la position du socialisme dans la guerre, le rôle du socialisme
en Europe. Aussitôt, Roosevelt, qui fut toujours un homme
d’action et non d’idéologie, apôtre de l’énergie individuelle,
137
excitateur de l’effort personnel, et plutôt belliciste et conquérant
de tempérament et de penchant, car il avait fait la guerre et
au fond, il l’aimait, s’applique avec sollicitude et en souriant
à satisfaire mon éminent ami. Il cherche à faire comprendre
qu’il est un peu socialiste sans l’être tout à fait, mais que le
socialisme européen suscite en lui une vive curiosité, qu’après
tout il est socialiste d’une certaine façon. Nous connaissons ce
genre de coquetterie, de complaisance ou de snobisme, assez
fréquent chez de grands bourgeois, et qui permet de se donner,
sans rien compromettre, des airs avantageux d’esprit avancé.
Je n’accuse pas Roosevelt d’avoir joué ce jeu. E t peutêtre se bornait-il à des gestes et à des paroles de bienveillance
pour l’homme d’E tat belge qui venait aux Etats-Unis plaider
la cause de son pays.
Mais M. Yandervelde le prit au mot, car, il y a un an,
dans un article du Peuple, racontant avec quelque inexactitude
notre entrevue de Cleveland, et non, comme il dit, de Colombo,
il rapporta que Roosevelt lui déclara etre « un socialiste de
droite » et n’avoir pas de plus ardent désir que de venir en
Europe visiter les Maisons du Peuple (1). Toujours est-il que,
tandis que le colonel déployait sa courtoise phraséologie, à
nuance rougeâtre, M. Garfield se pencha vers moi et me dit
à l’oreille :
— Il est beaucoup moins socialiste qu’il ne le fait croire.
Je répondis :
— Je m’en doute bien.
Mais ses dissertations nous éloignaient de la question
belge, et je les interrompis pour revenir au sujet capital de notre
entretien. Je reprends ici mes notes cursives, qui datent de
l’époque.
Roosevelt avait dit :
— E t maintenant, gentlemen, que puis-je faire pour vous ?
Tout ce qu’il m’est possible de faire pour la Belgique, je le ferai.
Je répondis :
— Nous comprenons les devoirs qu’implique la politique
de neutralité qu’il a plu aux Etats-Unis d adopter et la reserve
qu’elle vous impose. Mais il y a deux choses que nous pouvons
(1) Le Peuple, 11 mars 1929.
138
demander au peuple américain : l’une, ce sera, au moment des
négociations de paix, du settlejnent, de soutenir la Belgique,
d’assurer le maintien de son indépendance et la reconstitution
de son territoire.
Roosevelt acquiesce aussitôt et déclare qu’il n’y a pas de
doute à ce sujet.
— L’autre, continuai-je c’est d’intervenir immédiatement
par une action morale, pour prévenir de nouveaux excès, et par
exemple (ici je faisais allusion à des bruits alarmants qui cou­
raient la presse américaine) la destruction de Bruxelles où les
Allemands auraient fait des travaux de défense et qu’ils
pourraient sacrifier dans un accès de rage (on racontait qu’ils
avaient miné la Grand’Place et feraient sauter l’hôtel de ville).
Roosevelt s’écrie :
— C’est cela ! L’idée est exellente. Je vais en faire le sujet
d’un article. Je dois en écrire un aujourd’hui même. Ce sera mon
thème...
Il me remercie à plusieurs reprises, affirme qu’il va em­
poigner la question, qu’il en fera quelque chose...
Peu après, nous nous séparons. Avant de nous quitter
je cause avec M. Garfield. Il revient sur les tendances socialistes
que Roosevelt a esquissées et les nie. De mon côté, je lui dépeins
ma couleur politique, dont M. Porter, à Philadelphie, m’avait
dit qu’elle ferait de moi, aux Etats-Unis, un adepte des opinions
de Roosevelt.
— Vous seriez, m’avait-il dit, du progressive party, ce dont
je ne suis d’ailleurs pas certain du tout.
Mais, pour l’avoir raconté à M. Garfield j ’obtiens aussitôt
un sourire ravi, une large poignée de main et le don de l’in­
signe du parti, un petit buffle en cuivre (bull moose).
Je devais revoir M. Garfield quelques années plus tard.
En 1926, je le rencontrai chez M. Philipps, le charm ant ambas­
sadeur des Etats-Unis à Bruxelles. Il venait m’inviter à faire
pendant l’été des conférences de politique internationale à
l’Institut des sciences politiques de Williamstown, invitation
à laquelle je ne pus donner suite, car, depuis peu éloigné du
gouvernement, j ’y fus rappelé quelques semaines plus tard.
Roosevelt ne tarda pas à secouer la discipline présidentielle.
Il préconisa de plus en plus vigoureusement l’intervention
139
des Etats-Unis. Après le torpillage de la Lusitania, en mai 1915,
il demanda la guerre et ouvrit campagne contre Wilson.
Quand l’Amérique envoya sa jeunesse armée en France, les
deux fils de Roosevelt en furent. Tout deux tombèrent blessés
sur le champ de bataille ; l’un succomba. Roosevelt ne lui sur­
vécut que quelques mois. Il mourut d’une embolie, en janvier
1919, au moment où s’ouvrait la Conférence de la Paix.
Le 27 septembre, le jour même de notre visite chez Roo­
sevelt, nous quittâmes Cleveland pour Buffalo, d’où nous
allâmes, pendant un court intervalle de repos, rafraîchir nos
yeux à l’aspect des chutes du Niagara. De là, nous rentrâmes
à New-York. Ce fut notre dernière étape.
Notre troisième séjour à New-York nous réserva l’occasion
d’une ultime propagande. Nous avions tenté précédemment
d’approcher un personnage considérable, M. Nicolas Murray
Butler, président de l’Université de Columbia, l’un des grands
centres de la pensée américaine. Aux Etats-Unis, les fonctions
de la présidence universitaire sont entourées d’un prestige
imposant. E t l’homme lui-même occupait un rang élevé,exerçait
une forte influence personnelle. Mais on nous avait déconseillé,
au début, de chercher à forcer son accueil ; il valait mieux
attendre que, spontanément, il nous fît signe et nous appelât.
Dès notre retour à New-York, M. Butler nous invita à
venir causer à l’Université avec quelques sommités de la
science. Il convoqua les doyens des Facultés et, dans une réunion
intime, nous fûmes priés d’expliquer la position internationale
de la Belgique, la politique de neutralité que le gouvernement
belge avait suivie jusqu’à l’ultimatum, l’origine et la portée
du régime de la neutralité garantie, les conditions dans lesquelles
la guerre nous avait été soudain déclarée.
Nos explications satisfirent nos interrogateurs à un tel
point que M. Butler voulut donner plus de retentissement à notre
cause. Il offrit en notre honneur un grand dîner dans son opulent
hôtel de Riverside Avenue. Nous nous y trouvâmes entourés
de tous les rois de New-York, les rois du pétrole et de l’acier,
les rois du lard et des chemins de fer, les seigneurs de la banque
et des mines.
Quant le repas fut terminé, une épreuve me fut infligée.
Tous les professeurs de l’Université avaient été invités à passer
140
la soirée chez leur président. Dans un vaste salon, qu’ils rem­
plissaient, une petite table, recouverte d’un tapis vert, m’at­
tendait. E t je fus prié d’exposer de nouveau, en anglais,
pour ce redoutable auditoire, the case oj Belgium. J ’avais fini
par acquérir, dans cette spécialité, une certaine audace, quelque
virtuosité. E t l’assemblée fut convaincue.
Les conversations suivirent le discours. Nous nous répan­
dîmes en développements. E t nous quittâmes l’hospitalière
demeure du président de l’Université avec la conviction que
nous avions conquis pour la Belgique la sympathie de tous.
De tous sauf un : c’était un professeur d’origine et d’accent
germaniques, allemand de sang et de cœur, qui, sans prendre
ouvertement parti contre nous, nous opposa des objections faciles
à réfuter, mais obstinées et dénotant une hermétique hostilité.
Ce fut en somme une excellente soirée, qui donna à notre
mission de propagande une conclusion efficace et fructueuse.
J ’ai, depuis, revu plusieurs fois M. Butler en Europe et
je suis resté en relation de correspondance avec lui. Il devint
très vite un ardent allié de la Belgique. Il fut l’un des promoteurs
de la souscription pour la réédification de la bibliothèque
de l’Université de Louvain. Il préside le collège qui dirige la
propagande intellectuelle de la Fondation Carnegie. Ses brochu­
res, ses discours, ses articles dans les revues, sont imprégnés
d’un esprit largement international et compréhensif, et témoignent
d’une forte culture historique et de hautes inspirations philoso­
phiques. Il est resté au loin, pour la Belgique et pour moi, un ami.
Le 30 septembre notre mission s’achève. Nous nous embar­
quons pour l’Europe, sur un magnifique paquebot de vingtquatre mille tonnes, YAdriatic.
Nous partîmes avec l’impression que nous avions fait œuvre
utile. Les événements, dans la suite, montrèrent que la cause
belge fut l’un des stimulants de la politique américaine. Elle
remua les profondeurs sentimentales de l’opinion ; House et
Wilson, inspiré par lui, ne perdirent jamais de vue, parmi
les buts du règlement définitif, la restauration complète de la
Belgique dans son entière souveraineté, et le Président l’inscrivit
en termes solennels dans les quatorze points où il fixa son pro­
gramme de paix.
Sans doute la mission belge de 1914 ne saurait s’attribuer
141
le mérite d’avoir déterminé cette politique. Mais elle révéla la
Belgique aux Etats-Unis, éclaira les chemins et jeta les pre­
mières semences.
Quatre ans et demi plus tard, je devais revoir le Président
Wilson à la Conférence de Paris, plaider devant lui la révision
des traités de 1839, travailler sous sa direction à l’élaboration
du pacte de la Société des Nations.
Sans doute c’était un homme de pure doctrine. On a dit
avec raison, parfois, que, fondamentalement américain, il ne
connaissait, ne comprenait guère l’Europe ; mais il était désin­
téressé. Son idéal avait de la noblesse. Il cherchait à réaliser
la justice intégrale, l’union des peuples, la paix des cœurs et
des intérêts. Son nom est attaché à la Société des Nations ;
mais sa gloire vient moins de l’avoir conçue que d’avoir lutté
pour elle. La pensée première, l’initiative appartient à House
et à Grey beaucoup plus qu’à lui. Mais il com battit pour elle à
Paris, et, rentré en Amérique, il succomba en s’épuisant pour
la faire reconnaître par son pays.
Je n’ai pas rencontré House lors de mon voyage en 1914.
Je me liai avec lui pendant la Conférence de la Paix. Cet homme
discret et instruit, plein de tact et de finesse, apporta à la Belgique
un appoint inestimable. C’est lui qui, le premier, songea à la
priorité belge, qu’il nous fut si difficile d’obtenir, puis de faire
respecter, et qui nous valut, par privilège sur les payements
de l’Allemagne, une somme de deux milliards et demi de francs or.
La priorité, jointe à l’annulation de nos dettes de guerre, assura
la prodigieuse restauration de notre pays (1). Ceux-là l’oublient
trop facilement qui se complaisent, sans examen, à exalter leurs
déceptions !
A l’époque où je visitai quelques centres des Etats-Unis,
le débat sur les contradictions et les rivalités des deux civili­
sations, l’européenne et l’américaine, n’avait pas commencé.
Je connaissais l’américaine par l’ouvrage classique de Lord
Bryce et le petit livre profond et clair du professeur Boutmy.
Aujourd’hui, les livres foisonnent. Beaucoup ont lu ceux de
Siegfried et de Duhamel, et tous Babbit assurément. Je n’oserais
(1) Ces sommes peuvent être évaluées en francs belges d’aujourd’hui pour la priorité à 25
milliards et pour les dettes de guerre à environ 50 milliards.
142
en dire autant de l’énorme, pesante et diffuse Psychoanalyse du
comte de Keyserling.
Mais cette controverse n’est pas mon sujet. Au surplus,
le règne du jazz, du cinéma, de la radiophonie ne s’affirme
qu’après 1914. E t l’on ne discutait pas encore le taylorisme et
la standardisation.
Mais je tiens à dire que je rencontrai aux Etats-Unis beaucoup
d’hommes d’esprit ouvert et de cœur chaleureux, avides de
savoir, et quelques-uns d’une culture supérieure ; beaucoup
de femmes gracieuses de ligne et de visage, et parfaitement
distinguées ; et, en général, je trouvai partout un accueil simple
et vraiment humain, une prompte inclination à s’échauffer
contre l’injustice et la violence, le respect inné du droit, c’està-dire, en somme, d’incontestables forces spirituelles. Maintes
fois, dans la rue, des personnes de la petite classe nous arrêtèrent,
nous dirent :
—
Que la Belgique vive longtemps ! Que Dieu bénisse la
Belgique !
E t c’était l’âme qui parlait.
Sans doute j ’ai vu des paysages urbains et ruraux qui ne
ressemblent pas à ceux de chez nous. Mais les gratte-ciel de Wall
Street font figure de cathédrales de la finance et leur destination,
leurs dimensions, leur impriment un style ; le soir des milliers
de lampes, à toutes les fenêtres de tous les étages, dessinent
dans le ciel enfumé un décor étincelant. Des disparités heurtent
nos yeux, déconcertent notre sens de l’harmonie et des valeurs.
A côté d’un building massif, une chapelle se dissimule modes­
tement. Mais ces contrastes révèlent le caractère même de ces
cités en état de prodigieuse croissance. E t il ne faut pas chercher
aux Etats-Unis une copie de l’Europe, mais un autre monde,
jeune et neuf, où l’on découvre, avec des gaucheries et des
discordances, un immense travail d’organisation et de dévelop­
pement.
Un monument me charma. C’est la Bibliothèque de Boston,
de style classique d’ailleurs : au centre, un atrium qu’entourent
des galeries où les jeunes gens studieux lisent à l’ombre, des
murs ornés de fresques de Puvis de Chavannes et de toiles de
Sargent, et une délicieuse salle de lecture pour enfants.
J ’ai vu l’Université de Princeton, ses préaux paisibles
143
et ses fraîches pelouses, les bosquets centenaires et les prés
de Mount-Vernon, et, dans les campagnes, autour des grandes
agglomérations, des rangées de villas coloniales dont les jardins
fleuris se touchent sans haies ni clôtures. Au long des routes,
on aperçoit des maisons villageoises qu’on dirait déposées sur
le sol comme au hasard et qu’on croirait pouvoir déplacer sans
inconvénient. Elle ne sont pas, comme les nôtres, incorporées
à la terre, ne formant qu’une famille avec le site où elles semblent
avoir planté leurs racines et poussé avec les arbres.
Le spectacle de la rue, avec le mouvement intense et hâtif
des piétons et des voitures, la sonorité métallique des lignes
ferrées qui surplombent, m’amusèrent sans m’étourdir. Un jour,
à New-York, je vis, de notre automobile, un immense cortège
qui dévalait dans une même direction, d’un courant continu
et régulier. Je demandai à notre consul, qui nous servait d’obli­
geant cicerone :
— Est-ce une manifestation ? Tous ces gens vont-ils à
une cérémonie publique, ou à une fête populaire ?
Il me répondit :
— C’est l’heure de la fermeture des bureaux ; ils vont à la
prochaine station prendre le train qui les ramènera chez eux.
Tout cela est bien différent de notre antique Europe.
Mais pourquoi la civilisation nouvelle et l’ancienne se com­
battraient-elles, ou pourquoi l’une devrait-elle écraser l’autre
ou la supplanter ? Les civilisations ne sont pas faites pour
s’entre-tuer, mais pour s’interpénétrer, se vivifier par des em­
prunts, des reflets et des échanges.
Mais je m’arrête, et je termine par le récit sommaire de notre
retour, aux premiers jours d’octobre 1914.
Il
n’y avait que peu de monde sur le bateau : une cinquantaine
de jeunes Canadiens qui allaient s’engager en Angleterre,
quelques jeunes femmes qu’appelait la mission d’infirmière.
Le soir, ils dansaient et chantaient.
Mais la mer était mauvaise, le vent dur, le ciel sombre
et bas.
Des marconigrammes incomplets nous parvenaient. Nous
y devinions la réalité. Les Allemands attaquaient Anvers.
Nous nous promenions longuement sur le pont, inquiets et
silencieux.
144
Le 8 octobre nous arrivons à Liverpool. Au moment de
monter dans le train de Londres, j ’achète le Times, je l’ouvre,
je vois un titre en gros caractères, et je crie à mes amis :
— Anvers est tombé !
Le 9, je rejoignais le gouvernement belge à Ostende, où
ma femme m’attendait.
Le 13 nous nous embarquâmes pour le Havre.
L’armée, la veille débandée sur la plage, reformait ses
rangs et s’apprêtait à marcher vers Dunkerque.
Le drame de l’Yser commençait. E t ceci, c’est une autre
histoire !...
145
TABLEAU DE GUERRE
22 janvier 1915
C’est en Flandre, sur le sol belge, au mdieu de notre armée,
sous notre ciel natal chargé de nuées que perce un pâle rayon
de soleil d’hiver. La mer est forte. Le vent souffle du large,
courbe l’herbe jaunie des dunes, fait voler le sable.
Sur la plage, des troupes qui s’exercent défilent, clairons
sonnant. Des soldats déambulent par groupes, la pipe aux
dents, regardant se briser les vagues. Des cavaliers galopent,
courbés sur leurs montures que fouette la rafale. Partout la vie,
âpre, rude, martiale. L’ennemi est à 15 kilomètres d’ici, der­
rière la nappe de l’Yser. De temps à autre, des profondeurs
de l’horizon, surgit une rumeur sourde, c’est le canon.
Sur la terrasse d’une villa, une quarantaine d’hommes
viennent se ranger, de tous grades et de toutes armes, des
officiers supérieurs à moustaches grises, de simples soldats,
petits et tout jeunes, au visage imberbe, de vieux sergents
chevronnés, des lieutenants d’allure fière, et parmi eux, un
aumônier et un médecin. Silhouettes droites, figures franches,
regards clairs.
Ce sont des héros, le Roi va les décorer. Ils auront la croix
de l’Ordre de Léopold ou la Légion d’Honneur, ou l’Ordre de
la Couronne, ou la médaille militaire.
Ils s’alignent au hasard ; à côté d’un capitaine, un soldat,
sans préoccupation de hiérarchie. Pourquoi les classer ? Ils
sont égaux par le courage. Il n’y a pas de grades dans l’héroisme.
On m’a dit leurs hauts faits. On m’a montré les récits
de leurs prouesses, de style simple et concis, sans recherche
d’effet, mais de quelle éloquence !
Celui-ci s’est spontanément offert, la nuit, pour une mission
périlleuse ; celui-là courut, au milieu des balles, chercher
son officier tombé ; l’un, par son sang-froid, son intrépidité a
entraîné ses hommes qui hésitaient, ou a réussi à réatteler ses
pièces qui risquaient d’être prises. L’autre a, sous le feu de
146
l’ennemi, jeté une planche sur un cours d’eau et a passé le
premier, m ontrant le chemin à ses camarades. Ce petit sergent
a donné un bel exemple en revenant sur la ligne de feu après
avoir été deux fois blessé, et ce capitaine a déployé une rare
force d’âme en continuant à commander sa compagnie quoique
grièvement atteint et tout couvert de sang.
Quel poème épique vaut ces rapports sommaires, écrits
après la bataille, et dont les formules brèves exaltent les plus
nobles vertus humaines : le sacrifice, l’abnégation, le mépris
de la mort !
Le Roi paraît. Tous se raidissent, saluent. Le Roi passe
lentement, s arrete devant chaque homme, interroge longuement,
écoute, sourit, fait un signe d’encouragement. On n’entend
point les paroles qui s’échangent, mais on les devine sobres et
cordiales. Les soldats regardent le Roi de face, répondent sans
timidité. Le Roi reçoit des mains d’un de ses aides de camp
une boite, l’ouvre, attache sur la poitrine du soldat ou de l’ofcier une croix ou une médaille ; souvent pour le simple soldat,
pour le petit caporal qui cambrent le torse, c’est la croix de
l’Ordre de Léopold !
Puis quand le Roi a terminé la revue, il se place devant
la petite troupe et la harangue.
Il
parle sans gestes, d’une voix mâle, appuyant sur certains
mots, m artelant la fin d une phrase. Il a le ton du chef, sans
emphase et sans morgue. De sa haute taille, il les domine tous.
Il a le teint hâlé, l’œil qui commande; la guerre a façonné
ce visage, les méplats sont d’un modelé plus ferme, les traits
plus accentués. La ressemblance avec Léopold Ier s’accuse.
Au vol du discours, que scande le vent, je saisis des phrases :
« Vous avez combattu à Liège, à Anvers, sur l’Yser, dans
la boue et sous la mitraille et vous n’avez pas bronché ; le pays
est fier de vous... Je vous félicite et place en vous toute ma
confiance.
»Vous avez soutenu vos camarades au combat par votre
courage et votre foi... L’intrépidité est la plus belle vertu
militaire...
» Nous luttons pour la defense de nos foyers et le patrimoine
sacré des ancêtres... Nous voulons rester Belges...
» Si de toutes parts, du pays envahi comme des centres
147
de réfugiés, nous viennent chaque jour des témoignages de
confiance dans les destinées de la patrie, c’est à notre glorieuse
armée, à ses héros, à vous que cet hommage est rendu. »
Le Roi porte la main au képi et se retire.
Derrière le rideau d’une fenêtre entr’ouverte de la villa,
la Reine a tout vu, tout écouté. Elle surgit brusquement et,
vive, fine, souriante, dans un costume gris très simple, elle
va serrer la main d’un des plus braves de cette cohorte d’élite.
Tout cela fut très court, très simple et très grand. E t j ’en
garde au fond du coeur une émotion sacrée.
148
LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE A LONDRES,
LES 21 JUILLET 1916 ET 1917
Pendant que je dirigeais à Londres la Légation de Belgique,
je m’attachai à donner de l’éclat à nos fêtes nationales. C’était
l’occasion d’unir la vaste colonie belge dans l’expression des
sentiments de fidélité, des souvenirs, des espérances qui lui
faisaient, pendant ces jours d’exil et d’anxiété, une seule âme.
En novembre, pour célébrer la fête du Roi, un Te Deum
était chanté à la Cathédrale de Westminster. Le Cardinal
Bourne assistait à l’Office. Au premier rang se dressait la haute
et noble silhouette de la Princesse Clémentine, qui incarnait
la Famille Royale. Le Lord Maire représentait la Cité. La
Cour et le Gouvernement envoyaient des délégués. C’étaient
d’émouvantes solennités religieuses.
J ’eus, en 1916, l’idée d’organiser une imposante mani­
festation anglo-belge qui attesterait l’intime amitié des deux
peuples, qui fortifierait notre cause, en exaltant le patriotisme
belge et en affirmant la volonté britannique de la soutenir
jusqu’au bout.
L’entreprise fut admirablement réalisée le 21 juillet 1916,
anniversaire de la proclamation de l’Indépendance Nationale,
Belgian Indépendance Day.
J ’obtins du Premier Ministre Asquith qu’il viendrait
parler à l’Albert Hall. Il fut convenu que je prendrais la parole
le premier pour le saluer, et que M. Standaert, député de
Bruges, parlerait le dernier en flamand. Enfin, la grande canta­
trice Clara Butt, pour terminer la céremonie dans une atmos­
phère de ferveur et de joie, ferait entendre les accents de sa
voix pathétique.
Le moment était propice. La résistance civile dans le ter­
ritoire occupé, comme la résistance de l’armée, sur l’Yser,
stimulaient l’estime et la solidarité qui attachaient l’opinion
anglaise au sort de la Belgique.
L’Albert Hall est un immense vaisseau, à l’intérieur duquel
dix mille spectateurs peuvent trouver place.
149
La salle se remplit d’une assemblée fiévreuse, où Belges
et Anglais se coudoyaient. La haute société de Londres et les
notabilités de notre colonie occupaient les loges. L’afïluence
populaire bourrait les galeries supérieures.
J ’avais l’ambition de prononcer un discours qui lentement
échaufferait la foule et qui, lorsque le degré final aurait été at­
teint, déclancherait tout à coup un geste unanime d’enthousiasme.
Je voulais que d’un seul mouvement elle se levât, agitant
les mouchoirs et criant : Vive le Roi ! Je devais, pour y réussir
préparer une phrase sonore, rythmée, entraînante, la conduire
par un crescendo soutenu jusqu’au sommet et lancer d’en
haut le cri comme une fusée.
Voici comment je rédigeai le morceau.
Après avoir décrit le front indissoluble soudé par les Belges
autour du Roi, j’écrivis :
« Le Roi est le symbole vivant de leur unité.
« Ils le connaissent et ont joi en lui. De loin ils le contemplent
et Vaiment et l'admirent.
« Ils Vespèrent, ils rappellent, ils Vattendent : Vive le Roi ! ».
Je répétai dans mon cabinet dix fois, vingt fois, ces trois
paragraphes.
Il fallait commencer lentement et articuler avec netteté
pour se faire entendre d’un énorme public, dans une salle de
cette ampleur.
Il fallait débuter sur un ton mineur, et puis monter, éche­
lon par échelon, en élevant le diapason et pressant 1 élocution
jusqu’à l’appel final.
J ’avais alors une voix claire et qui portait. Mais je craignais
de ne pas réussir et de ne décrocher qu’une salve d’applaudis­
sements.
L’effet dépassa mon espoir.
Je vis, en parlant, les visages se tendre, les yeux s’allumer.
E t quand, le bras étendu, je jetai les trois derniers mots, l’im­
mense auditoire, d’un élan fébrile se dressa, et au milieu de
frénétiques acclamations, des milliers de mains agitèrent les
mouchoirs.
Ce fut un inoubliable moment. E t, pour moi, mon plus
beau succès oratoire.
Le discours de M. Asquith remua le public belge par la
150
sincérité de l’hommage rendu à la Belgique et la promesse
catégorique de l’assistance britannique jusqu’au bout.
La présence du Premier Ministre nous donnait un témoi­
gnage vivant de sûre amitié. Asquith était alors au faîte de son
autorité. Il joignait au prestige de sa fonction celui d’un caractère
loyal et d’une éloquence qui dominait le Parlement.
Cette éloquence était très différente de l’éloquence française,
plus sobre dans les termes, plus réaliste dans la substance,
dépourvue de grands gestes et dédaignant l’effet vocal.
Asquith parlait une belle langue dont les Anglais admiraient
la pureté et le style. Mais, dans les moments mêmes où il pro­
nonçait les mots les mieux choisis pour donner à la pensée
de la force et de l’émotion, il gardait un visage impassible,
ne haussait pas le ton et esquissait à peine un mouvement du
bras ou de la main.
Physiquement, il donnait l’image de la franchise, du sangfroid, de l’équilibre. Il était simple d’allures : carré d’épaules,
de taille moyenne ; la tête aux cheveux blancs, le masque
rappelaient un peu Frère-Orban avec le menton moins accentué,
des traits moins nettement dessinés, une expression moins
sévère.Dans la conversation, il était affable et accueillant, mais
peu expansif.
Deux phrases du discours d’Asquith portèrent vivement.
Rappelant la réponse belge à l’ultimatum allemand, le
Premier Ministre dit :
« Jamais résolution aussi héroique ne fu t prise par un petit
Etat depuis que, dans Vantiquité, Athènes et Sparte acceptèrent
le défi de la Perse et de V Orient. »
Enfin, me chargeant d’un message au peuple belge: «Dites
à vos compatriotes, s’écria-t-il en terminant, que lorsque viendra
Vheure de la délivrance, ce sera pour nous en Grande Bretagne
un sujet d'indicible fierté de nous rappeler que nous avons collaboré
à leur rendre cette indépendance et cette liberté auxquelles aucune
nation dans Vhistoire du monde n'a jamais eu un droit aussi incon­
testable. »
Tous les journaux de Londres consacrèrent des articles à cette
mémorable manifestation et mirent en lumière les engagements
de l’Angleterre, solennellement répétés par le Premier Ministre.
Une brochure fut publiée reproduisant les discours, avec
151
une préface qui décrit les scènes d’enthousiasme dont l’Albert
Hall fut le théâtre.
L’année suivante, le 21 juillet 1917, j ’invitai M. Lloyd
George qui avait succédé à M. Asquith, à assister à son tour à
la célébration de notre anniversaire national.
La cérémonie fut moins impressionnante. Elle se déroula au
Queen’s Hall, salle moins vaste que l’Albert Hall. La guerre
se prolongeait et l’attention se portait sur les opérations des
grandes armées et les péripéties nouvelles de l’immense cata­
clysme qui ravageait l’Europe.
Lloyd George vint et parla. E t comme le Chancelier du
Reich avait quelques jours auparavant prononcé un discours
qui appelait une réponse des Alliés, le Premier Ministre profita
du moment pour la faire, à notre tribune. Des journaux de
Londres le lui reprochèrent, estimant que les convenances poli­
tiques exigeaient que cette réponse se fit entendre dans l’enceinte
parlementaire, et revêtit, au milieu d’une atmosphère plus
grave, un caractère plus officiel.
Quoi qu’il en fût, le discours eut du retentissement et du
succès. Mais il ne toucha pas l’auditoire belge aussi directement
que le discours d’Asquith.
Tout d’ailleurs était contraste entre les deux hommes
et les deux éloquences.
Lloyd George est un Gallois, un Celte, avec de la verve,
du mouvement, des accès d’ardeur, d’ironie ou de colère. Le
geste anime la phrase. Le ton est vif et nerveux, celui d’un
polémiste, presque d’un tribun.
Les Belges l’acclamèrent, fiers de le voir parmi eux. Son
prestige grandissait. L’astre montait au zénith. Lloyd George
avec Clémenceau fut l’organisateur de la guerre et de la victoire.
Plus tard il devint pendant deux ans, une sorte de dictateur
de la paix.
Dans son œuvre diplomatique, comme dans la suite de sa
carrière politique, on relève des erreurs, des contradictions,
une instabilité de jugement et des légéretés qui ont fini par
éloigner de lui la confiance de la nation britannique et par le
réduire à l’impuissance.
152
UN DIPLOMATE AMERICAIN, W. H. PAGE
«Le Soir», 31 juillet et 7 août 1923.
Un livre récent met en relief une figure de diplomate améri­
cain qui passa discrètement à travers de grands événements, et
dont des lettres et des rapports, publiés par un biographe amical et
consciencieux révèlent de hautes qualités de caractère et d’esprit.
M. W. H. Page fut ambassadeur des Etats-Unis à Londres
pendant la guerre. Je l’y connus et j ’appréciai son affabilité,
et la sympathie qu’il ne cessa de témoigner pour la cause de la
Belgique. Mais, comme beaucoup, je crois, j ’ignorais les soucis
dont il fut accablé, et qui finirent par ruiner sa santé, et les efforts
qu’il fit pour hâter l’entrée de son pays dans la grande guerre
européenne. Sa correspondance offre le tableau d’une intéres­
sante psychologie d’Américain brusquement mêlé à un drame
inattendu, dans un vieux monde dont les traditions, les passions,
les rivalités, les petitesses et les gloires lui étaient inconnues,
et le frappaient tout à la fois d’étonnement, d’admiration et de
dédain.
M. Page avait, lors de l’arrivée au pouvoir de M.Wilson,
qu’il admirait et à l’élection duquel il avait collaboré, soudaine­
ment passé du journalisme à la diplomatie. C’était un bourgeois
aux manières simples, au langage sobre et cordial.
Le voilà, en 1913, promu ambassadeur à Londres, et jeté
dans une société aristocratique et brillante où sa dignité et son
rang lui valent un accueil empressé. Le monde politique anglais
est profondément divisé par la question irlandaise et par la poli­
tique financière du cabinet libéral, contre laquelle se dresse
toute la pairie britannique. Du dehors viennent des rumeurs de
guerre. On sent l’approche de la catastrophe.
Le conseiller intime du Président, le colonel House, alarmé
par ces bruits, songe à une tentative de pacification.
D’accord avec le Président et avec Page, il vient en Europe et
expose aux hommes d’E tat britanniques un plan utopique de
153
la guerre, au moins une ou deux fois par siècle, et quand ils ne
se battent pas, ils se préparent à se battre. Dès qu’ils se sont
enrichis, ils jettent dans la guerre ou dans ses préparatifs tout ce
qu’ils ont gagné. Us sacrifient le meilleur d’une génération sur
trois ou quatre, et ne laissent survivre que les moins aptes.
Ah ! rendez-moi l’oncle Sam et ses grandes fermes !...
E t plus tard, en 1916, à une époque où il agit aussi effi­
cacement qu’il le peut pour déterminer le Président à prendre
le parti des Alliés, à rompre avec l’Allemagne, il dit encore :
« L’Europe n’a rien à nous apprendre. Elle est demeurée mé­
diévale. » Il érige au sommet la démocratie américaine, ses
mœurs, ses institutions.
Mais il s’est mis à aimer l’Angleterre, l’art de la vie tel qu’on
l’y pratique, la courtoisie des relations, la fermeté, le stoïcisme
du caractère britannique, le goût, l’élégance de l’esprit français,
unis à tant d’énergie. E t dans une lettre familière à l’un des
siens, il donne ce conseil : « Ne raillez jamais un Français. Le
peuple de France est un grand peuple ».
Dès les premiers jours de la guerre, l’Europe tourna les
yeux vers l’Amérique. Les Etats-Unis étaient un énorme ré­
servoir de blé, de matières premières et d’argent. On y pourrait
organiser un formidable arsenal ou s’outilleraient les armées.
De quel côté pencheraient-ils ? A qui donneraient-ils leur con­
cours économique ? E t si un jour, ils prenaient la résolution
d’intervenir directement dans le conflit, n’était-il pas certain
qu’ils décideraient de la victoire ?
C’est sous l’empire de ces préoccupations que le gouverne­
ment belge, d’accord avec les gouvernements français et anglais,
envoya à Washington, en septembre 1914, une mission dont
je fus, avec MM. Carton de W iart et Vandervelde, pour initier
le Président Wilson aux horreurs de l’invasion allemande (x).
Pendant longtemps le Président s’enferma dans la doctrine
de la stricte neutralité, de « l’impartialité de pensée et d’action. »
Son ambassadeur à Londres, M. Page, d’instinct, parce
que l’agression prussienne l’avait révolté, et sous l’influence
du milieu britannique et de la proximité des événements, opta
dès le début pour les Alliés. « Un gouvernement, dit-il, peut
(1) Voir p. 121 et suiv. de ce volume.
156
se déclarer neutre. Un homme ne peut l’être.» E t il félicite
son secrétaire particulier, un jeune Américain qui s’enrôle :
« Si j ’avais votre âge, je m’enrôlerais moi-même.» Il répudie
la neutralité morale.
C’est dans son cabinet que furent arrêtées les grandes lignes
du plan de ravitaillement de la Belgique. Un Américain, M. Shaler,
arriva de Bruxelles et décrivit le péril de famine qui menaçait
les populations. M. Hoover le mena chez M. Page, qui à son tour
conduisit M. Hoover chez Sir Edward Grey. Bientôt vinrent
MM. Franqui et le baron Lambert. Quel serait l’Américain qu’on
chargerait de la direction de l’énorme entreprise qui s’élaborait ? Page se tourna vers Hoover et lui dit: «Vous êtes l’homme ».
Hoover ne répondit ni oui ni non, regarda l’horloge, et sortit.
Quant il rentra, il expliqua qu’il avait constaté qu’une heure
devait s’écouler avant la fermeture de la Bourse de New-York
et qu’il en avait profité pour acheter, par câble, quelques millions
de boisseaux de froment. Page aimait à raconter cette anecdote
pour montrer la rapidité de réflexion et d’action qui caractéri­
sait cet homme de cœur et d’affaires, chez qui de grands élans
de sentiment stimulaient l’esprit d’initiative et d’entreprise.
La première phase de l’activité diplomatique de Page à
Londres, est remplie par de pénibles négociations avec le gouverment britannique au sujet de la contrebande de guerre et du
commerce des Etats-Unis avec l’Allemagne. Le blocus des Em ­
pires centraux par la marine anglaise, irritait les intérêts du
négoce américain, que couvrait la neutralité.
Le gouvernement anglais, soucieux de ménager l’opinion
américaine, et Sir Edward Grey, qui au fond de lui-même ne
cessait de rêver une alliance qui assurerait le triomphe final,
se montraient d’une relative tolérance. Mais Washington
réclamait la liberté des mers, le commerce libre des neutres,
protestait contre les arrêts de navires et les saisies de cargaisons.
De là des incidents multiples que M. Page cherche à régler ami­
calement avec Grey, tandis que de Washington se succèdent
les lettres, les instructions, les notes du département d’E tat,
conçues dans un style désagréable, amer et rude qui exaspère
l’ambassadeur. Page s’en plaint au colonel House et ne mé­
nage pas M. Lansing, qui, ayant succédé à Bryan, traite les af­
faires diplomatiques de la guerre en juriste étroit, en procé­
157
I
durier incapable de saisir le sens des événements, M. Bryan
était un ineffable utopiste, avec des yeux d’enfant dans un
visage olympien. Je le vis en septembre 1914 à Washington,
Il ne trouva dans le drame affreux de l’invasion d’autre recom­
mandation à nous faire que de signer des traités d’arbitrage
qu’il venait de préparer, et où il voyait le salut du monde.
Quant àM. Lansing, je le rencontrai plus tard, à la Conférence
de la Paix, où le Président Wilson le laissa au second rang ; dans
l’affaire de la révision des traités de 1839 où il fut appelé
à intervenir, il se prononça dans un sens défavorable a la these
belge, et fit adopter, en juin 1920, par la Commission des minis­
tres des affaires étrangères, une décision qui restreignit singuliè­
rement le champ des négociations et les possibilités de solution.
Son entêtement de juriste l’emporta sur l’avis de l’expert
américain M. Haskins, qui connaissait admirablement les éléments
historiques et politiques du problème.
Lorsqu’en mai 1915 la Lusitania, torpillée par un sousm arin allemand, coula, entraînant dans les flots des centaines
de vies innocentes, M. Page crut, comme le colonel House, qui
se trouvait alors à Londres auprès de lui, que ce crime serait
le signal de l’intervention américaine. L’attitude du Président
Wilson le déçut, le blessa dans son amour-propre national et sa
conscience d’homme. Le Président répond à l’attentat par des
notes et des discours. L’ambassadeur s’en irrite, et rend compte
à Washington de l’énervement de l’opinion publique. Les Al­
lemands poursuivent sans merci la guerre sous-marine. Le Pré­
sident proteste, multiplie les notes et les prédications. En
Angleterre le dédain monte. On tourne en ridicule la démocratie
américaine. Les journaux illustres publient des satires et des
caricatures. Page, ulcéré, envoie, sans effet, au Président et
au colonel House des avertissements pressants. Prenez-garde,
écrit-il, je vous le dis solennellement : l’opinion et le gouvernement
anglais ont perdu toute estime pour nous et notre Président.
Nous ne la regagnerons qu’en agissant rapidement.
Mais on ne l’écoute pas. E t il insiste toujours. Quelques
semaines après le torpillage du Sussex, M. Wilson prononce
un discours où il déclare les causes et les objectifs de la guerre
indifférents aux Etats-Unis.
La correspondance de M. Page est une continue et ardente
158
protestation contre cette politique d’indifférence. Il appelle les
Allemands des brigands, et il décrit l’immense entreprise de rapine
qu’est l’occupation de la Belgique. «Vous ne comprenez pas
la guerre», écrit-il à House. Il cite des exemples de l’esprit
de sacrifice qui imprègne toutes les couches de la population
anglaise, et il reproduit une phrase qu’il a souvent entendue,
à Londres, et qui est vraiment caractéristique de la mentalité
britannique. Elle éclaire la politique de l’Angleterre de guerre
et d’après-guerre : «Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne
sommes pas un peuple belliqueux. Nous ne haïssons pas les
Allemands. Il n’y a chez nous aucun appétit de vengeance.
Mais puisque les Allemands ont entrepris de gouverner le
monde et de vaincre la Grande-Bretagne, nous mourrons d’abord.
E t voilà to u t...»
Tout à coup, le Président fait signe à M. Page et l’invite
à venir le voir à Washington. L’ambassadeur déjeune avec
M. Wilson. Il y a d’autres convives. La conversation touche
tous les sujets sauf la guerre. Il voit successivement les ministres.
Nulle part on ne parait s’intéresser aux grands aspects de la si­
tuation. Enfin, il obtient un entretien particulier avec le Président.
Il lui montre, sans parvenir à l’émouvoir, la médaille, l’affreuse,
la brutale médaille frappée en Allemagne pour commémorer la
destruction de la Lusitania. Il part avec l’impression que le
Président est isolé, vit cloitré dans ses idées, n’a aucun contact
avec les réalités du dehors qui bouleversent le monde, et qu’il
n’interviendra que pour tâcher de faire la paix.
La paix dont alors rêve M. Wilson, c’est la paix blanche,
c’est la paix sans victoire. E t, vers la fin de 1916, il fait une
tentative de médiation. Les Alliés la repoussent, et Lord Robert
Cecil déclare à l’ambassadeur, dans une entrevue au Foreign
Office, que l’Angleterre luttera jusqu’au bout. «Si les EtatsUnis aident l’Allemagne, dit-il en conclusion, la civilisation
périra. Si les Etats-Unis aident les Alliés, la civilisation triom ­
phera. »
Une année s’écoule, et voici que la lumière s’est faite dans
le cerveau de l’homme qui tient dans ses mains l’instrument
de la victoire. Le Président fait remettre ses passeports à
Bernstorff. C’est la rupture diplomatique, prélude de la déclara­
tion de guerre. On attend la nouvelle à l’ambassade anglaise.
159
V
Un coup de sonnette retentit. Le secrétaire se précipite. Il ren­
contre sur l’escalier un amiral anglais qui, hors d’haleine,
s’écrie: «Que Dieu soit loué!...» et montre un télégramme
reçu de l’attaché naval britannique à Washington.
En voici la teneur, bien militaire et vraiment pittoresque :
«Bernstorff vient de recevoir ses passeports. Je me griserai
probablement ce soir. »
Puis c’est à Londres, après la déclaration de guerre, l’en­
thousiasme déchainé, les démonstrations de gratitude du gou­
vernement, du Roi, de la foule. On célèbre à Saint-Paul un ser­
vice d’actions de grâce. Je m’en souviens, j ’y étais. Nous enten­
dîmes un sermon d’un évêque américain, qui, devant le Roi,
la Cour et les ministres de Sa Majesté, proclama que la guerre
serait désormais la guerre de la démocratie.
On hissa le drapeau étoilé sur la haute tour du Parlement,
où jamais jusque-là n’avaient flotté que les couleurs britanniques.
E t j ’entendis ce jour-là, dans une maison amie, un jeune et
brillant fonctionnaire anglais qui devait jouer plus tard un
rôle im portant à la Conférence de la Paix s’écrier, avec un ac­
cent de colère : « C’est la première fois que les Anglais voient
sur cette tour se déployer un drapeau étranger. J ’espère bien
que ce sera la dernière. »
Mais l’union du monde anglo-saxon était faite. Les soldats,
les armes, les vivres, allaient affluer du Nouveau Monde vers
l’Angleterre et la France. Bientôt l’aurore de la victoire blan­
chirait l’horizon. M. Page sent son cœur libéré, sa poitrine
s’ouvrir.
« Je n’avais jamais, écrit-il à son fils, douté du peuple
américain. » Mais il n’oublie pas cependant ses durs soucis,
les peines morales que lui avait infligées une si longue et dou­
loureuse attente, et il rédige, pour la satisfaction de sa conscience,
son jugement sur la politique du Président. C’est un jugement
sévère, le plus sévère que nous ayons lu.
Quant à lui même, il avait rempli sa tâche. Il plie sous
le fardeau des préoccupations, des angoisses, des devoirs qui ont
accablé son âme pendant plus de trois ans. Il donne sa dé­
mission, part pour l’Amérique ; ses forces s’en vont, et il meurt
sur le sol natal, ayant beaucoup aimé son pays, la liberté,
la démocratie, et beaucoup souffert des souffrances des autres.
160
LES RÉPARATIONS
LA PRIORITÉ BELGE ET LA LIBÉRATION
DES DETTES DE GUERRE
Discours prononcé à la Chambre
des Représentants le 15 juillet 1925
( Annales ParlementairesJ.
Je crois utile de rappeler, en quelques mots, devant la
Chambre, comment les délégués belges à la Conférence de la
Paix obtinrent le double et considérable privilège de la priori­
té et de la libération des dettes de guerre.
Ce fut une concession longuement négociée, vivement
debattue, obtenue finalement dans une séance du Conseil des
III, quelques jours avant la remise du traité de paix aux délé­
gués allemands.
Elle constitua pour nous la condition même de notre ad­
hésion au traité et c’est ce que je crois devoir faire ressortir
en ce moment, en relatant brièvement cet épisode des négocia­
tions de Paris.
La question des réparations avait été, dès le début de
la Conférence de la paix, renvoyée à une commission où la cause
belge fut défendue par M. Van den Heuvel, ministre d’E tat,
et par M. Maurice Despret, avocat à la Cour de Cassation et
président de la Banque de Bruxelles.
Les travaux de cette commission se prolongèrent pendant
plusieurs semaines sans arriver à un résultat définitif. Les reven­
dications des divers Etats s’y heurtaient et s’y entrechoquaient
sans qu’on pût aboutir à un accord.
Le Conseil des IV qui, bientôt, par suite du départ de la
délégation italienne, devint le Conseil des III, se saisit de l’af­
faire et la soumit à un collège d’experts.
161
Pendant qu’il se livrait à cette étude, je poursuivis de
mon côté, avec le Colonel House, la négociation relative à la
priorité de 2 milliards et demi de francs, dont l’idée, je tiens à le
proclamer, appartient au colonel House, esprit éclairé et géné­
reux, qu’anima toujours une vive amitié pour la Belgique.
Vers la fin d’avril, M. Loucheur convoqua M.Van den Heuvel
à une réunion qui eut lieu le 23 et à laquelle j ’assistai avec
mon collègue belge.
M. Loucheur nous donna connaissance des dispositions
que le Conseil des IV se proposait d’insérer dans le traité con­
cernant le règlement des indemnités à réclamer de l’Allemagne.
Déçu par ce projet, nous retournâmes chez M. Loucheur
afin de nous expliquer de nouveau sur les revendications de
la Belgique auxquelles satisfaction n’était pas donnée.
En même temps, le 24 avril, nous adressâmes à M. Clemen­
ceau Président de la Conférence, une lettre détaillée dans la­
quelle nous précisions les demandes de la Belgique que nous
avions déjà formulées antérieurement. Nous exprimions en
même temps le désir de discuter la question avec le Conseil
des III et la réunion que nous sollicitions fut fixée au 29 avril.
Je tenais le Cabinet de Bruxelles au courant de toutes
les phases de la négociation.
Le bruit se répandit que l’on refusait à la Belgique le
traitem ent auquel l’opinion estimait qu’elle avait droit, et
M. Delacroix, accompagné de M. Franck, vinrent me trouver
à Paris pour délibérer sur la situation.
Nous rédigeâmes ensemble une note complémentaire et
catégorique, que je remis au Conseil des III au début de la
séance. Celle-ci eut lieu dans le grand salon de l’hôtel du
Président Wilson. Le Président Wilson, M. Lloyd George et
M. Clémenceau y assistaient entourés de nombreux experts
techniques. MM. Yandervelde et Van den Heuvel m’accompa­
gnaient.
La discussion commencée à 4 heures, fut longue et pé­
nible ; elle se prolongea jusqu’à 7 1/2 heures.
Je donnai lecture des notes du gouvernement belge, ar­
rêtées de concert avec le premier ministre. Je réclamai le
paiement par l’Allemagne de toutes nos dépenses de guerre
et des dépenses pour le ravitaillement des populations de la
162
Belgique occupée, dépenses qui avaient été effectuées à l’aide
d’emprunts consentis par l’Angleterre, la France et les Etats-Unis.
Je réclamai notamment une priorité de 2 milliards et demi
de francs sur les premiers paiements faits par l’Allemagne.
Je développai l’ensemble de nos autres revendications.
Je les basai toutes sur la position spéciale de la Belgique
qui seule, de tous les peuples alliés, avait été entraînée dans la
guerre par la violation d’un traité qui garantissait sa neutralité.
J ’invoquai la déclaration de Sainte-Adresse du 16 février
1916 et les termes de la seconde des quatorze propositions
du Président Wilson, qui devaient servir de base à la négociation
de la paix.
Je montrai la situation faite au gouvernement belge par les
charges résultant des taxes de guerre dont les Allemands avaient
frappé les provinces belges pendant l’occcupation, par les dettes
qu’avaient dû contracter les municipalités en vue de pourvoir
aux nécessessités de la population civile, et je terminai en dé­
clarant que si nos revendications n’étaient pas agréées, que si
nous ne pouvions obtenir des assurances précises quant à la
part que la Belgique recevrait des indemnités allemandes,
notre devoir serait de soumettre la question tout entière
au Parlement belge.
On comprendra qu’il m’est impossible de rapporter ici
les réponses que me firent mes illustres interlocuteurs. Elles ne
restèrent pas sans réplique.
J ’intervins à nouveau et, de leur côté M. Van den Heuvel,
et Yandervelde firent entendre leur voix. M. Yan den Heuvel,
avec sa profonde connaissance du dossier des réparations qu’il
avait scrupuleusement étudié et son clair sens juridique, intervint
efficacement.
M. Vandervelde, à son tour, attira l’attention sur l’excep­
tionnelle gravité d’un refus opposé par les Alliés aux demandes
de la Belgique, qui étaient modérées et se réduisaient au strict
nécessaire dont le pays avait besoin. Il montra le développe­
ment du chômage - il y avait alors 900.000 chômeurs en
B elgique-et les charges qui en résultaient pour le gouvernement.
Il indiqua l’augmentation du prix de la vie et fit ressortir
la nécessité, si l’on voulait maintenir la paix sociale, d’assurer
la Belgique d’une restauration complète. Si satisfaction n’était
163
Pendant qu’il se livrait à cette étude, je poursuivis de
mon côté, avec le Colonel House, la négociation relative à la
priorité de 2 milliards et demi de francs, dont l’idée, je tiens à le
proclamer, appartient au colonel House, esprit éclairé et géné­
reux, qu’anima toujours une vive amitié pour la Belgique.
Vers la fin d’avril, M. Loucheur convoqua M.Yan den Heuvel
à une réunion qui eut lieu le 23 et à laquelle j ’assistai avec
mon collègue belge.
M. Loucheur nous donna connaissance des dispositions
que le Conseil des IV se proposait d’insérer dans le traité con­
cernant le règlement des indemnités à réclamer de l’Allemagne.
Déçu par ce projet, nous retournâmes chez M. Loucheur
afin de nous expliquer de nouveau sur les revendications de
la Belgique auxquelles satisfaction n’était pas donnée.
En même temps, le 24 avril, nous adressâmes à M. Clemen­
ceau Président de la Conférence, une lettre détaillée dans la­
quelle nous précisions les demandes de la Belgique que nous
avions déjà formulées antérieurement. Nous exprimions en
même temps le désir de discuter la question avec le Conseil
des III et la réunion que nous sollicitions fut fixée au 29 avril.
Je tenais le Cabinet de Bruxelles au courant de toutes
les phases de la négociation.
Le bruit se répandit que l’on refusait à la Belgique le
traitem ent auquel l’opinion estimait qu’elle avait droit, et
M. Delacroix, accompagné de M. Franck, vinrent me trouver
à Paris pour délibérer sur la situation.
Nous rédigeâmes ensemble une note complémentaire et
catégorique, que je remis au Conseil des III au début de la
séance. Celle-ci eut lieu dans le grand salon de l’hôtel du
Président Wilson. Le Président Wilson, M. Lloyd George et
M. Clémenceau y assistaient entourés de nombreux experts
techniques. MM. Vandervelde et Yan den Heuvel m’accompa­
gnaient.
La discussion commencée à 4 heures, fut longue et pé­
nible ; elle se prolongea jusqu’à 7 1/2 heures.
Je donnai lecture des notes du gouvernement belge, ar­
rêtées de concert avec le premier ministre. Je réclamai le
paiement par l’Allemagne de toutes nos dépenses de guerre
et des dépenses pour le ravitaillement des populations de la
162
Belgique occupée, dépenses qui avaient été effectuées à l’aide
d’emprunts consentis par l’Angleterre, la France et les Etats-Unis.
Je réclamai notamment une priorité de 2 milliards et demi
de francs sur les premiers paiements faits par l’Allemagne.
Je développai l’ensemble de nos autres revendications.
Je les basai toutes sur la position spéciale de la Belgique
qui seule, de tous les peuples alliés, avait été entraînée dans la
guerre par la violation d’un traité qui garantissait sa neutralité.
J ’invoquai la déclaration de Sainte-Adresse du 16 février
1916 et les termes de la seconde des quatorze propositions
du Président Wilson, qui devaient servir de base à la négociation
de la paix.
Je montrai la situation faite au gouvernement belge par les
charges résultant des taxes de guerre dont les Allemands avaient
frappé les provinces belges pendant l’occcupation, par les dettes
qu’avaient dû contracter les municipalités en vue de pourvoir
aux nécessessités de la population civile, et je terminai en dé­
clarant que si nos revendications n’étaient pas agréées, que si
nous ne pouvions obtenir des assurances précises quant à la
part que la Belgique recevrait des indemnités allemandes,
notre devoir serait de soumettre la question tout entière
au Parlement belge.
On comprendra qu’il m’est impossible de rapporter ici
les réponses que me firent mes illustres interlocuteurs. Elles ne
restèrent pas sans réplique.
J ’intervins à nouveau et, de leur côté M. Yan den Heuvel,
et Yandervelde firent entendre leur voix. M. Yan den Heuvel,
avec sa profonde connaissance du dossier des réparations qu’il
avait scrupuleusement étudié et son clair sens juridique, intervint
efficacement.
M. Yandervelde, à son tour, attira l’attention sur l’excep­
tionnelle gravité d’un refus opposé par les Alliés aux demandes
de la Belgique, qui étaient modérées et se réduisaient au strict
nécessaire dont le pays avait besoin. Il montra le développe­
ment du chômage — il y avait alors 900.000 chômeurs en
B elgique-et les charges qui en résultaient pour le gouvernement.
Il indiqua l’augmentation du prix de la vie et fit ressortir
la nécessité, si l’on voulait maintenir la paix sociale, d’assurer
la Belgique d’une restauration complète. Si satisfaction n’était
163
pas donnée, l’existence même du gouvernement deviendrait
impossible.
La discussion fut, à deux reprises, interrompue, chacun des
chefs des gouvernements alliés délibérant avec ses experts.
Des propositions nous furent faites. Elles étaient insuffi­
santes.
L’accord s’était réalisé assez rapidement sur la priorité
des 2 milliards et demi de francs, mais ce n’était point assez.
Je déclarai que je ne pouvais accepter et que, dans ces
conditions, j ’avais pour devoir de retourner à Bruxelles afin
de mettre le gouvernement au courant. Il jugerait probable­
ment nécessaire de saisir les Chambres.
Je fus alors l’objet de vives instances.
Je répliquai que le gouvernement belge ne pouvait ac­
cepter la responsabilité de la solution qui m’était proposée,
que le Parlement devrait se prononcer et qu’il m’était impos­
sible de prévoir la décision qui serait prise.
Les questions qu’on me posait se multiplièrent. Serez-vous
présent, me demanda-t-on, à la réunion prochaine où le projet
de traité sera soumis à la délégation allemande ?
Je répondis que je ne pouvais en donner l’assurance et
qu’avant d’adhérer au traité le gouvernement belge devrait entrer
en contact avec les Chambres.
On m’objecta qu’en l’absence des représentants de la
Belgique les Alliés n’auraient pas qualité pour stipuler des
avantages à son profit ; qu’en somme la Belgique serait ainsi
laissée à ses propres moyens.
Je persistai dans mon attitude et, après de nouvelles dé­
libérations engagées entre experts et hommes d’E tat, dans tous
les coins du salon, on finit par m’offrir les deux privilèges
que je rapportai à Bruxelles : la priorité de 2 milliards 1 ¡2 et
la libération de nos dettes de guerre, dont l’Allemagne sup­
porterait les charges, comme une conséquence de la violation
du traité de 1839 (1).
De l’assentiment de mes collègues MM. Vandervelde et
(1) M. André Tardieu, dans son beau livre «La Paix», préfacé par Clémenceau a donné
un récit coloré de la séance où furent discutées les revendications de la délégation belge :
« M. Hymans, assisté de MM. Van den Heuvel et Vandervelde, vint devant les IV : séance
émouvante où les trois ministres belges parlèrent avec la force conjuguée du cœur et de la raison :
séance complexe où pour conseiller à la Belgique le calme et la modération, les grandes Puis-
164
Van denHeuvel, je déclarai que nous acceptions personnellement
et que nous recommanderions l’acceptation à notre gouverne­
ment.
Le soir même je télégraphiai à Bruxelles pour faire con­
naître les arrangements sur lesquels nous nous étions mis d’ac­
cord.
Il avait été convenu que notre acceptation officielle et
définitive devait parvenir le lendemain.
Mais, à Bruxelles, le cabinet s’inquiète et hésite ; l’opinion
s’agite ; des associations se réunissent et votent des ordres
du jour invitant le gouvernement à refuser de signer le traité.
Cette émotion se comprend. Nous sortions des horreurs et des
souffrances de la guerre et devant le pays couvert de ruines
se dressait le problème formidable de la restauration.
On se rappelait les promesses éclatantes que nos grands
alliés nous avaient prodiguées ; le cœur était remplis d’espérances
et d’illusions. On ignorait encore les cruelles réalités issues
de la guerre; elles ne s’imposèrent aux esprits que plus tard.
Le 1er mai arrivèrent à Paris MM. Jaspar, Franck et Renkin.
Ils venaient me recommander de ne pas signer le traité et de
refuser les conditions obtenues à la réunion du Conseil des III.
MM. Vandervelde, Van den Heuvel et moi, nous leur
montrâmes que le refus de signer conduirait à une impasse,
entraînerait la rupture de la Belgique avec l’Entente, compro­
m ettrait notre avenir financier et que ce serait, en somme,
une aventure sans issue.
On a pu, dans la suite, mesurer la valeur des avantages que
nous avions assurés à la Belgique.
On ne pouvait, en ces premiers jours, estimer l’importance
de la priorité; on la jugera plus tard à son rendement qui a donné
les ressources nécessaires pour la restauration du pays et aux efforts
qu’il fallut déployer pour la faire respecter et la maintenir....
Les entretiens que nous eûmes à Paris avec nos collègues
sances employèrent les arguments les plus divers d’esprit et de ton ; séance troublante aussi,
d’où à de certaines heures on put se demander si la Belgique ne sortirait point par une rupture!
— Songez à notre peuple, disait M. Vandervelde. Il est petit mais il a confiance en vous.
Ne lui refusez pas ce qu’il attend et qu’il a le droit d’espérer.
— Vous avez eu moins de tués que nous, répliquait M. Lloyd George.
— Regardez la France, disait M. Clémenceau. Je n’ai pas été toujours satisfait des réso­
lutions que j’ai dû accepter. Nos parlements croient tous que nous n’obtenons pas assez. Je
remplis mon devoir et cela suffit. »
165
venus de Bruxelles nous déterminèrent cependant à faire un
dernier effort pour obtenir des concessions complémentaires.
Nous écrivîmes dans ce but à M. Clémenceau une lettre
que signèrent les trois plénipotentiaires et nous provoquâmes
une réunion qui se tint à l’hôtel Crillon et à laquelle assistèrent
M. Hoover, les délégués japonais et américains et M. Keynes,
délégué de la trésorerie anglaise.
J ’étais accompagné de mes collègues plénipotentiaires,
de MM. Theunis, de Cartier de Marchienne, notre ministre à
Washington, et Yandeven, délégué du Ministère des Finances.
Au bout d’une longue discussion, souvent vive et cahotée,
nous réalisâmes un accord de principe.
Le 2 mai, M. Delacroix revint à Paris, et après un examen
approfondi de la situation, il télégraphia à M. Jaspar, qui
avait regagné Bruxelles, que nous avions obtenu le maxi­
mum de ce qui était possible et qu’il était d’avis de signer le
traité.
Une nouvelle réunion eut lieu le 3 mai, à l’Hôtel Crillon,
afin de mettre au point les résolutions de principe qui avaient
été primitivement convenues et, une heure après, je partis
pour Bruxelles. M. Delacroix m’y avait rappelé par un télé­
gramme urgent. L’opinion était désorientée ; il im portait de
prendre une décision définitive. Nous devions, d ailleurs,
donner aux puissances alliées une réponse formelle.
Le dimanche 4 mai, dans la soirée, un Conseil de la Couronne
auquel assistaient tous les membres du gouvernement et tous
les ministres d’E tat se réunit au Palais sous la présidence du Roi.
A l’unanimité, le Conseil décida qu’il y avait lieu de signer
le traité. Il décida, à l’unanimité aussi, qu’il fallait attirer
l’attention des puissances sur la situation financière et économique
de la Belgique et sur la nécessité pour les alliés de nous accorder
leur appui au point de vue de notre restauration économique.
Le lendemain je m’expliquai devant la commission des
Affaires étrangerès de la Chambre et du Sénat, et M. Van den
Heuvel, à Paris, notifia à M. Clémenceau l’assentiment du
gouvernement belge.
Voilà l’histoire que je tenais à résumer devant la Chambre.
Elle démontre que la priorité et la libération de nos dettes
de guerre constituent deux privilèges qui ont été concédés
166
à la Belgique en raison de la violation par l’Allemagne du traité
de 1839, et qu’elles ont été la condition de notre adhésion au
traité de paix. Elles font partie d’un contrat et constituent
en quelque sorte, vis-à-vis de nous, des engagements synallagmatiques.
M. Vandervelde, après le discours, de M. Hymans, se leva
pour confirmer Vexactitude de Vexposé que celui-ci venait de faire
entendre.
M. Brunet, Président de la Chambre, ajouta ces paroles :
«Le discours qui vient d'être prononcé par Fhonorable M inis­
tre d’Etat, M. Hymans a été émouvant par sa simplicité. Il a re­
cueilli Vapprobation unanime de la Chambre.»
167
..
LA PREMIÈRE
PREMIÈRE ASSEl\ffiLÉE
ASSEMBLÉE DE
DE LA
LA
LA
SOCIÉTÉ DES
DES NATIONS
NATIONS
SOCIÉTÉ
DISCOURS PRONONCÉ A LA SÉANCE
INAUGURALE
A Genève, le 15 novembre 1920.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
L’assemblée de la Société des Nations remercie le Président
de la République Helvétique de ses souhaits de bienvenue,
qu’il vient d’exprimer en termes pleins de noblesse et d’émotion.
A mon tour j ’adresse au Gouvernement de la Confédération
et à son chef éminent le salut de la Société des Nations. C’est
à Genève qu’elle a fixé son siège. Elle est sûre d’y trouver
l’hospitalité la plus libérale, une sympathie réfléchie et cordiale.
Qu’il me soit permis de remercier spécialement Son Excel­
lence Monsieur Motta pour l’hommage éloquent qu’il vient
d’adresser à mon souverain et à mon pays. Ses paroles reten­
tiront en Belgique dans tous les cœurs et feront plus intime
l’ancienne amitié des deux peuples.
Comment, Messieurs, au moment où nous nous réunissons
sur le sol genevois, oublierions-nous que c’est ici, dans ce milieu
imprégné d’une si haute culture morale, que naquit l’institution
de la Croix Rouge ?
Comment oublierions-nous que la Suisse, îlot de Paix
autour duquel, pendant près de cinq années, s’entrechoquèrent
les vagues furieuses de la guerre, offrit un accueil fraternel aux
prisonniers, aux blessés, aux malades, qui au sortir des hôpi­
taux et des camps d’internement y trouvèrent du repos, de la
sérénité, de l’affection et s’y sentirent enfin revivre.
Nous saluons la libre démocratie suisse, ses antiques, solides
et fières traditions, et la merveilleuse nature au milieu de
laquelle elle se développe et s’épanouit, cimes altières, vallons,
lacs transparents, qui sont comme d’éternelles images de beauté,
de grandeur et de paix.
171
La réunion de cette grande assemblée où se rencontrent
les représentants de 41 Etats est un événement qui marquera
dans l’Histoire.
Elle atteste l’aspiration des peuples à une organisation
équitable, durable et pacifique des relations internationales. E t
la manifestation de ce sentiment universel constitue le symp­
tôme impressionnant d’un esprit nouveau.
Si de nos délibérations se dégage, comme nous l’espérons,
la volonté de poursuivre le développement et la m aturation
de l’œuvre dont le Pacte contient le germe, de multiplier l’effort
destiné à rapprocher les Etats pour le service de quelques
grands intérêts communs dont la sauvegarde est la condition
même de la civilisation et du progrès, nous aurons ouvert les
voies d’un avenir meilleur et justifié la pensée dont est issue
la Société des Nations.
Sans doute nous ne prétendrons point que l’institution
organisée par le Pacte de Versailles soit parfaite et que les
leçons du temps et de l’expérience ne puissent nous amener à
en améliorer le fonctionnement et l’efficacité.
Sans doute aussi nous ne pouvons, sans risquer d’exciter
d’illusoires espérances, annoncer que, par un coup de baguette
magique, nous allons transformer le monde, et dans le monde,
ce qui change le plus lentement, je veux dire les hommes.
Enfin, il est bon de l’affirmer une fois de plus, la Société
des Nations n’est et ne saurait être un super-Etat qui absor­
berait les souverainetés ou méditerait de les réduire en tutelle.
Notre but est d’abord d’établir entre Etats indépendants
des contacts fréquents et amicaux, des rapprochements, d’où
jailliront des courants d’affinités et de sympathies.
Par l’intervention du Conseil et de l’Assemblée, par l’ar­
bitrage et la conciliation et par la création d’une juridiction
internationale régulière et permanente, par de multiples organes
où, comme en des laboratoires, les problèmes financiers, écono­
miques et commerciaux, les conditions de la vie ouvrière, les
questions d’hygiène seront soumis à une étude impartiale et
objective, la Société des Nations pourra contribuer puissamment
à prévenir des crises inquiétantes, à régler des différends qui,
en se prolongeant, risquent de s’irriter et de s’envenimer, et à
172
améliorer par une sage coopération le sort moral et matériel
des peuples.
Nous avons en somme l’ambition de créer progressivement,
dans des sphères de plus en plus larges, une certaine vie com­
mune des nations, dominée par des principes de justice, impré­
gnée de bonne foi et de loyauté, inspirée d’un esprit interna­
tional. Et j ’entends par là un esprit qui superpose l’intérêt
général aux intérêts particuliers et, en un mot, un esprit de
solidarité tendant à alléger les souffrances des peuples et les
difficultés où se débattent les Gouvernements, à coordonner
leur action, à apaiser les rivalités et les haines, d’où surgissent
parfois brusquement les grands sursauts de folie qui ébranlent
le monde jusque dans ses fondements et menacent de ruiner
le travail accumulé des siècles.
Ainsi nous ne sommes pas associés seulement pour l’ac­
complissement d’une entreprise utilitaire et pratique.
Nous poursuivons un idéal très haut, vers lequel monte
l’élan de nos cœurs et de nos pensées.
Malgré des critiques bien sévères parfois, qui viennent
de loin — et de là précisément d’où nous espérions et conti­
nuons à espérer une collaboration féconde — la Société des
Nations, dans notre conviction, répond à un besoin, à un
sentiment qu’après le drame effroyable d’où nous sortons, les
peuples portent dans leur âme ; c’est un sentiment, un besoin
de justice, d’harmonie et de paix.
Dans toute collectivité nationale, la morale impose aux indivi­
dus des devoirs envers les autres et envers la collectivité elle-même.
Il est une morale pour les nations comme pour les indi­
vidus, et, comme les individus, les nations vivent en société.
Elles ont les unes vis-à-vis des autres des devoirs autant que
des droits, et elles ont des devoirs encore vis-à-vis de la grande
société humaine.
Sans effacer les traits qui distinguent nos nationalités et
nos races, sans méconnaître ni tenter d’affaiblir l’originalité
des peuples, leurs facultés, leur vocation propre, efforçons-nous
d’assurer leur collaboration à l’œuvre du bien commun.
Servons l’humanité. Cherchons ensemble à préparer et à
réaliser par étapes le règne tant rêvé de la morale internationale
et du Droit humain.
LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
« Revue bleue », 19 mars 1921
Il y a un peu plus d’un an, dans le salon de l’Horloge, au
palais du Quai d’Orsay, et devant un auditoire clairsemé,
le Conseil de la Société des Nations tenait sa première séance
publique, sous la présidence de M. Léon Bourgeois. Ce fut
un modeste et bref début. Puis, de mois en mois, se succédèrent
les sessions du Conseil, de plus en plus longues ; il se réunit à Lon­
dres, à Rome, revint à Paris, retourna à Londres, se transporta à
Saint-Sébastien, délibéra à Bruxelles, pour se fixer enfin à
Genève, la veille du jour où s’ouvrit la première assemblée de
la Société des Nations.
Pendant ces dix mois de travail itinérant, le Conseil ac­
complit les tâches spéciales que lui avait assignées le Traité
de Versailles ; peu à peu les événements, le développement
naturel des affaires, et ses propres initiatives élargirent son
champ d’action. Il constitua le gouvernement de la Sarre,
arrêta le statut de la ville libre de Dantzig, confirma le transfert
définitif des cantons de Malmedy et d’Eupen sous la souverai­
neté de la Belgique et régla le mode d’application des dispositions
du Pacte au sujet des mandats d’administration des territoires
qui avaient appartenu avant la guerre à l’Empire ottoman
et des anciennes colonies allemandes. Il institua une commis­
sion militaire, navale et aérienne, permanente et consultative,
et traça le plan de ses études.
Il convoqua à Bruxelles une conférence financière et éco­
nomique et fixa le programme de ses discussions. Il chargea
des juristes d’élite de préparer un projet d’organisation d’une
Cour permanente de justice internationale. Il soumit à un
examen impartial le problème des îles d’Aland et le différend
de la Pologne et de la Lithuanie et prit des mesures destinées
à en assurer la solution équitable et pacifique.
174
Ce tableau en raccourci donne une idée approximative de
l’activité de ce collège restreint, où ne siégeaient que les re­
présentants de huit Etats, et qui ne tirait son autorité, une
autorité purement morale, que de ses origines et de lui-même,
c’est-à-dire de la prudence, de la sagacité, du tact qu’il déploie­
rait dans ses méthodes, dans ses interventions, dans l’inter­
prétation du Pacte qui l’avait appelé à la vie.
Durant près d’une année, le Conseil fut à lui seul toute la
Société des Nations. Il agit sans tapage ni sollennité. Un vif
désir d’entente ne cessa de l’animer et bientôt une étroite et
intime collaboration lia les hommes d’E tat et les diplomates
qui se retrouvaient à des intervalles périodiques en des réunions
où l’on parlait librement, amicalement, en pleine confiance,
et où toujours les solutions admises le furent unanimement.
Mais que serait l’assemblée, la première assemblée, où
brusquement seraient mis en contact des hommes venus des
quatre coins du monde, représentants de l’Afrique et de l’Orient,
du Canada et de l’Amérique latine, de la vieille Europe, des
peuples alliés et des pays neutres, d’antiques civilisations et
de neuves, chrétiennes, bouddhistes et musulmanes, catho­
liques et protestantes, des grandes puissances, des moyennes et
des petites ? Oui, trouverait-on le moyen de les accorder, de
leur imprimer une commune direction, de dégager une pensée
d’ensemble de ce mélange de tendances, de tempéraments,
d’intérêts variés et peut-être divergents ?
Les membres du Conseil, à l’approche de l’assemblée,
n’étaient pas sans anxiété. Nous allons tenter, disait à Bru­
xelles M. Balfour en octobre 1920, une grande expérience dont
l’avenir de la Société des Nations dépendra.
L’expérience fut menée à bien. Les témoignages de M.
Viviani et de Lord Robert Cecil, de M. Balfour, de M. Bour­
geois, de M. Barnes, le délégué travailliste anglais, de M. Lafontaine, le délégué socialiste belge, sont concordants.
L’assemblée a rempli la fonction qui lui était attribuée et,
dans les délais prévus, épuisé son ordre du jour. Elle a fait
tout ce qu’elle devait et pouvait faire, dans l’état présent de
l’Europe et du monde et dans la limite des possibilités actuelles
de la Société des Nations. Elle l’a fait avec diligence et
dignité, dans un esprit d’harmonie et de coopération qui im­
pose le devoir de persévérer et donne l’espérance de réussir.
Je chercherai plus loin à fixer les traits caractéristiques de
l’œuvre accomplie mais je voudrais, en un rapide croquis,
esquisser la physionomie de l’Assemblée.
C’était dans une grande salle quadrangulaire, nue, austère,
construite pour des réunions religieuses et dont le nom seul, on
l’appelle Salle de la Réformation, fait deviner l’aspect. En bas
les délégations, flanquées de leurs secrétaires et escortées de
conseillers techniques s’alignaient le long des rangées de pupitres,
suivant l’ordre alphabétique des Etats. En haut, deux galeries
superposées, l’une réservée à la presse — on n’y comptait pas
moins de deux cents journalistes — l’autre au public de Genève,
qui suivait passionnément les séances et souvent mêlait ses
applaudissements à ceux des délégués. Au fond, la loge du
corps diplomatique et des notabilités et, faisant face aux délé­
gations, sur une haute plate-forme, le bureau présidentiel
dominant la tribune des orateurs.
L’Assemblée de la Société des Nations n’est pas, dans
le sens propre, un Parlement international, où des députés
expriment leur pensée personnelle et n’engagent qu’eux-mêmes.
Chaque délégation représente collectivement un E tat et
reçoit des instructions de son Gouvernement. Les chefs des
délégations prennent seuls part aux scrutins. E t l’unanimité
est requise pour toutes décisions, sauf en ce qui concerne les
questions de procédure, les nominations et certains cas par­
ticuliers prévus par le Pacte. Enfin, l’Assemblée de Genève
adopta un système d’études préparatoires qui devait abréger
les discussions en séance plénière et prévenir beaucoup de
difficultés. Elle classa les questions dont elle était saisie en six
catégories et répartit le travail préliminaire en six commissions
où les délégations envoyèrent chacune un de leurs membres.
Tous les Etats étaient donc également représentés dans
toutes les commissions dont plusieurs nommèrent des souscommissions composées des personnalités les plus compétentes
et qui jouissaient d’une particulière autorité. Ainsi l’examen
préliminaire fut approfondi. Tous les Etats y furent associés.
Des accords, des transactions purent être négociés et délibérés
avant que les rapporteurs ne vinssent résumer et défendre les
conclusions de leurs commissions en séance publique et générale.
176
Il semblerait que dans une assemblée ainsi constituée et
fonctionnant sous un tel régime les débats dussent se réduire à
de froids commentaires aboutissant à des votes presque autom a­
tiques, sans imprévu, sans émotions ni incidents.
Il n’en fut rien. L’Assemblée, dépourvue de la liberté
d’allures d’une Chambre politique n’eut point cependant la
tenue compassée d’une conférence diplomatique, ou la raideur
d’un conseil de techniciens.
Elle eut de la vie, du mouvement ; elle eut des nerfs ;
elle eut de la chaleur et de l’humour. Elle entendit des appels
éloquents, parfois des controverses ardentes ; elle connut quel­
ques moments de fièvre et d’effusion.
Quand, interrompant M. Motta, qui regrettait l’absence
de l’Allemagne, M. Viviani cria brusquement de sa voix cuivrée :
« Je demande la parole ! » un choc fit tressaillir l’auditoire. E t
une immense acclamation monta vers l’orateur, lorsque, après
avoir maîtrisé et entraîné avec lui l’assemblée, il lui lança cette
péroraison évocatrice : « Si les Nations libres qui se sont levées,
vengeresses et émancipatrices, pour répondre au défi qui leur
a été jeté, n’avaient pas été victorieuses, vous ne seriez pas à
Genève pour essayer de bâtir avec nous l’humanité sur le Droit ! »
Une démonstration spontanée accueillit la nouvelle, annon­
cée par le Président, de l’attribution à M. Bourgeois du prix
Nobel pour la Paix. Elle n’eut rien d’officiel ou de banal. Ce
fut un geste sincère et touchant qui honorait le grand Français,
dont le tour d’esprit noble et délicat, le passé rempli d’œuvres
et de services et les exquises manières inspiraient à tous autant
d’affection que de respect.
Lord Robert Cecil maintes fois impressionna par son
accent de ferveur et de force contenue. Avec M. Nansen il
représentait en quelque sorte la gauche de l’assemblée, prompt
aux initiatives énergiques, soucieux cependant d’aboutir, mê­
lant à un idéalisme hardi un bon sens britannique, qui ne
néglige jamais les réalités. Ses appels aux nations civilisées,
dans le débat sur la tragique Arménie, puisaient leur inspiration
dans une sensibilité profonde, une religieuse et chevaleresque
conception du devoir.
La première apparition, à la tribune, de M. Balfour, arrivé
tardivement à Genève, fut saluée d’applaudissements. Il parla
177
souvent, avec cette grâce un peu indolente, cette voix harmo­
nieuse, ce ton parfois légèrement hésitant, cette élégance natu­
relle du geste et de la phrase, dédaigneuse de toute recherche
et dont la simplicité laisse paraître un art consommé, une
pensée sûre, la plus habile dialectique.
M. Tittoni, qui ne put rester à Genève jusqu’à la fin des
travaux, nous apporta la contribution de son expérience, d’une
fine connaissance de la politique et des hommes. Il avait parti­
cipé à toutes les délibérations du Conseil et se chargea, dans
la discussion générale, d’en expliquer la portée et de répondre
aux questions et aux critiques. Il s’acquitta de sa tâche à
merveille. La voix est mince, mais agile, et excelle à glisser et
faire pénétrer l’argument. Toute sa personne dénote l’intel­
ligence vive et aiguisée. On découvre du premier coup d’œil
l’homme d’E tat qui a été mêlé aux grandes affaires. L’autorité
de l’orateur s’adoucit d’un sourire ; et sous le charme du dis­
cours luit parfois l’acier d’une épigramme.
Puis, voici M. Paderewski dont l’éloquence nuancée est
d’un virtuose, qui joue de la parole comme d’un clavier, et
M. Branting dont le langage paterne contraste avec le rude
aspect ; M. Fernandez, le délégué brésilien, qui prit une part
marquée à l’élaboration du statut de la Cour de justice et
déploya dans sa discussion tant de verve juridique, et M. de
Aguero, le délégué cubain, au masque napoléonien ; M. Nansen,
l’explorateur norvégien, prêt à tous les héroïsmes ; M. Rawell
et Sir George Foster, du Canada, parlementaires avisés, tenaces
et pressants dans la controverse et M. Motta, enfin, le Président
de la Confédération Suisse. A diverses reprises, avec une rare
élévation d’esprit et dans un langage nourri de bonnes lettres,
il exprima les aspirations de la démocratie helvétique, la plus
vieille et la plus égalitaire de l’Europe, demeurée neutre dans
la guerre, et, par un privilège unique, entrée neutre dans la
Société des Nations, créatrice de la grande œuvre de la CroixRouge et qui, dans les années terribles fut la bienfaisante m ar­
raine de nos blessés et de nos prisonniers.
Voilà le cadre, les méthodes, le milieu, les hommes.
Quelle fut l’œuvre accomplie ? Sans doute l’assemblée n’a
résolu aucun des lourds problèmes politiques qui pèsent sur
l’Europe.
178
Elle n’y prétendait point et ne l’aurait pu tant à raison
de la situation trouble et fiévreuse où se débattent les peuples,
que de la limitation de ses propres forces.
Le Conseil suprême des Alliés, la Conférence des Ambassa­
deurs, la Commission des Réparations n’ont point achevé de
régler l’exécution définitive de quelques-unes des clauses les
plus importantes du Traité de Versailles. Le Traité de Sèvres
n’est pas ratifié et l’on parle de le reviser. La Russie est dans
le chaos et toute l’Europe Orientale en fermentation.
Quant à la Société des Nations, elle débute et n’en est
encore qu’à un stade de primaire développement. A se lancer
dans de vastes entreprises, un équipage aventureux risquerait
de faire sombrer le navire, à peine sorti des chantiers et qui
ne porte pas encore son gréement.
Sans doute le but final, le but idéal et lointain de la Société
des Nations, la grande pensée dont elle est issue, est de prévenir
les guerres futures en assurant par un réseau d’obligations et de
sanctions le respect du nouveau contrat social des peuples,
en soumettant les différends à la discussion, à la médiation, à
l’arbitrage, en offrant à l’opinion publique universelle un ins­
trum ent assez puissant et sonore pour maîtriser les volontés
de violence, de lucre ou de conquête.
Mais comment réaliser progressivement cette fin supérieure
si ce n’est en se préoccupant d’abord d’établir entre les Gou­
vernements des points de contact et, selon l’expression de
M. Bourgeois, une mutualité d’intérêts, de tisser les liens qui
les rapprocheront, d’organiser les laboratoires techniques où
les problèmes d’utilité collective seront soumis à une étude
commune et qui prépareront les solutions conciliatrices et
harmoniques, de constituer un tribunal assez haut et respecté
pour formuler des arrêts que le monde reconnaîtra comme
l’expression d’une justice suprême et incontestée.
C’est donc à monter la machine, à en finir et à en ajuster
les rouages, à en ordonner le fonctionnement pour en assurer
le rendement régulier et fructueux que la première assemblée
de la Société des Nations devait consacrer sa majeure activité.
E t c’est ce que fit l’Assemblée de Genève.
Après s’être donné un règlement, elle s’occupa de la tâche
délicate de fixer la compétence respective et les relations du
179
Conseil et de l’Assemblée auxquels le Pacte, sauf en quelques
matières, a donné des attributions presque équivalentes, et
elle laissa à l’avenir la détermination de frontières plus précises
qui se dégageraient de l’expérience.
Elle ne voulut pas inaugurer ses travaux par la revision
de sa charte fondamentale. Les amendements au Pacte, proposés
par les Etats scandinaves, puis par M. Costa, délégué du Por­
tugal, et par M. Puyrredon, au nom du Gouvernement argentin,
furent renvoyés à une Commission que désignera le Conseil.
Sans doute, nul ne soutient que le Pacte soit parfait et les cir­
constances amèneront à l’améliorer et à l’assouplir. Mais on
estima généralement qu’il convenait de le mettre à l’épreuve
avant de le reviser et d’attendre les leçons des faits et de la
réflexion.
Seule l’Argentine manifesta une résistance qui se tra ­
duisit par la retraite de sa délégation. E t l’on éprouva un vif
regret du départ de M. Puyrredon, diplomate distingué, dont
le concours éclairé était prisé par tous. Mais on eut l’impression
que la retraite des délégués argentins n’entraînait qu’une
séparation temporaire. Assurément l’incident fit sensation et
inspira des inquiétudes. Mais l’esprit de solidarité fut le plus
fort ; l’Assemblée demeura unie et persévéra.
Elle pourvut la Société de trois outils destinés à la re­
cherche et à l’analyse des besoins matériels, commerciaux et
physiques des peuples et à la préparation des ententes néces­
saires pour coordonner leurs intérêts généraux et pour remédier
aux maux qui résultent de l’isolement ou de rivalités égoïstes.
C’est une Commission financière et économique qui appro­
fondira les conclusions de la Conférence de Bruxelles et étudiera
les formules d’un accord tendant à l’organisation internationale
du crédit. C’est une Commission spéciale qui se chargera de
poser les bases de conventions générales sur le régime du tran­
sit, des ports et des communications par eau et voies ferrées.
C’est enfin une organisation internationale permanente de
l’hygiène qui unira les efforts de la science, des Croix-Rouges,
de la philanthropie afin d’éteindre des foyers d’épidémie et de
porter secours partout où la misère et la souffrance menacent
de décimer l’humanité.
Ainsi la Société des Nations est armée pour exercer une
180
action efficace et pratique dans le domaine des intérêts et pour
substituer au désordre où s’agite le monde un système de
coopération libérale et rationnelle.
L’œuvre capitale de l’Assemblée — tout le monde le
proclame et la critique devant elle a abdiqué — ce fut l’éla­
boration des statuts de la Cour permanente de justice inter­
nationale. C’est une grande œuvre de paix. On donne au monde
quinze juges, « magistrats indépendants élus sans égard à
leur nationalité parmi les jurisconsultes jouissant de la plus
haute considération morale ». On entoure leur sélection de
garanties telles que nul n’oserait renier leur autorité. On leur
donne une large compétence. On va plus loin. Sans décréter
l’arbitrage obligatoire, on ouvre les voies qui y conduisent,
par une clause qui donne aux Etats la faculté de l’adopter
entre eux. Il manquait à la Société des Nations une colonne
qui soutînt tout l’édifice, le fît solide, harmonieux, durable.
Elle est debout ajourd’hui et ancrée au sol.
Deux questions : le blocus, pénalité et contrainte qui
menace l’E tat violant ses engagements, la réduction des ar­
mements, mesure préventive contre les tentations et les en­
traînements belliqueux, ont provoqué, dans les commissions
principalement, de longs débats pleins de franchise et de clarté.
L’Assemblée a préconisé une série de mesures qui feraient
du blocus économique une ceinture étouffante, étroitement
ajustée.
D’autre part, elle a formulé le vœu de voir s’arrêter la
course aux armements et pris des mesures d’étude et de con­
trôle. Mais elle a fait preuve de sagesse, en reconnaissant que,
dans l’état présent de l’Europe, la position de certains Etats
qui restent menacés de périls graves ou à qui incomberaient,
dans certains conflits, des devoirs immédiats d’intervention, ne
leur permet pas de désarmer. Sur le principe de la limitation
des armements, l’accord théorique fut unanime. Tous les peu­
ples indistinctement plient sous le fardeau et aspirent à l’allé­
gement des charges qui oppriment leurs finances publiques,
retentissent sur le bien-être des individus et entravent le relè­
vement des conditions économiques.
Mais les dures réalités ne sauraient être méconnues. L’Al­
lemagne n’a pas encore exécuté les obligations que lui impose
181
le Traité de Versailles. D’épaisses nuées que traversent des
lueurs d’orage, obscurcissent l’horizon oriental. Les garanties
de la Société des Nations sont trop faibles encore pour dis­
penser les peuples de veiller à leur sécurité et d’organiser leur
défense. Comment la France et la Belgique qui montent la
garde sur le Rhin, comment la Pologne pourraient-elles désar­
mer ? L’heure n’a pas sonné.
Toute la puissance d’émotion de l’Assemblée se dépensa
dans la discussion de l’affaire d’Arménie. On s’ingénia à découvrir
le moyen d’arracher ce peuple infortuné à la longue torture
qui l’étreint et l’épuise. Les grands Alliés n’avaient trouvé ni
l’argent ni les troupes pour restaurer le droit par la force et
leur action était demeurée stérile. Par quel procédé diploma­
tique, par quelle méthode miraculeuse la Société des Nations
se révélerait-elle plus habile et parviendrait-elle à délivrer
l’Arménie qui se meurt ? Sur la suggestion de M. Viviani, le
Président ^Vilson fut prié d’intervenir comme médiateur entre
les Arméniens et les Kémalistes. Il accepta. Le Brésil et l’Es­
pagne lui promirent leur appui. Mais une étrange obscurité
couvre ce coin tragique d’Asie-Mineure et nul ne peut prévoir
encore l’épilogue du drame qui s’y déroule.
L’un des derniers actes de l’Assemblée atteste son libé­
ralisme. Elle admit dans la Société des Nations l’Autriche, la
Bulgarie et l’Albanie, en même temps que la Finlande, le Lu­
xembourg et Costa-Rica.
Si l’on élimine les détails, tels sont, dans leurs caractères
essentiels, la physionomie et les travaux de l’Assemblée de
Genève.
Elle a répondu pleinement à ce qu’il était permis d’attendre
d’elle. Elle a achevé d’organiser la Société des Nations. Elle
l’a dotée de l’outillage qui lui manquait. Elle lui a donné de
la vie et de la sonorité.
Elle a fait éclore dans un milieu rempli de contrastes et
de nuances un esprit remarquable d’entente et de coopération,
qui se manifesta sans tarder dans les relations personnelles,
dans les entretiens politiques, dans les travaux des commissions.
De cet échange d’idées, de propos intimes, de discours,
se dégagèrent très vite une aspiration intense vers un régime
nouveau, stable, régulier, juridique des relations internationales,
182
une réelle anxiété d’éviter les perturbations qui secouent par
ressauts successifs toutes les Nations, d’un bout du monde à
l’autre. On perçut à Genève un immense désir d’organiser
l’avenir de manière à prévenir le retour de crises qui entraî­
neraient d’irrémédiables catastrophes et que seule peut con­
jurer la solidarité fondée sur le droit.
Les petits Etats, les plus nombreux, ont éprouvé la satis­
faction de se voir traités en égaux des plus grands. Beaucoup
étaient représentés par des hommes d’élite. Ils ont agi avec
indépendance et sagesse. On n’a pas vu se constituer de partis
ou de groupements dont telle ou telle haute puissance serait le
noyau. La volonté d’aboutir à des accords généraux s’attesta
de toutes parts. Mais à voir mêlés aux Européens les délégués
de tant de races et de pays lointains avec lesquels les contacts
directs sont si rares, on s’est fait une conception nouvelle et
plus complète de l’univers. Il ne se réduit pas aux nations à
qui le sort a tracé dans la tragédie récente des rôles émouvants
et glorieux et qui ont rempli la scène. Il y a là-bas, au-delà des
mers, dans un vaste continent, toute une agglomération de
peuples jeunes, vigoureux et riches qui constituent des facteurs
de l’évolution générale. L’Amérique latine, avec ses millions
d’habitants et ses immenses territoires, prend place dans la
vie commune. L’Asie à son tour, où se dessine un renouveau,
apparaît et fera entendre sa voix.
Quelle complexité d’intérêts, de désirs, de sentiments, de
besoins et d’instincts héréditaires dans cette énorme collec­
tivité humaine dont toutes les fonctions cependant sont inter­
dépendantes, dont toutes les ressources se combinent et se
complètent et qui, à des degrés divers, souffre en toutes ses
parties, dès qu’en un point quelconque du globe, un de ses
membres est atteint !
Les Etats-Unis, il est vrai, n’étaient point à Genève. On
sentit un vide. Mais il semble impossible qu’ils se désintéressent
de la plus grande entreprise de coopération internationale qui
ait jamais été tentée et qu’on ne trouve point une formule de
conciliation qui leur permette de s’y associer.
Des esprits enclins à la critique ont reproché à l’Assemblée
de n’avoir point, dans le tumulte actuel des idées, tracé aux
foules une direction morale.
Mais, dans une première expérimentation, elle devait se
contenter d’explorer, d’éclairer le terrain et d’ouvrir des sentiers
que les efforts prochains élargiront. Comme l’a fait observer un
commentateur impartial, elle a montré plus de hardiesse dans
les tendances que dans les décisions. C’est qu’il fallait se garder
des audaces vaines. E t tant que l’autorité effective ne sera
point acquise, il faudra se borner aux problèmes mineurs et
concrets.
Mais l’Assemblée est une tribune d’où l’on peut parler
à l’opinion et d’où l’opinion peut se faire entendre. C’est une
force qui naît, et qui se cherche et s’essaie. La constitution
d’une opinion publique mondiale, ayant ses organes, ses leviers,
ses moyens d’action, changerait l’aspect et les procédés de la
politique internationale. Pour reprendre le mot de M. Viviani,
l’Assemblée de la Société des Nations peut devenir, si la confiance
l’entoure et l’appuie, non le super-parlement d’un super-Etat,
mais l’arbitre moral. Certains cependant persisteront à rire.
Passons. Il n’est rien à attendre des sceptiques et des pessi­
mistes. D’aucuns diront que la guerre est un phénomène iné­
vitable, normal et périodique. Songent-ils à ce qui resterait de
l’Europe et de la civilisation, des vainqueurs et des vaincus,
si dans cinquante, dans cent ans une tourmente nouvelle jetait
les uns contre les autres les peuples de l’Occident ?
La Société des Nations sauvera-t-elle le vieux monde ?
Peut-être. Ce n’est qu’une espérance. Elle suffit pour agir.
Que si l’on me reproche, disait l’autre jour Lord Grey,
de poursuivre une utopie, je répondrai que je préfère ce risque
à la certitude de la destruction.
184
VV AARIA
RIA
RÉMINISCENCES
«Le S o ir», 27 mars 1923.
En ces derniers jours, d’intéressantes silhouettes d’étran­
gers notables se sont profilées sur le fond coutumier de notre
monde intellectuel : M. de Reynold, professeur à l’Université
de Berne, qui, pendant les années de guerre, consacra de bril­
lantes leçons à l’étude des lettres belges, M. de Nolhac, le
conservateur du Musée de Versailles, M. Hagbar Wright, le
directeur de la London Library.
Versailles.
Dans un coin de salon, au cours d’une conversation d’aprèsdîner, M. de Nolhac rappela la dernière cérémonie qui illustra
la salle des Glaces : la signature du Traité de Paix.
La paix nous a donné des désillusions. La cérémonie de
Versailles fut une déception. J ’allai contempler cette salle
d’une si noble ordonnance, la veille du grand jour. Tout était
prêt pour la solennité.
Aux deux extrémités, des rangées de banquettes pour
les dames, les diplomates, les dignitaires d’un côté, pour
les députés, les sénateurs, les journalistes de l’autre.
Au fond, en face des fenêtres qui s’ouvrent sur les terrasses,
les sièges réservés aux plénipotentiaires. Au centre, la table
où serait déposé le parchemin fatidique, sur lequel se penche­
raient, la plume à la main, les représentants de vingt-huit Etats.
C’était, si je ne me trompe, un meuble somptueux, de marque
célèbre et dont l’auguste origine avait paru convenir à la ma­
jesté de l’événement.
Le lendemain, tout ce clair et beau décor s’assombrit et
se banalisa. Une foule moderne, d’aspect gris et maussade
emplit l’aristocratique galerie d’une rumeur bourdonnante.
On entendait fuser des rires ; des apostrophes familières s’entre-
187
croisaient. M. Lloyd George eut grand peine, pour gagner
sa place, à franchir un rem part de curieux qui obstruaient
l’entrée. Les secrétaires, innombrables et affairés, couraient
de Tun à l’autre, collectionnant des autographes. Les délé­
gués défilèrent, dans le bruit, devant la table où reposait le
papier qui consacrait la victoire du Droit. E t c’est presque
inaperçus que passèrent les plénipotentiaires allemands qu’avait
introduits M. de Nolhac.
Waxweiler et Paul Lippens
M. Hagbar Wright évoqua avec moi le souvenir d’un belge
éminent, prématurément disparu, et qu’il connut beaucoup à
Londres pendant la guerre, M. Emile Waxweiler. Tout le drame
de cette mort me revint à la mémoire. Waxweiler, après la
conférence économique interalliée qui se tint à Paris en 1916
— et dont les plans magnifiques s’évanouirent en fumée —
vint à Londres afin de se joindre à une démarche que M. de Broqueville et moi nous nous proposions de faire auprès du gouvenement britannique.
Waxweiler me rendit visite à la légation de Belgique,
vers 6 heures du soir, immédiatement après son arrivée. M. de
Broqueville s’était annoncé pour le lendemain, et il avait été
convenu que nous déjeunerions à trois à l’hôtel Ritz, où le premier
ministre devait descendre.
Waxweiler prolongea sa visite jusqu’à 8 heures du soir.
Nous sortîmes ensemble et cheminâmes jusqu’à Hydepark.
Il me raconta les résultats des conversations qui s’étaient pour­
suivies à Paris ; nous les discutâmes longuement. Il me quitta en
me donnant rendez-vous pour la matinée suivante, à 10 heures,
à la légation, et il fut entendu que nous nous rendrions de com­
pagnie à l’hôtel Ritz. Je ne devais plus revoir cet infatigable
et noble travailleur, qui s’était donné tout entier à la patrie.
On ne dira jamais assez l’effet considérable que produisit son
livre La Belgique neutre et loyale, ni l’ardeur de son œuvre
de propagande et ses efforts pour préparer la reconstruction
économique, entrevue déjà à travers les périls et les angoisses.
Le lendemain m atin j ’attendis en vain Waxweiler avec
qui il m’était nécessaire de conférer avant notre entrevue
188
avec M. de Broqueville ; je téléphonai à son bureau. Il n’était
pas arrivé. On apprit cependant qu’il avait depuis près d’une
heure quitté son domicile. Il habitait un petit cotage à Golders
Green. Je téléphonai encore. Point de nouvelles. Je partis
pour l’hôtel Ritz. J ’excusai Waxweiler auprès de M. de
Broqueville et nous nous mîmes à table avec son secrétaire,
le jeune comte Louis de Lichtervelde.
A peine le repas était-il commencé, je fus appelé au télé­
phone. On me mandait d’un hôpital que Waxweiler venait d’y
être apporté mourant.
Sortant de chez lui, il avait traversé, en courant, la chaussee pour prendre un autobus. Un wagon automobile, survenu
brusquement, l’avait happé, renversé. On l’avait relevé vivant,
mais mortellement atteint. Il rendit le dernier soupir, à l’hô­
pital, une demi-heure après.
Cette fin stupide et cruelle, a privé la Belgique d’un servi­
teur précieux qui, j en suis sûr, eut joué un grand rôle dans la
reconstitution nationale, après l’armistice. Waxweiler était
à la fois un esprit positif et pratique. Il avait réussi à conquérir
la sympathie des hommes d affaires que cependant une peur
instinctive éloigne des professeurs, et le Roi lui avait donné
sa confiance.
J ’ai toujours associé, dans une même pensée de regrets,
deux hommes tombés pendant la guerre, et qui eussent rendu
au retour de notables services au pays, Waxweiler et Paul
Lippens, qui n’avait pas encore donné sa mesure. Paul Lippens,
le frère de l’ancien gouverneur du Congo, serait devenu une
de nos forces parlementaires, une colonne du libéralisme.
C’était un beau caractère, une intelligence ouverte, loyale,
entreprenante. Je passai la soirée avec lui à La Panne, quelques
jours avant qu’une balle le frappât au cerveau. Il ne restait
plus rien en lui de l’homme politique. C’était un soldat ; il ne
me parla que de ses camerades du front, des charges de son
commandement, de ses devoirs militaires, de la guerre, la guerre
des tranchées à vif et sous le feu. Le devoir remplissait son cœur
et sa pensée. Il était de la race des grands citoyens.
Qu’on excuse ces réminiscences de l’amitié, qu’éveilla
le hasard d’une conversation.
189
EMILE VERHAEREN
Discours prononcé à la Royal
Society of Literature à Londres,
à la Séance commémorative dédiée
à EmileVerhaeren, le 3 mars 1917.
Les discours qui viennent d’être prononcés évoquent une
grande mémoire. Je me lève à mon tour pour la saluer.
Sans doute c’est le poète qu’Anglais et Belges célèbrent
ici dans une commune pensée de piété littéraire. Mais qu’il
fût Belge, c’est pour tous une raison de plus de l’honorer.
Car les Anglais voient en lui l’expression du génie d’un peuple
qu’ils aiment pour sa fidélité au devoir, son courage et ses
douleurs. E t nous autres, nous reconnaissons notre âme dans
la sienne, nous retrouvons dans ses vers les chères images de
la patrie, les joies du passé, nos enthousiasmes, nos espoirs,
nos souffrances et nos haines, transposées et magnifiées par la
splendeur du verbe.
Belge, il l’était jusqu’aux moelles. Né sur les bords de
l’Escaut et flamand de naissance, c’est la langue française qui
fut l’instrument de son art.
Il la maniait en maître, la pliant aux volontés de son
inspiration, en sorte que celle-ci, dans le bel idiome de France,
gardait la saveur du terroir et sa robuste originalité.
H abitant tour à tour Paris et la Belgique, Belge il était
resté par l’allure comme par le tempérament, ne sacrifiant ni
à la mode, ni au désir de plaire. On ne découvrait en lui
point d’affectation, ou de pose, ou de snobisme. Il était lui
même, par l’accent, la parole martelée, la simplicité des manières
et du costume, la brusque franchise, la familiarité cordiale et
sensible. Le visage tendu et nerveux, que sabrait une longue
moustache, retombant aux deux coins de sa bouche et qu’il
lissait d’un doigt machinal, rappelait la rude physionomie du
guerrier gaulois. Mais les yeux clairs, ingénus, ardents et ten­
dres révélaient la contemplation mystique du passé, l’obser­
190
vation aiguë de la nature et de la vie, les inquiétudes et les
ferveurs de l’âme moderne.
Il bâtissait et sculptait des rythmes neufs, retentissants,
farouches, harmonieux et passionnés, qui bousculaient parfois
les normes classiques, mais qui dessinaient d’un trait puissant
la structure de l’idée, lui imprimaient la couleur et l’élan ;
et l’idée venait de chez nous, de chez lui, puisée aux sèves
profondes du sol natal. Son œuvre est nationale. On pourrait
l’appeler « Toute la Patrie ».
Toute la patrie, c’était jusqu’à trois ans d’ici les grands
fleuves et les canaux dormants où glissait la forêt mouvante
des cheminées et des mats de navires, c’était les dunes et leur
guirlande de fleurs sauvages, c’était les tours massives des égli­
ses de la côte, que secouent les vents du large, le silence des
béguinages et des vieilles cités endormies de Flandre, où d’au­
gustes momuments rappellent l’opulence des marchés du
moyen-âge. C’était les gloires et les drames de l’histoire
d’où, à l’appel du poète, surgissaient le cortège des vierges
mystiques de Bruges, les ducs de Bourgogne drapés de pourpre
et bardés de fer, la sombre figure de Philippe II, l’art plantureux,
sensuel et magnifique de Rubens et de ses disciples. E t c’était
aussi les douceurs du foyer, les amours humbles, les heures
claires. Et c’était enfin, le tumulte des villes, les rumeurs des
foules, le monde rugissant des usines, couronnées de fumée
et de feu, où l’humanité ouvrière, courbée sur les enclûmes,
forge les instruments de la richesse et les réformes populaires.
Mais tout cela c’était la paix, la paix d’un peuple laborieux
et fort, aimant le bien-être et l’abondance, énivré de liberté,
épris de faste et de profits.
E t voici la guerre !
Jamais Yerhaeren ne s’atteste plus foncièrement belge,
plus enraciné à la terre des aieux, dont le suc nourrit son
génie, que le jour où l’ennemi foule le sol de la patrie, pié­
tine le droit de la nation, dont il est par le cœur et par la
chair, et entreprend son œuvre de crime, de destruction et de
mort.
Le bruit des clochers qui s’effondrent, les flammes qui
dévorent les bibliothèques sacrées, les lamentations des
femmes et des enfants qu’on égorge le bouleversent et lui
191
arrachent des cris de désespoir et de haine. Il entend sur
les routes sonner le pas lourd des régiments qui vont à la
bataille, il les suit dans la mêlée ; il voit les tombes s’ouvrir,
le sang rougir les prairies et les eaux calmes des Flandres.
Son âme s’exalte et prend son vol sur les ailes de la guerre. Il ceint
de lauriers le héros qui succombe, il bénit les mains douces
qui dans les hôpitaux blancs soignent les plaies et pansent
les chairs meurtries, il venge Ypres, il lance l’anathème à
l’Allemagne, il jette une brassée de fleurs sur le roc formi­
dable d’où l’Angleterre domine les Océans. Sa voix perce la
tempête, voix de douleur, voix de malédiction, voix d’amour
et d’espérance.
Tout à coup il meurt, d’une mort affreuse et stérile.
Il ne sera pas au milieu de nous, à l’heure du retour, pour
annoncer les aubes, pour claironner la victoire, pour consoler,
pour réveiller, pour conduire.
Mais ne pleurons pas. Nous l’entendons encore. Ses poèmes
résonnent en nous. Ils sont sur nos lèvres ; ils se répéteront de
bouche en bouche ; la mère les redira à l’enfant et l’écho de
ses vers retentira de génération en génération. Ses chants sont
les chants de la Patrie. Ils sont immortels comme la Patrie
elle-même.
LES VIEUX ARBRES
En ju in 1923
Nous sommes en deuil, mes voisins et moi.
Cinq grands arbres, cinq ormes superbes, qui faisaient
l’orgueil du Parc, le décor de notre quartier paisible, la fierté
de la rue Ducale, le bonheur des tendres couples accoutumés
de se blottir sous leur ombre, cinq arbres centenaires, cinq
ormes vénérables viennent d’être décapités par la hache impi­
toyable des bûcherons municipaux.
La mort avait précédé cette cruelle opération.
Lorsque dans les chaudes journées des Pâques dernières
le Parc se couvrit de bourgeons, les hautes ramures de ces
cinq aïeux restèrent nues et noires ; sans doute, se dit-on,
la sève n’avait pas eu le temps encore, montant du sol nourricier,
d’atteindre leurs altitudes et leur printemps serait-il tardif.
Mais bientôt l’illusion se dissipa. D’un bout du Parc à
l’autre se tendait un voile de tulle frissonnant. Le jeune feuil­
lage s’animait du chant de l’oiseau. Les corneilles, au grand vol
tournoyant, perchaient sur les cimes sèches et froides, dont le
dessin se détachait sur l’azur léger en traits d’eau-forte.
Non, non, ils ne reverdiraient plus, les vieux arbres. Ils
étaient morts, morts d’usure et de vétusté, taris et gelés.
Ils avaient, disent les compétences sylvicoles, cent cinquante
ans. E t la sécheresse de l’avant-dernier été avait épuisé leur
suc. A la première tempête, ils se seraient brisés par le milieu.
On vit alors des hommes hardis s’attacher à l’aide de
cordes aux troncs, où ils enfonçaient les crochets de fer dont
leurs chaussures étaient armées, et s’élever lentement jusqu’aux
hautes branches. Puis détachant de leur ceinture une hache
luisante, ils se mirent à frapper, à frapper férocement, impi­
toyablement. Les branches amputées tombaient. Le tronc fris­
sonnait sous les coups, mais restait intact encore. Enfin,
quand il fut dépouillé de ses membres, c’est sur lui-même que
la hache s’abattit. E t longuement on tailla dans l’écorce,
193
dans la pulpe morte jusqu’à ce que, enfin, avec un craquement
sinistre, tout le dôme s’effondrât.
Ils sont cinq que l’on mit à terre et qu’ensuite on découpa
en tronçons ; et dans l’allée voisine, qui va de la rue Zinner
à la Montagne-du-Parc, ils sont quatre encore, et deux dans
l’allée qui, la coupant, va du Palais des Académies au grand
bassin.
Toute une génération s’évanouit, tout un morceau du passé
tombe en poussière. De grands témoins de la vie bruxelloise
d’autrefois disparaissent.
Ils ont abrité les promenades des héros de la Révolution
brabançonne et les sombres réminiscences des conventionnels ré­
gicides qui, après 1815, vinrent chez nous chercher la sécurité
et l’oubli ; et les fiers enthousiasmes de 1830, les colères et les
rêves des proscrits du Second Empire, et jusqu’à quelques
quarante ans d’ici, les élégances bruxelloises, le froufrou des
toilettes et des causeries mondaines.
Car le Parc fut pendant longtemps la promenade à la mode.
De jolies lithographies, exemplaires jaunis d’un art disparu,
montrent les pittoresques aspects de ses avenues encombrées
de crinolines, de redingotes à jupes, de sveltes officiers coiffés
de hauts schakos.
Ce n’est qu’en 1849 qu’on enferma le parc jusque là bordé
d’une haie agreste, dans sa ceinture de fer. E t l’on n’y fumait
pas autrefois, par galanterie pour ne pas effaroucher les dames,
par hygiène pour ne pas corrompre un air pur consacré aux
vieillards, aux enfants et aux convalescents...
Il fallut un long débat pour ouvrir le Parc aux fumeurs.
Timidement un édile, ami du cigare, proposa qu’il fût permis
d’y fumer jusqu’à 11 heures du matin. L’opposition fut vive. Mais
les solutions les plus radicales finalement triomphèrent,
grâce au bourgmestre Charles de Brouckère, qui, ripostant
à un défenseur des antiques usages s’écria : « Il n’y a plus,
à fumer, un manque de courtoisie, les dames sont si éloignées de
nous, grâce à leur crinolines, que l’odeur du tabac ne peut plus
les gêner ! »
Ils ont vécu ces temps périmés, les vieux arbres morts !
Combien ils ont surpris de confidences ! Que d’hommes et
d’événements ont passé à leur pied ! Au milieu des modes
194
changeantes, des variations de régime et de mœurs, ils demeu­
raient droits, dressaient plus haut leur pointe vers le ciel,
déployaient leur altière couronne, beaux, immobiles et cléments
aux humains.
Il ne reste plus devant nous que des colonnes brisées.
Le rideau de verdure s’est aminci et déchiré. Il y aura moins
de feuillage et plus de ciel.
Les bosquets vides pleurent leurs nobles ainés. Les vieux
s’en vont. Qui les remplacera ?
195
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE
TROIS EXEM PLAIRES SUR JAPON
MITSUMATA ET H UIT CENTS EXEM ­
PLAIRES NUMÉROTÉS DE 1 A 800
CONSTITUANT L’ÉDITION ORIGINALE.
DEUXIÈM E ÉDITION
ACHEVÉ D ’IMPRIMER LE 25 MARS 1910 SUR
LES PRESSES V. VAN DIEREN & C° A ANVERS.
IMPRIMÉ EN BELGIQUE