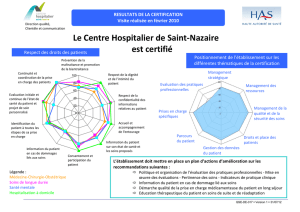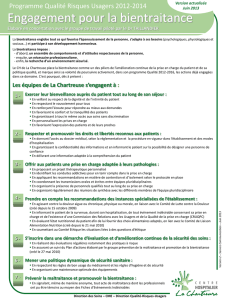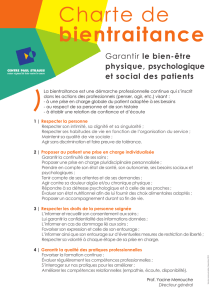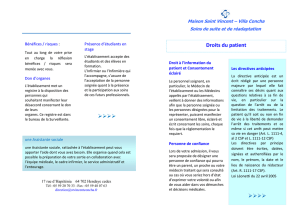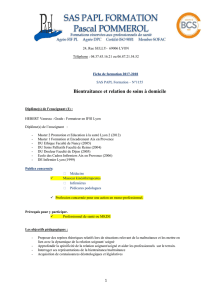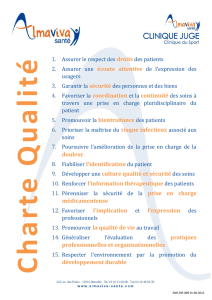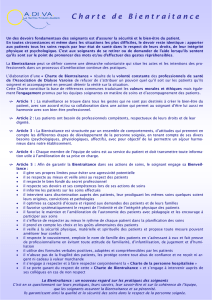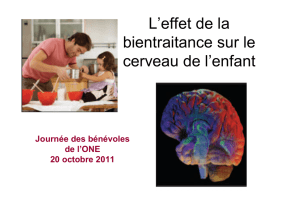Synthèse COLLOQUE

1/21
Union Départementale des
Associations Familiales
de Saône et Loire
Lundi 12 décembre 2011
COLLOQUE
_____________________
La Bientraitance
Une dynamique à développer
www.udaf71.fr www.ch-sevrey.fr

2/21
10 H 00
Ouverture Philippe COLLANGE, Directeur CHS SEVREY et
Annick GIRAUDET, responsable Commission Santé UDAF 71
Ouverture M. Philippe COLLANGE,
Directeur CHS SEVREY
Bienvenue au Centre Hospitalier Spécialisé de
SEVREY qui vous accueille aujourd’hui pour une
journée de travail et de réflexion sur la Bientraitance.
Tout d’abord, je remercie M. DESBROSSES, Président de
l’UDAF 71, Mme GIRAUDET, responsable de la
Commission Santé à l’UDAF et M. J.P. GUYOT, Directeur
de l’UDAF et représentant des usagers du Centre
Hospitalier Spécialisé.
J’en profite pour saluer les autres personnes
représentantes des usagers que je vois dans la salle, M.
FALLET et M. SUTET.
L’UDAF est à l’origine de cette initiative et c’est avec
plaisir et un grand intérêt que le Centre Hospitalier
Spécialisé vous reçoit.
Je veux dire tout le plaisir que nous avons d’avoir parmi
nous Mme COMPAGNON, auteur d’un rapport pour la
Haute Autorité de Santé sur le sujet de la maltraitance
« ordinaire » et de la Bientraitance dans les hôpitaux.
Sa contribution à nos travaux marque toute l’importance
que ces notions ont acquise dans la conduite,
l’organisation et le fonctionnement de nos établissements,
au regard des droits et du bien-être des usagers.
Je ne peux évidemment citer toutes les personnes qui
animeront les deux tables rondes mais, à toutes et à tous
présents aujourd’hui, je souhaite une journée féconde en
idées, en échanges.
Qu’entend-on par Bientraitance ?
L’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des
Etablissements sociaux et médico-sociaux a produit un
document « La Bientraitance, définition et repères pour
la mise en œuvre » dans lequel je puise cette définition :
« La bientraitance est une culture inspirant les
actions individuelles et les relations collectives au
sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à
promouvoir le bien-être de l’usager en gardant à
l’esprit le risque de maltraitance. »
La bientraitance ne saurait se réduire à l’absence de
maltraitance, ni à la prévention de la maltraitance, cette
maltraitance « ordinaire », « passive », « institutionnelle »,
non intentionnelle à laquelle Madame COMPAGNON, je
l’indiquais, a consacré une monographie.
Cette maltraitance, nous dirons banale, « du quotidien »
que nous ne voyons plus et que les professionnels et les
patients en quelque sorte « intériorisent ».
Nous en avons tous mille exemples en tête provenant du
fonctionnement ou de l’organisation de nos structures qui
insidieusement se mettent à être organisées et à
fonctionner d’abord pour elles-mêmes.
Oubliant quelques fois leur raison d’être première qui est
de respecter et de protéger l’intérêt des patients, de
répondre à leurs besoins, patients pris dans toutes ces
dimensions de leur personne.
La Bientraitance ne saurait donc se limiter à l’absence ou
à la prévention de cette maltraitance même si c’est déjà
beaucoup.
Elle n’est ni son contraire logique, ni son contraire
pratique. Elle est une culture pratique.
Pour l’Agence Nationale de l’Evaluation, la Bientraitance
s’inscrit dans les conceptions d’une société, à un moment
donné de l’histoire.
Elle s’inscrit dans un horizon large qui peut être défini, par
les différentes Déclarations Internationales, celle des
Droits de l’Homme (1948), des Droits de l’Enfant (1959),
des droits des personnes handicapées (1975), la charte
des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2000) et
les travaux du Conseil de l’Europe sur la question de la
maltraitance (2002).

3/21
Fondée philosophiquement et politiquement sur ces
textes, la bientraitance comporte un certain nombre
d’exigences incontournables, non arbitraires, liées aux
respects des droits fondamentaux, des libertés civiles, à
l’intégralité, à la dignité, et au bien-être général d’une
personne vulnérable ».
Mais si elle est ainsi fondée, sa mise en œuvre s’inscrit
toujours dans un contexte particulier, singulier qui pour
nous sera la réalité d’un service, d’une unité, et dans le
sens du prendre-soin.
La bientraitance naît d’un équilibre entre ce corpus de
principes fondamentaux et une analyse, une interprétation
puis une action par définition contextuelle, ponctuelle,
singulière menée par une équipe de professionnels au
sein d’une structure déterminée.
Au-delà des exigences fondamentales acceptées, et
rattachées aux droits essentiels de la personne, il n’y
saurait y avoir de définition figée et définitive de la
bientraitance, celle-ci étant un aller retour entre le penser
en référence à ces principes et l’agir dans l’intérêt de la
personne, celle-ci est un mouvement de personnalisation
de l’action de professionnels de soins, une manière d’être
de ceux-ci, une démarche continue pour que les droits
reconnus aux patients soient des usages.
Souvent et cela est vrai dans tous les domaines, politique,
économique, social, de nombreux droits sont reconnus
aux personnes. Les constitutions, les lois en sont pleines.
MAIS l’USAGE, est-il lui toujours possible, est-il toujours
aussi simple ?
Et puis, il y a les droits non écrits : le droit à la culture,
le droit à la conversation, le droit à la beauté, le droit à
être valoriser, le droit à la tendresse, à la
compassion...
Il faut aussi ne pas les oublier lorsque l’on parle de
bientraitance. Ne sont-ils pas eux aussi attachés à toute
personne, à ses désirs, à son épanouissement.
Bref, pour conclure cette première partie de mon propos,
la Bientraitance est une culture qui, appuyée sur une
conception de l’homme, de ses droits et de ses qualités
fondamentales, doit nous amener, dans notre champ
d’action particulier, à penser notre action, à l’adapter en
permanence pour que ces droits et ces qualités soient une
réalité quotidienne.
C’est un effort quotidien, pragmatique pour que la
personne, ses besoins, ses aspirations demeurent
centrales dans l’organisation et le fonctionnement de nos
établissements.
C’est une vigilance constante pour ne pas laisser des
petites négligences quotidiennes, des habitudes
ritualisées prendre le dessus au détriment de l’attention
due aux personnes, toujours vulnérables, qui sont dans
nos institutions, leur histoire, leur sensibilité, leur
singularité et tout aussi important leur similarité avec nous.
C’est enfin, une dynamique individuelle et collective,
une éthique, individuelle et sociale, soutenue par
l’expression des usagers et l’engagement des
équipes.
Car la Bientraitance se situe pleinement dans le champ de
la réflexion éthique. A la fois parce qu’elle est toujours une
recherche de réponse à ce qui est bon ou a ce qui est
mauvais pour la personne, parce qu’elle est en
permanence « située » dans le temps et dans le concret et
parce que la réponse apportée à la question – comment
agir au mieux – sera toujours particulière, relative au cas
considéré.
Rien n’étant figé, fixé et imposé du dehors, le travail sur la
Bientraitance ne peut venir si je puis dire que du dedans,
du dedans de l’institution, des équipes par un
questionnement permanent sur nos bonnes ou nos
mauvaises pratiques.
C’est pourquoi, le C.H.S a considéré qu’il était
indispensable qu’un lien et des temps de réflexions
puissent être créés.
Que ces temps deviennent réguliers afin de soutenir les
pratiques professionnelles, soutenir les professionnels
eux-mêmes en promouvant la réflexion, l’analyse au sein
de notre Comité Local de réflexion Ethique que nous
avons installé en septembre 2011.
De même, je voudrais souligner car je pense que cela y
concourt, l’existence ici d’une unité composée de deux
psychologues dont la mission est, face aux situations
difficiles que peuvent vivre un professionnel, une équipe,
de mettre en place un accompagnement spécifique,
ponctuel adapté.
C’est une initiative qui existe au C.H.S. depuis longtemps
bien avant qu’elle ne généralise dans d’autres
établissements.
Je terminerai mon propos par quelques questions et
une réflexion.
Mes questions portent sur le fait de savoir s’il existe une
approche spécifique de ce concept de Bientraitance
dans un hôpital psychiatrique. Je crois que oui et j’en
suis même convaincu.

4/21
Pourquoi ? Parce que la psychiatrie est la seule discipline
médicale où il existe la notion de soins sans
consentement, de contrainte aux soins.
C’est une zone de vigilance particulière au regard de la
liberté des patients et de leur autonomie.
Dans ce cadre, être bientraitant peut signifier prendre des
risques et entrer en contradiction avec le fameux principe
de précarisation qui a pris une telle importance.
Parce qu’en psychiatrie se pose la question de
l’acceptabilité de la maladie par le patient lui-même, mais
aussi par la société.
Cette question de l’acceptabilité interroge en terme
d’accès au système de soins et une fois que le patient y à
accéder, émerge souvent la question de l’acceptation des
soins eux-mêmes et du contrat de soins entre le patient et
ses thérapeutes.
Parce que la maladie psychiatrique rend extrêmement
vulnérable, le patient bien sûr, souvent déjà en situation
sociale, familiale, précaire mais les soignants eux-mêmes.
L’histoire de l’individu, l’installation, le développement de
la maladie peuvent entrer en résonnance et parfois de
manière violente avec l’histoire, le vécu, la sensibilité du
soignant.
La matière première des soins psychiatriques c’est le
temps et l’instrument de ces soins, c’est la relation. Un
hôpital psychiatrique, si je voulais le résumer et le
caractériser, c’est un plateau technique relationnel.
Alors dans un hôpital psychiatrique, comparé à un hôpital
général, aux disciplines médicales « dures » où la
technique et la technologie sont si présentes, le risque de
réification du malade pourrait sembler moins important, le
patient psychiatrique comme sujet dans la relation
thérapeutique.
Mais, à contrario, du fait même de cette proximité et de
cette intensité relationnelle, comme me le rappelle Mme le
Dr DUPERRET, la maladie psychiatrique peut être
contagieuse. C’est là une dimension tout à fait particulière
et importante lorsqu’on réfléchit sur la Bientraitance.
Ces quelques questions, j’en suis certain trouveront un
éclairage et peut être un début de réponse lors de la table
ronde qu’animera le Dr DUPERRET.
Enfin permettez-moi une réflexion.
Si la Bientraitance marque le souci d’une amélioration
intellectuelle et éthique du sens des soins, si le manque
de moyens n’empêche pas nécessairement d’améliorer
certains aspects de la pratique, elle doit aussi marquer le
souci d’une amélioration des conditions de travail et des
conditions matérielles d’accueil des patients.
Je parlais tout à l’heure de ces droits non écrits. Je
pourrais ajouter pour les patients du CHS celui de ne pas
avoir froid en hiver, de vivre et de dormir dans un espace
à soi, le droit à l’intimité…
L’architecture, l’organisation et l’articulation des espaces
revêtent en psychiatrie une importance toute particulière.
On parle de thérapie institutionnelle, on dit souvent que
« les murs soignent ».
Alors attention à ne pas créer, en mettant en avant de
manière légitime, la Bientraitance et ses exigences et
en oubliant les conditions concrètes, matérielles qui
font le quotidien des professionnels et des patients,
attention de ne pas créer un décalage, une frustration,
une incompréhension qui finalement laisserait percevoir
à travers la priorité mise sur la Bientraitance une de ces
injonctions paradoxales dont il est vrai nous avons une
certaine habitude.
Surtout si la Bientraitance s’accompagne de la production
de toute une série de recommandations, labels,
évaluations qui pèseront d’abord sur les professionnels qui
sont en première ligne, les soignants.
D’ailleurs je ne suis pas certain que ce ne soit pas là un
danger pour la motion de Bientraitance elle-même de la
rigidifier dans des indicateurs, de la quantifier, en quelque
sorte de la technocratiser.
Quoiqu’il en soit et sans esprit, ni de polémique, ni de
provocation, je veux dire que pour être tous
« bientraitants », il faut être « bientraités ».
Voilà, je me tais en concluant par la phrase que Mme
COMPAGNON a mise en introduction de son rapport :
« Retenez bien ceci : tout nous sépare. Vous êtes en
bonne santé, nous sommes malades, vous n’avez pas
le temps, nous avons trop de temps. Personne ne peut
se mettre à la place de l’autre ; en revanche nous
pouvons tous faire quelque chose pour nous parler,
nous comprendre. »
Cette phrase est une invitation pour qu’à travers le
développement de la Bientraitance dans nos structures,
chacun voit dans l’autre son semblable dans une relation
d’égalité d’humanité.

5/21
Introduction
Annick GIRAUDET, Responsable
Commission SANTE UDAF 71
Dès l'engagement des premières réflexions sur la
démocratie sanitaire, qui ont préfiguré la loi Kouchner,
l'UDAF de Saône et Loire a souhaité s'engager dans le
parcours qui devait déboucher sur une participation
effective des usagers à la prise en compte de leur
santé.
Notre union nationale, co-fondatrice du Collectif Inter
associatif Sur la Santé (CISS), s'est elle-même impliquée
dans cette démarche.
Naturellement engagée dans ses missions de
représentation de l'ensemble des familles, l’UDAF de
Saône et Loire s’est totalement investie dans la mise en
œuvre de la loi du 4 mars 2002, qui a permis de garantir
des droits aux usagers du système de santé.
Cette reconnaissance de droits se retrouve sous deux
aspects :
• Une approche individuelle, de façon à ce que la
volonté de la personne soit respectée dans
l’accès à l’information, le consentement, l’accès
au dossier médical ou la réparation des accidents
médicaux.
• Une approche collective, qui envisage,
notamment, la participation des usagers dans les
instances de santé.
Cet ensemble de droits collectifs et individuels a marqué
son temps, et il nous appartient désormais d’en assurer la
pérennité, mais aussi de démontrer au quotidien que la
représentation des usagers dans les établissements de
santé sera d’autant plus efficace qu’elle s’inscrira dans
une démarche de collaboration et de construction avec les
soignants, plutôt que dans la confrontation.
Notre Institution a donc voulu agir sous 5 axes :
Une mobilisation de ses structures internes, avec
d’abord la mise en action d’une commission
spécialisée dans les domaines de la santé. C’est à
ce groupe de bénévoles, mais aussi de salariés, que
nous devons l’organisation de cette journée. Cette
mobilisation nous a également amenés à solliciter
notre agrément au niveau régional, permettant de
désigner des représentants des usagers dans les
établissements de santé.
Une implication forte dans la formation de ces
représentants des usagers, sans nous limiter
toutefois aux seuls membres désignés au titre des
associations familiales. En effet, c’est par une action
commune et concertée que nous remplirons au mieux
nos missions. Et l’un des exemples les plus
significatifs se trouve être la place importante et
reconnue tenue par ces représentants dans les
conseils de surveillance et dans les commissions
de relation avec les usagers (CRUQPC). C'est
d'ailleurs dans ce cadre que nous avons apporté
notre participation à la mise en œuvre d'une Maison
des usagers, qui permet aux associations d'usagers
et de patients de tenir des permanences d'accueil
pour les familles et les malades eux-mêmes. Bien
entendu, les représentants des usagers participent
également aux autres commissions internes, telles la
lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou
l'alimentation et la nutrition (CLAN).
L’information des familles, dont l’un des exemples
aura été la conception et la distribution de 200.000
dépliants d’information sur la prévention des
infections nosocomiales. Tout en étant déjà ancien,
ce document que vous trouverez dans les pochettes
remises à l’accueil n’en conserve pas moins toute sa
pertinence.
La création et le portage d’une association
départementale ALMA, d’abord concernée par la
maltraitance envers les personnes âgées, et
récemment étendue aux personnes handicapées.
Notre rencontre d’aujourd’hui, tout à fait dans l’objet
de cette association, témoigne également de
l’évolution du concept, qui nous dicte d’assurer plutôt
la recherche et la promotion de la bientraitance, et
ceci tant à domicile que dans les établissements.
Les interventions réalisées lors des réunions
associatives, ainsi que dans les établissements de
santé, sur le thème des droits et devoirs des
usagers. Le public touché est alors sur un spectre
très large, allant des soignants jusqu’aux patients et
leurs familles.
La bientraitance se révèle donc être une préoccupation
de tous les instants, et qui tombe sous la responsabilité
des professionnels pour ce qui concerne les
établissements, et des familles pour ce qui est du
quotidien à domicile, mais également dans les lieux
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%