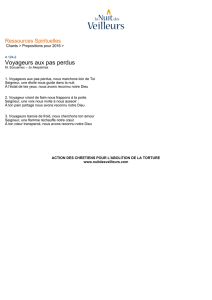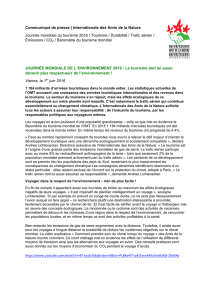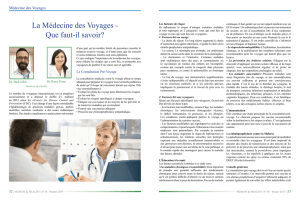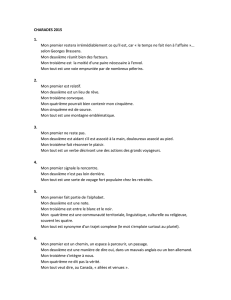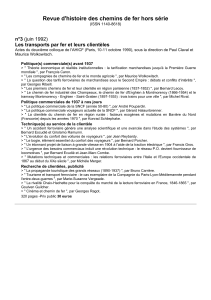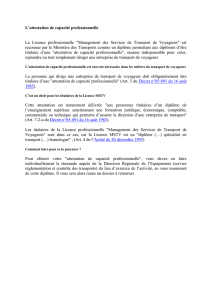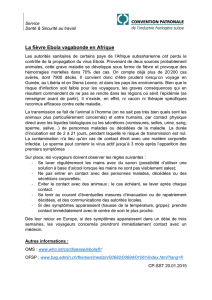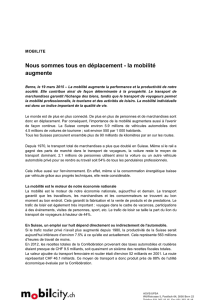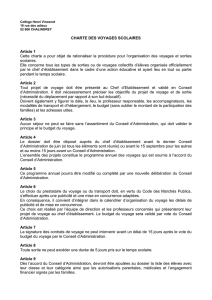Le transport de personnes à longue distance 30.

Le transport de personnes à longue distance
La mobilité des personnes n’a cessé de croître au cours de la seconde moitié du XXe siècle, accroissement qui a
été très favorable à la route. L’utilisation de l’automobile s’est en effet développée beaucoup plus rapidement
que celle des transports collectifs de voyageurs, trafic urbain comme interurbain. La voiture individuelle
supporte toutefois la concurrence d’autres modes collectifs de transport de passagers, en particulier le train à
grande vitesse et l’avion pour les déplacements de longues distances.
La voiture privilégiée au détriment des transports collectifs de voyageurs
Les transports intérieurs de voyageurs représentaient 96,6 milliards de voyageurs par kilomètre en 1954 contre
841,3 milliards de voyageurs par kilomètre en 2000. Cette croissance du trafic de voyageurs n’a été que peu
affectée par les deux chocs pétroliers.
Les voyages à longue distance
Entre 1982 et 1994, les voyages à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence, pour motifs personnels ou
professionnels, ont augmenté de 68 %. C’est le segment de mobilité qui a augmenté le plus rapidement. On est
passé de 4 voyages en moyenne par personne 1 et par an à 6 en 1994.
La fréquence de départ n’est pourtant pas uniforme selon la population, de même que le choix de la destination.
En effet, l’influence du revenu du ménage fait que les cadres supérieurs apparaissent comme les plus mobiles
(plus de 8 voyages par an en 1994 dont presque 2 fois plus à l’étranger que la moyenne des Français). Les
agriculteurs, qui voyagent relativement peu, ont néanmoins tendance à partir plus depuis quelques années : de
1982 à 1994, leur taux de départ a doublé.
Par rapport au cycle de vie, les jeunes et les personnes plus âgées ont des comportements assez semblables : ils
font les voyages les plus longs mais les moins lointains, même s’ils se déplacent à l’étranger un peu plus que la
moyenne.
Le motif du voyage joue sur la durée du séjour et sur la distance parcourue : les voyages professionnels sont en
moyenne moins éloignés du domicile (770 km en 1994) et plus courts (2,7 jours) que les voyages pour raisons
personnelles (917,6 km et 6,5 jours) et, autant en 1982 qu’en 1994, le quart des voyages personnels et plus de la
moitié des voyages professionnels sont des voyages d’une journée.
Le mode de transport choisi diffère également selon le motif principal : les transports collectifs tels que l’avion
et le TGV sont plus souvent utilisés dans le cadre des voyages professionnels que pour les motifs personnels,
particulièrement par besoin de rapidité. Mais, tous motifs confondus, on ne prend réellement l’avion qu’à partir
de séjours de 4 nuits, à plus de 1000 km, la voiture n’assurant plus que la moitié des déplacements.
Concernant les destinations, près d’un quart des voyages se font au sein d’une même région alors que moins du
dixième se déroulent à l’étranger. Les Français sont les plus grands détenteurs de résidences secondaires du
monde, et les utilisent dans le cinquième des séjours de loisir et de vacances. La possession de résidences
secondaires, dont la croissance a en effet été fulgurante (447500 en 1954, 950000 en 1962 et 1 160000 en 1968)
est toutefois en cours de stabilisation (2 818000 en 1990 et 2 912000 en 1999).
Bien qu’en croissance rapide, le transport des personnes à longue distance est loin d’être majoritaire dans
l’activité des transports. Les kilométrages automobiles liés à cette mobilité ne représentent qu’un quart de la
circulation automobile totale (exprimée en voyageurs-kimomètres).
Les évolutions de la répartition intermodale des transports de voyageurs
Dès le milieu des années 50, les deux tiers des déplacements intérieurs de voyageurs mesurés en voyageurs-
kilomètres étaient assurés par la voiture particulière, cette proportion a atteint 84 % en 1999. Les années 80 ont
1 Selon la méthodologie de l’enquête seuls sont pris en compte les déplacements des personnes de plus de 6 ans .
309
Futuribles / Etude rétrospective et prospective des évolutions de la société française (1950-2030)
30.
311

été marquées par une accentuation de la concurrence entre l’automobile et les transports collectifs, tant sur la
longue distance où, du fait de l’essor du réseau autoroutier, la voiture concurrence le train, qu’en milieu urbain.
Les transports aériens de voyageurs se sont également beaucoup développés, bénéficiant d’une progression plus
rapide que les transports ferroviaires de voyageurs, concurrençant les autres modes sur les moyennes distances
intérieures et profitant du développement des voyages à l’étranger.
La répartition entre modes de transports de personnes apparaît comme très sensible à la longueur des
déplacements (la voiture qui représente 91 % des déplacements inférieurs à 100 km, ne réalise que 52 % des
trajets de plus de 600km, distance pour laquelle la part de l’avion — 25 % des déplacements — dépasse celle du
train — 17 %). La nature des déplacements selon qu’il s’agit de voyages personnels ou professionnels influence
également le choix du mode de transport.
Les transports collectifs routiers de voyageurs (autobus et autocars) recouvrent un trafic tant urbain
qu’interurbain (transport scolaire et de personnel, transport régulier ou occasionnel) que les données accessibles
ne permettent pas de séparere. Leur part évolue peu depuis le milieu des années 80 (elle représente environ 5 %
du total des déplacements sur le territoire métropolitain mesurés en voyageurs par kilomètre), ce qui constitue
une certaine performance face à la concurrence de l’automobile particulière et des chemins de fer.
Si l’on additionne les parts respectives de la voiture individuelle et des transports routiers collectifs, la route
supporte plus de 89 % des trajets parcourus sur le territoire national. Ce pourcentage est resté stable au cours des
20 dernières années. Le reste des déplacements intérieurs (c’est-à-dire 11 % d’entre eux) sont effectués en train
ou en avion.
Les transports ferroviaires de voyageurs (mesurés en voyageur par kilomètre) ont augmenté depuis les années
50, mais à un rythme assez lent — entre 2 % et 3 % par an — jusqu’en 1985. Ils ont ensuite stagné pendant
plusieurs années. En dépit de l’accroissement du nombre de voyageurs par kilomètres transportés, la part du fer
dans les transports interurbains de voyageurs a fortement diminué (elle est passée de 23,6 % en 1954 — hors
RATP — à moins de 7 % en 2000).
Le développement du TGV, à partir du début des années 80, a donné un nouveau souffle au transport ferroviaire
de voyageurs. En 1999 les TGV représentent la moitié du trafic voyageur de la SNCF. Cet essor s’est toutefois
effectué aux dépens du réseau classique, les transports ferroviaires de personnes ayant même globalement
diminué au cours des années 90 avant de connaître une nouvelle croissance à la fin de la décennie.
Depuis le début des années 70, le transport aérien de voyageurs a connu une croissance largement supérieure à
celle des autres modes de transports collectifs (le taux de croissance des transports aériens intérieurs a été
supérieur à 60 % entre 1988 et 1998, contre 20 % pour le train et 10 % pour les autres modes de transports
terrestres –urbains, routier, taxis). La France demeure le premier pays européen en matière de densité de
fréquentation des vols intérieurs (les lignes de transport domestique ont été développées à un rythme soutenu et
régulier à partir de 1970). Entre 1980 et 1999, le trafic aérien domestique a augmenté de 10 milliards de
voyageurs par kilomètres, soit une croissance annuelle moyenne de 0,5 milliards par an. En 1999 le trafic aérien
intérieur s’est accru d’un milliard de voyageurs par kilomètres par rapport à l’année précédente (15,5 milliards
de voyageurs par kilomètres ont été transportés en 1999) ; taux de croissance annuel le plus élevé qui ait jamais
été observé.
La croissance du transport aérien international s’est poursuivie à un rythme élevé jusqu’au début des années
quatre-vingt, puis elle s’est infléchie par la suite. Son profil est devenu plus irrégulier du fait d’évènements
particuliers tels que la guerre du golfe en 1991 (et ultérieurement des attentats du 11 septembre 2001) et de la
forte concurrence internationale qui se traduit par une baisse des prix sensible. Le trafic aérien des compagnies
aériennes françaises est passé de 7,3 milliards de passagers par kilomètres en 1963 (y compris les transports
intérieurs) à 107,7 milliards de passagers par kilomètres en 1998.
310
Futuribles / Etude rétrospective et prospective des évolutions de la société française (1950-2030)
312

STABILISATION DE LA PART DE LA VOITURE PARTICULIERE DANS LES TRANSPORTS DE PERSONNES A
L’HORZON 2030 ?
Selon P. Merlin , la banalisation de la mobilité à moyenne et longue distance devrait réduire la différenciation
entre la clientèle des différents modes. La diminution de la taille moyenne des ménages, et celle des groupes se
déplaçant ensemble devraient jouer en faveur des transports collectifs. Cela d’autant plus que les personnes
vivant seules (jeunes, personnes âgées, ou séparées) résident le plus souvent en ville et sont moins équipées
d’automobiles. La distance deviendrait alors le principal critère discriminant entre les modes, l’avion prenant le
pas sur ses concurrents pour les trajets très longs, tandis que la voiture conserverait une part dominante des
trajets courts.
Bien qu’il soit peu probable que l’on assiste à une remise en cause de la domination du transport automobile, le
TGV peut espérer capturer une part importante du marché pour les trajets supérieurs à 250 kilomètres. On estime
en effet que le TGV a capturé environ un tiers du trafic aérien intérieur ou à destination des proches pays
européens. La diminution du trafic aérien a été estimée à 80 % pour des trajets d’une heure et demi en TGV, à
50 % pour des trajets de deux heures et demi et à 25 % pour des trajets de 4 heures. La vitesse en porte à porte
étant supérieure en TGV jusqu’à 300 Km environ. Le TGV, généralement moins coûteux pour l’usager apparaît
donc comme un concurrent sérieux (surtout si la liaison est intégralement TGV) pour l’avion pour les distances
de moins de 800 kilomètres.
En cinquante ans, le pourcentage du temps travaillé sur le temps d’une vie a été divisé par deux2. Ce
développement du temps libre a contribué à la forte croissance des déplacements liés aux loisirs et en particulier
les départs en week-end. Il semble difficile d’imaginer que la baisse du temps de travail se poursuive avec la
même intensité que par le passé un plateau pourrait être atteint. Cependant certains paramètres pourraient
prolonger la tendance à la hausse de la mobilité de longue distance:
- le développement de la double-résidence pour des retraités,
- le TGV qui permet d’élargir le bassin d’emploi de grandes villes,
- la poursuite du développement des courts séjours touristiques au détriment des longs séjours,
- l’augmentation du célibat et des couples sans enfants (catégories plus mobiles).
Dans le cadre d’un exercice de projection visant à évaluer les différentes composantes de la demande de
transport à l’horizon 2020 réalisé par le service économique et statistique du ministère de l’équipement, des
transports et du logement, les impacts de différentes politiques volontaristes en matière de transport ont été
analysés.
Les projections d’évolutions intermodales des transports de voyageurs
Les hypothèses
Les évolutions de la demande de transport sont dépendantes de l’environnement économique, législatif et
réglementaire, intégré sous la forme de deux types d’hypothèses 3. Les premières sont relatives à
l’environnement économique (avec trois hypothèses : une haute, une médiane et une basse 4). Les secondes sont
relatives aux politiques de transport mises en œuvre.
2 10% sur une vie entière aujourd’hui et 14% du temps de vie éveillé. « La France des temps libres et des vacances », J.
Viard, Ed. de l’Aube 2002.
3 Les projections de la demande de transport à long terme réalisées reposent sur l’hypothèse d’une stabilité des
comportements observés dans le passé en termes de consommation ou de sensibilité aux prix. Or il est peu probable que ces
comportements n’évoluent pas au cours des vingt prochaines années.
4 L’hypothèse haute recouvre une croissance annuelle forte du PIB (+2,9 %), la croissance médiane du PIB correspond à
+2,3 %, l’hypothèse faible revient à retenir une croissance du PIB de 1,9 %.
311
Futuribles / Etude rétrospective et prospective des évolutions de la société française (1950-2030)
313

Quatre scénarios recouvrant différentes hypothèses en matière d’évolution du prix moyen des carburants et des
différents modes de transports de voyageurs et de marchandises ont été testés en matière de politique de
transport :
• Le scénario A correspond à un scénario au fil de l’eau : poursuite des tendances observées sur les deux
décennies 1970-1980 .
• Le scénario B repose sur la poursuite des inflexions récentes apportées à la politique des transports (avec
notamment l’accroissement de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers – TIPP).
• Le scénario C, plus volontariste, correspond à une amélioration de l’internalisation des coûts externes et du
partage modal sans limitation de la mobilité des voyageurs.
• Le scénario D envisage un rééquilibrage des parts modales dans la perspective des engagements
internationaux relatifs à la lutte contre l’effet de serre.
• Sur la base de chacun des scénarios, la demande de transport de voyageurs à longue distance et la mobilité
locale ont été estimées 5.
Les résultats
Si l’on retient l’hypothèse médiane pour ce qui concerne l’environnement économique (croissance économique
de 2,3 % par an et hausse de 0,5 % par an du prix des carburants en francs constants) les projections de trafic
voyageurs à l’horizon 2020 se caractérisent par les inflexions suivantes relativement à la période passée :
• Un ralentissement de la progression des trafics routiers et aériens (l’arrivée à maturité des marchés
automobiles et aériens devrait se traduire par un ralentissement du rythme d’augmentation de ces modes de
trafics interurbains qui devrait se mettre à progresser au même rythme que la croissance économique contre
une fois et demie entre 1970 et 1996 6),
• Le maintien de la hiérarchie des parts modales (maintien de la prédominance routière, les hypothèses en
matière de croissance économique ayant toutefois un impact sensible sur le partage modal).
• Un contexte potentiellement plus favorable au transport ferroviaire (la demande demeurant très sensible à la
qualité de l’offre et aux tarifs)
L’évolution de la demande et de la répartition intermodale apparaît peu sensible au prix des carburants.
Le scénario le plus favorable aux transports ferroviaires qui ait été envisagé dans ces projections permet à la part
de la route de revenir à 74 % des transports interurbains de personnes en 2020 (contre près de 80 % en 1999) et à
la part du transport ferroviaire de voyageurs de passer de 16 % à 20 % (soit une situation qui se rapprocherait de
celle du début des années 90).
Ce scénario repose toutefois sur des hypothèses très fortes : multiplication par 2,5 du prix moyen pondéré des
carburants (ce qui correspond à un prix au litre du carburant d’environ 1,2 Euros) et baisse de 10 % des tarifs
ferroviaires. De telles hypothèses conduisent par ailleurs à une diminution globale des transports de voyageurs
de 17 %.
La sensibilité des projections aux politiques d’offre d’infrastructure a également été testée 7. Ces tests révèlent
l’impact relativement faible des hypothèses relatives aux infrastructures routières sur les trafics routiers. En
revanche, les hypothèses retenues en matière d’infrastructures ferroviaires (exprimées en termes de longueur de
5 Les perspectives d’évolution de la mobilité locale à horizon 2020 sont présentées dans le chapitre qui traite des grandes
tendances en matière de mobilité.
6 L’accroissement des trafics routiers et aériens demeurerait cependant important en valeur absolue avec une augmentation du
nombre de voyageurs-kilomètre comparable à celle observée dans le passé.
7 Trois hypothèses distinctes ont été testées. La première favorable à la route, la seconde favorable au rail, une hypothèse
médiane a également été envisagée.
312
Futuribles / Etude rétrospective et prospective des évolutions de la société française (1950-2030)
314

lignes nouvelles, toute amélioration des vitesses commerciales ayant un effet équivalent) ont un impact notable
sur ces trafics.
Il faut noter que dans les scénarios économétriques, le taux de croissance économique est sur-déterminant dans le
calcul des croissances de transport par rapport à d’autres paramètres, ce qui les rend encore plus discutables pour
le transport de voyageurs que pour le fret. En effet le scénario tendanciel fait apparaître des écarts de plus de
30% de trafic selon que le taux de croissance retenu est de 1,9% ou de 30%.
Les projections d’évolutions du transport aérien
Pour le transport aérien, la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) a également établi quatre scénarios
du transport aérien à l’horizon 2020 quantifiés en termes de passagers (Cf. Tableau 7). Le scénario qui envisage
la hausse la plus importante du trafic prévoit un doublement du trafic aérien sur les aéroports français à
l’horizon 2020 avec un taux de croissance annuel moyen de 3,3%.
Comparée à celles d’autres sources la prévision de la DGAC peut paraître prudente. En effet les constructeurs
prévoyaient une croissance annuelle moyenne de 5,2% pour Airbus et de 4,7% pour Boeing sur la période 1999-
2009. L’A.C.I. (Airports Council International) envisageait une croissance du trafic de 3,4% par an pour la
période 1999-2020 pour les aéroports européens et IATA (International Transport Association) une croissance
du trafic France de l’ordre de 4% l’an sur la période 1998-2015, un taux inférieur de 1,5 point à celui de la
période 1985-1998.
313
Futuribles / Etude rétrospective et prospective des évolutions de la société française (1950-2030)
315
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%