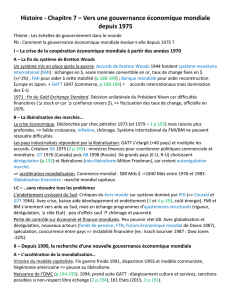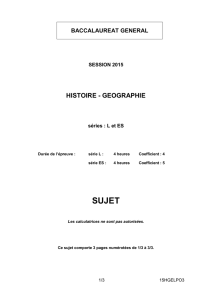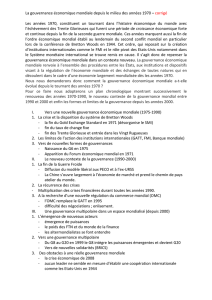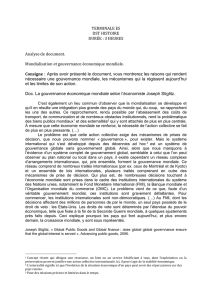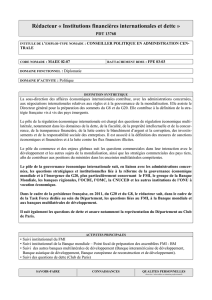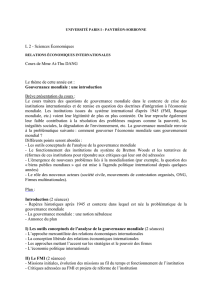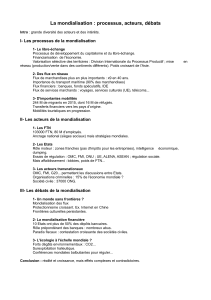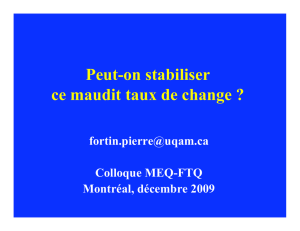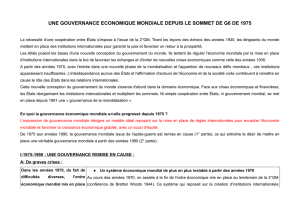CHAPITRE H3 LES ECHELLES DE GOUVERNEMENT

CHAPITRE H3
LES ECHELLES DE GOUVERNEMENT DANS LE MONDE
Gouvernance : action de gouverner, d’administrer, qui dépasse le cadre de l’Etat (ex : « gouvernance mondiale
»).
CHAPITRE H3c
LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE MONDIALE DEPUIS 1975
Au lendemain de le Seconde Guerre mondiale, la gouvernance économique mondiale est basée sur le
système mis en place à Bretton Woods en 1944. des institutions comme le FMI (Fond Monétaire International)
ou la BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement) tentent d'assurer une
gouvernance mondiale et d'assurer un cadre propice au développement dans les États ayant adopté un
système capitaliste. A partir de 1975, à la suite de l'échec de ces systèmes de régulation, une nouvelle
gouvernance économique, toujours inspirée par les pays développés, se met en place. Confrontée à l'essor de
la mondialisation, à l'accroissement des inégalités ainsi qu'à l'affirmation de nouvelles puissances
économiques, la gouvernance se transforme progressivement au début du XXIème siècle. Mais elle ne parvient
pas à faire taire les critiques lui reprochant de n'être ni assez efficace, ni assez démocratique. Comment a
évolué la gouvernance économique mondiale depuis 1975 afin de répondre aux défis de la mondialisation et
des crises financières ?
I - 1975-1991 : Quelle gouvernance a été mise en place dans un contexte de crises économiques et
financières mondiales ?
A) La dislocation du système de Bretton Woods
1) Un système économique mondial de plus en plus instable à partir des années 1970
Au cours des années 1970, une série de dérèglements économiques remet en cause le système mis en
place à Bretton Woods en 1944 et qui était fondé sur la libre convertibilité du dollar en or (faisant de celui-ci la
seule monnaie stable).
En août 1971, pour enrayer le risque de crise financière et d'épuisement de leur stock d'or, les Etats-
Unis décident de suspendre la convertibilité du dollar ; dans la foulée l’administration Nixon procède à une
dévaluation (diminution de la valeur en or d’une monnaie). En janvier 1976, les accords de la Jamaïque
consacrent le flottement généralisé des monnaies : la valeur de change de la monnaie est désormais fixée en
fonction de l'offre et de la demande sur le marché des changes. Le marché mondial des capitaux est alors très
instable. Les institutions internationales du domaine économique et financier (FMI, Banque mondiale, GATT…)
ne parviennent pas à lutter contre ces nouveaux déséquilibres économiques.
Entre 1973 (après la guerre du Kippour) et 1979 (après la révolution en Iran), en augmentant
considérablement les prix du baril de pétrole, les pays de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de
pétrole, créée en 1960 avec pour objectif de contrôler les prix et la production pétrolière) provoquent un
important ralentissement des économies des pays industrialisés frappés par une forte inflation et une montée
inquiétante du chômage : ce sont les deux chocs pétroliers. L’essoufflement de la croissance économique
mondiale touche aussi par ricochet les pays pauvres frappés par la baisse des prix des matières premières.
L’économie mondiale entre dans la première vraie période de crise depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale ; c’est la fin des Trente Glorieuses.
2) La libéralisation de l'économie mondiale
Face à ces difficultés à la fin des années 1970, les solutions issues du néolibéralisme (prônant une
déréglementation accrue, une restriction de l'intervention de l’État dans les affaires économiques) sont

d'abord défendues aux États-Unis par les Républicains (Reagan) et au Royaume-Uni (Thatcher). Elles se
diffusent en Europe occidentale puis dans de nombreux pays du Sud par l'intermédiaire du FMI et du GATT qui
appliquent le consensus de Washington. Ce vaste mouvement de déréglementation se traduit par la
privatisation des entreprises publiques, la libéralisation des capitaux et des services financiers, la réduction des
dépenses de l’État dans les services publics.
Consensus de Washington : ensemble des règles suivies par le FMI pour ses plans d'ajustements structurels.
Ces règles organisent le désengagement de l’État dans l'économie et la libéralisation de celle-ci.
Dans les années 1980, le processus de mondialisation s'accélère. Il est encouragé par la confiance dans
la capacité des marchés à s'autoréguler et facilité par les progrès techniques et les révolutions des
communications. Les acteurs privés (FTN, banques centrales, agence de notation) acquièrent de plus en plus
d'influence sur le fonctionnement de l'économie mondiale et cherchent à s'émanciper de la gouvernance des
États et des institutions internationales. Du fait de la déréglementation des activités boursières et des facilités
offertes par les nouvelles technologies de la communication (mise en réseau des ordinateurs), les services
financiers sont de plus en plus déconnectés de l'activité économique réelle et les transactions boursières
connaissent une véritable explosion. Cette spéculation financière est souvent à l'origine des crises, car la
régulation par les Etats des flux financiers devient moindre.
Agence de notation : entreprise chargée d'évaluer la capacité d'un emprunteur (État, entreprise) à faire face
au remboursement d'une dette.
B) Une nouvelle gouvernance mise en accusation
1) G6 / G7 : une tentative de reprise en main l'économie mondiale...
Le ralentissement économique incite, dès les années 1970, les États les plus riches et les plus
industrialisés de la planète à mettre en place des réunions régulières de chefs d’État et de gouvernement. Le
Groupe des six (G6 : Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni, France, RFA, Italie) créé en 1975 à l’initiative de Valéry
Giscard d’Estaing, se réunit pour la première fois à Rambouillet. Il est élargi au Canada en 1976 (G7) et
symbolise la volonté des États de retrouver une influence face aux nouveaux acteurs privés de la gouvernance
économique mondiale sans toutefois remettre en cause les principes du consensus de Washington.
Au cours de rencontres multilatérales régulières, le G7 cherche à relancer une coordination
internationale des politiques monétaires et commerciales. Influencé par les préconisations néolibérales,
notamment à partir de la fin des années 1970, il est accusé par ses détracteurs d'être un club des pays les plus
riches et de promouvoir un processus de mondialisation libérale, profitant d'abord aux pays développés sans
tenir compte des intérêts des pays du Sud.
Conscients de cette situation, les pays du Sud déjà groupés depuis 1964 au sein du G 77 créé au sein de
la CNUCED (Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement) réclament à l'ONU à partir
de 1974, un nouvel ordre économique mondial leur permettant de se développer et de se libérer de la tutelle
des pays du Nord et des FTN.
2) ...qui se manifeste au travers d'institutions de contrôle et de régulation …
Jusqu'en 1980, grâce au recours abondant à des prêts internationaux facilement accordés par des
banques privées en l'absence de contrôle du FMI, les pays du Sud ont pu limiter les effets des chocs pétroliers
et de la crise mondiale. À l'été 1982, alors que l’endettement des ces pays a atteint un record, le Mexique
annonce qu'il est incapable de rembourser sa dette, suivi par la plupart des pays débiteurs.
Cette crise de la dette conduit à la restauration de l'autorité du FMI, soutenu par la Banque mondiale et
promu « gendarme » des politiques publiques des pays débiteurs. Le FMI devient donc une instance de
contrôle, mais qui ne s'exerce que sur les pays en difficulté donc les plus pauvres. Afin d'obtenir un
rééchelonnement de leur dette et une aide au développement, les États en difficulté financière se voient
imposer des mesures drastiques de réduction des dépenses publiques, de déréglementation, de privatisations
sous la forme de programmes d'ajustement structurel (PAS).

PAS (Programme ou plan d'ajustement structurel) : programme de réformes économiques imposées par le
FMI ou la Banque mondiale aux pays en difficulté financière en contrepartie de leur aide. Il oblige ces pays à
réduire leurs dépenses publiques, à privatiser des entreprises et à ouvrir leurs marchés nationaux. Les
conséquences sociales de ces plans ont entraîné de nombreuses critiques.
3) ...dont les mesures ont des effets limités sur la gestion des crises
La direction du FMI étant entre les mains des pays les plus riches, cette situation est interprétée par
certains comme une situation de domination des pays du Nord sur les pays du Sud. En outre, la mise en place
des programmes d’ajustement structurel (PAS), inspirés du néolibéralisme, suscite de fortes contestations.
Leurs opposants, comme Joseph Stiglitz, les jugent responsables de l'aggravation des difficultés des pays
d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ces plans ont en effet conduit à réduire considérablement les dépenses de
santé, d’éducation, de protection sociale, hypothéquant ainsi le développement des ces pays. C'est pourquoi
les opposants aux PAS réclament une annulation partielle ou totale de la dette des pays concernés.
Les mesures d'austérité préconisées par le FMI et la Banque mondiale ne permettent pas aux pays
soumis aux PAS de sortir de la crise de la dette, dont le montant global ne cesse d'augmenter au cours des
années 1980. Les pays du Sud protestent contre une gouvernance qui s'accompagne du maintien voire de
l'accentuation des écarts avec les pays du Nord.
Le maintien d’une certaine coopération économique au sein du G7 ne se traduit pas vraiment par une
politique commune de gestion des défis que posent la mondialisation et la crise. Il peut exister des divisions
comme sur la question de l’aide à apporter aux pays du Sud ou sur la question naissante du développement
durable (rapport Brundtland en 1987).
Alors qu'une gouvernance économique mondiale impliquant davantage les pays en développement
semble nécessaire, une tendance à la multipolarisation se manifeste au travers de la création et du
renforcement de regroupements économiques régionaux Acte unique européen en 1986, MERCOSUR en 1991
…). Enfin les mouvements spéculatifs de grande ampleur, facilités par la déréglementation, s'accompagnent du
retour des désordres financiers et d'une instabilité monétaire permanente (krach boursier de 1987, rechute de
l'économie mondiale entre 1989 et 1993). Les États et les institutions de Bretton Woods semblent incapables
de les éviter.
II- Comment la gouvernance économique mondiale cherche-t-elle à s'adapter aux nouveaux défis
économiques depuis 1991 ?
A) Le triomphe de la gouvernance libérale (1991-2008)
Entre 1989 et 1991, la disparition du bloc communiste semble consacrer la victoire du capitalisme. Le
monde paraît devoir être désormais concerné que par un seul système économique. Au G7 et aux
organisations économiques et financières dépendantes de l’ONU, vont s’ajouter de nouveaux acteurs.
La réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) de Davos, où se rassemblent de nombreux
acteurs de la nouvelle gouvernance économique mondiale. Dirigeants politiques, chefs d'entreprises,
intellectuels, journalistes, représentants d'ONG acquis aux mérites du libéralisme y discutent de l'avenir de
l'économie mondialisée. C’est, par exemple, devant ce forum de Davos que le premier ministre britannique
David Cameron vient annoncer en 2014 son intention de poursuivre encore la libéralisation de l’économie de
son pays.
FEM : réunion annuelle à Davos (Suisse) des principaux décideurs politiques et économiques du monde entier
qui symbolise, aux yeux des altermondialistes, la mondialisation libérale.
En 1994, au terme de l'Uruguay Round (un des 8 cycles de négociations du GATT), l'OMC remplace le
GATT avec l'ambition de renforcer le libre-échange et d'élargir les négociations commerciales à l'agriculture et
aux services. L'OMC peut sanctionner les entorses au libre-échange et, en réunissant plus des 2/3 des pays de
la planète, elle est une institution de premier plan dans la nouvelle gouvernance économique mondiale.

B) Une gouvernance économique toujours plus complexe et contestée
1) une évolution de la gouvernance dictée par l’enchaînement des crises
Dans les années 1990, relayés par le FMI et la Banque mondiale, les principes du consensus de
Washington s'imposent à un nombre croissant d'Etats incités à une ouverture toujours plus grande de leur
marché. Sous l'effet de ces incitations, la mondialisation prend un nouvel essor : les échanges commerciaux et
financiers internationaux s'intensifient, les pays émergents connaissent des taux de croissance records, mais
les crises financières se multiplient (1992-1993 : crise du système monétaire européen, 1997 : crise
économique asiatique …).
Cette interdépendance accrue des économies, révèle les dangers d'un capitalisme libéralisé échappant
au contrôle des États et des institutions internationales. La crise des subprimes qui démarre en 2008 au États-
Unis (elle est le résultat d’une politique de crédit trop laxiste de la part de la Banque fédérale américaine pour
permettre aux Américains d’acheter leurs maisons) confirme ces risques en devenant systémique : la crise du
crédit devient bancaire, boursière, financière et s'étend au monde entier. (On appelle risque systémique le
risque qu’un événement particulier entraîne par réactions en chaîne des effets négatifs considérables sur
l’ensemble du système pouvant occasionner une crise générale de son fonctionnement.)
La gravité de la situation stimule le renouveau de la coopération interétatique. En 2008, au sommet de
Washington, le G20 se lance dans la lutte contre la crise. En s'occupant désormais des grandes questions
financières et monétaires, le G20, réunion des grandes puissances économiques du Nord et du Sud, prend le
pas sur le G8 en déclin depuis le début des années 2000. Progressivement le G 20 se transforme en pôle de
concertation sur les réformes économiques internationales à mener à long terme (renforcement des moyens
d'intervention du FMI, pression sur les paradis fiscaux, projets de taxation des transactions financières) ; si
certains analystes estiment que le G 20 manque d'efficacité et de légitimité, sa création symbolise toutefois
l'accession des pays émergents au statut d'acteurs majeurs de la gouvernance économique mondiale. Un an
après leur entrée au G20, les pays émergents se regroupent au sein du BRIC, puis au sein du BRICS en 2011
avec l'adhésion de l'Afrique du Sud.
La mondialisation a en effet stimulé la croissance de nouvelles puissances décidées à ne plus laisser la
gouvernance aux mains des pôles de la Triade. La concurrence exacerbée entre les États a aussi rendu plus
difficiles les prises de décisions collectives en matière de libéralisation du commerce, de développement
durable (cf réticence du 1° ministre australien lors du G20 de Brisbane) ou de lutte contre les problèmes de la
dette en Europe (cf difficultés rencontrées par la Grèce afin de réduire son déficit et d'obtenir un
assouplissement de la part de l'UE). Autre exemple de ces difficultés, la fin du cycle de négociations lancées
par l'OMC que la plupart des analystes considèrent comme un échec en raison d’objectifs et d'intérêts de plus
en plus divergents des États.
Ces difficultés à mettre en place une gouvernance économique mondiale efficace et consensuelle se
traduisent également au travers du renforcement des organisations commerciales à l'échelle régionale plutôt
que mondiale.
2) des contestations de plus en plus virulentes
Des acteurs non-étatiques comme les FTN, les banques, les scientifiques (GIEC : groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat), mais aussi les ONG acquièrent une influence grandissante dans
la gouvernance économique mondiale. Au cours des années 1990, les ONG les plus influentes ( Médecins du
monde, Action contre la faim …) apparaissent à la fois comme une force de mobilisation contre les dérives de
la mondialisation, mais aussi comme des partenaires sollicités par les organisations internationales pour leur
expertise sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux.
En 1999, à Seattle, aux Etats-Unis, la forte mobilisation contre le sommet de l'OMC marque l'entrée en
scène des altermondialistes. A partir de 2001, les réunions du Forum social mondial (FSM) permettent aux
différents acteurs de l'altermondialisme de médiatiser leur opposition aux décisions prises par les promoteurs
de la mondialisation libérale (FMI, OMC, Banque mondiale notamment). Le FSM sert aussi de lieu de débats
consacrés aux projets d'une gouvernance soucieuse de réduire les inégalités de développement. En outre, la
crise de 2008 a suscité l'apparition de mouvement de citoyens (Indignés, « Occupy Wall Street ») réclamant

une gouvernance plus démocratique.
A la fin des années 1990, la prise de conscience des menaces provoquées par le réchauffement
climatique entraîne la recherche de solutions à l'échelle internationale. De la signature du protocole de Kyoto
en 1997 au sommet de la Terre à Rio en 2012 en passant par la conférence de Copenhague sur le climat en
2009, le thème du développement durable a progressivement été intégré aux débats économiques mondiaux.
Mais l'incapacité des Etats à dépasser le discours d'intention démontre l'absence d'instance supranationale
capable de réguler les contradictions de la mondialisation.
Les crises à répétition des années 2000 ont alimenté las contestations contre les institutions et les
principes de la gouvernance libérale. Le FMI et la Banque mondiale ont été remis en cause pour leur
fonctionnement antidémocratique et les conséquences néfastes des politiques d'ajustement structurel . La
mise à l'ordre du jour à l'agenda du G 20 de la lutte contre les paradis fiscaux symbolise la prise de conscience
des méfaits d'une mondialisation financière incontrôlée. Si la réforme de la gouvernance du FMI a permis le
renforcement du poids des pays émergents en 2010, certains tels Joseph Stiglitz, défendent le projet d'une
gouvernance plus démocratique, véritablement multilatérale, qui pourrait s'exercer dans le cadre des Nations
Unies.
1
/
5
100%