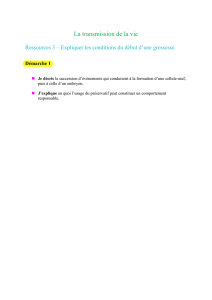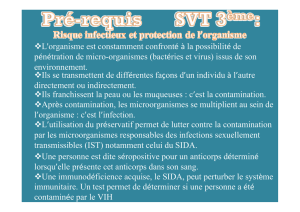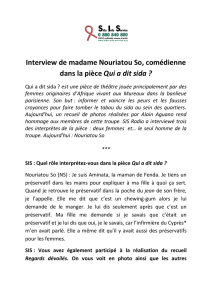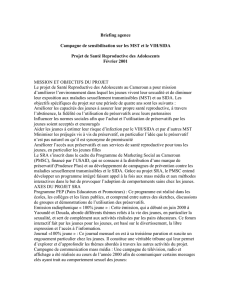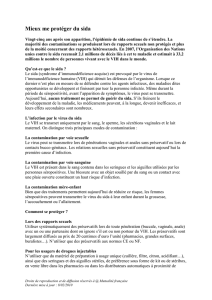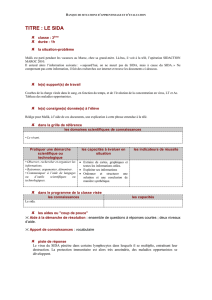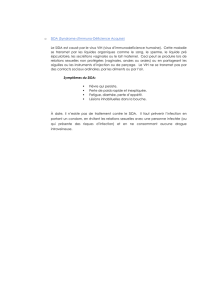Au royaume du Maroc, le silence n`est plus roi

7
Transversal n° 33 novembre-décembre grand reportage
grand reportage par Marianne Bernède
peutiques à plein temps, entièrement financés par l’as-
sociation, sont à la disposition des patients atteints par
le VIH. Une assistante sociale, elle aussi à plein temps,
complète le dispositif de prise en charge : indispensable
pour aider des malades qui sont, le plus souvent, dans
une situation financière et matérielle désastreuse.
Un suivi spécifique. L’éducation thérapeutique est depuis
longtemps le cheval de bataille de l’ALCS. Et nombre de
pays occidentaux, dont la France, pourraient s’inspirer de ce
qui se fait au Maroc. Tous les patients, sans exception,
bénéficient de ce suivi, sauf bien sûr ceux qui ne le sou-
haitent pas, mais ils sont peu nombreux. Dès que l’annonce
d’un résultat positif a été faite par un médecin, suite à un
dépistage dans un CDAG ou par l’unité mobile de dépis-
tage mise en place par l’ALCS, la personne est orientée vers
Au Maroc, l’Association de lutte contre le sida (ALCS) est presque devenue une institution.
Son action, exemplaire dans un contexte arabo-musulman où le tabou sur la sexualité
est pesant, sert aujourd’hui de référence au niveau international. Une réussite due,
sans aucun doute, au militantisme acharné et au charisme incontestable de sa présidente,
Hakima Himmich, mais aussi à la mobilisation d’équipes motivées dans tout le pays.
Reportage.
Au royaume du Maroc,
le silence n’est plus roi
«Vous n’avez pas encore vu le jardin ? Mais c’est le seul
véritable jardin qui existe au sein d’un hôpital, dans tout
le Maroc ! », s’exclame avec fierté la PrHakima Himmich,
chef du service des maladies infectieuses du CHU de
Casablanca et présidente de l’ALCS, dont elle a impulsé la
création, il y a presque 20 ans, en 1988. « Il est entre-
tenu par un particulier, qui paye le jardinier », ajoute-
t-elle, soucieuse d’être toujours précise sur l’utilisation
des fonds, à l’hôpital comme à l’association.
Il est vrai que cet îlot de verdure ressemble à un havre de
paix au milieu du grand établissement hospitalier.
Quelques patients se reposent sur les bancs en attendant
leur consultation à l’hôpital de jour, dont la modernité
contraste avec les services « classiques » d’hospitalisation,
un brin vétustes.
Un peu à l’écart, un petit bâtiment : une salle d’attente
spacieuse et plusieurs salles de consultation. C’est le fief
de l’ALCS au cœur de l’hôpital : quatre éducateurs théra- © Sidoli/Basoh
© Marianne Bernède

le service d’éducation thérapeutique. Idem pour tout patient
séropositif reçu dans le service des maladies infectieuses
ou à l’hôpital de jour. «Ce qui est extraordinaire, c’est qu’ici
tous les médecins et le personnel sont convaincus de
l’importance de l’éducation thérapeutique », explique le
DrKebir Dacif, l’un des éducateurs de l’équipe. Et ce suivi
spécifique prend tout son sens dès le départ. « La décou-
verte de la séropositivité est un choc, un traumatisme. Le
fait que le patient bénéficie d’une séance spéciale, dans
un local à part, avec une autre personne que le médecin
qui a annoncé le diagnostic, a un effet psychologique très
important », poursuit Kebir. La séance initiale, consacrée à
l’explication de la maladie et des modes de transmission,
permet aussi à l’éducateur d’élaborer un programme per-
sonnalisé, de définir des objectifs à atteindre lors des
séances suivantes, à l’aide d’outils pédagogiques particu-
liers. Exemple : un carnet (une sorte « d’agenda du traite-
ment ») est délivré aux patients afin de les aider à bien
prendre leurs médicaments ; pour les personnes ne sachant
ni lire ni écrire (au Maroc, plus de la moitié de la population
est analphabète), il est illustré d’autocollants représentant les
différents cachets ou comprimés.
Sexualité, utilisation du préservatif, interprétation des ana-
lyses biologiques, démarrage du traitement ou désir de
mariage : tous les sujets sont abordés. « L’éducation thé-
rapeutique va bien au-delà du médical. Nous évoquons
la prise de médicaments ou les effets secondaires, ainsi
que toutes les questions sociales et psychologiques liées au
VIH, sujets dont le médecin traitant n’a pas toujours le
temps ou la possibilité de parler. Une complicité se crée
entre le patient et l’éducateur thérapeutique : c’est une
relation extrêmement intéressante et intime », confie Kebir,
convaincu de l’intérêt de cette approche. « Un patient qui
se sent bien dans sa peau, dans sa famille, sa religion,
son entourage, c’est un patient observant. L’éducation thé-
rapeutique est le meilleur garant d’une bonne adhésion à
la thérapie. »
Justement, en ce début du mois de septembre, le rama-
dan est au centre des consultations : il commence dans
moins de trois semaines. Cette année, la période quoti-
dienne de jeûne est plus longue, ce qui pose problème
pour les patients qui doivent prendre leurs médicaments
à 12 heures d’intervalle maximum. Cela préoccupe Kebir :
«Le ramadan est un moment sacré pour les Marocains ;
rares sont les patients qui ne pratiquent pas le jeûne. »
Pourtant, le Coran autorise les malades à ne pas le suivre.
«Malheureusement, pour beaucoup de patients atteints
par le VIH, la maladie est une sorte de punition. Jeûner
est pour eux une façon de se racheter, en dépit des com-
plications médicales éventuelles. » Alors, au fur et à
mesure que les patients se succèdent, Kebir joue toutes les
cartes. Il explique que le non-respect de la posologie ou de
grand reportage par Marianne Bernède
l’horaire des prises peut entraîner une résistance virale.
Si l’argument médical ne prend pas, il rappelle qu’Allah
est puissant et sait que la personne est malade. En espé-
rant que l’idée fasse son chemin, tout en respectant le
choix de chaque patient.
La sexualité, tabou religieux et social. La société maro-
caine est paradoxale. Pour tous les malades du sida, les
soins et les médicaments antirétroviraux sont gratuits,
financés par le ministère de la Santé et le Fonds mondial
de lutte contre le sida. Mais les personnes séropositives
sont très stigmatisées et rejetées socialement.
Les messages de prévention passent encore difficilement.
Certes, la prévalence est faible dans ce pays d’Afrique du
Nord : 20 000 séropositifs estimés en 2005. « C’est jus-
tement pour cela qu’il faut continuer, pour éviter l’explo-
sion de l’épidémie !, s’enflamme Hakima Himmich. Et
puis, de nouvelles données sont préoccupantes : il y a
600 000 nouveaux cas d’infections sexuellement trans-
missibles par an, ce qui prouve que ces rapports n’étaient
pas protégés… Et la prévalence chez les prostituées est
importante : 2,3 %. »
Une prostitution qui n’existe pas officiellement : au Maroc,
toute relation sexuelle hors mariage est punie par la loi.
Pour autant, le plus vieux métier du monde y est prati-
qué, comme dans tous les pays, par des femmes et par
des hommes, même si l’homosexualité est illégale. Mais de
façon totalement clandestine, ce qui rend les travailleurs
du sexe plus vulnérables : c’est la raison pour laquelle
l’ALCS mène, depuis des années, des actions de préven-
tion de proximité à destination de ces populations. Quitte
à subir l’opprobre des musulmans intégristes. « Nous
sommes régulièrement la cible de journaux extrémistes,
qui nous accusent de favoriser l’homosexualité, la prosti-
tution ou la débauche en distribuant des préservatifs,
confirme Othman Mellouk, le très actif président de l’ALCS-
Marrakech. Nous disons que ces relations ont lieu de toute
façon, alors mieux vaut qu’elles soient protégées. » Leur
travail de prévention peut également être entravé par des
policiers trop zélés. En novembre 2004, Abdellatif, inter-
venant de l’association à Marrakech, a été insulté et
embarqué sans ménagement par la police alors qu’il s’ap-
prochait d’un groupe de quatre jeunes hommes pour leur
parler et leur distribuer capotes et gel. Précisons que le
simple fait d’avoir des préservatifs sur soi constitue une
preuve de délit. Comme il essayait de contacter l’ALCS,
son téléphone portable a été arraché et jeté par terre. Il a
fallu l’intervention du président, de la directrice et une
heure de tractations au commissariat pour qu’il soit libéré.
«Le plus marrant ?, rigole Abdellatif. Quand les choses
ont été réglées et que je suis sorti, un policier m’a
demandé des préservatifs ! »
8
Transversal n° 33 novembre-décembre grand reportage

9
Transversal n° 33 novembre-décembre grand reportage
Ahmed est un grand gaillard, plutôt bel homme, sou-
riant. Impossible de percevoir derrière cette carrure
imposante les difficultés de vie qu’engendre sa séro-
positivité.
« Je suis tombé malade en 1999. À l’époque, j’habitais
dans un autre pays arabe où je travaillais depuis plu-
sieurs années. J’avais énormément maigri, mais je ne
me doutais pas que j’avais le sida. Je pensais que
j’avais une maladie quelconque. J’ai été hospitalisé sur
place. Personne ne m’a dit que j’avais le VIH. Ils ont fait
le diagnostic, ils ont écrit ça sur un papier qu’ils m’ont
donné, mais je ne comprenais pas de quoi il s’agissait.
Je ne sais ni lire ni écrire. En plus c’était écrit en anglais !
Je maigrissais toujours. J’étais très faible, je ne pouvais
plus travailler. Je n’avais plus rien à faire dans ce pays,
alors j’ai choisi de rentrer au Maroc. Quand j’ai été hos-
pitalisé dans le service des maladies infectieuses du
CHU de Casablanca, j’avais 13 CD4, je pesais 43 kilos
au lieu des 86 habituels et j’avais la tuberculose.
À mon arrivée dans ce service, je n’en croyais pas mes
yeux : j’ai été bien accueilli, j’ai trouvé une assistance
médicale extraordinaire. J’ai même regretté d’être parti
de mon pays ! Le médecin m’a convoqué et m’a annoncé
le diagnostic gentiment, d’une façon très douce, tout
en m’expliquant que j’allais recevoir gratuitement des
médicaments, qui ne guérissent pas mais qui permet-
tent de vivre avec le VIH. Il m’a dit que j’allais retrou-
ver ma santé et que je n’arriverais jamais au stade sida
si je suivais bien mon traitement. C’est ce qui m’a per-
mis d’accepter la situation. Pour moi, avant, être malade
du sida signifiait qu’on allait forcément mourir.
Les mots et les maux d’un séropositif marocain
Prévention de rue
À Marrakech, l’ALCS se fond dans le paysage urbain où homosexualité et prostitution
existent et se vivent à l’abri des autorités. Pour une prévention bénéfique à tous.
Lieux de drague. Les trois jeunes intervenants de l’ALCS le
savent : ici, c’est un lieu de drague, de rencontre entre
hommes. Ils viennent, trois soirs par semaine, pour une per-
manence de prévention de proximité. Permanence bien infor-
melle, car tout doit se faire dans la plus grande discrétion.
Rien ne doit faire craindre au public visé d’être «repéré ». Les
trois militants ne portent donc aucun signe distinctif : pas de
tee-shirt à l’effigie de l’association, pas de ruban rouge.
Chacun déambule avec un sac en plastique banal, contenant
Deux heures après que j’ai vu le médecin, les gens de
l’ALCS étaient là. Ils m’ont tranquillisé, ils m’ont mis à
l’aise en m’expliquant ce que pouvait m’offrir l’associa-
tion, comment j’allais bénéficier de l’éducation théra-
peutique. Ce fut pour moi un vrai soutien psychologique.
Après avoir été guéri de la tuberculose, je suis revenu
pour prendre mon traitement antirétroviral. Dès que j’ai
commencé ma trithérapie, j’ai tout de suite regrossi.
J’ai retrouvé mon poids normal au bout de cinq mois.
En revanche, ça s’est très mal passé avec les membres
de ma famille. Ils m’ont rejeté quand ils ont su que j’étais
séropositif. Seule ma mère a continué à s’occuper de
moi. Mes frères ne voulaient plus me côtoyer. Quand
je suis sorti de l’hôpital, ils m’ont installé dans une petite
chambre, sans eau ni électricité. Aujourd’hui, je ne
leur parle plus.
Je me suis marié récemment avec une femme atteinte
par le VIH, que j’ai rencontrée à l’ALCS. Mais c’est très
difficile de vivre avec le VIH au Maroc, c’est très mal
accepté. Ma femme a été, elle aussi, complètement
rejetée par sa famille. Nous ne pouvons pas en parler
autour de nous, nous vivons en retrait, repliés sur
nous-mêmes. Nous n’avons qu’une seule amie, séro-
positive comme nous. Nous ne voyons personne d’autre,
nous n’avons aucune vie sociale. Notre quotidien est
monotone, nous ne sortons pas, nous regardons la
télévision. C’est comme dans une prison, c’est une mort
douce. Les gens ici ne comprendront jamais ce qu’est
le sida, tout le monde nous stigmatise, c’est très dur.
Et les difficultés matérielles sont très importantes. Je
n’ai aucun revenu, je n’arrive même pas à me nourrir
correctement, et c’est vraiment un problème de ne pas
manger avec les médicaments que je prends. »
Sur la place principale de Marrakech, la foule est nombreuse,
comme toujours. Peu de touristes en ce mois de septembre,
mais beaucoup de Marocains qui viennent prendre le frais et
se promener, seuls, en couple ou en famille. Vendeurs de
rue, charmeurs de serpents, musiciens, conteurs tentent
d’attirer le chaland. Des cercles se forment autour d’eux.
Pour un œil non averti, il ne se passe rien de spécial. Mais
sur une partie de la grande place, les attroupements ont un
autre objectif que celui d’écouter les artistes.

Transversal n° 33 novembre-décembre grand reportage
10
préservatifs et gel lubrifiant. « Notre présence sur le terrain
est indispensable, explique Younes, coordinateur “Prévention”
à l’ALCS. Cela fait longtemps que nous venons, les gens
nous connaissent et nous font confiance. Mais il a fallu du
temps pour nous faire accepter.»
Et ça marche. Plusieurs jeunes gens s’avancent vers eux, les
saluent, discutent un moment. Puis une main se tend.
Abdellatif, l’un des intervenants, fouille dans le sac en plas-
tique, tend son poing fermé et passe préservatifs et gel de la
main à la main : on dirait presque du deal de drogue telle-
ment le geste est discret ! Le jeune homme repart à ses
occupations. Ce soir, au moins, il aura un rapport protégé.
Au cours de la soirée, les prises de contact sont nombreuses.
Parfois, ce sont les intervenants qui abordent un groupe.
«Les nouveaux contacts se font très souvent par l’intermé-
diaire d’anciens, commente Younes. Si on voit un groupe
dans lequel il y a un garçon que l’on connaît, on s’avance et
on se présente. On dit tout de suite qui on est et on parle de
prévention. » Mais le tabou sur l’homosexualité est important.
«La première fois, le garçon refuse souvent le contact, pour-
suit Younes. Il dit qu’il n’est pas concerné, qu’il n’a pas de
relations sexuelles avec des hommes. On n’insiste pas.
Quelquefois, on lui propose un préservatif en lui suggérant
qu’il pourra s’en servir si jamais il en a besoin. Au fil des
jours, il nous voit revenir régulièrement et, “chouia chouia”
(petit à petit), il commence à parler, à accepter le préser-
vatif. Quand, ensuite, il vient au local de l’association pour
prendre des informations, demander des préservatifs ou
faire un test de dépistage, c’est gagné. »
Côté hommes. La « permanence» se poursuit. Trois types
d’hommes fréquentent ces lieux de rencontre. La première
catégorie, les hommes aimant les hommes, est minoritaire.
Sans se revendiquer ouvertement homosexuels (difficile dans
un pays où c’est illégal), ils viennent simplement pour ren-
contrer des partenaires. Les autres, plus nombreux, sont là
pour monnayer une prestation sexuelle. Ils reconnaissent
rarement avoir du désir sexuel pour un autre homme, disent
qu’ils font ça pour l’argent, en attendant de se marier et
d’avoir des enfants. Enfin, il y a les clients, jeunes ou vieux,
mariés ou célibataires. Justement, un papi en djellaba tourne
autour d’un cercle. Serait-il là pour observer et éventuelle-
ment dénoncer certains de ces garçons pour leurs pratiques
« interdites» ? Younes éclate de rire devant mon inquiétude.
«Mais il est là pour la même raison que les autres ! Tu sais,
la djellaba, c’est très pratique pour les caresses furtives.
Regarde-le, tu vas voir ! » Je me sens un peu voyeuse, mais
je le suis des yeux. Effectivement, il pénètre dans un cercle,
plusieurs garçons sont serrés autour de lui, on devine des frô-
lements, des attouchements. « Pour les rencontres, tout
passe par le regard. Les hommes se reconnaissent entre
eux : pas besoin de parler, décode Younes. Ils ont parfois
grand reportage par Marianne Bernède
des pratiques sexuelles sur place ou bien ils vont ailleurs
ensuite. » Il faut dire qu’à part la rue, les hommes ont peu de
lieux où se rencontrer. Suite à la parution, dans la presse
française, de plusieurs articles présentant Marrakech comme
une destination de tourisme sexuel pour les gays européens,
la police a renforcé la répression et fermé plusieurs bars,
compliquant le travail de prévention de l’association.
Qu’importe ! Abdellatif et Mohcine continuent à déambu-
ler avec leur sac en plastique. Ils parlent, serrent des
mains, répondent à des questions, expliquent l’impor-
tance du préservatif et du gel.
Côté femmes. Deux jours plus tard, c’est au tour des femmes.
J’accompagne Houda, trésorière de l’ALCS-Marrakech et inter-
venante en prévention, et Fatima, une ancienne travailleuse
du sexe formée comme « pair éducatrice » par l’association,
dans l’un des quartiers « chauds » de la ville. Ici, plus aucun
touriste. Les rues sont étroites et mal éclairées, les maisons
insalubres, les gamins traînent dehors : la pauvreté saute
aux yeux. Très peu d’hommes dans ces ruelles, essentielle-
ment des femmes, assises devant les portes des immeubles
ou qui discutent en petits groupes. Pas l’ombre d’une tenue
aguicheuse, pas de jupes courtes ou de hauts moulants.
Jeans et tee-shirt ordinaire pour quelques-unes, djellaba pour
d’autres. Certaines portent le foulard. Tous les âges sont repré-
sentés : de 20 ans à… plus de 50 ans. Rien ne pourrait
laisser penser qu’elles font le trottoir. C’est pourtant le cas.
Comment le sait-on, alors ? À ma question un peu naïve,
Houda répond avec bienveillance : « Dans ce quartier, dans
chaque maison, il y a au moins une fille qui se prostitue
pour faire vivre sa famille. Tout le monde le sait, mais per-
sonne n’en parle. Presque toutes les jeunes filles et les
femmes qui sont dehors ce soir sont là pour ça. » Beaucoup
ont un proxénète (c’est le plus souvent une femme, une
« matrone »), qui leur loue une chambre et à qui elles rever-
sent parfois la moitié de leurs gains.
Étonnant Maroc, où les choses interdites se font au vu et
au su de tous, l’important étant de ne rien dire.
Comme avec les garçons de la place, la discrétion est
donc de mise dans les activités de prévention auprès des
travailleuses du sexe. Le sac en plastique rempli de pré-
© Marianne Bernède

11
Transversal n° 33 novembre-décembre grand reportage
servatifs est de sortie. Là encore, le travail de terrain est
payant. Les filles reconnaissent les intervenantes, les inter-
pellent, s’approchent pour demander des préservatifs, qui
passent toujours de la main à la main, ni vu ni connu.
Fatima a un mot pour chacune : elle les connaît toutes
et sait leurs conditions de vie. Certaines réclament davan-
tage de préservatifs, râlent un peu quand elles n’en reçoi-
vent que quatre ou cinq. Houda et Fatima expliquent
qu’elles n’en auront pas pour tout le monde, qu’elles
reviendront. « Avant que nous ne commencions nos
actions de proximité dans ce quartier, ces filles ne savaient
rien sur le sida et les infections sexuellement transmis-
sibles, raconte Houda. Aujourd’hui, elles sont informées et
elles ont peur de ces maladies. Elles ne veulent plus
mettre leur santé et leur vie en jeu pour 20 dirhams
(environ 2 euros), ça ne vaut pas la peine. »
D’autant que la majorité ont des enfants à charge.
Beaucoup sont veuves ou divorcées : la prostitution est
leur unique moyen de subsistance. En plus de ces actions
de terrain, l’association organise, dans son local, des
réunions afin d’aider ces femmes à négocier l’usage du
préservatif avec leurs clients.
Un soutien indispensable. Une étude, menée en 2004
pour l’ALCS par un sociologue marocain auprès des pros-
tituées de rue, a mis en évidence le manque d’information
Fatima a pratiqué la prostitution pendant plusieurs années
avant de s’investir à l’ALCS. Retour sur son parcours.
« Après mon divorce, j’ai été obligée de trouver un moyen
pour vivre. Je ne pouvais pas compter sur ma famille. Je
n’ai pas de diplôme, je ne suis jamais allée à l’école. Je
n’avais pas d’autre solution que de faire le trottoir. C’est
très difficile de faire ça dans un pays musulman, surtout
quand tu as déjà vécu une vie normale, sans prostitu-
tion. Pour qu’on ne me reconnaisse pas, j’allais dans un
autre quartier où il y a beaucoup de prostituées, loin de
là où j’habitais. Avec le temps, je me suis habituée aux
regards désapprobateurs, je n’y faisais plus attention.
J’ai déjà subi des violences de la part des clients. Après
l’acte, certains refusent de payer le prix de la passe et
te frappent. Toutes les filles subissent des agressions,
des vols, des viols.
Un jour, j’ai rencontré des personnes de l’association
qui venaient faire de la prévention dans la rue. Je ne
croyais pas qu’on pouvait attraper des maladies, ni
même le sida, avec des relations sexuelles. Avant
d’être informée, je n’utilisais pas de préservatif. Après,
j’essayais de l’imposer, mais ce n’était pas évident.
D’autant que j’avais besoin d’argent. Les clients insis-
tent et ils peuvent proposer une augmentation du prix
pour ne pas mettre la capote. Ils ne connaissent rien à
la prévention et ne veulent que des rapports non pro-
tégés. C’est très rare de rencontrer un client qui réclame
de lui-même un préservatif.
Petit à petit, j’ai trouvé le courage de venir faire un test
de dépistage à l’ALCS. J’ai aimé l’ambiance. Je me
suis sentie acceptée, comprise, personne ne me jugeait.
Alors je suis revenue, juste pour voir les gens et discu-
ter. Et je suis devenue une « personne relais ». Ici, j’ai
connu des personnes séropositives. J’ai découvert ce
que c’était et j’ai décidé d’arrêter la prostitution, parce
que maintenant j’ai peur du sida. Un préservatif peut
se déchirer, je peux être victime d’un viol et je ne veux
pas être infectée par le VIH.
En plus, depuis que je travaille avec l’ALCS, je ressens
une certaine fierté. Alors je n’ai plus envie de reprendre
ma vie d’avant. J’ai commencé à penser que mon corps
vaut trop cher pour que je le vende.
J’ai retrouvé confiance en moi : je me suis rendu compte
que le travail que je fais avec l’association donne des résul-
tats. Mais il faut être tout le temps sur le terrain : dès qu’il
y a une coupure, les filles oublient tout et recommencent
à avoir des rapports non protégés. Le poids de la pauvreté
est énorme, alors le reste passe au second plan : l’im-
portant est d’avoir de l’argent et de pouvoir manger.
Dans l’avenir, j’espère rencontrer un homme qui me
comprendra et acceptera mes enfants. Je voudrais me
marier, vivre une vie normale, comme toutes les femmes.
Moi aussi, j’ai le droit d’être heureuse. »
Quand la prévention provoque une prise de conscience
et de prévention au sein de cette population. Seules 46%
des professionnelles disent utiliser systématiquement le
préservatif pour un rapport sexuel vaginal et 92 % ne l’uti-
lisent pas lors d’un rapport buccal ou anal. La disponi-
bilité du préservatif est un élément essentiel : quand ni le
client ni la fille n’ont de préservatifs sur eux, 60 % des
prostituées déclarent accepter quand même le rapport
sexuel. D’où l’importance de les distribuer directement
aux travailleuses du sexe.
Houda et Fatima continuent à arpenter les rues. Les filles
sont nombreuses, mais les clients ne se pressent pas : les
temps sont durs. Ici, c’est une prostitution populaire : les
clients sont des Marocains qui n’ont pas beaucoup de
moyens. Les tarifs sont très bas : entre 20 et 50 dirhams la
passe (environ 2 à 5 euros). Ailleurs, dans les quartiers
modernes, se pratique une prostitution plus « chic » avec
des filles jeunes, en tenue sexy, qui fréquentent les bars et les
boîtes de nuit. Elles sont plus cultivées, parfois étudiantes.
C’est un moyen d’arrondir les fins de mois difficiles. Leur
clientèle ? Des Marocains aisés, qui veulent se montrer avec
une jolie fille, et des touristes étrangers. « Ces filles-là sont
plus difficiles à toucher, déplore Houda. Elles ne recon-
naissent pas facilement qu’elles se prostituent et surtout
elles sont prêtes à prendre davantage de risques dans des
rapports non protégés, car les tarifs sont bien plus élevés,
entre 300 et 1 000 dirhams (de 30 à 100 euros). »
1
/
5
100%