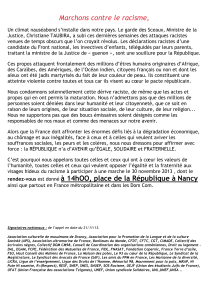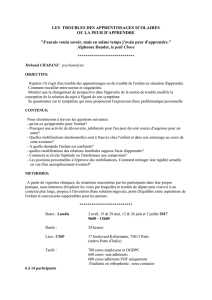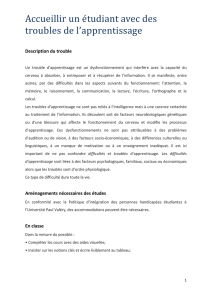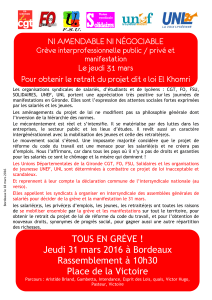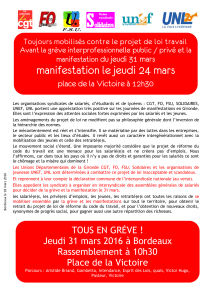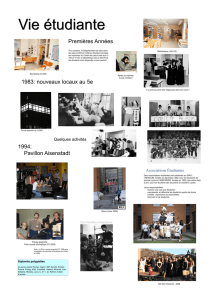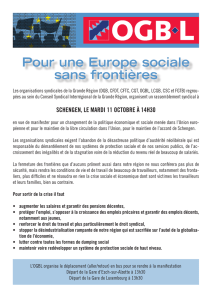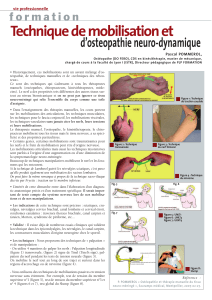les luttes etudiantes de 2007-2009

1
FACULTE DE PHILOSOPHIE, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
NICOLAS BRUSADELLI
Mémoire de Master 2 de Sociologie
Parcours « ethnographie et science de l‟enquête »
LES LUTTES ETUDIANTES DE 2007-2009
INSCRIPTION DANS UN CYCLE DE MOBILISATION ET DIVISIONS SOCIALES DES
MOUVEMENTS
Sous la direction de
MM. BERTRAND GEAY ET DENIS BLOT
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 – 2011

2
Résumé
Au-delà de la seule lutte anti-CPE de 2006, c‟est toute la dernière décennie qui a été marquée
en France par les mobilisations de la jeunesse scolarisée. En partant de l‟exploration des
mouvements étudiants amiénois de 2007-2009, en les réinscrivant dans un cycle de
contestation universitaire qui débute en 1998, ce mémoire se propose de fournir un éclairage
quant à l‟expérience étudiante récente, quant à son histoire, ses pratiques et ses formes de
structuration. Il se propose ensuite de se pencher sur les lignes de fracture ayant parcourues
ces mobilisations, révélatrices à la fois de dispositions socialement différenciées à
l‟engagement et des modalités particulières de concrétisation de ce dernier dans le milieu
étudiant des années 2000. Fruit d‟une méthodologie complémentaire alliant méthodes
qualitative et quantitative, ce travail pose l‟hypothèse de l‟émergence d‟une pratique politique
à caractère générationnelle ayant émergé ces dix dernières années dans l‟enceinte
universitaire, renvoyant ainsi à une mémoire, des liens, des vécus et des enjeux communs.
Remerciements
Je tiens à remercier Bertrand Geay et Denis Blot pour leur direction et leurs conseils, Audrey
Molis pour ses précieuses archives et son soutien intellectuel, Delphine Bouenel et Lucile
Jamet pour la qualité de nos échanges et l‟ensemble des documents qu‟elles ont mis à ma
disposition, Delphine Delamarre pour son aide indispensable lors du travail de collecte des
données, Laurianne Alluchon pour ses relectures nocturnes et enfin Daniel Couapel pour son
travail de compilation systématique des coupures de presses régionales.
« Le difficile, en sociologie,
c’est d’arriver à penser de façon complètement étonnée, déconcertée,
des choses qu’on croit avoir comprises depuis toujours. »
Pierre Bourdieu1.
1 BOURDIEU P., « La délégation et le fétichisme politique », Actes de la recherche en sciences sociales, 1984,
n° 52-53, pp. 49-55.

3
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION .................................................................................................................... 5
I – L’EXPERIENCE ETUDIANTE DE 2007-2009 : HISTOIRE ET FORMES DES
MOUVEMENTS .................................................................................................................... 18
1 Ŕ DE L‟AUTOMNE 2007 AU PRINTEMPS 2009 : UN « FEU DE PAILLE » DEVENU « FEU DE
BOIS » .................................................................................................................................... 19
1.1 Ŕ Un enseignement supérieur en pleine mutation ................................................................... 19
1.2 Ŕ La mobilisation éclair de l‟automne 2007 ........................................................................... 22
1.3 Ŕ L‟Education Nationale en mouvement : du printemps 2008 au printemps 2009 ................ 25
Remue-ménage dans le monde éducatif .................................................................................................................... 25
La fronde des Enseignants-Chercheurs .................................................................................................................... 28
Le relais étudiant, « Acte 2 » du mouvement anti-LRU ............................................................................................ 31
2 Ŕ LES FORMES DES MOUVEMENTS : ZOOM SUR LE CAS AMIENOIS ........................................ 34
2.1 Ŕ Un cadre d‟injustice néo-marxiste ....................................................................................... 35
2.2 Ŕ Rupture dans le répertoire d‟action : les implications du « blocage » ................................. 40
2.3 Ŕ L‟ « auto-organisation » des mouvements ........................................................................... 44
De l’organisation du mouvement social… ................................................................................................................ 44
… à des organisations de mouvement social ............................................................................................................ 46
CONCLUSION Ŕ UN CYCLE DE MOBILISATION ETUDIANT ? .............................................. 49
II – MISE EN PERSPECTIVE - CHAMP SYNDICAL ET ESPACE DES
MOBILISATIONS ................................................................................................................. 53
1 Ŕ CHAMP ET SYNDICALISME ETUDIANT ............................................................................... 54
1.1 Ŕ Champ syndical étudiant ou champ de la représentation étudiante ? .................................. 55
1.2 Ŕ Jeu et illusio, capitaux, rétributions ..................................................................................... 58
1.3 Ŕ Les cadres de perception du syndicalisme étudiant ............................................................. 62
1.4 Ŕ Processus d‟autonomisation du champ et stratégie de l‟UNEF en 2007-2009 .................... 64
2 Ŕ ESPACE ET MOUVEMENTS ETUDIANTS .............................................................................. 68
2.1 Ŕ Auto-organisation et stratégies syndicales à Amiens .......................................................... 69
2.2 Ŕ De la notion d‟ « espace des mouvements sociaux »… ....................................................... 71
2.3 Ŕ … à celle d‟ « espace des mobilisations étudiantes » .......................................................... 74
2.4 Ŕ Les lignes de fractures des mouvements étudiants .............................................................. 76
CONCLUSION Ŕ DES AFFRONTEMENTS AUX FACTEURS MULTIPLES ................................. 81
III – DIVISIONS SOCIALES DU MOUVEMENT ET TRAJECTOIRES
D’ENGAGEMENT DIFFERENCIEES ............................................................................... 83
I Ŕ LA COMPOSITION SOCIALE DE L‟ « ESPACE DE LA MOBILISATION » DE 2009 .................... 84
1 Ŕ Les caractéristiques des étudiants mobilisés ........................................................................... 85
2 Ŕ Les divisions sociales du mouvement ..................................................................................... 89
3 Ŕ Des trajectoires d‟engagement différenciées .......................................................................... 92
II Ŕ « ZOOM » SUR LES TRAJECTOIRES MILITANTES : DES DISPOSITIONS « ANTI-
AUTORITAIRES » ? ................................................................................................................. 97
1 Ŕ De l‟incapacité à s‟organiser sur le long terme en milieu étudiant ......................................... 98
Cyril, entre sentiment d’inutilité et culpabilisation .................................................................................................. 98
Les formes d’ « auto-organisation », une voie de réalisation de soi ...................................................................... 101
2 Ŕ Le rejet du champ de la représentation étudiante ................................................................. 103
Séverine, un entre-deux social fondateur ............................................................................................................... 103
Défense des classes populaires et remise en cause du champ : le « peuple » contre les « élites » ......................... 106

4
3 Ŕ Les organisations contre les individus .................................................................................. 109
Adrien, ou les conséquences d’un rapport « malheureux » à l’école ..................................................................... 109
La société des individus .......................................................................................................................................... 112
CONCLUSION Ŕ ORGANISATIONS ET CLIVAGES SOCIAUX .............................................. 115
CONCLUSION ..................................................................................................................... 117
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 123
GLOSSAIRE DES SIGLES ................................................................................................ 128
TABLE DES ILLUSTRATION .......................................................................................... 130
TABLE DES ANNEXES ..................................................................................................... 130
ANNEXES ............................................................................................................................. 131

5
INTRODUCTION
L‟université française a connu ces dernières années nombre de mouvements étudiants,
dont les plus récents Ŕ en 2007 et en 2009 Ŕ ont, à maints égards, tenu lieu de « douche
froide » pour les groupes de jeunesse ayant connu la mobilisation victorieuse de 2006 contre
le Contrat Première Embauche (CPE). Pour ceux qui avaient été les acteurs de cette dernière
dans l‟enceinte universitaire, le vécu différencié entre les mobilisations n‟en a été que plus
détonant. « Contre un gouvernement autoritaire, nous avons gagné en nous organisant de
manière à atteindre un niveau de démocratie rarement connu auparavant. Nous avons
construit l’unité étudiante, impulsé l’unité syndicale, gagné le retrait du CPE et enrayé la
machine libérale », écrivait le journal syndical de l‟UNEF2-Amiens en mai 2006, révélant
l‟état d‟esprit de certaines franges dirigeantes de la lutte étudiante. Les mobilisations qui ont
suivi n‟ont pas connu le même destin, mais ont au contraire été le lieu de défaites
revendicatives. Une première explication de cette évolution pourrait être trouvée dans
l‟isolement des milieux étudiants (2007) ou universitaires (2009), isolement renforcé par la
faiblesse des relais médiatiques nationaux (2007) et par l‟accroissement de la répression
policière (2007-2009). Entre la mobilisation de 2006 en celles de 2007-2009, les
« coordonnées de la situation », pour reprendre un langage militant, avaient changées. Sans
avancer l‟existence d‟un changement majeur dans la « structure des opportunités
politiques3 », le concept étant trop flou par bien des aspects4, force est de constater que la
prise de pouvoir politique de l‟oligarchie financière française en 20075 a considérablement
modifié l‟état du rapport des forces sociale et politique du pays. L‟adoption par les urnes d‟un
programme néolibéral affiché, la stratégie politique d‟inspiration néoconservatrice qui l‟a
2 Union Nationale des Etudiant de France, première organisation étudiante représentative.
3 « Le concept de structure des opportunités politiques (SOP) rend compte de l‟environnement politique auquel
sont confrontés les mouvements sociaux, et qui peut selon la conjoncture exercer une influence positive ou
négative sur leur émergence et leur développement ». FILLEULE O. & MATHIEU L., « Structure des
opportunités politiques » in FILLEULE O., MATHIEU L. PECHU C. (dir.), Dictionnaire des mouvements
sociaux, SciencesPo.- Les Presses, coll. Références / Sociétés en mouvement, 2009.
4 Si son premier modèle, mis au point par D. Mc Adam, est difficilement utilisable en raison des facteurs
quasiment indéfinis rendant possible un changement dans la SOP, les tentatives de modélisation systématique
ultérieure (S. Tarrow, H. Kriesi, C. Tilly, J. Mc Carthy, M. Zald) semblent souffrir une vision trop structuraliste
et idéaliste. Avec H. Fram, nous considérerons plutôt que « chaque moment de confrontation se définit de
manière propre, voire unique », le défi analytique revenant alors à « identifier une série de déterminants qui, dans
une séquence temporelle, peut expliquer les dynamiques de l‟interaction entre l‟état et les mouvements
d‟opposition, aussi bien que les effets institutionnels de cette dynamique ». Concernant toutes ces références voir
FILLEULE O., MATHIEU L. PECHU C., Ibid.
5 Voir PINCON-CHARLOT M. & M., Le Président des Riches, Enquête sur l’oligarchie dans la France de
Nicolas Sarkozy, Editions Broché, Zones, 2010.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
1
/
134
100%