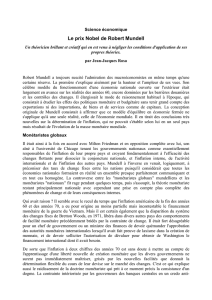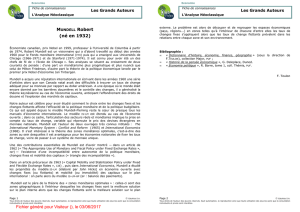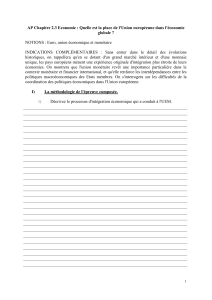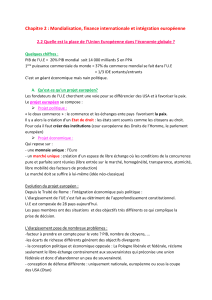Le paradoxe de Mundell - Institut de l`entreprise

132
Sociétal
N° 27
Décembre
1999
L E S L I V R E S E T L E S I D É E S
1Robert Mundell
est l’auteur
des ouvrages
suivants :
The international
Monetary System,
1965 ; Man and
Economies et
International
Economies,
1968 ; Monetary
Theory : Interest,
Inflation and
Growth in the
World Economy,
1971.
Il est coauteur
de A monetary
Agenda for the
World Economy,
1983 ; Global
Disequilibrium
1990 ;
Debts, Deficits
and Economic
Performance,
1991 ; Building
the New Europe,
1992 ; Inflation
and Growth
in China, 1996.
2Avec la mise
au point du
modèle connu
sous le nom de
Mundell-Fleming.
Le dernier prix Nobel d’écono-
mie est attribué à un homme
dont la réputation d’économiste
n’est plus à établir, tant en Europe
qu’en Amérique du Nord, mais dont
certaines positions fondamentales
et l’influence déterminante sur le
cours des événements américains
restent largement méconnues en
Europe continentale et en France
en particulier, où il vient en re-
vanche à point nommé jouer le rôle
de génial inspirateur de l’euro par
son prophétique travail sur un re-
doutable concept : les « zones mo-
nétaires optimales ». Les diffé-
rences de réaction de la presse
anglo-saxonne et française*à l’an-
nonce de la nomination de Robert
Mundell, premier économiste né au
Canada à être couronné par le prix
Nobel, sont révélatrices de ce défi-
cit relatif de connaissance, qui ne
doit sans doute pas tout au hasard
ou à l’ignorance.
Revenons un instant sur les aspects
de son œuvre, qui font de Mundell
une référence incontournable, et
un outil conceptuel devenu partie
intégrante de la culture et du bagage
de tout universitaire contemporain,
d’autant plus qu’ils n’ont pas tous
été soulignés dans le récent hom-
mage universel qui lui a été adressé.
Avant d’être nommé Professeur
d’économie à l’Université de Co-
lumbia à New York en 1974, Robert
Mundell a été Professeur d’écono-
mie internationale à l’Institut Supé-
rieur d’Etudes Internationales de
Genève de 1965 à 1971 et, pendant
la même période, Directeur du
Journal of Political Economy ; aupara-
vant, il a étudié au MIT (il y a reçu
son Ph. D. en 1956) ainsi qu’à la
London School of Economics ; il a
aussi été Post-Doctoral Fellow en
Economie politique à l’Université
de Chicago en 1956-1957. Enfin, il
a été économiste au FMI de 1961 à
1966 : c’est là qu’il a pu mettre au
point sa théorie de la politique éco -
nomique, un complément de la ma-
croéconomie internationale qu’il a
largement contribué à fonder 1.
UN PIONNIER
DE LA MODÉLISATION
MACROÉCONOMIQUE
Au-delà des zones monétaires
optimales, c’est largement
au titre de ces deux derniers cha-
pitres de la théorie économique
que les travaux de Robert Mundell
ont été couronnés par l’Académie
suédoise. Il est en effet le pionnier
de l’approche monétaire de la ba-
lance des paiements et de la prise
en compte de l’ouverture des
économies dans la modélisation
macro économique 2qui permet
l’utilisation combinée, dans un mo-
dèle conceptuel intégré, des don-
Le paradoxe de Mundell
BERNARD CHERLONNEIX
Commissariat Général au Plan
Cette fois-ci, le prix Nobel d’économie a été attri-
bué à un économiste qui semble avoir réussi à conci-
lier les inconciliables en menant des travaux d’une
scientificité irréprochable, tout en avançant des
thèses singulièrement novatrices sur l’Europe, voire
le monde, comme zones monétaires optimales.
* Si certains grands journaux de la presse anglo-saxonne comme le Financial Times en titrant : « Nobel Prize for “euro godfather”
»
, ou
l’International Herald Tribune : « Economist Who Backed Euro Takes Nobel Prize » ont souligné, à l’instar des Echos, seul grand jour-
nal français à avoir salué l’événement en temps réel, que « Le Nobel d’économie (est attribué) à Robert Mundell, théoricien de l’union
monétaire », ils ne manquent pas de saluer avec d’autres les aspects de son œuvre qui sont moins bien connus de ce côté-ci de l’Atlan-
tique ou de la Manche. Ainsi, Rudi Dornbusch signe pour Time une chronique intitulée « Supply-Side Savant », et le Wall Street Journal
publie le texte d’une conférence de synthèse tenue en 1990 par l’économiste de la Columbia University lui-même, intitulée « Why a New
Economic Model Was Needed » avant de publier une chronique d’Arthur Laffer, « Economist of the Century ». The Economist donne,
quant à lui, une vue d’ensemble non seulement sur l’œuvre, mais aussi sur la personnalité originale de Mundell.
En marge des livres,
regard sur l’actualité

133
Sociétal
N° 27
Décembre
1999
LE PARADOXE DE MUNDELL
nées statistiques provenant de la
comptabilité nationale (réelle et
financière) de la balance des paie-
ments et des bilans des banques à
partir desquelles les banques cen-
trales élaborent les agrégats de
monnaie et de crédit.
C’est sur la base de cette modéli-
sation macroéconomique en éco-
nomie ouverte et interdépendante
que Mundell a élaboré, pendant
qu’il travaillait au département de
recherche économique du FMI, ce
qu’il est convenu d’appeler, depuis
l’ouvrage de référence de Jan Tin-
bergen sur les Techniques modernes
de la politique économique (1952),
la théorie de la politique écono-
mique, en analysant, dans un article
fondateur de 1963, les effets à
court terme de la politique moné-
taire et budgétaire en économie
ouverte, où prévaut notamment la
liberté de circulation des capitaux.
UNE RÈGLE DE BON SENS
Il en ressort une règle de bon sens,
qui a fait le tour du monde, selon
laquelle il existe une spécialisation
des instruments de la politique
économique par objectif poursuivi.
Cette règle est en fait, dans le
contexte des années 60 dominées
par la macroéconomie keynésienne
ou la synthèse néoclassique et key-
nésienne, plus révolutionnaire qu’il
ne semble. En économie ouverte, la
politique monétaire – comprenons
« la manipulation des taux d’inté-
rêt » à des fins de stimulation de la
croissance – perd de son efficacité,
voire toute son efficacité, en cas de
changes fixes et en tout cas pour
une économie dépendante d’une
plus grande économie (comme par
exemple celle du Canada par rap-
port à celle des Etats-Unis). C’est
l’invention du fameux triangle d’in-
compatibilité, qui a fait les délices
des professeurs et des étudiants en
économie. Il n’y a pas d’autonomie
possible de la politique monétaire,
en l’absence de contrôle des
changes, dans une zone de changes
fixes (pour les économies « péri-
phériques », oublie-t-on de rajou-
ter en général).
En clair, la politique économique
d’inspiration keynésienne, le « fine
tuning » gouvernemental célébré
par Samuelson, perd, en économie
ouverte3l’un de ses deux instru-
ments favoris, sauf à se recréer une
marge de manœuvre apparente par
la flexibilisation des taux de change
(apparente puisqu’en raison des ef-
fets de courbe en J à répétition de
la dépréciation monétaire sur la ba-
lance des paiements courants, les
gouvernements ne persistent
guère dans la voie de la relance
en économie ouverte même dans
le cadre de changes
flexibles). Voilà, de
l’œuvre du prix No-
bel, ce qui est connu
et reconnu en Europe
et fait de Mundell,
dans les années 70 et
80, une sorte de nou-
vel Alfred Marshall.
DES TRAVAUX
À DÉCOUVRIR
Mais le modèle économique
d’ensemble dont procède
cette disqualification partielle du
modèle keynésien d’après-guerre
(valable en économie fermée par le
maintien de contrôles des changes
très stricts issus de l’économie de
guerre), le « nouveau modèle éco-
nomique requis »4, est moins bien
connu. En termes académiques, ce
modèle est composite, et il définit
donc Mundell, sur le plan théo-
rique, comme un « centriste », à
égale distance de l’école néoclas-
sique, de l’école keynésienne et de
l’école monétariste. Ecoutons-le.
« Avec le “friedmanisme”, ce mo-
dèle accepte l’importance de la
théorie quantitative de la monnaie,
mais rejette le programme de fixa-
tion a priori d’un taux de crois-
sance fixe de la masse monétaire et
de taux de change flexibles si chers
au cœur des monétaristes. Avec le
keynésianisme, il partage l’idée du
multiplicateur et la possibilité d’uti-
liser les diminutions d’impôts pour
faire redémarrer la croissance lors-
qu’on se trouve en pleine réces-
sion ; mais il prend en considération
les effets de multiplicateur inverse
lié au financement par l’emprunt
des déficits budgétaires et il rejette
l’inflation comme étant contrepro-
ductive. Avec le néo-ricardisme, il
accepte le rôle important joué par
les anticipations et la cohérence in-
tertemporelle, mais il rejette son
postulat d’hyperrationalité et l’in-
terprétation altruiste de la pro -
position d’équivalence ». Ce nou-
veau modèle économique, qui
comprend en outre des ingrédients
originaux, est appelé par son
fondateur « écono-
mie de l’offre » (sup-
ply-side economics).
«Tight money and tax
rate cuts » résume
assez bien la philoso-
phie de la politique
économique qu’il
préconise.
Il n’a généralement été connu
qu’au travers des disciples de
Mundell et les vulgarisateurs du
modèle comme Arthur Laffer, qui
a popularisé avec sa fameuse
courbe l’une des idées maîtresses
de son mentor. Pour Mundell, il
s’agissait d’abord de poursuivre et
compléter les travaux déjà anciens
de Ragnar Frisch (1954) selon les-
quels l’impôt sur le revenu n’est pas
compatible avec un « régime opti-
mal » et auxquels Tinbergen s’ef-
forçait de s’opposer en 1958, en
concluant un article ainsi : « l’impôt
sur le revenu réduit la production
de certains individus, mais n’influe
guère (sic) sur leur satisfaction ».
Et l’on comprend mieux pourquoi
en Europe continentale et en
France en particulier, une partie de
son héritage est moins bien connue
que l’autre. Il paraîtra sans doute
fort paradoxal à beaucoup que ce
centriste en théorie puisse être le
père d’un modèle largement perçu
comme révolutionnaire ou polé-
mique. A moins que cette percep-
3 Une situation
qui se généralise
et a un bel avenir
dans les années 60.
4 Selon le titre
de la conférence
de 1990
de Robert Mundell
publiée par
le Wall Street Journal
du 14 octobre
dernier.
Dans une zone
de changes fixes,
il n’y a pas d’autonomie
possible de la politique
monétaire en l’absence
de contrôle des changes

134
Sociétal
N° 27
Décembre
1999
L E S L I V R E S E T L E S I D É E S
tion ne soit trompeuse, et que ce
modèle ne paraisse « radical » que
dans un monde resté longtemps
sous l’emprise d’un modèle domi-
nant exagérément prévenu en fa-
veur d’un soutien de la croissance
par la relance de la demande. En
tout cas, il est bien vrai que Mun-
dell, en soulignant les effets réces-
sifs du financement du déficit bud-
gétaire par l’endettement de l’Etat,
prive la politique économique
d’inspiration keynésienne de son
deuxième levier favori : la politique
budgétaire d’augmentation des dé-
penses publiques.
On mesure mieux désormais qui
l’Académie suédoise a décidé de
couronner pour la dernière année
de ce siècle, mais on n’est pas pour
autant au bout de son admiration,
ou de ses peines. Il y a mieux, ou
pis, à venir.
Le point de départ des problèmes
économiques contemporains se
trouve, selon Mundell, dans la dis-
parition de la discipline monétaire
qui reposait sur un étalon moné-
taire stable dont l’unité était défi-
nie par une quantité déterminée
d’un actif réel tel que l’or, en don-
nant ainsi un ancrage ferme au sys-
tème des prix nominaux ou moné-
taires, aux prix absolus. C’est à une
telle discipline5que le système des
changes flexibles nous fait tourner
le dos depuis 1973 avec ses consé-
quences sur le niveau des déséqui-
libres internationaux de balances
de paiements et des capitaux flot-
tants, eux-mêmes à la base des em-
ballements financiers divers et de
l’instabilité financière généralisée.
Ce discours rappellera à tous ceux
qui ont lu les livres fondateurs de
l’analyse monétaire classique à l’âge
contemporain où J. Rueff expose
les origines institutionnelles du
désordre monétaire international 6,
que Robert Mundell a obtenu aux
Etats Unis en 1983 le Prix et la Mé-
daille Jacques Rueff. Nul n’est pro-
phète en son pays, mais cela doit
être une source de contentement
posthume pour Rueff de trouver au
Canada et aux Etats-Unis le disciple
éminent qu’il a si vainement cher-
ché en Europe. Un disciple qui
fait d’ailleurs comme lui le lien
entre désordre monétaire et abus
fiscal : « c’est l’abandon de la dis -
cipline monétaire
avec l’adop tion des
changes flexibles en
1973 et son effet sur
le prix du pétrole qui
ont conduit à l’infla-
tion qui a exacerbé la
progressivité des im-
pôts ». Il est d’ailleurs
frappant à cette occa-
sion de mesurer la co -
hérence interne de
toutes les parties de
l’œuvre de Mundell.
DE L’EURO À
LA MONNAIE UNIQUE…
MONDIALE
Il voit dans l’ère qui s’ouvre devant
nous une époque propice, non
pas à un retour à l’étalon-or,
comme s’il y avait jamais eu « un »
étalon-or, mais à la création d’une
monnaie unique mondiale gagée
notamment en or. C’est en effet
sur cette perspective qu’ouvre
ultimement et fructueusement
– mais peut-être de manière inat-
tendue – la notion de zone moné-
taire optimale. « Au temps de la
guerre froide, la sécurité nationale
primait sur la stabilité des systèmes
monétaires nationaux. Mais dans
l’après-guerre froide, il y a moins
de raison de s’opposer et plus à
gagner à l’établissement d’une
monnaie internationale stable. Le
monde multipolaire qui émerge a, à
beaucoup d’égards, plus de choses
en commun avec la configuration
du pouvoir mondial à la grande
époque de l’étalon-or qu’avec le ré-
cent passé d’un monde bipolaire. Il
offre une opportunité de créer une
banque centrale mondiale émet-
tant une monnaie internationale
stable plus forte qu’à aucun autre
moment antérieur de l’histoire. Il
n’y a pas de raison pour que les
stocks d’or détenus par les Etats et
les banques centrales ne soient pas
utilisés pour créer une monnaie
internationale ».
Certains ont tiré argument des
conditions mundelliennes d’ex -
tension d’une zone
monétaire au-delà
des frontières poli-
tiques, à savoir mo -
bilité du capital et
du travail, pour criti-
quer son soutien à
l’e uro. O n p eu t
imagi ner leur oppo-
sition à un projet de
monnaie unique
mondiale. Pourtant,
ne constate-t-on pas
une mobilité crois-
sante non seulement
des capitaux, mais aussi des per-
sonnes ? Cela n’est-il pas en partie
une conséquence directe de la fin
des blocs ? N’est-ce pas cela qu’on
nomme la « globalisation »?
Ainsi, le père de l’euro, celui qui
appelait avec d’autres, dès 1969, à
la création d’un « Europa », est en
réalité et plus profondément un
partisan d’une monnaie unique
mondiale – rendant définitivement
impossible par exemple tout dum-
ping monétaire américain – parce
qu’il pense que, seule, la stabilité
monétaire internationale et l’aban-
don des désincitations fiscales ex-
cessives peuvent garantir à long
terme la croissance et le plein
emploi. Son combat en faveur de
l’euro contre beaucoup d’écono-
mistes américains 7prend alors
tout son sens. L’euro exprime une
stratégie de « containment » à
l’égard du dollar. Il se justifie aussi
et surtout par la perspective de
l’ordre monétaire mondial qu’il
rend possible.
Mais le grand danger pour Mundell,
comme naguère pour Rueff, ne
viendra-t-il pas justement d’être
devenu trop compréhensible et
d’avoir trop évidemment raison ? l
Bernard Cherlonneix
5 Dont nous
avaient déjà
fortement
éloigné les deux
périodes d’étalon
de change-or
de l’entre-
deux-guerres
et de Bretton
Woods.
6L’âge de
l’inflation (1964),
Le lancinant
problème
des balances
de paiement
(1965), le Péché
monétaire
de l’Occident
(1971) ou
la Réforme
du système
monétaire
international
(1973).
7 Dont le
Wall Street Journal
a souvent été
le porte-parole.
Cela doit être
une source
de contentement
posthume
pour Jacques Rueff
de trouver au Canada
et aux Etats-Unis
le disciple éminent
qu’il a si vainement
cherché en Europe
1
/
3
100%