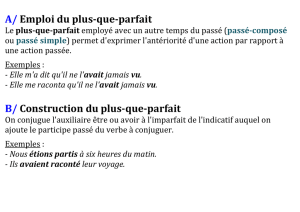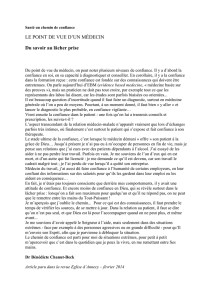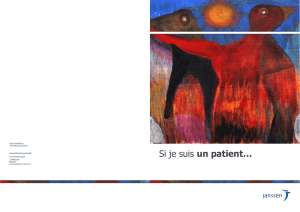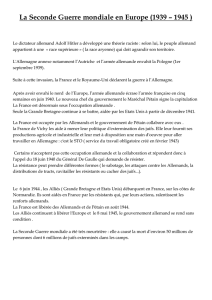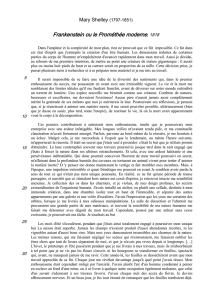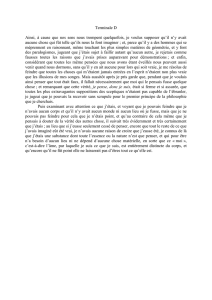Né en 1930 rue des Écouffes - Les Mémoires d`un Ane Communiste

Né en 1930 rue des Écouffes
Michel Taubes
À Félix, mon petit-fils.

Avertissement
Ce texte n’a aucune prétention littéraire. Il s’agit parfois d’une compilation
de notes plus ou moins développées. Mes idées politiques pourront heurter
certains. Elles sont la conséquence logique de mon vécu durant mon enfance,
mon adolescence et ma jeunesse. Quoi qu’il en soit, j’assume ces idées, même
si elles paraissent provisoirement démodées. Renier ces idées, serait me renier
moi-même. Ceux qui, avec le même parcours, l’ont fait, cachent mal, sous
des sarcasmes grinçants, une blessure profonde.
Sommaire
Introduction 5
Première partie : l’avant-guerre 9
24, rue des Écouffes 11
Rue Saint-Paul 21
Deuxième partie : la guerre 31
1940 • La Drôle de guerre 33
1941 • L’Occupation 43
1942 • Les rafles 51
1943 • Le tournant 65
1944 • La Libération 77
Troisième partie : l’après-guerre 103
1945 • La Paix, le retour 105
1946 • L’apprentissage de la fourrure 119
1947 • La maladie 131
1948 • La Forêt-Noire 141
1949 • Le baccalauréat 151
1950 • La guerre froide, que faire ? 159
1951 • La comptabilité, la carrière d’adulte 165
Épilogue 175

Introduction
Je suis né le 21 avril 1930 à l’hôpital de la Pitié dans le 13earron-
dissement. Au même endroit, Esther, mon épouse, devait naître
quatre ans plus tard. C’est dans cet arrondissement que nous avons
vécu notre vie d’adultes, après le Kremlin-Bicêtre où nous nous
sommes mariés en mars 1954.
Ma mère, Betty Sack, était née aussi à Paris dans une famille immi-
grée d’Autriche-Hongrie, mes grands parents Sack sont venus en
France avant la guerre de 14 et, le comble, c’est qu’en 1914, ils ont été
internés en France par les autorités comme ressortissants d’un pays
ennemi. Ils vivaient, avant d’émigrer, à Przemizl (prononcer pchémich),
ville de garnison, à la frontière de l’Autriche-Hongrie avec la Pologne,
dans la province de Galicie. Ils tenaient dans cette ville un salon de thé
que fréquentaient notamment les officiers de la garnison qui ne
devaient probablement pas se contenter de thé.
Mes grands-parents Sack ont eu neuf enfants, soit par ordre d’âge :
Renée, Jules, Charlotte, Berthe, Henri, Betty (ma mère), Bernard,
Suzanne et, le plus jeune, Léon. Les cinq derniers sont nés en France.
Seuls, les deux plus jeunes sont encore vivants lorsque j’écris ces lignes.:
Suzanne et Léon.
Ils se sont installés rue des Écouffes, en plein quartier juif du
4earrondissement et ont bien gagné leur vie en tenant une épicerie
Introduction 6

Elle était réputée dans sa famille pour son indolence. Certes elle parlait
yiddish avec ses parents, mais évidemment français avec ses frères et
sœurs. Jamais elle n’apprit ni n’exerça de métier et se consacra à son
mari et à ses quatre enfants. Malgré cela, elle avait des idées avancées
et je pense qu’elle a souffert de n’avoir pas eu une vie plus brillante
jusqu’à sa vieillesse qui fut, je crois, la partie la plus tranquille et
heureuse de sa vie.
Mon père eut un accent prononcé jusqu’à la fin de ses jours.
Pourtant, il apprit vite le français et arriva même à le lire, surtout les
journaux. Il savait aussi lire le yiddish (en caractères hébraïques). Mes
parents ne parlaient que très rarement yiddish, uniquement quand ils
souhaitaient que les enfants ne les comprennent pas. Mais à force, j’ai
appris à le comprendre, mais pas à le parler.
Le yiddish ne se prononce pas toujours de la même façon selon le
pays d’origine, ainsi mon père pour dire « sucre » disait « tsicker », comme
les Biélorusses qu’on appelait « litfak », c'est-à-dire Lithuaniens. Ma mère
au contraire disait « tsouker » comme les Juifs polonais, comme les
parents d’Esther.
Dès son arrivée, mon père travailla au garage de la rue Letort avec
son frère. Il fut présenté aux parents de ma mère par une marieuse,
comme cela se faisait. Mon père était très beau, ma mère accepta pleine
d’espoir d’échapper au cercle familial qui lui pesait.
Hélas, ouvrier manuel, nouvellement arrivé de Russie, mon père
ne correspondait pas à ses attentes romantiques et artistiques. De plus,
dès le mariage, les choses se gâtèrent. Mes parents étaient logés au-dessus
du garage de la rue Letort, près de la belle-famille qui parlait mal le
français. Ma mère me raconta souvent les tristes débuts de son mariage.
Son beau-frère, après l’apparition d’un cancer à l’estomac, agonisa
sur place. Elle l’entendait hurler de douleur. La nuit, le garage était
sinistre, avec des rats, qui cavalaient partout. Rapidement, la mort de
son frère et la crise économique de 1929 eurent raison du garage, et
mon père se trouva contraint de trouver du travail et un appartement.
Un an à peu près après leur mariage, je naissais.
Introduction 8
très spécialisée dans les produits de base utilisés dans la cuisine juive :
cornichons, harengs, carpes, pains azymes, etc.
Mon père venait de Biélorussie, d’un petit village juif (un stetle) aux
environs de Minsk. Il y avait beaucoup de ces villages dans la Russie
tsariste. C’étaient en fait des ghettos d’où les gens pouvaient sortir le
jour, mais il fallait rentrer avant la nuit, sauf autorisation.
Son père était artisan charron, c'est-à-dire qu’il fabriquait, dans son
atelier, des carrioles et surtout des roues en bois, ce dont mon père
était très fier, car ces roues étaient particulièrement difficiles à réussir.
Il travaillait dans l’atelier de son père, d’où le métier qu’il devait exercer
en France : menuisier en carrosserie.
Il a émigré quand son village fut occupé par les Polonais au moment
de la guerre entre la Pologne et les bolcheviks. Son village avait plusieurs
fois changé de mains et les Polonais étaient très antisémites; cela se
passait vers 1920.
Son frère, Marcel, était arrivé en France avant lui, vers 1910, puisqu’il
avait déjà un garage à Paris, rue Letort dans le 18earrondissement, quand
mon père débarqua. Il est donc arrivé vers 1920, en bateau, d’un port
polonais jusqu’au Havre.
Il est entré en France avec de faux papiers où seuls son nom et
son prénom (Aaron) étaient exacts. Il était soi-disant né à Dubenko,
Pologne, plusieurs années avant sa date de naissance véritable. Il fut ainsi
de nationalité polonaise jusqu’à sa naturalisation après la fin de la
guerre. Sa carte d’identité française portait comme prénom : Aaron,
dit Henry. Sa naturalisation découlait de son mariage avec une
Française, donc de ses enfants français, de la durée de son séjour en
France et enfin du fait qu’il avait été interné un certain temps pendant
la guerre. Mais, sous l’Occupation, sa fausse nationalité polonaise le fit
arrêter dans les premiers.
Ma mère était complètement assimilée. Née et scolarisée à Paris,
imprégnée de culture française grâce à son goût pour la lecture et les
chansons populaires, maman était romantique. Elle avait un réel talent
pour dessiner et je me souviens très bien de ses dessins de femmes nues.
7 Né en 1930 rue des Écouffes

Première partie :
l’avant-guerre
En souvenir du garage, on récupéra seulement de nombreuses
boîtes d’enveloppes à fenêtre au nom du garage, enveloppes utili-
sées pendant toute mon enfance pour classer des papiers divers et
surtout pour jouer.
Nous occupâmes au 24 de la rue des Écouffes, l’appartement que
les parents de ma mère libérèrent en prenant leur retraite.
Mes souvenirs de jeunesse peuvent avoir quelque intérêt du fait
que le hasard m’a fait naître de sorte que mon enfance consciente s’est
passée dans la période d’avant-guerre, puis pendant la guerre et enfin
au retour de la paix.
Les circonstances m’ont contraint de surcroît à une situation rela-
tivement rare : vivre toutes ces années à Paris alors que la plupart des
jeunes Juifs parisiens de mon âge ont été raflés ou ont pu se réfugier
en province. Certes, j’ai souffert de la peur, du froid et de la faim, mais
mon sort est évidemment préférable à ce qu’ont vécu beaucoup de
mes camarades d’école et du lycée Charlemagne qui ont été déportés.
Je n’ai pas cherché dans ce livre à faire œuvre d’historien détaché
des événements mais, au contraire, à exposer les événements tels que
je les ai ressentis.
9 Né en 1930 rue des Écouffes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
1
/
90
100%