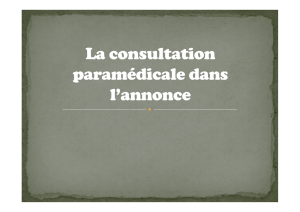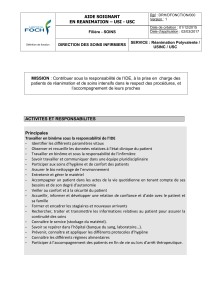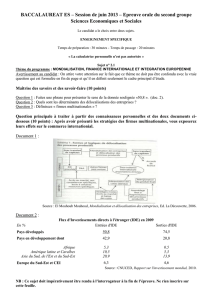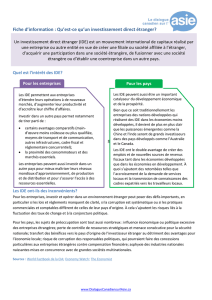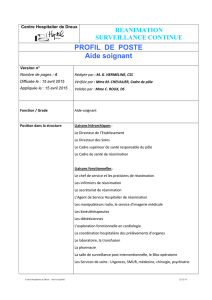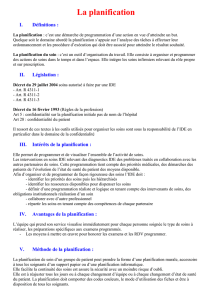Intérêt d`une démarche de formation des infirmier(e)

1
MEMOIRE POUR L'OBTENTION
DU DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE
DE PEDAGOGIE MEDICALE
PARIS V – VI – XI – XII
Intérêts d’une démarche de formation des infirmier(e)s de réanimation
pour la réalisation de l’hémodialyse intermittente
Par Frédérique Schortgen
Soutenu le 13-14 Octobre 2011

2
RESUME
L’hémodialyse intermittente (HDI) est une procédure de haute technicité qui est fréquemment
nécessaire chez les patients de réanimation les plus graves. Gérer une séance d’hémodialyse fait
partie des compétences qu’une IDE de réanimation doit acquérir. Contrairement à d’autre pays, en
France, aucune formation complémentaire n’est requise pour exercer le métier d’IDE en réanimation
et les personnels des services de néphrologie n’interviennent pas dans les unités de réanimation.
L’élaboration de procédures de soins est un moyen reconnu pour améliorer les pratiques et la
sécurisation dans les services de réanimation. Dans ce travail nous voulu évaluer l’impact à long
terme d’une démarche de formation et d’organisation incluant une procédure de soin standardisée
pour la réalisation des séances d’HDI dans notre service de réanimation.
En 2005 nous avons développé un programme de formation basé sur la constitution d’un groupe de
travail médico-paramédical sur l’hémodialyse. Les objectifs de ce groupe étaient la réalisation d’une
feuille de prescription-surveillance ciblée pour les séances d’HDI et d’un guide illustré pour chaque
étape du déroulement d’une séance, la formation théorique et pratique des IDE du service grâce à un
tutorat par les IDE « experts » du groupe et l’évaluation de l’impact de ce programme de formation.
Des paramètres préalablement déterminés ont été prospectivement recueillis avant, à 1an, 2 ans et 4
ans de la mise en place du programme incluant la traçabilité des séances, les réglages, la surveillance
et la gestion des cathéters. L’évolution de la mortalité hospitalière des patients traités par
hémodialyse a été prospectivement évaluée et comparée à la mortalité prédite par le score SAPS II.
Nous avons observé une amélioration significative de la traçabilité est des modalités de surveillance
des séances d’HDI après mise en place du programme de formation. Cette amélioration persiste dans
le temps. En revanche, la gestion des cathéters de dialyse n’a pas été significativement améliorée ce
qui a nécessité la mise en place de mesures correctrices. Nous avons observé une baisse progressive
du ratio mortalité prédite/observée au cours du temps.
Dans notre expérience, la mise en place d’un programme de formation multi-facettes des IDE
comportant principalement une procédure standardisée illustrée, un système de tutorat par des IDE
« experts » et une évaluation prospective continue permet une amélioration de la gestion des
séances d’hémodialyse intermittente qui persiste plusieurs années après sa mise en place.
Mots clés : Hémodialyse, réanimation, infirmier, formation, procédure standardisée, compétence,
tutorat

3
REMERCIEMENTS
A tous les membres du groupe dialyse pour leur investissement dans la réalisation de ce programme
de formation, et plus particulièrement à Irma Bourgeon pour son rôle prépondérant dans le succès
de cette entreprise multi facette et à Adrien Constan pour son aide précieuse à son évaluation.

4
INTRODUCTION
L’épuration extrarénale (EER) est une procédure de haute technicité qui repose sur du matériel
complexe et qui nécessite des réglages précis. Elle est sans doute la technique de réanimation dans
laquelle les infirmier(e)s (IDE) sont les plus impliqué(e)s [1-3]. Cette procédure met en première ligne
l’IDE car il est responsable de l’application de la prescription médicale, du montage du circuit
extracorporel, de la bonne programmation des paramètres, de la surveillance de la séance et de la
gestion des principaux incidents techniques. En réanimation, l’EER s’adresse aux patients les plus
graves, avec de multiples défaillances d’organe. L’instabilité hémodynamique est le premier risque
du processus de dialyse, mais de nombreuses complications peuvent survenir. Gérer une séance
d’EER fait partie des compétences qu’une IDE de réanimation doit acquérir [4]. Contrairement à
d’autre pays, en France, aucune formation complémentaire n’est requise pour exercer le métier
d’IDE en réanimation [5]. Seule une période d’adaptation à l’emploie est éventuellement respectée
au sein de chaque établissement de santé. De plus, le fonctionnement « fermé » des services de
réanimation français fait que les techniques d’EER sont réalisées par les IDE de réanimation sans
intervention des personnels des services de néphrologie comme cela est le cas dans la majorité des
pays.
La formation des équipes paramédicales de réanimation est rendue complexe par plusieurs obstacles
spécifiques à cette discipline : une prédominance de jeunes diplômés, un turnover très rapide avec
une moyenne nationale aux alentours de 2 ans, une formation sur le terrain réalisée dans l’urgence
et en condition de stress, des équipes soignantes nombreuses et de multiples compétences à
acquérir [4, 5]. L’entrée de la formation des IDE dans le système universitaire LMD renforcera
significativement l’acquisition de savoirs scientifiques avec un risque que cela soit aux dépends de la
formation pratique.
L’élaboration de procédures de soins est un moyen reconnu d’amélioration des pratiques et de la
sécurisation dans les services de réanimation [6, 7]. Celles appliquées par les IDE pour le sevrage de
la ventilation ou la gestion de la sédation ont montrés leur intérêt pour réduire la durée de la
ventilation artificielle [8]. En ce qui concerne la pratique de l’hémodialyse nous avons préalablement
montré que les réglages appliqués au cours des séances avaient un impact significatif sur leur
tolérance [9]. Ceci renforce l’intérêt d’une standardisation des pratiques pour la réalisation de cette
technique en réanimation. Cependant, l’évaluation de l’impact des procédures de soins dans le cadre
d’un travail de recherche clinique est parfois biaisée par une logistique matérielle et humaine mise
en place spécifiquement pour cette recherche et ne correspondant pas à la vie quotidienne d’un
service de réanimation [10]. L’impact à long terme de ces procédures n’est également pas connu et

5
pourrait être moindre du fait de la perte de l’effet « nouveauté » d’une nouvelle procédure et du
nombre croissant des procédures développées dans les services de réanimation. Enfin, l’élaboration
de ces procédures n’est pas systématiquement associée à un programme de formation théorique et
à une évaluation de leur impact facilitant leur application.
Dans ce travail nous voulu évaluer l’impact à long terme d’une démarche de formation et
d’organisation incluant une procédure de soin standardisée pour la réalisation des séances
d’hémodialyse dans notre service de réanimation.
METHODES
Le service de réanimation médicale du groupe hospitalier Henri Mondor comporte 13 lits de
réanimation déployés sur trois zones distinctes et une unité de surveillance continue de 11 lits. Notre
effectif est de 50 IDE. Uniquement 20% des IDE ont une expérience de l’hémodialyse avant d’arriver
dans notre service. Il existe un IDE référent en charge de l’encadrement des étudiants et des
nouveaux arrivants paramédicaux. Il participe aux processus d’élaboration et à la mise en application
des procédures de soins. En moyenne, 110 patients sont dialysés par an pour un nombre moyen de
séances d’hémodialyse intermittente (HDI) de 550. La réalisation de deux techniques d’EER,
hémodialyse intermittente et hémofiltration continue est apparue comme un handicap à
l’autonomisation des IDE. La présence de deux techniques diminue, en effet, la fréquence de leur
utilisation et nécessite une formation accrue. Les données actuelles de la littérature montrant une
équivalence des différentes techniques sur le pronostic des patients [11], le choix s’est porté sur une
seule technique, l’hémodialyse intermittente.
Constitution d’un groupe dialyse
Nous avons constitué en 2005 un groupe de travail sur la dialyse. Le groupe se compose de huit IDE
répartis sur chaque roulement d’équipe de jour et de nuit (soit 16% de notre effectif infirmier total),
de l’IDE référent, d’un cadre infirmier et d’un réanimateur. A terme, chaque membre du groupe
dialyse est considéré comme un « expert » et un tuteur. Ce choix nous permet d’assurer la présence
quasi quotidienne d’un « expert » dialyse dans le service. Les « experts », médecin et IDE, sont les
relais du groupe au sein du service. Ils diffusent les travaux du groupe, forment les nouveaux IDE,
contrôlent la bonne application des procédures de soins, apportent une assistance technique en cas
de problèmes lors des séances et participent à l’évaluation des procédures.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%