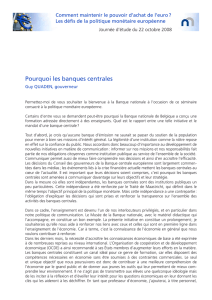Durée : 1h 00 Note : Justifier pour chaque réponse votre démarche

ECONOMIE MONETAIRE
Olivier Cardi
2ième année de DEUG de Sciences
Economiques
Cours du Pr. C. Ottavj
CONTROLE CONTINU 1
07/11/05
Université Panthéon-Assas
TD 3
Durée : 1h 00
Note : Justifier pour chaque réponse votre démarche de manière précise et succincte.
1. On considère une économie constituée d’une seule banque B.
a. Un client X apporte 500 d’or à la banque B et en contrepartie la banque lui
remet un certificat appelé « billet de banque ». Faites le bilan de la banque B.
Quand dit-on que la monnaie a une valeur intrinsèque ? La banque B observe
qu’une réserve d’or égale à 1/5 des billets émis est suffisante pour assurer leur
conversion. Quel est le montant de crédit que la banque B peut accorder à son
client Y. Faites le bilan de la banque B et dites ce que signifie monnaie
fiduciaire.
b. La banque centrale acquiert 100 de bons du trésor et en contrepartie émet 100
de billets. Faites le bilan de la banque centrale et définissez la monnaie légale.
2. Nous considérons une économie où les agents détiennent une fraction b=1/6 de
leurs encaisses monétaires sous forme de billets. Les autorités monétaires imposent
aux établissements de crédit de détenir une proportion égale à 1/15 de leurs dépôts
sous forme de réserves obligatoires.
a. La banque centrale décide une émission de monnaie centrale d’un montant
égal à H=100. Quelle approche vous permet de calculer la monnaie créée par
les banques ? A l’aide de cette approche, vous donnerez les raisons pour
lesquelles la masse monétaire peut différer entre les pays pour une quantité
donnée de monnaie centrale ? Déterminez le montant de la monnaie, M, qui
sera émise par les banques. Expliquez votre démarche.
b. Donnez la signification de la vitesse de circulation de la monnaie, V. Le PIB
réel, Y, est égal à 600, le niveau général des prix, P, s’établit à 3. En utilisant
le résultat de la question a., déterminez la vitesse de circulation de la monnaie.
c. La fonction de la demande de monnaie est donnée par l’équation suivante :
Md = 550 – 1000i.
Déterminez le taux d’intérêt d’équilibre et faites un graphique.
3. On considère une économie composée d'une Banque Centrale (BC) et de banques
commerciales (bc). Le bilan consolidé des IFM fait apparaître des créances sur
l'étranger pour un montant de 1000 (E), des créances sur l'Etat pour 2000 (T), des
créances sur l'économie 3000 (F) et la masse monétaire, M, s'élève à 6000. La Banque
Centrale détient des créances sur l'étranger pour un montant de 500 (E1), des créances
sur l'Etat pour 300 (T1), des créances sur l'économie pour 1000 (F1).

La Banque Centrale a émis des billets (B) pour un montant égal à 1500 et les banques
commerciales doivent constituer des réserves obligatoires (R) sur un compte à la
Banque Centrale. Les banques commerciales détiennent des créances sur l'Etat (T2),
et des créances sur l'économie (F2). Enfin, les banques ont capté des dépôts (D).
a. A partir des données ci-dessus, reconstituez les bilans de la Banque centrale,
des banques commerciales, et le bilan consolidé des IFM. Déterminez le taux
de réserves obligatoires, r, et le taux de détention de billets, b.
b. On suppose maintenant qu’un exportateur obtient des devises dont la contre-
valeur s’élève à 1800 qu’il cède aux banques commerciales (=E3). En
admettant que le rapport billet/masse monétaire, noté b, et le taux de réserves
obligatoires, noté r, sont constants, vous déterminerez le montant du
refinancement que devra assurer la Banque Centrale (ou le montant des fuites).
En distinguant trois étapes (création monétaire, demande de monnaie centrale,
et fuites) pour chacun des deux cas, vous établirez les bilans des banques
commerciales et de la Banque Centrale :
• Cas 1 : en supposant que les banques se refinancent en réescomptant
une partie des titres de créances détenues sur l’étranger pour un montant à
déterminer noté E4 ;
• Cas 2 : en supposant que les banques se refinancent en émettant des
titres de créance au profit de la Banque Centrale (c’est-à-dire en empruntant
auprès de la Banque Centrale) pour un montant noté RF.
De quels montants se sont accru la masse monétaire et la monnaie centrale à la fin des
opérations de refinancement ?

ECONOMIE MONETAIRE
Olivier Cardi
2ième année de DEUG de Sciences
Economiques
Cours de Monsieur Ottavj
CONTROLE CONTINU 1
CORRECTION
Université Panthéon-Assas
TD 3
1. On suppose qu’un agent X apporte 500 de billets à la banque B. En contrepartie, la banque
B lui remet 500 de billets qui sont en fait un certificat qui constate la remise de métaux
précieux.
Le processus de création monétaire repose sur la constatation des banques qu’elles peuvent
disposer d’un montant de métaux précieux (nécessaires à la conversion) inférieur à l’émission
de billets. Si la banque suppose que le comportement des ANF en matière de demande de
conversion est stable, elle va créer un montant de billets de telle manière qu'elle puisse faire
face en moyenne aux retraits. Puisque qu’une réserve d’or égale à 1/5 de la valeur des billets
émis est suffisante pour assurer leur conversion, la banque B peut donc accorder un crédit à
son client Y de 2000.
Banque B Banque B
A P
A P
Or : 500 Billets 500 Or : 500
Crédit à Y : 2000
Billets 2500
La monnaie est acceptée, soit parce qu'elle a une valeur intrinsèque (l'or par exemple) soit
parce qu'elle constitue une reconnaissance de dette émise par une institution qui bénéficie de
la garantie de l'Etat. La monnaie a une valeur intrinsèque lorsque son support a lui-même de
la valeur comme l’or ou les pierres précieuses. En revanche, le billet n’a pas de valeur
intrinsèque mais seulement une valeur d’échange. Pour que la monnaie soit acceptée par tous
en contrepartie du paiement d’une transaction, il faut que ce bien ait une valeur garantie par
son émetteur. L'existence de la monnaie dématérialisée repose sur la confiance des agents
dans l’émetteur d’où la nature fiduciaire de la monnaie. Le billet circule parce que l'on a
confiance dans la qualité de son émetteur qui y appose sa marque, sa capacité à honorer ses
dettes. La monnaie fiduciaire fait donc référence à la monnaie qui n’a plus de valeur
intrinsèque mais seulement une valeur garantie par son émetteur. Les agents ont confiance
dans son pouvoir libératoire et utilisent donc le billet comme instrument de paiement dans les
échanges.
b. Une monnaie légale signifie que le pouvoir politique impose que cette monnaie ne puisse
être refusée en paiement d'une transaction. Les billets et pièces sont les seules monnaies
officielles légales. Les autres monnaies, appelées monnaies scripturales sont en fait des
monnaies de banques.
Banque Centrale
A P
BTN : 100 Billets : 100
2.
a. Lorsque la monnaie centrale est considérée comme exogène par les banques commerciales,
on peut montrer sous des hypothèses de constance du taux de réserves obligatoires et du taux

de détention de billets que la masse monétaire, notée M, est un multiple, noté m, de la
monnaie centrale préalablement émise, notée H.
En considérant que les pays disposent de la même quantité de monnaie centrale, la quantité de
monnaie en circulation pourra différer si le comportement des agents en matière de détention
de billets est différent et/ou si les autorités monétaires imposent un taux de réserves
obligatoires différent. Prenons deux pays avec la même quantité de monnaie centrale H=H*.
Si r=r* et b<b*, le pays où les agents détiennent une fraction moins importante de la masse
monétaire sous forme de billets aura une masse monétaire plus importante car les fuites sont
plus faibles et le multiplicateur plus fort.
La masse monétaire regroupe les billets et les dépôts bancaires ; la monnaie centrale
est égale à la somme des billets et des réserves des banques :
M = B+D; H = B+R. Comme B = b.M et R = r.D, on a :
D = M-B = (1-b)M.
En substituant l’expression des dépôts bancaires dans l’expression de la monnaie centrale, on
obtient :
H = b.M + r(1-b)M = [b+r(1-b)].M.
Cette équation fait apparaître une relation entre la monnaie centrale émise et la masse
monétaire :
M = k.H avec )1.(
1
brb
m−+
=
Comme r < 1 on a r.(1-b) < (1-b), b + r.(1-b) < 1 donc )1.(
1
brb
m−+
= > 1. Puisque
la constante m est supérieure à l’unité, elle est un multiplicateur. D’après cette expression, la
quantité de monnaie (M) existant dans l’économie est une proportion constante de la monnaie
centrale (H). Dans la théorie du multiplicateur, la banque centrale est à l’origine de la création
monétaire puisqu’elle contrôle l’émission de monnaie centrale dont la masse monétaire est un
multiple. Comme la monnaie centrale émise est à la base de la création monétaire, on
l’appelle base monétaire.
En substituant b=1/6 et r=1/15 dans l’expression du multiplicateur monétaire, on obtient
m=9/2. Par conséquent, si la banque centrale élève la monnaie centrale d’un montant de 100,
la masse monétaire va s’élever d’un montant égal à M=9/2*100=450.
b. La vitesse de circulation de la monnaie est définie comme le nombre moyen de fois qu’une
unité monétaire est la contrepartie de transactions ayant généré un revenu. Pour évaluer la
vitesse-revenu de la monnaie, on utilise l'équation des échanges, soit MV = PY avec P, niveau
des prix, Y, le revenu réel, PY (PIB), la valeur des biens échangés dans la période. L’équation
des échanges est une identité comptable selon laquelle la valeur des transactions est égale à la
quantité de monnaie utilisée pour régler les transactions. On aura alors V=PY/M=PIB/M avec
V, l'expression de la vitesse-revenu. Par conséquent, V = 3*600/450=4. Une unité monétaire
sert 4 fois en moyenne à régler les transactions.
c. Le taux d'intérêt d'équilibre est celui qui égalise la demande et l'offre de monnaie, c’est-à-
dire Md=Ms. L’égalité entre l’offre et la demande de monnaie implique : 450 = 550-1000i ou
encore i0=100/1000=0,1. Le taux d’intérêt d’équilibre est donc égal à 10%.
3.
a. Détermination du montant des dépôts : D=M-B=6000-1500=4500

Détermination de E2 = E-E1=500
Détermination de T2 = T-T1=1700
Détermination de F2= F-F1=2000
Détermination de R = D-E2-T2-F2=300
Bilan consolidé des IFM
A P
Créances sur l’extérieur : Devises E1+E2: 1000
Créances/TP T1+T2 : 2000
Créances sur l ‘économie : Crédits F1+F2: 3000
Billets B: 1500
Monnaie scripturale : Dépôts : 4500
Total Contreparties MM : Masse monétaire M : 6000
Banques commerciales Banque Centrale
A P
A P
E2 : 500
T2 : 1700
F2 : 2000
R : 300
D : 4500 E1: 500
T1: 300
F1: 1000
B: 1500
R: 300
4500 4500 1800 1800
Le taux de réserves obligatoires est obtenu en rapport les réserves obligatoires aux dépôts :
r=R/D=300/4500=1/15. La fraction des encaisses monétaires détenue sous forme de billets
est déterminée en rapport les billets à la masse monétaire :
b. Détermination du montant des fuites = montant du refinancement. Les banques sont
confrontées à une demande de billets pour un montant égal à ∆B = b*∆M =
(1/4)*1800 = 450. Elles conservent 1350, c’est-à-dire ∆D = (1-b) ∆M =
(3/4)*1800=1350, sous forme de dépôts. Sur ces dépôts, les banques constituent des
réserves s'élevant à : ∆R = r∆D = r(1-b) ∆M = (1/15)*(3/4)*1800 = 90. Les banques
doivent donc se refinancer auprès de la BC pour un montant égal à : RF = ∆B+∆R =
450+90 = 540.
Cas 1 : On suppose que les banques obtiennent la monnaie centrale en réescomptant les titres
de créance détenus sur l’étranger (E4). Le montant des créances détenues par le secteur
bancaire sur l’étranger s’élève maintenant à E2+E3-E4= 500+1800–540 = 1760. La BC
acquiert un montant égal à E4=540 de créances sur l'étranger.
Banques commerciales Banque Centrale
A P
A P
E2 +E3-E4: 500+1800-540
T2 : 1700
F2 : 2000
R : 300 +90
D: 4500 +1350 E1+E4: 500 +540
T1: 300
F1: 1000
B: 1500 + 450
R: 300 +90
5850 5850 2340 2340
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%