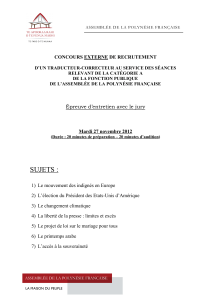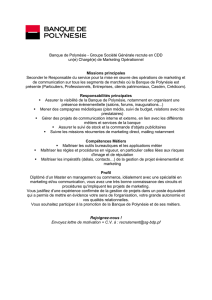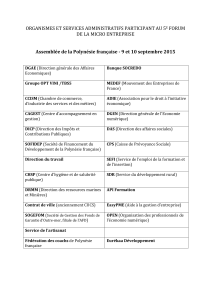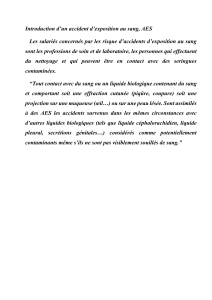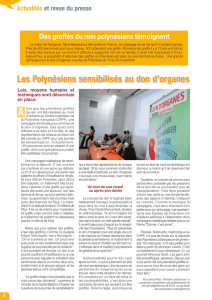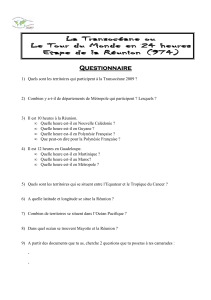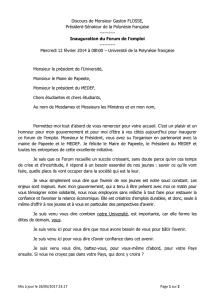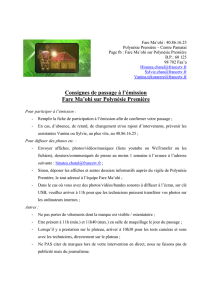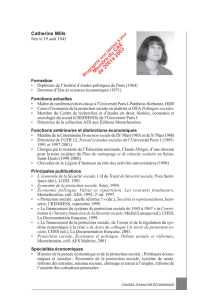Mise en page 1

#4 • T R I M E S T R I E L - J A N V I E R 2 0 0 9
dossier
L'asthme
chez l'enfant
zoom service
Démarche Qualité
congrès
F.H.R.P.S.
dossier
Accidents
d'Exposition
au Sang
Se protéger,
se soigner,
partager son expérience
Se protéger,
se soigner,
partager son expérience
Accidents
d'Exposition
au Sang
ou
aux liquides biologiques
ou
aux liquides biologiques

#4
#4
03
# 3
eaMAG
Comité de rédaction :
AM. Jeannette, I. Haiti, M.Corbaz, A.Soulignac,
C. Bournaillie
Conception graphique : Wake Up !
Photos : CHPf, Wake Up !
Tirage : 1 000 exemplaires sur papier recyclé.
est le journal interne gratuit du CHPf.
04
16
18
21
22
08
14
07
10
23
06
eaMAG
sommaire
Hommage à
Pau HAAMA
Le service technique
souhaite rendre un
dernier hommage à leur
collègue et ami de travail
Pau HAAMA, décédé le 15 Février 2008, suite
à une longue maladie.
Ayant fait ces débuts au CHT, au sein du
service intérieur depuis le 7 juillet 1993 au
21 mars 1993, et par la suite , continué sa
carrière au service technique, dans le domaine
de la plomberie, du 22 mars 1993 au 31
janvier 2008.
Pau était quelqu’un de très motivé, sociable et
optimiste. Il était toujours présent et volontaire
pour aider ces camarades malgré tout.
Il nous a quitté en laissant derrière lui des
souvenirs gravés dans la mémoire de beaucoup
de personnes, famille, amis et collègues de
travail.
C’était une personne formidable.
Que Dieu te bénisse Pau, et te garde dans sa
grande miséricorde.
Adieu.
ILS NOUS ONT AUSSI QUITTÉ TROP TÔT…
Mme Gloria CRIDLAND épouse TIHONI,
infirmière décédée le 11/04/2008
M. Patrice MOU, pâtissier,
décédé le 04/08/2008
Mlle Maiana FAATIARAU,
assistante de la cellule achat,
décédée le 14/12/2008
LIHAULT Irène - URGENCES, EVASAN, URGENCES - 11/01/2008
LETANG Maryvonne, Bella - CARDIOLOGIE, CONSULT CARDIOLOGIE - 31/01/2008
ATENI Hélène
MEDECINE, MEDECINE A - 31/01/2008
RUAHE Solange
HEMODIALYSE, NEPHROL., HEMODIALYSE - 31/01/2008
GROS Jean-Claude
DIRECTION GENERALE, SERVICE BIOMEDICAL - 31/01/2008
PERO Myriam
OBSTETRIQUE, BLOC OBSTETRIQUE - 13/04/2008
TEUMERE Sonia
MEDECINE, ENDOSCOPIE - 31/05/2008
GUITTON Jacques
RADIOLOGIE, SCANNER, ADIOLOGIE/SCANNER - 30/07/2008
HOATAU Thaddée
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DROIT DES PATIENTS - 30/11/2008
RAOULX Claude
ANESTHESIE, REANIMATION, CONSULTATION ANESTHESIE - 31/12/2008
VIRIAMU Martha
URGENCES, SERVICE DES URGENCES - 31/12/2008
ROOPINIA André - PSYCHIATRIE, CUISINIER PSYCHIATRIE - 31/12/2008
ROHI Laurent
URGENCES, SERVICE DES URGENCES - 31/12/2008
BON VENT ET HEUREUSE RETRAITE A :
Ea MAG est votre journal. Si vous
désirez parler de votre métier, de
votre service, de ce que vous faites,
si vous voulez participer à l’écriture
du journal, vous êtes les bienvenus. Contactez-
nous au 46 61 63 ou par mail : [email protected]
métier
> Jack ERHEL
Directeur des Affaires Financières
et Gestion de la Clientèle
zoom service
> Le service achat
métier
> Fabien COURTAT
Chef du Service Technique
dossier
> AES
congrès
> FHRPS
zoom service
> Démarche Qualité
événement
> CUMP
dossier
> L'asthme de l'enfant
formation
> Aides soignants
espace expression
> Service pédiatrie
nouvel hôpital
>La nef
2008 laissera dans les esprits le souvenir d’une année noire sur le plan international,
en raison de la crise financière qui a touché tous les pays, sans épargner la Polynésie.
Dans ce contexte l’hôpital, même s’il est de plus en plus soumis aux contraintes économiques,
a assuré sa mission de service public dans les conditions optimales pour la population,
grâce à l’engagement quotidien de tous les personnels qui savent mobiliser leur énergie
pour offrir à chacun la meilleure qualité médicale et de soins.
2009 sera à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du CHPf, en raison de la mise
en adéquation des moyens matériels avec la qualité des ressources humaines dont nous
disposons.
L’hôpital neuf va enfin nous permettre de venir en aide à un nombre de patients bien plus
important, quelle que soit leur souffrance.
Le souhait de chaque malade est de bénéficier de la meilleure technologie médicale au
plus près de son entourage familial. Les nouveaux équipements à la pointe de la technicité
et le prochain hôtel des familles nous permettront de répondre à cette double attente.
Pour nous hospitaliers, ça sera également la satisfaction de voir tout polynésien bénéficier
de la même qualité de prise en charge que tout usager de service public où qu’il se trouve
sur le territoire national.
Louis ROLLAND, Directeur Général
édito
édito
Ua ‘ite tātou i te mau ‘ārepurepura’a i ‘atutu na te ao i te matahiti i ma’iri iho nei, ua ‘itehia
te faufa’a i te topatarira’a na te mau fenua ato’a, aita tō tātou iho fenua i ‘ere noa a’e.
Noa atu teie mau ‘ārepurepura’a, e te tū’atira’a e vai nei i roto i te fare ma’i e te parau no
te tapiho’ora’a aopapa, ua mau pāpū noa te ‘āvei’a tāvinira’a a te fare ma’i i te nūna’a o te
fenua nei, aita te reira i ha’amarirau i te itoito e te tūtavara’a a te feiā ūtutuūtu ma’i i te mau
mahana ato’a, ua pūpu mai te tā’ato’ara’a o te feiā rave ‘ohipa i te maita’i hope no te tāvini
i te feiā ma’i.
E riro te matahiti 2009 i te tāpa’ohia i te tahi piri ta’a’ē ia au i te papara’a ‘ā’ai o te fare ma’i
o te fenua nei, ‘inaha te tūera marū noa ra te mauiha’a e tu’uhia mai ra e te pu’e ta’ata
‘aravihi e vai nei i te fare ma’i nei.
Te piri mai nei te ‘āvarira’a o te fare ma’i ‘āpī o te Fenua, e riro teie fare ‘ei rāve’a no te
ūtuūtu-maita’i-ra’a i te tahi fāito ta’ata ma’i huru rahi e aha nao atu ā tō rātou mamae.
Te hina’aro nei te feiā ma’i i te rapa’aura’a ma’i hau i te maitata’i o teie tau, e i te fāna’ora’a
i te fa’aitoitora’a o tō rātou mau feti’i. E rave rahi mau mauiha’a ‘āpī mau e fa’a’ohipahia i
roto i teie fare ma’i, e ua feruri-ato’a-hia te tahi fa’anahora’a no te nohora’a o te mau feti’i,
‘inaha ua fa’ati’ahia te tahi hotēra fa’ari’ira’a no te mau ‘utuafare feti’i.
No mātou iho nei te feiā ūtuūtu ma’i no te fenua nei, ua riro
ia teie mau fa’anahora’a ‘āpī ‘ei tāpa’o fa’a’ite i te mea ē
te fāna’o nei tō te fenua nei i te hō’ē ā huru ūtuūtura’a ma’i
mai tei fa’anahohia ra i ni’a i te aupapa fenua tā’ato’a o te
hau farani.
Te ra’atira’a fa’atere rahi
Louis ROLLAND tāne

04
# 4
eaMAG
05
# 4
eaMAG
t i r e z l a l a n g u e …
e t f a i t e s a a a a h h h !
apprécier le monde de l'hôpital. C'est donc en 1990
que j'ai décidé de franchir le pas en prenant le poste
de secrétaire général aux Hospices Civils de Lyon, où
j'ai été étroitement associé à la préparation du plan
stratégique pour la réorganisation des hôpitaux lyonnais.
Puis j'ai ensuite poursuivi une carrière bretonne en
prenant la direction des centres hospitaliers de
Lannion et, plus tard, de Dinan dans les Côtes
d'Armor. J'ai également eu l'occasion de bien connaître
le monde hospitalo-universitaire en tant que directeur
général adjoint du CHU de Rennes.
Au cours de ma carrière hospitalière, comme beaucoup
de mes collègues, j'ai souvent été confronté à des
problèmes difficiles de restructuration d'établissement :
absorption d'une maternité privée à Lannion,
réorganisation complète du pôle urgences au CHU de
Rennes, création d'un pôle hospitalier public/privé à
Dinan, à la suite d'un rapprochement avec une clinique
chirurgicale. J'ai également pu faire le constat au cours
de ces dernières années, de l'extraordinaire dégradation
budgétaire et financière qui a touché au fil du temps
la quasi totalité des hôpitaux de la métropole et de la
tension difficilement supportable qui s'est abattue sur
les acteurs toutes catégories confondues, qu'ils soient
médecins, soignants ou directeurs.
Mon arrivée à la direction financière et de la clientèle
du CHPF à la mi septembre 2008 s'est faite sans
transition puisqu'il a fallu en quelques jours avec mon
équipe préparer et présenter les grandes orientations
budgétaires pour 2009 au conseil d'administration
d'octobre 2008.
Bien entendu j'aborde ces nouvelles responsabilités avec
le souci d'apporter ce que l'on est en droit d'attendre
d'un directeur financier : rigueur, souci de maîtrise
des dépenses, mise en place d'outils et d’indicateurs
de contrôle et d'alerte, etc. Mais ma conviction est
qu'on ne peut pas être directeur financier d'un hôpital
si l'on est pas avant tout hospitalier, au fait des réalités
et de la culture hospitalière. Mon premier souci en
arrivant dans cet établissement a été d’accompagner
le directeur général à la rencontre des acteurs dans
les services pour m'imprégner des difficultés sur le
terrain au plus près des malades. C’est de mon point de
vue la seule manière d’appréhender et de comprendre
les vrais enjeux. L’accueil remarquable qui nous a été
réservé à Louis Rolland et moi-même nous a confortés
dans cette conviction. Cette démarche a d’ailleurs été
essentielle dans la mission qui m’a été confiée de
reprendre le dossier des effectifs du nouvel hôpital,
étape indispensable dans la prévision des budgets
2009 et suivants.
Je terminerai cet article en évoquant en quelques
ligne la Direction financière, ses missions et ses projets.
La première des missions d’une direction financière
est d’assurer toute la chaînes des opérations relatives
au budget de l’hôpital, du stade de sa préparation au
suivi de son exécution : élaboration du budget primitif
et gestion de toutes les décisions modificatives qui
peuvent venir ajuster ce budget. Ce volet budgétaire
est le plus lourd et celui auquel il faut consacrer
beaucoup de temps.
Un autre aspect restera à développer : se doter d’un
véritable dispositif de pilotage et de contrôle de gestion
avec au préalable la mise en place d’une comptabilité
analytique qui doit nous permettre d’identifier le coût
des activités et des services dans l’établissement.
Faire que chaque service clinique ou administratif
puisse être doté d’un tableau de bord simple grâce
auquel il pourra suivre son activité et l’évolution de
ses dépenses directes.
Il est également indispensable de travailler en étroite
collaboration avec le service d’information médicale
qui par la valorisation sur la base de la tarification à
l’activité ( la T2A) pourra nous permettre, pour chaque
service ou département clinique ou médico-technique,
d’identifier des recettes (un chiffres d’affaires,
pardonnez ce vocabulaire peu courant dans nos hôpitaux
publics) en face des coûts et ainsi de calculer
la contribution de chacun à l’équilibre financier de
l’établissement.
Je ne voudrais pas terminer sans rendre hommage
au personnel du service clientèle des encaissements
et de facturations sans lesquels l’établissement ne
pourrait être économiquement viable.
Je souhaite profiter de cette occasion pour dire
combien j’ai apprécié la très grande sympathie avec
laquelle j’ai été accueilli.
Soyez en tous remerciés.
Je suis né en Bretagne voilà de nombreuses années
(il y prescription!), originaire de l'Ile de Batz, une
petite île très active de la côte nord du Finistère.
L'insularité est donc une chose familière que je
retrouve ici avec plaisir et que je partage avec les
habitants de ce pays.
L’hôpital est mon second métier. Après une thèse de
doctorat en économie, j’ai longtemps exercé comme
enseignant maître de conférences dans les universités
de Brest puis de Rennes où j'ai dû faire souffrir
quelques générations d'étudiants en sciences
économiques, plus particulièrement en économie
monétaire,analyse et gestion financière des entreprises.
C'est à l'occasion de mes participations nombreuses
au jury d'entrée à l'Ecole Nationale de la Santé
Publique (ENSP) que j'ai été amené à connaître puis
Merci au journal interne Ea MAG
de m'offrir cette occasion
de me présenter après quelques
semaines dans mes nouvelles
fonctions de directeur
des finances et de
la clientèle du CHPF.
Directeur des Affaires Financières
et Gestion de la Clientèle
Jack ERHEL
métier
métier

06
# 4
eaMAG
07
# 4
eaMAG
c ’ e s t b o n i c i …
zoom service
zoom service
…e t l à a u s s i .
Composante du Service
Economique, le service
achats est constitué de
4 cellules sous la responsabilité
de Mme Liliane KONSANE,
adjointe au Directeur
des Moyens Généraux
Responsable des Achats,
Magasin général et
du service Douane.
La cellule magasin général est constituée d’un
responsable magasinier Mr FROGIER Bernard et de
2 magasiniers Mr VEIHIATUA Thierry et YU TIM
Vetearii. Ces agents ont pour fonction de gérer les
stocks au sein du magasin et de distribuer les
produits par service suivant un planning établi
annuellement. Les produits stockés se déclinent
en 4 catégories, hygiène, ménage, fournitures de
bureau, petites fournitures médicales non stériles.
Les commandes sont passées via l’AS400, et pour les
produits non listés en dotation, la commande est faite
dans la case « commentaires ».
La cellule reprographie gérée par Mr YU TIM Bill fournit
les consommables informatiques, les imprimés,
effectue des photocopies et des reliures.
Les demandes se font par l’ASSET+ ou par mail :
La cellule achats comprend 2 acheteurs, Mr WONG Max et Mr MANJARD Teiva.
Leur rôle :
- traiter les demandes des services.
- saisir les bons de commandes suivant des proformas et devis établis préalablement.
- suivre les commandes (relances et réceptions).
Ils achètent principalement : les fournitures de bureau et consommables informatiques,
les mobiliers de bureau et médicaux, les produits d’hygiène et de ménage, les
fournitures hôtelières pour la cuisine et les consommables médicaux non stériles.
La cellule fait aussi des bons de commande pour des prestations de service tels
que les réparations sur le mobilier (rehoussage),le matériel de cuisine et de buanderie.
Les demandes d’achats se font via ASSET+.
Depuis 2007, Mr WONG Max a inventorié l’ensemble du mobilier médical et de
bureau susceptible d’être transféré sur le nouvel hôpital. Cet inventaire sera
mis à jour au fur et à mesure selon les achats et des réformes.
La cellule douane est composée de 3 agents, 2 déclarants en douane Mr TEAOTEA
Eric et Mr TEMARII Thierry et un aide déclarant Mr TAPI-MAAU Robinson.
Ces agents s’occupent du dédouanement de tous les achats importés. Le CHPF
est tenu de faire une déclaration de douane, quelque soit la valeur de l’envoi
(même inférieure à la somme de 30 000 cfp).
métier
métier
Recruté localement par le CHPf, j’ai été embauché en
mai 2008.
Depuis 6 mois, je suis donc «Chef du service
Technique».
A ce titre j’ai le plaisir d’animer une équipe de 24
personnes.
Outre les relations humaines, je suis amené à travailler
avec tous les corps de métiers qui composent notre
service (électricité, climatisation, plomberie, menuiserie,
maçonnerie…) ainsi qu’avec des entreprises
extérieures. Cette pluridisciplinarité me passionne.
L’autre volet de mon travail consiste à préparer, d’un
point de vue technique, le transfert vers le nouvel
hôpital du Taaone. Je suis, à ce titre, en relation avec
l’Etablissement public d’Aménagement et de
Développement et visite régulièrement le chantier du
Nouvel Hôpital.
Même s’il m’arrive d’entendre des avis sceptiques, je
suis optimiste sur ce transfert qui ne se fera certes
pas sans encombres mais qui correspond, selon moi,
à une évolution technique et architecturale nécessaire
et bénéfique.
Enfin,je tiens à saluer et à remercier très chaleureusement
tous les membres du service technique qui m’ont
accueilli (voir adopté) et avec qui je prends un réel
plaisir à travailler jour après jour.
Au plaisir donc de vous croiser dans les couloirs.
Fabien
Vie privée :
31 ans, Célibataire, sans enfant
Capitaine de « l’Inconnu » (mon voilier)
Sports : Surf, Krav maga, skateboard, footing
e t f a i t e s a a a a h h h !
Le Service Achat de la Direction
des Moyens Généraux Chef du Service Technique
Ia orana,
Arrivé en Polynésie en 2002 avec
mon diplôme d’ingénieur en poche,
j’ai travaillé pour plusieurs sociétés
avant de créer mon bureau d’études
dans le Bâtiment des Travaux Publics.
Cherchant à réorienter mon activité
professionnelle, l’idée de contribuer
à la vie du nouvel hôpital m’a motivé.
J’ai alors travaillé pour ETDE
(entreprise réalisant les lots
techniques du nouvel hôpital) pour
acquérir un maximum de connaissances
inhérentes aux installations techniques.
Fabien COURTAT

a l o r s , u n e d o s e …
… m a t i n , m i d i
e t s o i r .
Ne sont pas considérés comme un AES :
- un contact avec du sang sur une peau saine
- une coupure ou une piqûre par du matériel non contaminé
Nouvelle procédure de prise en charge des AES :
Le circuit de prise en charge de l’AES a été réorganisé par l’équipe opérationnelle
d’hygiène en janvier 2008. Dans les services, les informations sont disponibles
sur les affiches AES et dans le diaporama AES, consultable sur les ordinateurs.
Les dossiers de prise en charge sont à la disposition des médecins du CHPF
dans K: /Public/ AES
Risque de
contamination virale
( étude métropolitaine )
VHB : 2 à 40%
VHC : 2 à 3%
VIH : 0,3%
Ce qu’il ne faut jamais faire :
- recapuchonner
une aiguille
- laisser traîner une aiguille
ou un bistouri
- désadapter à la main
une aiguille ou une lame
de bistouri
Histoire d’AES :
"Positif. A la découverte de ce simple mot inscrit après le titre « test de
détection des anticorps anti-VIH » ma gorge se noue, la réalité se perd dans
cet obscurcissement subit de mon avenir.
J’ai fait ce test par acquis de conscience, pour me débarrasser de ce doute
auquel je ne voulais pas attacher d’importance mais qui me poursuivait
depuis plusieurs semaines, à la suite de ce geste incontrôlé sur ce
conteneur à aiguilles. Il n’y avait pas de raison que je n’arrive pas à y faire
rentrer cette seringue. J’étais débordé, je venais de retirer mes gants, juste
pour une seringue de plus…
La sensation aiguë de la piqûre m’avait surpris, je voyais à peine la blessure
sur mon doigt où perlait le sang. Un passage à l’eau savonneuse avait
suffit, le saignement n’avait pas duré. D’ailleurs, c’était déjà la fin de mon
service et je suis rentré. La brochure sur les AES que j’ai lue récemment,
indiquait bien qu’il fallait vérifier les sérologies du patient source et
consulter le médecin du travail. Mais c’était bien compliqué pour si peu de
choses."
DÉFINITION :
un AES correspond à tout contact avec du sang
ou un liquide biologique (LCR, pleural, péritonéal,
péricardique, articulaire, amniotique) et comportant
soit une effraction cutanée (piqûre ou coupure),
soit une projection sur une muqueuse (œil, bouche)
ou sur une peau lésée (plaie, eczéma).
Le risque infectieux après un AES
Il expose à la transmission de tout micro-organisme
présent dans le liquide concerné. Le virus de
l’hépatite B (VHB), de l’hépatite C (VHC) et du SIDA
(VIH) sont particulièrement à craindre du fait de leur
prévalence dans la population et de la gravité des
maladies qu’ils provoquent :
- risque d’hépatite aiguë fulminante souvent mortelle,
en cas de transmission du VHB
- risque d’hépatite chronique, de cirrhose ou de cancer
du foie après transmission du VHC
- risque de SIDA après transmission du VIH
Le risque de contamination individuelle varie en fonction
de la gravité de l’AES (profondeur de la blessure)
et de l’importance de l’inoculum viral (virémie
élevée du patient source, aiguille de gros calibre
macroscopiquement souillée).
La prévention du risque infectieux
Des moyens particuliers permettent de se protéger
du risque d’AES : port de gants, masque, lunettes,
utilisation de matériel de soin sécurisé.
En cas d’AES, il est encore possible d’éviter la
contamination. En effet, les virus peuvent
être facilement inactivés par un nettoyage et une
désinfection immédiate. L’infection par le VIH
peut être évitée par une administration rapide
(< 4 heures) de médicaments antiviraux prescrits
pour un mois.
Il est indispensable de savoir si le sang ou le liquide
biologique responsable de l’AES est contaminé par le
VIH. Les recommandations médicales nationales
indiquent que le risque d’infection est inexistant si le
sang ou le liquide biologique provient d’un patient
dont la sérologie VIH est négative.
La prescription des sérologies du patient est faite en
urgence par tout médecin de l’hôpital. Si la sérologie
VIH du patient n’est pas négative, le personnel
victime de l’AES est adressé à un médecin
des urgences habilité à décider d’un traitement
prophylactique antiviral.
dossier
dossier
08
# 4
eaMAG
09
# 4
eaMAG
Les sérologies du personnel victime de l’AES ne sont
pas systématiques. Elles peuvent être prescrites
ultérieurement par le médecin du travail en fonction
des résultats des sérologies du patient.
La vaccination
Un vaccin protège efficacement contre le risque de
transmission du VHB. La vaccination contre l’hépatite
B est obligatoire pour les personnels de santé
exposés au risque d’AES. Elle est contrôlée ou mise
en œuvre par le médecin du travail du CHPF.
Il n’existe pas de vaccin pour le VHC et le VIH.
Le traitement des hépatites B et C et du SIDA
Il n’existe pas de traitement pour l’hépatite fulminante
en dehors de la greffe du foie.
Les traitements proposés pour lutter contre l’hépatite
B et C sont longs, contraignants et pas toujours efficaces.
Les médicaments actifs sur le VIH doivent être pris à
vie, procurent des effets indésirables et ne permettent
pas d’obtenir une guérison définitive. Cependant il est
possible d’éviter une infection VIH après contamination,
grâce à la mise en œuvre d’un traitement antiviral
précoce.
Déclaration et surveillance des AES
Un AES est un accident du travail, il doit être signalé
au médecin du travail par le personnel accidenté,
dans le cadre de la surveillance et de la prévention
des AES.
La Direction des Ressources Humaines doit être
informée pour permettre la reconnaissance de
l’accident du travail et l’éventuelle couverture des
frais médicaux ultérieurs.
Au sein de l’hôpital, le recueil des informations liées
aux circonstances des AES est essentiel pour organiser
la prévention.
Accidents d'Exposition au Sang (AES)
ou aux liquides biologiques
Dr Marc LEVY, Mme Irène DUHOURCQ,
Equipe Opérationnelle d’Hygiène
Médecine du Travail
CGPME, carrefour Camp d’ARUE
Tél : 50 21 21 ou 50 21 26 - Fax : 43 14 41
Mettre des gants pour tous gestes à risques
Mettre un masque et des lunettes pour tous
risques de projection
Bien utiliser
les conteneurs
à déchets sans forcer
ni dépasser la limite
de remplissage
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%